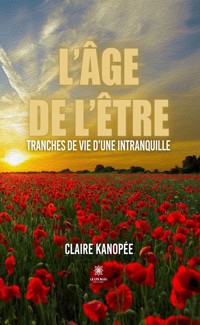
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Toucher le point de rupture, celui où l’on sait que l’on ne peut plus faire machine arrière. Celui que l’on atteint après avoir usé tous les subterfuges pour l’éviter. Aucune trajectoire n’est linéaire, celle de Marianne n’échappe pas à la règle, à cette spécificité qu’est l’existence humaine, riche d’expériences et ponctuée d’épreuves. Dans cette biographie restaurative,
Claire Kanopée nous invite à découvrir la quête de sens de Marianne, une femme qui, au milieu de sa vie, n’aura de cesse de relier les différents points des moments saillants de son histoire pour mieux la comprendre, l’accepter. Une écriture singulière, un genre inspiré par le mouvement de libération de la parole des femmes. Une approche qui offre une certaine hauteur de vue, qui déjoue le clivage bourreau-victime en portant un regard analytique et existentiel sur un sujet hautement sensible.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Professionnelle du soin et de l’accompagnement depuis près de 30 ans,
Claire Kanopée se tourne vers l’écriture en 2020 pour surmonter une période difficile. Cette expérience libératrice lui permet de se retrouver, d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. À présent, en tant que biographe hospitalière, elle met sa plume au service des personnes gravement malades.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Claire Kanopée
L’âge de l’être
Tranches de vie d’une intranquille
© Lys Bleu Éditions – Claire Kanopée
ISBN : 979-10-422-3598-7
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À mes enfants,
À mon Robin qui se reconnaîtra.
À F., à tous celles et ceux qui n’ont pas eu accès aux mots, qui n’ont pas pu dire…
Votre corps porte en mémoire toute votre histoire.
Chaque symptôme est un message qui raconte une partie de votre vie trop lourde à porter.
La maladie n’est pas une fatalité.
Faites la paix avec votre passé pour retrouver l’harmonie dans votre corps et votre vie.
Estelles Daves
Thérapeute en libération psycho-Émotionnelle
Préambule
Ce livre-témoignage s’apparente à une autobiographie restaurative. En toile de fond de ce travail apparaissent l’analyse existentielle et la logothérapie fondée par Viktor Frankl. Il s’agit d’une approche psychanalytique centrée sur le postulat que tout être humain a besoin de donner un sens à sa vie. La perte de sens pouvant occasionner de la frustration, de la détresse voire un vide existentiel. Cette approche psychothérapeutique nous invite à reprendre la responsabilité de notre vie. Elle est résolument tournée vers l’avenir. Elle s’appuie sur les valeurs qui font sens pour nous. Le but étant de se remettre en accord avec celles-ci, pour passer à l’action et les concrétiser « dans la matière ». D’un abord résolument spirituel, Frankl conçoit que nous nous adressons à la partie du psychisme qui ne tombe jamais malade : la noétique, que l’on peut aussi appeler notre conscience supérieure, notre âme.
Au début des années 30, Viktor Frankl, psychiatre et psychothérapeute juif autrichien, a développé la logothérapie face au désœuvrement des jeunes à la suite de la crise de 1929. En effet, il a constaté que le taux de suicide chez les jeunes était terriblement élevé et a décidé de créer des centres d’écoute et d’accompagnement pour ces jeunes en détresse existentielle. Ce fut un véritable succès, en quelques années les suicides régressent massivement.
Frankl fut ensuite déporté. Son manuscrit contenant sa théorie sur l’analyse existentielle et la logothérapie lui fut confisqué. Cette expérience des camps le marqua à jamais et lui permit de vérifier une nouvelle fois sa théorie : même dans des circonstances les plus inhumaines il soutenait que la vie peut avoir un sens : « Il est possible de trouver un sens à l’existence, même dans une situation désespérée, où il est impossible de changer son destin. L’important est alors de faire appel au potentiel le plus élevé de l’être humain, celui de transformer une tragédie personnelle en victoire, une souffrance en une réalisation. ».
Trouver un sens à sa souffrance permet, lorsque nous ne pouvons pas changer une situation, de nous changer nous-mêmes. Son livre « Man’s Search for Meaning », écrit à son retour des camps, témoigne de son expérience et présente ses théories détaillées.
Cette rencontre avec Frankl et la logothérapie a représenté un tournant décisif dans mon existence. À mon humble niveau, je tenterais de vous en faire découvrir la puissance.
Prologue
C’est tout au fond de soi,
dans l’obscurité des failles profondes,
que l’on trouve parfois la force
de se battre pour la lumière.
Agnès Ledig, Pars avec lui
J’appartiens à la génération d’après, celle qui n’a pas connu la guerre. Et cela, ça change tout. Cela me place à un endroit où pour la première fois depuis plusieurs générations, il m’est donné la possibilité de regarder les choses autrement. La possibilité de les comprendre, d’utiliser différents outils, différentes approches pour apprendre à mieux me connaître et travailler sur moi afin de vivre une vie en conscience, bien plus reliée à ma singularité.
L’enjeu est de taille, me direz-vous. C’est indéniable, notre mission consiste à apprendre à devenir complet, à retrouver notre unité originelle et à s’affranchir des déterminismes familiaux et sociétaux qui parfois nous empêchent de nous révéler. Faire grandir en soi les possibles, répondre à l’appel que la vie nous adresse. Car cette vie est riche de sens, dès lors que l’on accepte de ne plus vouloir tout contrôler. Dès lors qu’on lâche prise, elle nous appelle par les signes, les synchronicités, les rencontres, par les revirements qu’elle met sur notre parcours pour nous intimer à retrouver notre axe, notre alignement. Pour enfin apporter au monde ce qu’il y a de si singulier et de si unique en chacun de nous. Pour enfin baisser les armes, arrêter la lutte accepter de prendre de la hauteur.
Monter à la canopée, entre terre et ciel, pour regarder les choses dans leur globalité, de façon plus systémique en chaussant de nouvelles lunettes. En laissant celles de l’ego de côté. Car c’est à cette hauteur-là qu’il devient possible de comprendre, de se relier à son soi profond, pour faire complètement corps avec notre environnement. Je mesure la chance qui m’est offerte de pouvoir m’accomplir pleinement en tant qu’être humain. Car, une chose est sûre, les générations d’avant n’ont peut-être jamais eu la possibilité ni les moyens de questionner leurs propres motivations pour rattraper leurs rêves.
Je m’appelle Marianne, Margaret, Jacqueline, je suis née au début des années 70.
Jusqu’à ces derniers mois, je n’avais jamais envisagé de passer par l’écriture pour raconter ma vie. Je pensais que mon histoire ne regardait que moi, encore moins ma famille, et pourtant… J’ai, au travers de ce récit, expérimenté intuitivement ce que pouvait être l’écriture restaurative. Cette expérience autobiographique, je l’ai vécue comme un long processus de soin. Ligne après ligne, je suis venue poser du baume sur mes blessures. À la façon du Kintsugi1, l’art japonais du XVe siècle qui consiste à poser sur les brisures et les fêlures d’un objet, un onguent d’or pour les mettre en relief, les magnifier plutôt que de les masquer.
Cet acte d’écriture, comme tout autre type de création, est selon Irvin Yalom2 le meilleur rempart contre nos angoisses de mort. Angoisses qui, en tant qu’être humain, nous traversent de façon plus ou moins prononcée selon notre parcours, nos expériences vécues…
Je n’aime pas m’épancher. J’ai toujours accordé plus d’importance aux autres qu’à moi-même. D’ailleurs, cet altruisme exacerbé n’est sûrement pas étranger au métier que j’ai exercé, celui d’infirmière puéricultrice. Avant de m’orienter vers le soin j’ai fortement hésité avec l’enseignement. La langue anglaise m’attirait fortement. Finalement, j’ai réussi à ne pas trancher puisqu’en seconde partie de carrière j’ai assouvi ma soif de transmission en devenant cadre de santé formatrice.
Accompagner, transmettre c’est ma seconde nature. Je dis toujours que les étudiants sont le meilleur baromètre qui soit en termes de sentiment d’utilité. Sentiment que j’ai perdu un jour en prenant d’autres responsabilités dans la coordination de leur formation.
J’ose relater mon expérience. Elle peut servir à d’autres. Mieux se comprendre, mettre à distance, démontrer que l’on peut se révéler en se relevant, voilà ce que j’ai souhaité partager.
Je me suis retrouvée… J’ai retrouvé le sens de ma vie. Je vais donc, au travers de ce témoignage, me dévoiler en toute intimité. Certaines personnes pourront, je l’espère, en miroir s’identifier, trouver des pistes pour s’inspirer, pour débuter ou poursuivre leur propre parcours de résilience.
Je menais jusqu’ici une vie bien rangée avec un mari aimant, trois enfants bien élevés qui, à leur rythme, accédaient chaque jour un peu plus à leur autonomie. Pour autant, la mélancolie et la tristesse m’accompagnaient de plus en plus souvent. À bien y regarder, plus les années passaient, plus cette souffrance larvée s’expansait. Cet état générait de l’incompréhension chez mes proches sans que je sois capable par moi-même de poser des mots dessus. J’avais bien eu quelques alertes il y a quelques années. En les traitant avec mépris, j’avais toujours réussi à tenir mes fantômes à distance… Jusqu’à cette rentrée de 2018 où je n’ai plus réussi à lutter.
Toute ressemblance avec la réalité est loin d’être fortuite. C’est pourquoi par souci de confidentialité, j’ai doté les différents protagonistes de prénoms fictifs.
1
Stop !
« On ne se méfie jamais assez des êtres qui semblent tout accepter, tout supporter en silence et parfois même en souriant. Leur soumission paraît sans limites, leur tolérance inépuisable, puis un jour, ils quittent le jeu, tournent les talons, claquent la porte et c’est définitif. On ne peut plus les retenir. Intérieurement, ils ont fait tout le chemin, bloqué les comptes, ils ne sont presque déjà plus là quand ils annoncent qu’ils vont partir ».
Anny Duperey In Allons voir plus loin, veux-tu ? Paris : Seuil, 09/2002, Points Roman n° 1136, p. 23.
Depuis le début de ce premier confinement, mes nuits sont perturbées, l’anxiété m’accompagne bien trop souvent… Lorsque l’heure du lever arrive, c’est avec bien des difficultés que je quitte le sommeil venu enfin m’apaiser sur le petit matin. Je m’active pour ne pas penser. Je suis même dans l’hyperactivité et tente de faire bonne figure auprès des enfants. Je ne manque de rien, la maison est très confortable, le réfrigérateur est plein. L’espace et l’accès au jardin nous placent parmi les privilégiés du confinement. Malgré tout cela, ce confort matériel n’a aucun effet d’apaisement sur ma détresse, sur ce sentiment de vide intérieur qui me tenaille.
Chaque jour qui passe m’amène un peu plus à puiser dans mes réserves, à vider mes batteries. J’ai conscience qu’il faut que je lève le pied : je dois impérativement réussir à décompresser. Mais comment faire ? Mon activité était déjà conséquente, mais avec ce confinement, chaque jour qui passe m’oblige à en faire encore plus. Il faut s’adapter, accompagner, motiver, rassurer. Et moi, qui me rassure ? Sûrement pas ma petite voix intérieure, je l’entends à peine s’exprimer, elle est à bout de souffle. À quoi bon s’accrocher ? Je sens que je vais rechuter. Cette fois, c’est pire qu’il y a quelques mois… Je n’ai vraiment plus la force.
En ce jour d’anniversaire d’Agathe : les quinze ans de notre petite dernière, je termine la journée exténuée, incapable d’éteindre mon ordinateur. Cette après-midi j’ai appris qu’il paraît qu’avec le télétravail, certains seraient planqués… La direction du personnel envisage de faire la chasse à ceux qui profiteraient du système. On va où là ? Je prends cette information de plein fouet, comme si cette méfiance m’était directement destinée. Je ne touche déjà pas terre, alors, quand j’entends ce genre de remarques, rapportées par ma chef que j’ai dû écouter alors que j’avais des dizaines d’appels téléphoniques à passer, je me retrouve à la fois sidérée puis carrément agacée.
Les mails n’arrêtent pas de tomber. Robin, mon mari a beau me répéter qu’il faut lâcher c’est plus fort que moi, je vais les consulter. Sans parler du projet sur lequel on m’a demandé de travailler pour pouvoir, soi-disant, accueillir les enfants du personnel soignant. Plus les jours passent et plus celui-ci ne débouche sur rien de concret. Il aura au moins un intérêt, il sera parfait pour caler mon bureau. Je suis tellement épuisée que j’en deviens sarcastique…
Dans la nuit, après une lutte féroce pour m’endormir, je pleure dans mon sommeil. La tristesse et l’angoisse viennent encore frapper à l’heure habituelle : 3 h 30 du matin. Comme chaque nuit, me voilà en proie à des angoisses : mon ventre se tord, mon cœur bat si fort qu’il pulse dans mes oreilles. Le stress m’envahit et je finis terrassée par des bouffées de chaleur qui me laissent hagarde. Au petit matin, apeurée, épuisée, je trouve enfin le repos. Celui-ci est de courte durée. On a beau être le 1er mai, aujourd’hui, c’est « faites du travail ! ».
Je passe sous la douche, les gouttelettes servent d’amorce pour que ma tristesse réapparaisse. Ce moment seule avec moi-même constitue un espace-temps idéal pour laisser les larmes monter. Je trouve quand même l’énergie pour me préparer. Lorsque je retrouve Robin pour le petit déjeuner, il ne met pas longtemps à remarquer que je suis exténuée :
La journée passe, rythmée par le bruit régulier, crispant, des mails qui arrivent dans ma boîte mail. Vite répondre pour que les collègues puissent avancer. Depuis mi-mars, pas un week-end sans travailler, ordres et contre-ordres émanent des instances. Combien de tableaux renseignés en début de journée pour qu’au final dans la soirée une nouvelle version à compléter nous soit renvoyée ? Et encore, s’il n’y avait que cela… Que dire des réunions par Skype où l’on peine à avancer ? Pourtant, à chaque fois, l’ordre du jour est envoyé en amont et les documents qui y sont associés également, mais c’est peine perdue… Je sors les rames pour tracter les collègues, chaque détail devient une affaire personnelle, on n’avance pas ! Il y a bien Solène sur qui je n’arrête pas de m’appuyer, mais je sais que je la mets en difficulté vis-à-vis de ses trois autres collègues.
Je me faisais une tout autre idée de cette nouvelle responsabilité. J’imaginais que ma hiérarchie et moi allions former un vrai tandem. Pourtant il n’en est rien, ma chef connaît ma sensibilité et ma vulnérabilité. Elle joue avec la faible estime que j’ai de moi-même, sait très bien utiliser mes propres failles. Elle demande toujours à ses subordonnés d’appliquer les choses qu’elle n’a pas la capacité d’obtenir ou de mettre en œuvre.
Je surnage. Les encouragements et les compliments qu’elle m’adresse ne sont que pure formalité : le principal c’est de faire tourner la boutique. Cette crise sanitaire liée au Covid 19 a complètement fait exploser les barrières que je tentais de dresser entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Avant tant bien que mal, j’y arrivais.
Là, ce n’est plus pareil, ma tête n’arrive pas à scinder. Elle ne comprend pas que quelques mètres d’écart sont bien trop peu pour différencier ces deux espaces : passer d’une pièce à l’autre ne permet pas à mon cerveau de switcher entre le personnel et le professionnel.
À cela viennent s’ajouter tous ces repas qu’il faut à chaque fois anticiper, préparer. La cantine à la maison c’est le pompon sur la Garonne ! Surtout quand on est cinq à table, ça revient vraiment trop souvent !
Samedi matin, je suis la première levée pour vite ouvrir et consulter les derniers mails. C’est l’enfer ! Avec la réouverture des stages des étudiants, de nombreux ajustements sont nécessaires, cela génère beaucoup d’aléas. Je prends mon petit déjeuner seule, attablée devant mon bol. Quand est-ce que tout cela va cesser ? Les larmes reviennent embuer mon regard posé dans le vide. Je n’arrive plus à relativiser, à me dire que ça va aller, que c’est seulement une mauvaise période à passer, qu’après on pourra ensuite repartir du bon pied en présentiel.
Robin arrive dans la cuisine, les yeux encore pleins de sommeil. Là, je ne peux plus rien contrôler. Heureusement les enfants dorment et ne sont pas près d’émerger.
Je ne lui laisse pas le temps de finir sa phrase. Je tombe dans ses bras et laisse toute ma peine remonter. Mes yeux s’embuent de larmes puis de profondes secousses prennent le relais. Les vannes sont ouvertes, je ne peux plus m’arrêter. Robin me serre de plus en plus fort pour me retenir, pour m’éviter de tomber.
Au fond de moi, je sais qu’il essaie de faire de son mieux. Il tente de me réconforter, pourtant, ses paroles ne font que m’accabler encore plus. Il me propose d’aller me recoucher, ce que j’accepte. Je ne peux pas lutter, je manque trop de sommeil. Il m’installe confortablement et, après un léger baiser, il ferme la porte pour me laisser récupérer.
Cette crise de larmes m’a permis de me relâcher. Ainsi, le sommeil ne met pas longtemps à me gagner. Vers dix heures, j’émerge, et je retourne aussitôt dans le séjour, car de nombreux autres mails sont tombés. Une des cadres m’a laissé un message sur le portable. Robin me fusille du regard. Je lui explique que ma collègue compte sur moi et que je ne peux pas la laisser tomber. Je la rappelle et nous travaillons d’arrache-pied jusqu’à l’heure du déjeuner. Sitôt le repas terminé, nous nous y remettons jusqu’à dix-sept heures. On se souhaite une bonne fin de journée puis je peaufine le travail initié ensemble jusqu’au dîner.
La nuit qui suit me prive toujours d’apaisement. J’en arrive à réfléchir à quel moyen employer pour que tout s’arrête. Quel moment choisir ? Quel type de comprimés avaler ? C’est le seul moyen que j’ai en tête pour en finir.
Le dimanche matin Robin tente de m’interdire de travailler. C’est peine perdue, puisque je dois rappeler Solène. À la fin de notre conversation, elle me glisse qu’elle est préoccupée par mon état.
Robin, assis dans le canapé avec sa tablette, redresse la tête et l’air de rien, me glisse :
Plutôt que d’avaler une plaquette de comprimés, j’ai enfin accepté de prendre soin de moi. J’ai capitulé, j’ai fini par écouter cette partie de moi devenue de plus en plus bruyante à force d’être niée. Certes en prenant la fuite, mais c’est le seul moyen que j’ai trouvé pour m’échapper. Pourtant, à plusieurs reprises depuis des mois, j’avais évoqué mes difficultés auprès de ma chef, sans jamais une seule fois être entendue…
2
J’ai froid
Notre besoin de consolation est impossible à rassasier.
Stig Dagerman
Seulement quelques minutes que je viens de naître et déjà, je me retrouve séparée de ma maman. La matrice qui me protégeait n’est plus là pour me contenir et me réchauffer. Ce monde est si froid, si sec, tous ces bruits qui m’assaillent, ces lumières qui m’éblouissent, ces odeurs qui m’agressent. La seule qui m’apaise vraiment, c’est celle de ma maman. Pourquoi je ne peux pas me blottir contre elle pour me réchauffer ? J’ai besoin de me laisser bercer encore et encore tout contre ce cœur battant la mesure régulière de ma sécurité. Cette sécurité dans laquelle j’ai maturé ces derniers mois, ce cocon magique siège de mon développement que je viens juste de quitter. Pourquoi si tôt m’arracher à ma mère ? En 1971, les concepts d’attachement et d’interactions précoces n’effleurent pas encore les professionnels de la maternité, « le peau à peau » n’a pas encore fait son entrée dans les lieux de naissance. Non, pour me réchauffer, l’on m’installe sous une lampe, sans aucun contour, même pas dans une couveuse. Là au moins, peut-être que j’aurais pu me sentir contenue, mais sous une lampe alors qu’il y a encore quelques minutes, je ne faisais qu’un avec ma maman à 37 °C. Le monde aérobie semble si vaste, déjà cette séparation brutale. Minuscule et déjà ne pouvoir compter que sur soi.
Mon âme a choisi cette famille pour cette vie-là. Que me réserve-t-elle ? Comment exister dans ce monde si vaste, imprévisible et parfois si hostile ?
La grossesse d’Anémone, ma maman s’est bien déroulée, j’ai été conçue une nuit de réveillon. Elle fut ravie de m’accueillir puisqu’elle avait déjà mis au monde trois ans auparavant un garçon, mon frère Marc.
Durant cette grossesse, un événement est advenu. Je compose avec celui-ci depuis toujours. Quand vais-je comprendre pourquoi celui-ci a autant impacté toute ma vie ?
Je comprends maintenant que ce passage sous la lampe, je l’ai associé à cette toute première séparation. De fait, inconsciemment, pour moi être dans la lumière impliquait de se sentir vulnérable… Je comprends mieux pourquoi cela me coûte tant d’être visible, de me mettre en avant. Je n’ai pris conscience de cela que très récemment. J’ai travaillé sur cette croyance par le biais des mouvements oculaires pour la modifier et vivre ce « entrée dans la lumière» de façon plus apaisée.
3
Avoir confiance…
La chute n’est pas un échec. L’échec, c’est de rester là où on est tombé.
Socrate
Il y a neuf mois, en janvier 2018, j’ai pris mes nouvelles fonctions. Nouveau défi à relever puisqu’en parallèle de cela, j’ai continué à me former chaque mercredi. Objectif : décrocher un Master 2 en sciences de l’éducation, sésame indispensable pour pouvoir continuer à légitimement former les étudiants. La formation de ces derniers, passée à l’université, implique une montée en compétences pour tout le monde, pas seulement pour les apprenants.
J’ai tenu à rendre mon mémoire fin juin pour pouvoir souffler durant l’été. C’était sans compter sur l’avis de concours sur titre paru mi-juin. Malgré la fatigue qui m’accompagne en permanence, j’accepte de concourir. Même si je suis déjà lessivée, je monte mon dossier d’admissibilité pour le rendre juste avant les congés d’été.
En septembre, en pleine rentrée pour les étudiants et juste après ma soutenance de mémoire pour le Master, j’apprends que je suis admissible pour l’oral de ce concours. J’ai à peine deux semaines pour me préparer. La semaine qui précède celui-ci, le lundi, je vais chez le dentiste pour un détartrage : ne rien négliger pour l’emporter ! Excès de zèle ?
Dans la nuit, je suis prise de frissons, je suis glacée puis la fièvre prend le relais. Cela ressemble à une belle infection associée aux soins : une bactériémie avec un tableau digestif qui finit par complètement me détraquer. Pendant toute la semaine, je me bourre d’antipyrétiques et de Smecta®. Je suis l’ombre de moi-même. Le mercredi matin, en sortant de la douche, je suis même prise d’un vertige. Encore vêtue de mon peignoir de bain, je suis contrainte de me recoucher un moment pour reprendre quelques forces et aller travailler. Le jeudi et le vendredi, afin de me préparer au mieux à ce concours, je continue à me bourrer de médicaments pour pouvoir rencontrer les professionnels ressources conseillés par ma chef. Encore quelques jours à tenir et je pourrai souffler.
Le grand oral arrive le mercredi suivant : le 19, je suis la deuxième à passer. Je me sens stressée c’est vrai, mais pas plus pourtant que pour d’autres entretiens ou concours que j’ai déjà passés. Mon tour arrive, j’entre dans la salle et salue le jury composé de cinq personnes. La première question que l’on m’adresse me déroute un peu : vous venez pour quoi ? Alors, je me présente et décris le poste de « faisant fonction » que j’occupe. J’explique que je suis là pour passer le concours sur titre. En face de moi le jury est tellement surpris, qu’après quelques instants, l’un des membres appelle l’organisatrice du concours. Celle-ci entre et explique que même si le poste associé à ce concours n’est pas paru, j’ai le droit de concourir pour le titre. Un peu capillotracté comme réponse, mais ça semble passer au niveau du jury… Elle quitte la salle puis le président du jury prend la parole :
— Bon, eh bien, puisque vous êtes là, on va quand même vous écouter.
Le « quand même » a du mal à passer. Je réalise ma présentation, elle doit tenir en dix minutes pile, je me suis tellement entraînée que c’est le cas. Puis, tant bien que mal, je réponds aux questions du jury. Au fond de moi je n’ai qu’une envie : m’enfuir, que ce calvaire se termine enfin. Je quitte la salle, reprends mon vélo et retourne au bureau. Je ne suis pas dupe, j’ai fait une piètre prestation… Compte tenu de ce contexte, pouvait-il en être autrement ?
Ma chef me rejoint dans mon bureau pour débriefer. Nous échangeons quelques minutes à peine, puis elle reçoit l’appel de son N + 2, l’un des membres du jury de mon concours qui, au téléphone, semble très remonté. J’entends « C’est quoi ce bordel ! Tu peux m’expliquer… ». Elle quitte précipitamment la pièce pour terminer sa conversation en privé.
Le lendemain, dans la matinée, elle m’invite à entrer dans son bureau. Sans ménagement aucun, elle m’annonce que j’ai échoué au concours, que je suis trop sensible… elle ajoute : « Il va falloir vous blinder, vous étiez trop stressée ».
Ce que je comprends surtout, c’est que, le poste n’étant pas paru, c’est un inédit dans ce type d’établissement. De ce fait, je n’avais que très peu de chance d’être nommée. Surtout, ce qui m’a mise encore plus en colère, c’est que j’ai appris que ma chef savait depuis le jeudi de la semaine précédente que le poste n’était pas paru. Elle s’est bien gardée de m’en avertir ! Quand je l’ai questionnée à ce sujet, elle s’est justifiée ainsi : « Si j’ai agi ainsi, c’était pour que vous ayez toutes vos chances… ».
La moindre des choses aurait été de me laisser décider par moi-même. Dans ce contexte de vice de procédure, j’aurais voulu être prévenue, qu’on me laisse choisir si oui ou non je souhaitais me présenter à cet oral. Le nouveau directeur adjoint était membre du jury, cet amateurisme organisationnel a sûrement fait désordre dans un concours aussi formel. Il venait de prendre ses fonctions au début du mois. Donner à voir une telle désorganisation à un grand directeur fraîchement arrivé, vraiment ce n’est pas très pro.
Je ne saurai jamais d’où est venue l’omission concernant la parution de ce poste. En tout cas, la sidération ressentie au moment de cet oral a fait place à une grande colère. Colère d’avoir été dépossédée de ma décision. Sentiment d’avoir été « l’objet » de ma directrice. Subir cela une nouvelle fois m’a fait prendre conscience de ma difficulté récurrente à accéder à mes propres choix. J’ai eu le sentiment d’être instrumentalisée, d’être au service d’une institution tout en étant niée en tant que personne. C’est comme si j’étais de nouveau propulsée des années en arrière, où pour être aimée, la petite Marianne croyait qu’elle devait se ranger aux souhaits et désirs de mes parents, au détriment de ses propres aspirations.
Par loyauté, j’avais accordé ma confiance à ma supérieure hiérarchique. Elle m’avait recrutée, j’avais une sorte de « dette morale » envers elle. Malheureusement, le dicton se vérifiait une fois encore : « Avoir confiance c’est accepter d’être trompée ». Une amie me dira d’ailleurs, à propos de cette douloureuse expérience : « Ce n’est pas toi qui as manqué de discernement, c’est juste le système qui n’est pas loyal. ». Implicitement, j’ai donné ma confiance et voilà ce que j’ai récolté.
À un niveau plus méta, au niveau transgénérationnel, il s’est peut-être aussi joué quelque chose de bien plus inconscient qui appartient à ce que Vincent de Gaulejac appelle les loyautés familiales. Cet engagement inconscient qui a pour but selon ce psychosociologue de protéger le groupe social si particulier que constitue la famille. Dans ces loyautés familiales se retrouvent une dimension appelée « socio-économique » que de Gaulejac a très bien décrit dans la Névrose de classe. Il met ainsi en relief combien il est difficile pour un enfant de passer devant son père ou sa mère en termes de niveau d’études. C’est à la lecture de Aïe mes aïeux3, d’Anne Ancelin Schutzenberger que j’ai réalisé que cette dimension transgénérationnelle s’était sûrement invitée malgré moi dans ce cuisant échec. D’autant que lorsque j’ai été retenue pour ce poste de cadre supérieur, ma mère m’avait dit : « Mais quand vas-tu t’arrêter ? »…
Dans notre vie, tant que nous ne les avons pas comprises, certaines épreuves nous sont resservies afin que l’on finisse par enfin les comprendre… Qu’est-ce qui fait que j’ai persisté aussi longtemps dans ce contexte professionnel où chaque jour qui passait m’éloignait toujours un peu plus de moi-même et de mes valeurs ?
4
États d’âme
Mon drame, c’est mon ombre
Une ombre profonde comme la nuit
Qui gronde et ronronne
Quand je lui donne ma peur d’être seule
Ma peur d’échouer
Mon drame c’est mon ombre
Elle, c’est le diable
Qui l’a cousue à mes pieds
Était-ce le diable
Le jour où je suis née ?
Clara Luciani
J’ai à peine deux ans, de cette période maman raconte que mon arrivée dans la famille a contrarié Marc, mon frère aîné. Elle se rappelle sa difficulté à m’accepter. Au point, lorsque j’étais bébé, d’aller mettre un oreiller sur ma tête pour que j’arrête de pleurer. Heureusement a-t-elle dit, ça n’a pas duré longtemps. Dès que les interactions ont été plus évidentes, il s’est écrié « Maman, Marianne, elle me rit ! ».
Ce petit bout d’homme de trois ans mon aîné a vécu sa période d’Œdipe de façon très affirmée. Ma mère aime à raconter qu’un jour, Marc s’est placé devant elle, très fier, l’a regardée droit dans les yeux et lui disant : « J’ai enfermé ton mari dans la chambre. ». Sur le coup elle a cru qu’il plaisantait. Il n’en était rien. Il avait même pris soin de retirer la clé. D’ailleurs elle a pris conscience de la véracité de cette situation quand elle a entendu son mari tambouriner à la porte de la chambre parentale.
De constitution fragile, j’étais souvent malade. À peu près à la même période l’ORL a conseillé à mes parents de me faire retirer les amygdales. À l’époque, en 1973, point de chambre parent enfant ni de lit d’appoint pour rassurer les bambins. L’enfant était donc laissé à la clinique et les parents revenaient le chercher le lendemain. Ma mère se rappelle encore ce déchirement en me laissant là-bas. Elle me revoit dans ma petite robe de chambre rose essayer de la rattraper lorsqu’elle a dû me laisser. Elle entend encore mes cris mêlés à mes sanglots, je l’exhortais à revenir me chercher. Rien n’y a fait. Ce désespoir n’a fait que renforcer ce sentiment d’abandon déjà si présent. En post opératoire, elle a tout de même obtenu que je sois installée dans la même chambre que mon père qui lui aussi était entré la veille pour une intervention ORL. À ses côtés, mon sourire est instantanément revenu.
Par la suite, il en sera ainsi à chaque fois que l’on me laissera. Même en complète sécurité avec des personnes aimantes, ce profond sentiment de vide m’accompagnera.
Quelques années plus tard, un sentiment de malaise sera réactivé par une omission fort gênante. Ma mère s’en souvient encore avec beaucoup de culpabilité. C’était l’été, il faisait chaud, j’avais six ou sept ans et j’allais au centre aéré. Je portais une jupe en jean et un T-shirt léger. Tout allait bien jusqu’au moment où l’on a fait une ronde pour s’asseoir dans l’herbe. La gêne m’a envahie dès qu’une de mes camarades a crié : « Elle n’a pas de culotte, elle n’a pas de culotte ! ». Tout le monde s’y est mis, j’ai vraiment passé une mauvaise journée…
J’ai sept ans, sur la boîte contenant le projecteur de diapo, un objet crisse sur le polystyrène. Ce bruit caractéristique attise ma curiosité. Mon Frère Marc vient de commencer ce petit jeu sonore avec une lame de rasoir trouvée dans la salle de bain. À mon tour, je voudrais faire crisser cette boîte. Je n’en ai ni l’occasion ni le temps. Marc ne veut pas me passer la lame. On se chamaille, la lame finit enfoncée sur le dessus de mon poignet droit : belle entaille de trois centimètres ! Heureusement ni la veine, ni les tendons, ni même l’artère ne sont touchés. Quelques jours avant, ma mère venait d’acheter des Stéristrips®, quelle clairvoyance ! Marquée à vie je le suis !
Cet épisode m’a valu une dizaine de points de suture, maintenue de force par plusieurs professionnels de santé qui luttaient pour me contenir tellement je me débattais en hurlant ! Personne ne voulait rien m’expliquer, un champ tendu devant mon visage, mon bras de l’autre côté, je voulais juste savoir ce qu’on allait me faire… À cette époque-là encore, point d’explication, de distraction, ni de MEOPA, ce gaz si efficace pour réaliser les soins invasifs en douceur. Il est apparu bien des années plus tard, tant mieux pour tous ceux qui peuvent en bénéficier !
L’été suivant, pour ma fête, je reçois une jolie poussette en bois et toile vichy rouge. Je descends jouer avec au bas de l’immeuble, dans la résidence. Je promène ma poupée de chiffon avec sa robe à petits carreaux blancs et bleus ciel. Puis, je remonte quelques minutes pour prendre une couverture. Je monte ma poupée avec moi en laissant la poussette dans le hall de l’immeuble. Quand je redescends quelques minutes plus tard, la poussette n’est plus là. Je découvre ainsi la dure réalité de la vie.
CE1, épidémie de poux à l’école : je fais partie des têtes infestées. Mes parents ont prévenu le maître. Telle une pestiférée, il m’isole au fond de la classe. Quel sentiment d’humiliation et d’injustice ! Cet épisode sonne le glas de mes cheveux mi-longs. On ne lésine pas pour éradiquer ces petites bêtes-là ! Je me retrouve avec une coupe à la garçonne. Malgré cela, la méfiance de mes camarades envers moi mettra longtemps à s’estomper.
En CE2, lorsque les élèves ont terminé leur travail, qu’il reste un peu de temps en fin de journée, ils peuvent prendre un puzzle. J’adore ce moment de reconstitution, quand je relie les différentes pièces d’un puzzle, pour moi c’est une récompense suprême.
Un jour la maîtresse nous fait faire une dictée. À des fins pédagogiques, au lieu de la corriger, elle indique pour chacun le nombre de fautes commises et nous demande de les retrouver. Je retrouve la plupart d’entre elles. Il n’en reste plus qu’une sur laquelle je bute désespérément. Pendant ce temps interminable de recherche, je vois mes camarades un à un se diriger vers le meuble pour choisir leur puzzle. Je les envie de plus en plus d’autant qu’à force de chercher sans trouver, j’en viens à générer de nouvelles fautes en transformant des mots bien orthographiés… Devant ma difficulté, la maîtresse finit par m’aider à trouver cette ultime faute : « ché s’écrit chez », m’explique-t-elle. Enfin, le calvaire est terminé ! Je file choisir un puzzle et me mets à mon activité préférée. J’ouvre la boîte, trie les pièces du contour. J’ai à peine commencé que la cloche se met à sonner…
Blessures d’enfant comme chacun d’entre nous en a connu. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, voilà les cinq blessures avec lesquelles nous avons chacun fort à faire pour nous en départir. Elles sont profondément ancrées en nous et c’est seulement lorsque l’on commence à en prendre conscience que l’on peut enfin travailler dessus et réussir à s’en distancer.
5
La fuite
Voir le sens de son existence demande de prendre soin de soi, de travailler à se libérer des regrets et de toutes ces émotions qui nous figent dans la mélancolie.
Stéphane Allix , Après, p 173
Après cet échec au concours, ma déception est bien réelle. Pour autant, même si la colère gronde en moi, ce sont d’abord les larmes qui me viennent. Je revendique une fatigue extrême pour prendre une RTT le vendredi : débrancher, fuir, tout laisser derrière moi, voilà à quoi j’aspire. Je végète tout le week-end. Plus celui-ci avance, moins je parviens à me projeter pour retourner travailler. Je préviens donc Robin que vu mon état de fatigue et le contexte ambiant, je ne vais pas travailler lundi. Je vais prendre rendez-vous chez le médecin, car je suis épuisée.
Bien sûr j’ai le sentiment de prendre la fuite, c’est ma seule solution pour ne plus penser. Mon arrêt va durer quatre mois : deux mois de « descente » et deux mois de « remontée ». La descente avec une extrême culpabilité : celle d’avoir échoué, mais aussi d’avoir « trahi la confiance » des personnes qui m’ont recrutée et le sentiment surtout d’abandonner l’équipe avec laquelle je travaillais. Celle aussi d’avoir été lâche avec moi-même, d’avoir dû attendre ce profond mal-être pour reconnaître que j’étais responsable pour partie de la situation dans laquelle je me trouvais.
La fatigue accumulée depuis des mois est bel et bien là. Je passe le début de cet arrêt prostré sur le canapé. Je ne me reconnais plus, moi d’habitude si dynamique, toujours active me voilà comme stoppée nette les deux pieds figés dans le béton.
Robin est très inquiet, d’autant que c’est la première fois que je me laisse aller à une telle fragilité. Il a tellement l’habitude de me voir en action qu’il ne peut s’empêcher de se faire du souci pour moi. À tel point, que chaque jour de la semaine, à la mi-journée, il m’appelle pour se rassurer.
Cette situation est inédite pour toute la famille. D’ailleurs, Adam, notre fils de dix-sept ans me répète en boucle : « T’inquiète, maman, ça va aller, prends du temps pour toi. Si tous les gens étaient aussi altruistes que toi, notre planète serait un vrai régal à vivre ! On est grands maintenant, tu n’as pas à t’en faire pour nous, on peut se débrouiller ».
Ses mots me font l’effet d’une décharge électrique. Cet écho me fait prendre conscience de la façon dont je projette mon anxiété sur tous ceux qui me sont chers. De toute façon, je vis avec cette peur tapie au fond de moi depuis tellement d’années… Je passe mon temps à m’inquiéter. Même pour un rien, je suis vite déstabilisée. Chez moi, l’intranquillité est une seconde nature.
J’ai conscience que le chemin va être long, mais, à présent, je vais tenter de m’écouter. Après deux semaines à regarder toutes les saisons de « Reign » pour m’empêcher de penser, je me plonge dans la lecture de « Ta deuxième vie commence quand tu as compris que tu n’en avais qu’une » de Raphaëlle Giordano. Je m’identifie très vite à Camille, l’héroïne. Je l’envie au fur et à mesure que les pages défilent : plus facile à lire qu’à mettre en pratique. Malgré tout, je commence timidement à appliquer ce que lui suggère son coach au fil du roman. Je choisis donc un joli cahier sur lequel est écrit « Tout va bien » sur la couverture pour commencer à faire à cheminer vers moi-même.
6
Les Apaches
Tout enfant est obligé de supporter le climat dans lequel il grandit, mais aussi les effets pathogènes restés en séquelles, du passé pathologique de sa mère et de son père.
Françoise Dolto , La cause des enfants p 446
Fin des années 1970… Il y a quelques mois, mon père a eu un accident en vélomoteur. Un vendredi soir, il s’est fait faucher par un chauffard ivre à la débauche. La voiture qui l’a tamponné a freiné sur cinquante mètres, il a rebondi sur le capot et a été projeté dans le fossé. Il a eu l’avant-bras droit fracturé en plusieurs endroits. Intervention chirurgicale, hospitalisation et rééducation, au total, il en a eu pour plus de quatre mois d’arrêt de travail.
À partir de ce moment-là, j’ai perdu le papa que je connaissais jusqu’alors. Il est devenu imprévisible et versatile. Son avant-bras a très bien été réparé. En revanche, lui a été laissé en friche avec ses peurs et ses angoisses. En 1979, on ne se souciait pas des conséquences psychiques d’un tel traumatisme. Les effets du choc post-traumatique ne seront pris en considération que bien plus tard. À l’époque, s’occuper du psychologique ne faisait pas partie des priorités. Mais moi, j’ai très vite intégré que quelque chose clochait.
Un jour d’été, quelques jours avant de partir en colonie de vacances, afin de constituer nos trousseaux, maman avait fait l’achat d’un ruban adhésif en tissu thermocollant et d’une réglette alphabétique pour marquer nos affaires. En effet, mes frères et moi partions pour trois semaines. Le stylo s’est cassé, il s’agissait sûrement d’un objet de piètre qualité, mais mon père ne s’est pas contenté de cette conclusion.
Marc, mon frère aîné, Simon, mon frère cadet et moi-même avons été sommés de dire la vérité. Qui avait cassé le stylo ? Notre père voulait absolument que celui qui l’avait fait se dénonce. Plus il s’énervait et criait, plus nous étions muets. Je reverrai toujours son regard : il fulminait. Sa pulsion de rage l’a emporté. Comme aucun de nous ne se manifestait, il est passé à la manière forte. Pas des coups, non, c’était plus fourbe et plus sournois que cela. C’était surtout d’une violence psychologique extrême. Il nous a alignés sur le rebord de la baignoire et a sorti le Mercurochrome® : « Dénoncez-vous où je vous badigeonne les joues ! » a-t-il crié. Aucune réponse n’est arrivée. Alors, tels des Apaches, nous nous sommes retrouvés avec les joues peintes en rouge. Il est allé jusqu’au bout de son coup de sang ! Avant notre départ en colo, nous avons passé un long moment devant la glace, à frotter nos joues jusqu’au sang pour faire disparaître les stigmates infligés.
Je ne me souviens pas que ma mère ait tenté de s’interposer. Pourtant elle était présente. Et pour cause, l’imprévisibilité de notre père pouvait, elle aussi, l’effrayer.
À partir de ce jour-là, j’ai compris que je ne pouvais plus compter sur lui pour me protéger ni sur ma mère pour se positionner. De fait, notre solidarité fraternelle s’en est trouvée renforcée. C’était le seul moyen pour tenter collectivement de faire front face à un père qui pouvait dégoupiller en une fraction de seconde.
7
Tête contre les murs
La vraie souffrance est dans la solitude qui l’accompagne.
André Malraux
J’ai tout juste douze ans, je crois, je viens de rentrer en cinquième, mon manque de maturité est criant comparé à certains qui n’ont pas doublé, mais déjà triplé une classe. Cela entraîne une amplitude d’âges surprenante. L’agencement de notre classe est un imbroglio de jeunes gens en proie aux modifications physiologiques de l’adolescence. Chacun se trouvant à un stade plus ou moins avancé dans ce remaniement corporel et psychologique.
Trouver mes marques est vraiment difficile. Me situer dans cette horde de jeunes dont les hormones pour certains commencent à bouillir, est loin d’être simple. Je suis malmenée en permanence et deviens la tête de Turc de ma classe. Il y a les moqueries répétées, les situations gênantes… Les jours passent, rien ne vient améliorer ce constat. Perdue, apeurée c’est dans cet état émotionnel que je me rends chaque jour au collège. Je n’ai pas vraiment d’amie avec qui me lier alors qu’en face j’ai affaire à des petits groupes bien soudés. À Noël, j’ai un nouveau vélo : un vélo Argenta rouge bordeaux. Je vais pouvoir l’utiliser pour éviter d’attendre le car de ramassage les jours où je finis tôt.
Un jour, en arrivant au collège, deux garçons de ma classe me surprennent à ranger mon vélo sous l’abri. L’après-midi même, à la sortie des cours, je retrouve mes phares avant et arrière complètement cassés. Je rentre à la maison, les yeux rougis. J’ai tant de peine que lorsque ma mère rentre du travail je me mets à me taper la tête contre les murs de la cuisine. Devant ce profond mal-être, elle essaie tant bien que mal de me consoler. Elle me dit que ce n’est rien que cela va passer. Mais plus les jours passent et moins ça passe, plus ces deux-là prennent un malin plaisir à me malmener.
Mes parents prennent enfin mon malaise en considération et demandent une entrevue avec le principal du collège, Monsieur Bidon ! Le jour du rendez-vous arrive enfin. À la fin de la récréation, toutes les classes sont en rang. La sonnerie retentit. Alors qu’il ne vient quasiment jamais dans la cour, Mr Bidon fait irruption. Il s’approche de notre classe m’appelle ainsi que les deux garçons en question. Cet appel vient de signer ma stigmatisation à tout jamais !
Cela partait pourtant d’une bonne intention de la part de mes parents. Le résultat n’a pas eu l’effet escompté. Bien au contraire, cela a été pire que mieux ! À partir de ce jour-là, j’ai compris qu’un fossé s’était creusé entre mes parents en moi. J’ai pris sur moi, les semaines et les mois ont passé. En juin, pour m’éviter de vivre une autre année aussi difficile que celle-ci, les professeurs ont proposé mon redoublement, le justifiant par un manque de maturité et des résultats tout juste passables. À cette période-là, j’ai pris conscience de ma différence, de mon extrême sensibilité, de ma difficulté à prendre du recul vis-à-vis d’évènements. Insignifiants pour certains, mais si déstabilisants pour la toute jeune adolescente que j’étais.
Auparavant d’ailleurs, j’étais plutôt démonstratrice dans mes émotions. Ma mère m’appelait « la mère lapin qui tape du pied ». Surtout lorsque je n’étais pas d’accord, que je revendiquais la prise en compte de mon point de vue. Mais, à force de me faire traiter comme la cousine de Peter Rabbit, de me faire malmener à l’école sans que mes parents ne se rendent compte de l’anxiété que j’éprouvais, comme Caliméro, je me suis recroquevillée dans ma coquille. J’ai fini par ne compter que sur moi sans pouvoir accueillir ni gérer mes émotions, seulement les refouler bien profondément en moi. Quand j’avais l’outrecuidance de me plaindre, ma mère me servait du « Notre dame des sept douleurs » qui n’était pas plus engageant que cela pour amorcer un dialogue déjà pas toujours simple à maintenir.
Au moment où encore une fois, j’aurai eu besoin de la compréhension de mes parents, je me suis fait humilier une fois de plus… Un mercredi après-midi, j’étais partie à vélo chez des amis de mes parents. Ils avaient trois adorables petites filles dont j’adorais m’occuper. Je n’ai pas vu le temps passer. J’ai dépassé d’une heure environ l’heure fixée par mes parents pour rentrer. Je n’ai pas osé demander à appeler pour prévenir de ce retard. Lorsque je suis arrivée à la maison, je me suis fait remonter les bretelles. Somme toute, c’était normal : j’avais dépassé les bornes. Après un bon sermon, mes parents auraient pu en rester là. Pourtant, dans cette éducation bien ferme, menée à coup de menaces et de phrases parfois bien piquantes, on était encore loin du compte. Pour bien marquer le coup et asseoir leur autorité, j’ai dû me présenter le soir même au commissariat pour prévenir que j’étais bien rentrée au domicile parental.
Cette approche éducative par l’humiliation, aussi bien dans les mots que dans les faits, m’a particulièrement figée. C’était la première fois que je contrevenais. Cet événement humiliant a de nouveau contribué à alimenter ma désillusion. Dans ma relation avec mes parents, il creusait encore un peu plus le fossé tel un gouffre qui devenait infranchissable.
C’est comme si je devais en permanence m’excuser d’être là, d’avoir des émotions, des désirs. Comme si le simple fait d’exister venait tout compliquer. Bien sûr que mes parents m’aimaient, pourtant l’éducation dispensée, par moments, était loin d’être bienveillante et positive. Elle n’était pas non plus maltraitante, c’était plutôt une absence de bientraitance. Les petites phrases cinglantes, le chantage en termes de comportement de la part de mes parents me mettaient dans des injonctions paradoxales, dans une relation de soumission totalement dysfonctionnelle. Une forme inconsciente de négligence s’était installée.
Pourtant, plus je vivais cette relation, plus je tentais de m’adapter à ce grand huit des émotions parentales. Je réagissais par une réponse adaptative dite de « survie ». Cette réponse apprise dans l’enfance avait pour but d’éviter le rejet, ma blessure la plus profonde, je crois, pour éviter l’humiliation que l’on nous faisait sentir lorsque nous tentions d’être authentiquement nous-mêmes.
Inexorablement, cette négligence a alimenté mon insécurité.
Cette insécurité, d’ailleurs, c’est la nuit que je la ressentais le plus. En journée aussi elle était facilement repérable tant je me rongeais les ongles.
D’aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours appréhendé d’aller me coucher. Pour m’apaiser lors de l’endormissement, je frottais le plat puis le dos de ma main droite sous mon oreiller. À force de répéter ce mouvement, je finissais par trouver le sommeil.
Encore maintenant, pour retrouver cet apaisement, je conserve ces quelques rituels : je frotte mon pied droit sur le drap. J’ai aussi deux oreillers, un carré et un rectangle. Chaque fois qu’entre 3 et 5 heures du matin je cherche à m’apaiser, je prends ce dernier entre les bras pour qu’il couvre le haut de ma poitrine et mon cou, c’est très efficace pour me sécuriser.
8
Quand maman n’est pas là
La solitude ne vient pas du fait que l’on n’a personne autour de soi, mais du fait que l’on ne peut pas communiquer les choses qui semblent importantes pour soi, ou que l’on a certaines opinions que les autres trouvent inadmissibles.
Carl Gustav Jung
Depuis quelques mois mon père est au chômage. L’entreprise qu’il a créée n’a pas tenu. Ce n’est pas un manque de clients ni une insatisfaction de ces derniers. Non, l’associé de mon père a détourné plus de cinquante mille francs ! Une sacrée somme pour l’époque. Ce commercial véreux n’en était pas à son premier coup d’essai. Mon père lui a donné toute sa confiance sans se méfier. Ce beau parleur d’origine italienne a réussi à l’embobiner jusqu’à obtenir procuration sur le compte de la société. À partir de là, il a commencé à signer plusieurs chèques pour son propre compte et a disparu à l’étranger ! Personne ne l’a jamais revu.
Mon père s’est retrouvé avec un énorme découvert à rembourser. Son amour propre en a pris un coup. Il a beaucoup culpabilisé d’autant que ses parents ne voyaient pas ce projet d’un bon œil. Edgar, le « vilain petit canard », était le seul de leurs enfants à travailler dans le privé. Les trois autres enfants occupaient tous des postes dans la fonction publique. Ils ont suivi la même voie que leurs parents. Mon père, Edgar, était le seul à sortir du rang. Ça n’a pas dû être facile d’aller quémander leur aide financière.
Jamais il n’en a reparlé. Petit à petit, il s’est muré, s’est isolé. Je ne lui connaissais peu d’amis proches. La plupart des amitiés que nous avions étaient à l’initiative de ma mère, idem pour les relations familiales. Mon père était plus attaché à sa belle-famille qu’à la sienne. Il vivait toujours comme un devoir et non un plaisir le fait d’aller passer un week-end chez ses parents. Il n’a jamais été un grand bavard, mais, à partir de ce moment-là, il a plus cherché à se défendre. La morosité s’est emparée de lui. Ceci peut aisément se comprendre. Pour un homme, ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, c’est ce qu’il y a de pire.
Il a laissé dans cette épreuve le peu de confiance qui lui restait. Pendant cette période où il dégringolait, paradoxalement, ma mère évoluait vers un poste de chargée d’export. Ainsi, au fil du temps, ils se sont éloignés. Une forme de jalousie s’est insinuée puisque pour conclure des marchés à l’étranger, ma mère partait régulièrement avec son directeur.
Avec mes frères, témoins de tous ces évènements, nous étions dépassés. Au quotidien ce sont surtout les changements brutaux d’humeur de mon père qui nous déroutaient. Les déplacements de notre mère rendaient la situation pas toujours évidente. Mon père passait beaucoup de temps assis dans son fauteuil, le regard absent, à se frotter les mains, tout absorbé qu’il était par ses pensées. Alors avec Marc et Simon, nous faisions front ensemble comme nous pouvions.
Pour arrondir les angles, nous assumions régulièrement le ménage, le linge, le repassage afin d’assouplir ce qui pouvait encore l’être. Le soir, mon père s’abrutissait en regardant la télévision. Il n’allait se coucher que tard dans la soirée comme s’il redoutait la nuit. Souvent, c’est seulement après le second film qu’il consentait à aller dormir.





























