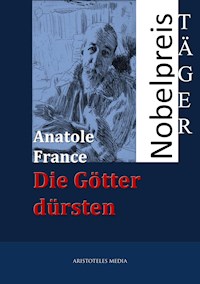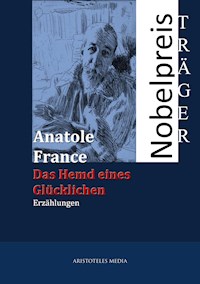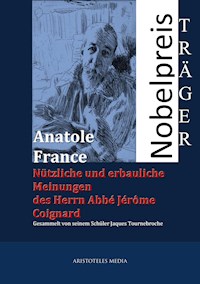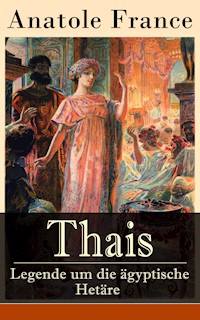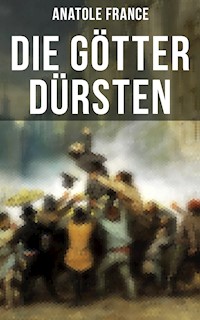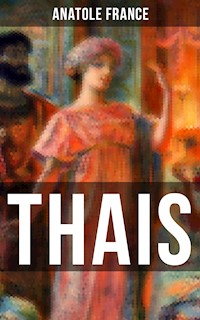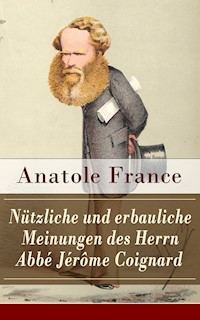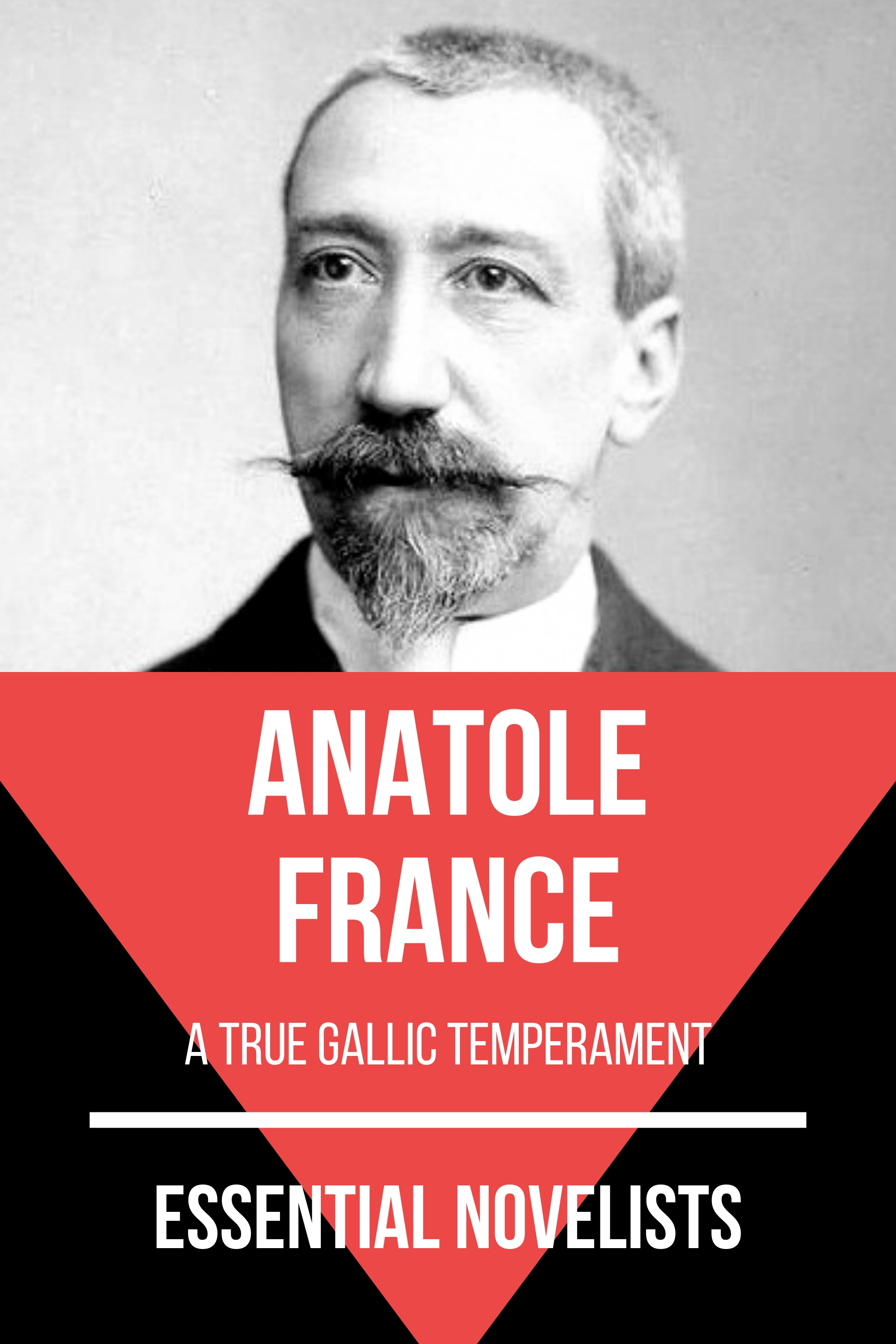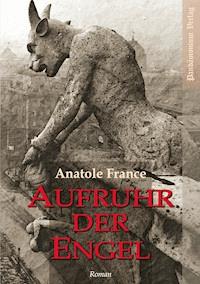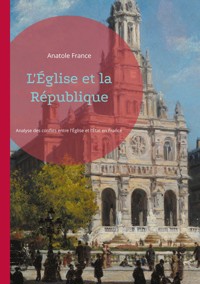Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
« L'Anneau d'améthyste » d'Anatole France, publié en 1899, est le troisième volet de la tétralogie « Histoire contemporaine ». Ce roman satirique offre une critique acerbe de la société française de la Troisième République, mêlant habilement politique, religion et moeurs sociales. L'intrigue se déroule autour de plusieurs personnages récurrents, dont M. Bergeret, professeur de littérature latine, figure centrale et alter ego de l'auteur. À travers ses observations et conversations, France dépeint avec ironie les travers de son époque, notamment l'affaire Dreyfus qui divise alors la France. Le titre fait référence à l'anneau épiscopal de Mgr Guitrel, un ecclésiastique ambitieux dont les manoeuvres pour obtenir un évêché servent de fil conducteur au récit. Autour de cette quête se tissent des intrigues politiques, des débats intellectuels et des scènes de la vie quotidienne, offrant un panorama saisissant de la société française fin-de-siècle. France excelle dans l'art du dialogue, utilisant l'humour et l'ironie pour dénoncer l'hypocrisie, le carriérisme et l'intolérance. Il aborde des thèmes variés tels que l'antisémitisme, le cléricalisme et les luttes de pouvoir au sein de l'establishment politique et religieux. Le style élégant et incisif de France, empreint d'érudition classique, sert une critique sociale mordante. « L'Anneau d'améthyste » n'est pas seulement une oeuvre de son temps ; il offre une réflexion intemporelle sur les mécanismes du pouvoir et les faiblesses humaines. Ce roman, à la fois divertissant et profond, confirme le talent d'Anatole France comme observateur lucide et impitoyable de la société, maniant avec brio l'art de la satire littéraire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
L’ANNEAU D’AMÉTHYSTE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
L’ANNEAU D’AMÉTHYSTE[1]
I
Madame Bergeret quitta la maison conjugale, ainsi qu’elle l’avait annoncé, et se retira chez madame veuve Pouilly, sa mère.
Au dernier moment, elle avait pensé ne point partir. Pour peu qu’on l’en eût pressée, elle aurait consenti à oublier le passé et à reprendre la vie commune, ne gardant à M. Bergeret qu’un peu de mépris d’avoir été un mari trompé.
Elle était prête à pardonner. Mais l’inflexible estime dont la société l’entourait ne le lui permit pas. Madame Dellion lui fit savoir qu’on jugerait défavorablement une telle faiblesse. Les salons du chef-lieu furent unanimes. Il n’y eut chez les boutiquiers qu’une opinion : madame Bergeret devait se retirer dans sa famille. Ainsi l’on tenait fermement pour la vertu et du même coup l’on se débarrassait d’une personne indiscrète, grossière, compromettante, dont la vulgarité apparaissait même au vulgaire, et qui pesait à tous. On lui fit entendre que c’était un beau départ.
— Ma petite, je vous admire, lui disait, du fond de sa bergère, la vieille madame Dutilleul, veuve impérissable de quatre maris, femme terrible, soupçonnée de tout, hors d’avoir aimé, partant honorée.
Madame Bergeret était satisfaite d’inspirer de la sympathie à madame Dellion et de l’admiration à madame Dutilleul. Pourtant elle hésitait à partir, étant de complexion domestique et coutumière et contente de vivre dans la paresse et le mensonge. En ces conjonctures, M. Bergeret redoubla d’étude et de soins pour assurer sa délivrance. Il soutint d’une main ferme la servante Marie qui entretenait la misère, la terreur et le désespoir dans la maison, accueillait, disait-on, des voleurs et des assassins dans sa cuisine et ne se manifestait que par des catastrophes.
Quatre-vingt-seize heures avant le jour fixé pour le départ de madame Bergeret, cette fille, ivre à son habitude, répandit le pétrole enflammé de la lampe dans la chambre de sa maîtresse et mit le feu aux rideaux de cretonne bleue du lit. Cependant madame Bergeret passait la soirée chez son amie madame Lacarelle. En rentrant dans sa chambre, elle vit les traces du sinistre dans le silence terrible de la maison. En vain elle appela la servante ivre-morte et le mari de pierre. Longtemps elle contempla les débris de l’incendie et les signes lugubres tracés par la fumée sur le plafond. Cet accident banal prenait pour elle un caractère mystique et l’épouvantait. Enfin, comme sa bougie allait mourir, qu’elle était très lasse et qu'il faisait froid, elle se coucha dans le lit, sous la carcasse charbonnée du ciel où palpitaient de noirs lambeaux pareils à des ailes de chauves-souris. Le matin, à son réveil, elle pleura ses rideaux bleus, souvenir et symbole de ses jeunes années. Et elle se jeta nu-pieds, en chemise, échevelée, toute noire du désastre, criant et gémissant, par l’appartement muet. M. Bergeret ne répondit point, parce qu’elle était devant lui comme si elle n’était pas.
Le soir, avec l’aide de la servante Marie, elle tira son lit au milieu de la chambre désolée. Mais elle connut que cette chambre n’était plus désormais le lieu de son repos et qu’il fallait quitter la demeure où, quinze ans, elle avait accompli les fonctions ordinaires de la vie.
Et l’ingénieux Bergeret, ayant pris à location, pour sa fille Pauline et pour lui, un petit logis sur la place Saint-Exupère, déménageait et emménageait studieusement.
Sans cesse allant et venant, se coulant le long des murs, il trottait avec une agilité de souris surprise dans des démolitions. Il se réjouissait dans le fond de son cœur, et il cachait sa joie, car il était sage.
Avertie que le temps était proche de rendre les clefs au propriétaire et qu’il fallait partir, madame Bergeret s’occupa semblablement d’expédier ses meubles à sa mère, qui habitait une maisonnette sur les remparts d’une petite ville du Nord. Elle faisait des tas de linge et de hardes, poussait des meubles, donnait des ordres à l’emballeur, en éternuant dans la poussière soulevée, et écrivait sur des cartes l’adresse de madame veuve Pouilly.
Madame Bergeret tira de ce labeur quelque avantage moral. Le travail est bon à l’homme. Il le distrait de sa propre vie, il le détourne de la vue effrayante de lui-même ; il l’empêche de regarder cet autre qui est en lui et qui lui rend la solitude horrible. Il est un souverain remède à l’éthique et à l’esthétique. Le travail a ceci d’excellent encore qu’il amuse notre vanité, trompe notre impuissance et nous communique l’espoir d’un bon événement. Nous nous flattons d’entreprendre par lui sur les destins. Ne concevant pas les rapports nécessaires qui rattachent notre propre effort à la mécanique universelle, il nous semble que cet effort est dirigé en notre faveur contre le reste de la machine. Le travail nous donne l’illusion de la volonté, de la force et de l’indépendance. Il nous divinise à nos propres yeux. Il fait de nous, au regard de nous-mêmes, des héros, des Génies, des Démons, des Démiurges, des Dieux, le Dieu. Et dans le fait on n’a jamais conçu Dieu qu’en tant qu’ouvrier. C’est pourquoi madame Bergeret retrouva dans les emballages sa gaieté naturelle et l’heureuse énergie de ses forces animales. Elle chantait des romances en faisant ses paquets. Le sang rapide de ses veines lui composait une âme contente. Elle augurait un avenir favorable. Elle se figurait sous de riantes couleurs son séjour dans la petite ville flamande, entre sa mère et sa plus jeune fille. Elle espérait d’y rajeunir, d’y plaire, d’y briller, d’y trouver des sympathies, des hommages. Et qui sait si la richesse ne l’attendait pas sur la terre natale des Pouilly, dans un second mariage, après un divorce prononcé en sa faveur ? Ne pourrait-elle pas épouser un homme agréable et sérieux, propriétaire, agriculteur ou fonctionnaire, tout autre chose que M. Bergeret ?
Les soins de l’emballage lui procuraient aussi des satisfactions particulières, les avantages de quelques gains manifestes. Non contente, en effet, de prendre pour elle et les meubles qu’elle avait apportés au ménage et sa large part dans les acquêts de la communauté, elle entassait dans ses malles des objets qu’elle devait équitablement laisser à l’autre partie. C’est ainsi qu’elle mit dans ses chemises une tasse d’argent que M. Bergeret tenait de sa grand’mère maternelle. C’est encore ainsi qu’elle joignit, à ses propres bijoux, qui n’étaient pas d’un grand prix, à la vérité, la chaîne et la montre de M. Bergeret père, agrégé de l’Université qui, ayant refusé, en 1852, de prêter serment à l’Empire, était mort en 1873, oublié et pauvre.
Madame Bergeret n’interrompait ses travaux d’emballage que pour faire ses visites d’adieu, mélancoliques et triomphantes. L’opinion lui était favorable. Les jugements des hommes sont divers et il n’est pas un seul endroit au monde sur lequel se fasse le consentement unanime des esprits. Tradidit mundum disputationibus eorum. Madame Bergeret elle-même était un endroit à disputes courtoises et à secrets dissentiments. Les dames de la société bourgeoise, pour la plupart, la tenaient pour irréprochable, puisqu’elles la recevaient. Plusieurs cependant soupçonnaient que son aventure avec M. Roux n'était pas tout à fait innocente ; quelques-unes le disaient. Telle l’en blâmait, telle autre l’en excusait ; telle autre enfin l’en approuvait, rejetant la faute sur M. Bergeret, qui était un méchant homme.
Cela encore était un sujet de doute. Et il y avait des gens pour soutenir que M. Bergeret leur paraissait tranquille et débonnaire, et haïssable seulement pour son esprit trop subtil, qui offensait l’esprit commun.
M. de Terremondre affirmait que M. Bergeret était fort aimable. À quoi madame Dellion répondait que s’il était vraiment bon il aurait gardé sa femme même méchante.
— C’est là, disait-elle, que serait la bonté. Il n’y a pas de mérite à s’accommoder d’une femme charmante.
Et madame Dellion disait aussi :
— Monsieur Bergeret s’efforce de retenir sa femme à la maison. Mais elle le quitte et elle a raison. C’est le châtiment de monsieur Bergeret.
Ainsi madame Dellion tenait des propos qui ne s’accordaient pas bien ensemble, parce que les pensées humaines sont conduites non par la force de la raison, mais par la violence du sentiment.
Bien que le monde soit incertain dans ses jugements, madame Bergeret aurait laissé dans la ville une bonne renommée, si, la veille même de son départ, faisant visite à madame Lacarelle, elle n’avait pas rencontré M. Lacarelle seul dans le salon. M. Gustave Lacarelle, chef du cabinet du préfet, avait d’épaisses et longues moustaches blondes qui, déterminant sa physionomie, déterminèrent ensuite son caractère. Dès sa jeunesse, à l'École de droit, les étudiants lui trouvaient une ressemblance avec ces Gaulois qu'on voit sculptés ou peints par les derniers romantiques. Quelques observateurs plus subtils, attentifs à ce que ces longs poils étaient situés sous peu de nez et surmontés d'un regard placide, appelaient Lacarelle le « Phoque ». Mais ce nom ne prévalut pas contre celui de « Gaulois ». Lacarelle fut le Gaulois pour ses camarades, qui en conçurent l'idée qu’il devait beaucoup boire, se battre en toute rencontre et culbuter les filles, pour se conformer, en réalité comme en apparence, au personnage qu’on croit être celui du Français à travers les âges. Ils le forçaient, dans les repas de corps, à boire plus qu'il n'aurait voulu, et ils n'entraient pas avec lui dans une brasserie sans le pousser immédiatement sur une servante chargée de plateaux. Lorsqu’il retourna dans son pays natal pour s'y marier et quand, par une fortune unique en ce temps, il fut attaché à l’administration centrale du département dont il était originaire, Gustave Lacarelle fut encore nommé « Gaulois » par l'élite des magistrats, des avocats et des fonctionnaires, qui fréquentaient chez lui. Mais la foule ignorante ne lui décerna point ce surnom honorable avant l'année 1895, au cours de laquelle fut inaugurée, sur le terre-plein du pont National, la statue d’Éporédorix.
Vingt-deux ans auparavant, sous la présidence de M. Thiers, il avait été décidé qu’un monument serait élevé par souscription nationale, avec le concours de l'État, au chef gaulois Éporédorix qui, en l'an 52 avant Jésus-Christ, souleva contre César les peuples riverains du fleuve et mit en péril la petite garnison romaine en coupant le pont de bois jeté par elle pour assurer ses communications avec l’armée. Les archéologues du chef-lieu croyaient que ce fait d’armes avait été accompli dans leur ville, et ils fondaient leur créance sur un passage des Commentaires dont s’autorisait chaque société savante de la région pour établir que le pont de bois rompu par Éporédorix était situé précisément dans la ville où elle siégeait. La géographie de César est pleine d’incertitudes ; le patriotisme local est fier et jaloux. Le chef-lieu du département, trois souspréfectures et quatre chefs-lieux de canton se disputaient la gloire d’avoir massacré des Romains par l’épée d’Éporédorix.
Les autorités compétentes tranchèrent la question en faveur du siège de l’administration départementale. C’était une ville ouverte qui, en 1870, après une heure de bombardement, avait dû, non sans tristesse ni colère, laisser entrer l’ennemi dans ses murs, déjà ruinés au temps du roi Louis XI et cachés sous le lierre. Elle avait subi les rigueurs de l’occupation militaire ; elle avait été vexée, rançonnée. Le projet d’un monument élevé à la gloire du chef gaulois y fut accueilli avec enthousiasme. La ville, se sentant humiliée, fut reconnaissante à cet antique compatriote de lui donner un sujet d’orgueil. Renommé après quinze cents ans d’oubli, Éporédorix réunit tous les citoyens dans un sentiment de filial amour. Son nom n’inspira de défiance dans aucun des partis politiques qui divisaient alors la France. Opportunistes, radicaux, constitutionnels, royalistes, orléanistes, bonapartistes, contribuèrent de leurs deniers à l'entreprise et la souscription fut à demi couverte dans l'année. Les députés du département obtinrent le concours de l'État pour parfaire la somme nécessaire. La statue d'Éporédorix fut commandée à Mathieu Michel, le plus jeune élève de David d'Angers, celui que le maître appelait l’enfant de sa vieillesse. Entré alors dans sa cinquantième année, Mathieu Michel se mit aussitôt à l'œuvre et attaqua la glaise d'une main généreuse, mais un peu gourde, car le sculpteur républicain n’avait guère modelé pendant l'Empire. En moins de deux ans, il termina sa figure dont le modèle en plâtre fut exposé au salon de 1873, au milieu de tant d'autres chefs gaulois, réunis sous le vaste vitrage, parmi les palmiers et les bégonias. En raison des formalités exigées par les bureaux, le marbre ne fut exécuté qu'au bout de cinq autres années. Après quoi surgirent de telles difficultés administratives, de tels conflits furent soulevés entre la ville et l'État, qu'on crut que la statue d'Éporédorix ne serait jamais érigée sur le terre-plein du pont National.
Elle le fut pourtant en juin 1895. La statue, envoyée de Paris, fut reçue par le préfet qui en fit la remise solennelle au maire de la ville. Le sculpteur Mathieu Michel vint avec son œuvre. Il avait alors plus de soixante-dix ans. La ville entière vit sa tête de vieux lion à la longue crinière blanche. L'inauguration du monument eut lieu le 7 juin, M. Dupont étant ministre de l’Instruction publique ; M. Worms-Clavelin, préfet du département ; M. Trumelle, maire de la ville. L’enthousiasme ne fut point tel sans doute qu’il aurait été au lendemain de l’invasion, dans les jours indignés. Du moins, le contentement fut-il général. On applaudit les discours des orateurs et les uniformes des officiers. Et, quand la toile verte qui cachait Éporédorix tomba, la ville entière s’écria tout d’une voix : « Monsieur Lacarelle !... C’est monsieur Lacarelle !... C’est tout le portrait de monsieur Lacarelle !... »
En fait, il s’en fallait de quelque chose. Mathieu Michel, l’élève et l’émule de David d’Angers, celui que le vieux maître appelait son Benjamin, le sculpteur républicain et patriote, l’insurgé de 48, le volontaire de 70, n’avait pas précisément représenté M. Gustave Lacarelle en ce marbre héroïque. Non ! Ce chef au regard farouche et doux, qui pressait sa framée sur son cœur et semblait méditer, sous le casque aux larges ailes, la poésie de Chateaubriand et la philosophie historique de monsieur Henri Martin, ce militaire baigné de mélancolie romantique n’était pas, comme disait la voix du peuple, le vrai portrait de M. Lacarelle. Le secrétaire du cabinet du préfet avait de gros yeux à fleur de tête, le nez court et rond du bout, les joues molles, le menton gras ; l’Eporédorix de Mathieu Michel jetait sur l’horizon le regard de ses prunelles enfoncées. Son nez était droit, le contour de son visage pur et classique. Mais il portait, comme M. Lacarelle, de terribles moustaches dont les longues branches courbes se découvraient de tous les points de l’horizon.
La foule, frappée de cette ressemblance, salua unanimement M. Lacarelle du nom glorieux d’Éporédorix. Et, dès lors, le chef du cabinet du préfet fut tenu de réaliser publiquement le type populaire du Gaulois et d’y conformer en toute circonstance ses actes et ses paroles. Lacarelle y réussit assez bien, parce qu’il y était préparé dès l’École de droit et qu’on lui demandait seulement d’être jovial, cocardier et grivois à l’occasion. On trouva qu’il avait bonne grâce à embrasser les femmes et il devint grand embrasseur. Femmes, filles et fillettes, belles et laides, jeunes et vieilles, il les embrassait toutes et toujours, par gauloiserie pure et sans penser à mal, car il avait de bonnes mœurs.
C’est pourquoi, trouvant d’aventure madame Bergeret seule dans son salon, où elle attendait madame Lacarelle, il l’embrassa tout de suite. Madame Bergeret n’ignorait pas les habitudes de M. Lacarelle. Mais sa vanité, qui était forte, troubla son jugement, qui était faible. Elle pensa être embrassée par amour et elle en éprouva des mouvements confus qui soulevèrent sa poitrine avec un grand tumulte et la firent fléchir sur les jarrets, en sorte qu’elle glissa haletante dans les bras de M. Lacarelle. M. Lacarelle en conçut de la surprise et de l’embarras. Mais il se sentit flatté dans son amour-propre. Il assit du mieux qu’il put madame Bergeret sur le divan et, penché sur elle, il lui dit d’une voix où perçait la sympathie :
— Pauvre dame !... Si charmante et si malheureuse !... Vous nous quittez donc !... Vous partez demain ?...
Et il lui mit sur le front un baiser innocent. Madame Bergeret, dont les nerfs étaient tout ébranlés, éclata soudain en larmes, en sanglots. Puis, lentement, gravement, douloureusement elle rendit à M. Lacarelle son baiser. À ce moment même, madame Lacarelle entra dans le salon.
Le lendemain, toute la ville jugeait sévèrement madame Bergeret, qui y était trop restée d’un jour.
II
Le duc de Brécé recevait, ce jour-là, à Brécé, le général Cartier de Chalmot, l’abbé Guitrel et M. Lerond, substitut démissionnaire. Ils avaient visité les écuries, le chenil, la faisanderie et parlé cependant de l’Affaire.
Au déclin tranquille du jour, ils commençaient à traîner le pas sur la grande allée du parc. Devant eux, le château dressait, dans un ciel gris pommelé, sa façade lourde, chargée de frontons et surmontée de toits à l’impériale.
— Je le répète, dit M. de Brécé, l’agitation soulevée autour de cette affaire n’est et ne peut être qu’une manœuvre exécrable des ennemis de la France.
— Et de la religion, ajouta doucement M. l'abbé Guitrel, et de la religion. On ne saurait être un bon Français sans être un bon chrétien. Et nous voyons que le scandale est soulevé principalement par des libres penseurs et des francs-maçons, par des protestants.
— Et des juifs, reprit M. de Brécé, des juifs et des Allemands. Et quelle audace inouïe de mettre en question l’arrêt d’un Conseil de guerre ! Car enfin il n’est pas admissible que sept officiers français se soient trompés.
— Non, assurément, ce n’est pas admissible, dit M. l’abbé Guitrel.
— En thèse générale, dit M. Lerond, une erreur judiciaire est la chose la plus invraisemblable. Je dirai même que c’est une chose impossible, tant la loi offre de garanties aux accusés. Je le dis pour la justice civile. Je le dis aussi pour la justice militaire. Devant les Conseils de guerre, l’accusé, s’il ne rencontre pas toutes les garanties dans les formes un peu sommaires de la procédure, les retrouve dans le caractère des juges. À mon sens, c’est déjà un outrage à l’armée que le doute émis sur la légalité d’un arrêt rendu en Conseil de guerre.
— Vous avez parfaitement raison, dit M. de Brécé. D’ailleurs, peut-on admettre que sept officiers français se soient trompés ? Peut-on l’admettre, général ?
— Difficilement, répondit le général Cartier de Chalmot. Je l’admettrais, pour ma part, très difficilement.
— Le syndicat de trahison ! s’écria M. de Brécé. C’est inouï !
La conversation alentie, tomba. Le duc et le général virent des faisans dans une clairière et, pris du désir instinctif et profond de tuer, regrettèrent au dedans d’euxmêmes de n’avoir pas de fusil.
— Vous possédez les plus belles chasses de toute la région, dit le général au duc de Brécé.
Le duc de Brécé songeait.
— C’est égal, dit-il, les juifs ne porteront pas bonheur à la France.
Le duc de Brécé, fils aîné du feu duc qui avait brillé parmi les chevau-légers à l’Assemblée de Versailles, était entré dans la vie publique après la mort du comte de Chambord. Il n’avait pas connu les jours d’espérance, les heures de lutte ardente, les entreprises monarchiques amusantes comme une conspiration, passionnées comme un acte de foi ; il n’avait pas vu le lit de tapisserie offert au prince par les dames des châteaux, les drapeaux, les bannières, les chevaux blancs qui devaient ramener le roi. Député héréditaire de Brécé, il entra au Palais-Bourbon avec des sentiments d’inimitié sourde à l’endroit du comte de Paris et un secret désir de ne point voir le trône restauré pour la branche cadette. À cela près, monarchiste loyal et fidèle. Il fut mêlé à des intrigues qu’il ne comprenait pas, s’embrouilla dans ses votes, fit la fête à Paris et, lors du renouvellement de la Chambre, fut battu à Brécé par le docteur Cotard.
Dès lors, il se consacra à l'agriculture, à la famille, à la religion. De ses domaines héréditaires, qui se composaient en 1789 de cent douze paroisses, comprenant cent soixantedix hommages, quatre terres titrées, dix-huit châtellenies, il lui restait huit cents hectares de terres et de bois, autour du château historique de Brécé. Ses chasses lui donnaient dans le département un lustre qu'il n'avait point reçu du Palais-Bourbon. Les bois de Brécé et de la Guerche, où François Ier avait chassé, étaient célèbres aussi dans l'histoire ecclésiastique de la région : c’est là que se trouvait la chapelle vénérée de Notre-Dame-des-Belles-Feuilles.
— Retenez bien ce que je vous dis, répéta le duc de Brécé : les juifs ne porteront pas bonheur à la France... Mais aussi pourquoi ne se débarrasse-t-on pas d'eux ? Ce serait si simple !
— Ce serait excellent, répondit le magistrat. Mais ce n'est pas aussi simple que vous croyez, monsieur le duc. Il faut, pour atteindre les juifs, faire d'abord de bonnes lois sur la naturalisation. Il est toujours difficile de faire une bonne loi, qui réponde aux intentions des législateurs. Des dispositions législatives qui, comme celles-ci, modifieront tout notre droit public, sont d'une rédaction singulièrement difficile. Et il n'est pas certain, malheureusement, qu'il se trouvera un gouvernement pour les proposer ou les soutenir, un Parlement pour les voter... Le Sénat est mauvais...
» À mesure que se développe à nos yeux l'expérience de l'histoire, nous découvrons que le XVIIIe siècle est une vaste erreur de l'esprit humain, et que la vérité sociale, comme la vérité religieuse, se trouve tout entière dans la tradition du moyen âge. La nécessité s'imposera bientôt en France, comme elle s’est déjà imposée en Russie, de renouveler à l’égard des juifs les procédés en usage dans le monde féodal, vrai type de société chrétienne.
— C’est évident, dit M. de Brécé ; la France chrétienne doit appartenir aux Français et aux chrétiens, et non pas aux juifs et aux protestants.
— Bravo ! dit le général.
— Il y a dans ma famille, poursuivit M. de Brécé, un cadet surnommé, je ne sais pourquoi, Nez-d’Argent, qui faisait la guerre dans la province sous Charles IX. Il fit pendre à l’arbre dont vous voyez là-bas la cime dénudée, six cent trente-six huguenots. Eh bien, je suis fier, je l’avoue, de descendre de Nez-d’Argent. J’ai hérité sa haine des hérétiques. Et je déteste les juifs, comme il détestait les protestants.
— Ce sont des sentiments bien louables, monsieur le duc, dit l’abbé Guitrel, bien louables et dignes du grand nom que vous portez. Permettez-moi seulement de vous présenter une observation sur un point particulier. Les juifs n’étaient pas considérés au moyen âge comme des hérétiques. Et ils ne sont pas à proprement parler des hérétiques. L’hérétique est celui qui, ayant été baptisé, connaît les dogmes de la foi, les altère ou les combat. Tels sont ou tels furent les ariens, les novatiens, les montanistes, les priscillianistes, les manichéens, les albigeois, les vaudois et les anabaptistes, les calvinistes, si bien accommodés par votre illustre aïeul Nez-d’Argent, et tant d’autres sectateurs ou défenseurs de quelque opinion contraire à la croyance de l'Église. Le nombre en est grand. Car la diversité est le propre de l’erreur. On ne s’arrête pas sur la pente funeste de l’hérésie ; le schisme produit le schisme à l’infini. On ne trouve en face de l’Église véritable que de la poussière d’églises. J’ai recueilli dans Bossuet, monsieur le duc, une admirable définition de l’hérétique. « Un hérétique, dit Bossuet, est celui qui a une opinion à lui, qui suit sa propre pensée et son sentiment particulier. » Or, le juif, n’ayant reçu ni le baptême ni la vérité, ne peut être dit hérétique.
» Aussi voit-on que l’Inquisition ne sévit jamais contre un juif en tant que juif, et que, si elle en abandonna quelqu’un au bras séculier, ce fut comme profanateur, blasphémateur ou corrupteur des fidèles. Le juif, monsieur le duc, serait plutôt un infidèle, puisque nous nommons ainsi ceux qui, n’étant point baptisés, ne croient point les vérités de la religion chrétienne. Encore ne devons-nous point rigoureusement considérer le juif comme un infidèle de la même sorte qu’un mahométan ou un idolâtre. Les juifs ont une place unique et singulière dans l’économie des vérités éternelles. Ils reçoivent de la théologie une désignation conforme à leur rôle dans la tradition. Au moyen âge on les nommait des témoins. Il faut admirer la force et l’exactitude de ce terme. Dieu les conserve en effet pour qu’ils servent de témoins et de garants des paroles et des actes sur lesquels notre religion est fondée. Il ne faut pas dire que Dieu rend exprès les juifs obstinés et aveugles, afin qu’ils servent de preuve au christianisme ; mais il profite de leur obstination libre et volontaire, pour nous confirmer dans notre croyance. Il les conserve dans ce dessein parmi les nations.
— Mais pendant ce temps, dit M. de Brécé, ils nous prennent notre argent et détruisent nos énergies nationales.
— Et ils insultent l’armée, dit le général Cartier de Chalmot, ou mieux ils la font insulter par des aboyeurs à leurs gages.
— C’est criminel, dit l’abbé Guitrel avec douceur. Le salut de la France est dans l’union du clergé et de l’armée.
— Alors, monsieur l’abbé, pourquoi défendez-vous les juifs ? demanda le duc de Brécé.
— Bien éloigné de les défendre, répondit M. l’abbé Guitrel, je condamne leur impardonnable erreur, qui est de ne pas croire à la divinité de Jésus-Christ. Sur ce point leur opiniâtreté demeure invincible. Ce qu’ils croient est croyable. Mais ils ne croient pas tout ce qu’il faut croire. Par là, ils se sont attiré la réprobation qui pèse sur eux. Cette réprobation est attachée à la nation et non point aux individus, et elle ne saurait atteindre les israélites convertis au christianisme.
— Pour moi, dit M. de Brécé, les juifs convertis me sont aussi odieux et plus odieux, peut-être, que les autres juifs. C’est la race que je hais.
— Permettez-moi de n’en rien croire, monsieur le duc, dit l’abbé Guitrel, car ce serait pécher contre la doctrine et contre la charité. Et vous pensez, comme moi, j’en suis sûr, qu’il convient de savoir gré, dans une certaine mesure, aux personnes israélites, non converties, de leurs bonnes intentions et de leur libéralité en faveur de nos œuvres pieuses. On ne peut nier, par exemple, que les familles R*** et F*** n’aient donné à cet égard un exemple qui devrait être suivi dans toutes les maisons chrétiennes. Je dirai même que madame Worms-Clavelin, bien qu’elle ne soit pas encore ouvertement convertie au catholicisme, a cédé, dans plusieurs circonstances, à des inspirations vraiment angéliques. Nous devons à l’épouse du préfet la tolérance dont jouissent, dans notre département, au milieu de la persécution générale, nos écoles congréganistes.
» Quant à madame la baronne de Bonmont, juive de naissance, elle est chrétienne de fait et d’esprit et elle imite, en quelque sorte, ces saintes veuves des siècles passés, qui donnaient aux églises et aux pauvres une partie de leurs richesses.
— Ces Bonmont, dit M. Lerond, s’appellent de leur vrai nom Gutenberg, et sont d’origine allemande. Le grand-père s’est enrichi en fabriquant de l’absinthe et du vermout, des poisons ; il a été condamné trois fois comme contrefacteur et comme falsificateur. Le père, industriel et financier, fit une scandaleuse fortune dans la spéculation et les accaparements. Depuis lors, sa veuve a donné un ciboire d'or à monseigneur Charlot. Ces gens-là me font songer aux deux procureurs qui, après avoir entendu un sermon du bon père Maillard, se disaient l'un à l'autre, tout bas, à la porte de l'église : « Compère, faut-il donc restituer ? »
» Il est remarquable, continua M. Lerond, qu'il n'y ait point de question sémitique en Angleterre.
— C'est parce que les Anglais n’ont point le cœur placé comme nous l'avons, dit M. de Brécé, ni le sang bouillant comme le nôtre.
— Assurément, dit M. Lerond. J’apprécie cette remarque, monsieur le duc, mais c’est peut-être aussi parce que les Anglais emploient leurs capitaux dans l'industrie, tandis que nos laborieuses populations réservent les leurs à l'épargne, c'est-à-dire à la spéculation, c'est-à-dire aux juifs. Tout le mal vient de ce que nous avons les institutions, les lois et les mœurs de la Révolution. Le salut est dans un prompt retour à l’ancien régime.
— C'est vrai ! dit le duc de Brécé, pensif.
Ils allaient ainsi conversant. Soudain, devant eux, par le chemin que le feu duc avait ouvert dans son parc aux habitants du bourg, un char à bancs passa, rapide, gai, tapageur, portant, au milieu de fermières en chapeaux à fleurs et de cultivateurs en blouse, un jovial gaillard à barbe rousse, fumant sa pipe, et qui fit mine, avec sa canne, d’ajuster des faisans, le docteur Cotard, député en exercice de l’arrondissement de Brécé, ancienne seigneurie de Brécé.
— C’est un spectacle au moins étrange, dit M. Lerond en secouant la poussière du char à bancs, de voir l’officier de santé Cotard représenter au Parlement cet arrondissement de Brécé que vos ancêtres, monsieur le duc, ont comblé, pendant huit cents ans, de gloire et de bienfaits. Je relisais hier encore, dans le livre de monsieur de Terremondre, la lettre que le duc de Brécé, votre trisaïeul, écrivait en 1787 à son intendant et dans laquelle il laisse voir la bonté de son cœur. Vous vous rappelez cette lettre, monsieur le duc ?
M. de Brécé répondit qu’il croyait se la rappeler, mais que les termes mêmes ne lui étaient pas présents.
Et aussitôt M. Lerond cita de mémoire les phrases essentielles de cette lettre touchante : « J’ai appris, écrivait le bon duc, que l’on désolait les habitants de Brécé en les empêchant de prendre des fraises dans les bois. On trouvera le secret de me faire haïr, et cela me procurera un des plus vifs chagrins que je puisse avoir en ce monde. »
— J’ai trouvé encore, poursuivit M. Lerond, d’intéressants détails sur la vie du bon duc de Brécé dans le précis de monsieur de Terremondre. Le duc passa ici même, sans être inquiété, les plus mauvais jours. Sa bienfaisance lui assura, pendant la Révolution, l’amour et le respect de ses anciens vassaux. En échange des titres qu’un décret de l’Assemblée nationale lui avait ôtés, il reçut celui de commandant de la garde nationale de Brécé. Monsieur de Terremondre nous apprend encore que, le 20 septembre 1792, la municipalité de Brécé se rendit dans la cour du château et y planta un arbre de la Liberté auquel cette inscription fut suspendue : « Hommage à la vertu. »
— Monsieur de Terremondre, répliqua le duc de Brécé, a puisé ces renseignements dans les archives de ma famille. Je les lui ai fait ouvrir. Malheureusement je n’ai jamais eu le loisir d’en prendre connaissance par moi-même. Le duc Louis de Brécé, dont vous parlez, surnommé le bon duc, mourut de chagrin en 1794. Il était doué d’un caractère bienveillant, auquel les révolutionnaires eux-mêmes se plurent à rendre hommage. On s’accorde à reconnaître qu’il s’honora par sa fidélité à son roi ; qu’il fut bon maître, bon père et bon mari. Il ne faut tenir aucun compte des prétendues révélations produites par un monsieur Mazure, archiviste départemental, d’après lesquelles le bon duc aurait entretenu des relations intimes avec ses plus jolies vassales et volontiers exercé le droit de jambage. Au reste, c’est là un droit fort hypothétique et dont, pour ma part, je n’ai jamais découvert la trace dans les archives de Brécé, qui ont déjà été dépouillées en partie.
— Ce droit, dit M. Lerond, s’il a jamais existé dans quelque province, se réduisait à une redevance de viande ou de vin que les serfs devaient fournir à leur seigneur avant de contracter mariage. Je crois me rappeler que, dans certaines localités, cette redevance se payait en espèces sonnantes et qu’elle était de trois sous.
— À cet égard, reprit M. de Brécé, je crois le bon duc entièrement lavé des accusations portées par ce monsieur Mazure, qu’on me dit être un mauvais esprit. Malheureusement...
M. de Brécé poussa un léger soupir et reprit d’une voix un peu plus basse et voilée :
— Malheureusement le bon duc lisait beaucoup de mauvais livres. On a trouvé dans la bibliothèque du château des éditions entières de Voltaire et de Rousseau, reliées en maroquin, à ses armes. Il subit, en quelque sorte, la détestable influence que les idées philosophiques exerçaient, à la fin du XVIIIe siècle, sur toutes les classes de la nation et même, il faut bien le dire, sur la haute société. Il avait la manie d’écrire. Il a rédigé des Mémoires dont je possède le manuscrit. Madame de Brécé et monsieur de Terremondre y ont jeté les yeux. On est surpris de trouver dans ces Mémoires quelques traits de l’esprit voltairien. Monsieur de Brécé s’y montre parfois favorable aux encyclopédistes. Il était en correspondance avec Diderot. Aussi n’ai-je pas cru devoir autoriser la publication de ces Mémoires, malgré les sollicitations de plusieurs érudits de la région et de monsieur de Terremondre lui-même.
» Le bon duc tournait assez joliment les vers. Il remplissait des cahiers entiers de madrigaux, d’épigrammes et de contes. C’est bien pardonnable. Ce qui l’est moins, c’est qu’il se laissait aller, dans ses poésies fugitives, jusqu’à railler les cérémonies du culte et même les miracles opérés par l’intervention de Notre-Dame-des-Belles-Feuilles. Je vous prie, messieurs, de n’en rien dire. Cela doit rester entre nous. Je serais désolé de livrer ces anecdotes en pâture à la malignité publique et à la curiosité malsaine d’un monsieur Mazure. Ce duc de Brécé est mon trisaïeul. Je pousse très loin l’esprit de famille. Je pense que vous ne m’en blâmez pas.
— Il y a, monsieur le duc, dit l’abbé Guitrel, un enseignement précieux et de grandes consolations à tirer des faits que vous venez de produire. Nous en pouvons conclure que la France, tombée au XVIIIe siècle dans l’irréligion et gagnée à l’impiété jusque dans ses sommets, à ce point que des hommes honorables par ailleurs, comme monsieur votre trisaïeul, sacrifiaient à la fausse philosophie, que la France, dis-je, punie de ses crimes par une affreuse révolution dont les effets se font sentir encore, revient à résipiscence et voit renaître la piété dans toutes les classes de la nation et particulièrement dans les classes les plus hautes. Un exemple tel que le vôtre, monsieur le duc, ne saurait être perdu ; si le XVIIIe siècle, considéré dans son ensemble, peut paraître le siècle du crime, le XIXe vu de haut, pourra être nommé, si je ne m’abuse, le siècle de l’amende honorable.
— Puissiez-vous dire vrai ! soupira M. Lerond. Mais je n’ose l’espérer. Mis en contact, par ma profession d’avocat, avec la masse de la population, je la trouve le plus souvent indifférente ou même hostile en matière religieuse. Mon expérience du monde, permettez-moi de vous le dire, monsieur l’abbé, me dispose à épouser la tristesse profonde de monsieur l’abbé Lantaigne, bien loin de me faire partager votre optimisme. Et, sans sortir d’ici, ne voyezvous pas que la terre chrétienne de Brécé est devenue le fief du docteur Cotard, athée et franc-maçon ?