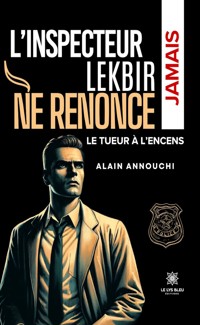
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Au cœur des années 80, l’inspecteur Lekbir, d’origine marocaine, se bat dans les couloirs sombres de la « criminelle ». Entre les barrières dressées par la société et les collègues hostiles, il navigue avec ténacité. Sa mission ? Traquer un tueur de femmes solitaires, une affaire qui s’étend jusqu’au Maroc, prenant une dimension internationale. Armé seulement de son esprit et des outils de son époque, il devra déployer toute son ingéniosité pour résoudre cette énigme complexe.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ancien officier de police,
Alain Annouchi possède une connaissance approfondie des arcanes de la justice. Dans cette œuvre de fiction qu’il a voulue ancrée dans la réalité, il explore minutieusement les méthodes et les outils utilisés dans les années 1980 et 1990. Tout comme son protagoniste, Alain est issu de l’immigration maghrébine, ce qui enrichit son témoignage à travers ses investigations.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alain Annouchi
L’inspecteur Lekbir
ne renonce jamais
Le tueur à l’encens
Roman
© Lys Bleu Éditions – Alain Annouchi
ISBN : 979-10-422-3558-1
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Synopsis
L’auteur est un ancien Commandant de Police, qui a commencé sa carrière en 1983 en tant qu’administratif (commis), affecté au secrétariat de l’Office Central de Répression du Trafic illicite de Stupéfiants. Il devenait, en 1990, inspecteur de police, suite à un concours. Lors de la réforme de 1995, les inspecteurs sont devenus lieutenants, c’est ainsi qu’il a évolué, passant Capitaine, puis finalement Commandant. Toutes ces années ont forgé son expérience et sa connaissance du travail policier et judiciaire. À la retraite depuis 2020, il s’est mis à écrire, avec une vision réaliste et experte de la délinquance et de son traitement par la justice.
Il a choisi d’écrire ce roman se situant dans les années 80, qu’il connaît bien ; vous n’y verrez donc pas les avancées technologiques qui existent en 2024, les smartphones, l’utilisation de l’ADN pour confondre les criminels, le maillage de vidéo surveillance étendu et internet, les réseaux sociaux…
Les policiers enquêteurs n’avaient que leur flair et leur intelligence déductive, des traces, des indices ou des témoignages pour identifier l’auteur d’une infraction, et aussi les empreintes digitales (reines des preuves) quand elles étaient laissées sur la scène de crime.
Le héros, Alexandre Lekbir, est un inspecteur de police, lui-même d’origine marocaine, ce qui était rarissime en 1980, arrivé en France en 1959 à l’âge de 3 ans avec ses parents ; il s’était parfaitement intégré, voire assimilé dans son pays d’accueil, qu’il aime profondément, faisant siennes les valeurs républicaines. Mais il doit également lutter contre les préjugés véhiculés à l’époque à cause de ses origines arabes, et de sa réussite jugée suspecte par ses détracteurs, et même par sa hiérarchie qui se méfie de lui, notamment le Commissaire Fernandez qui est fils de pied noir, et qui a connu très jeune l’exode avec ses parents.
Ces obstacles, ces réticences loin de le ralentir dans sa progression, le galvanisent et lui donnent de l’énergie pour avancer contre vents et marées ; en outre, il est adepte des arts martiaux qu’il pratique régulièrement, et qui renforcent son mental déjà aguerri. Fan de moto, il est propriétaire d’une Honda 750 four, considérée comme la mère des motos modernes. Il vit tranquille dans le pavillon de ses parents, son père qui travaille comme cariste passe ses temps libres à réparer la maison, et sa mère est femme au foyer. La vie est douce dans le cocon familial, c’est dans ce contexte qu’il va néanmoins rencontrer l’amour, auprès d’une jeune femme qui était témoin dans le dossier en cours, entre eux cela devient sérieux, l’auteur décrit des scènes d’amour précises sans verser dans la vulgarité. Il s’agit avant tout d’un roman policier.
Le tueur, auteur de plusieurs assassinats de femmes vivant la plupart du temps seules, ne laissait pas d’empreintes digitales, et il n’y avait pas encore de fichier ADN, le téléphone portable était un fantasme, une vue de l’esprit. Pour téléphoner il y avait les cabines publiques et le téléphone fixe, le Bi-Bop premier téléphone portable était sorti seulement en 1991, Le Minitel grand public était apparu le 4 juin 1982, il fallait attendre 1994 pour qu’il soit supplanté par internet qui n’était pas encore à la portée de tout un chacun.
L’inspecteur Lekbir ne lâche rien et, avec ses collègues, il arrive avec sa perspicacité, malgré sa hiérarchie qui cherche à le freiner, à identifier l’auteur présumé de plusieurs assassinats, en France et peut-être à l’étranger.
La sagacité des enquêteurs, les recoupements concernant parfois des détails qui semblent insignifiants, la chance qui est au rendez-vous de manière inattendue, tous ces éléments permettent d’établir un profil du suspect, qui finit par être identifié. Il s’agit d’un homme, lui-même en souffrance, en manque d’amour et d’affection, qui a choisi de se venger des femmes de manière radicale. Les investigations seront poursuivies au Maroc par l’Inspecteur Lekbir avec la Police locale, ce qui lui permettra d’affiner davantage le portrait du suspect, pour comprendre la genèse de ses actes meurtriers.
En même temps il essaie d’analyser l’avancée sociale de son pays d’origine, notamment concernant les rapports hommes/femmes, et l’organisation patriarcale dominante en 1980, cela a bien changé en 2024 avec les avancées du féminisme.
L’ouvrage se passe ainsi, décrivant l’enquête, la vie du héros partagé entre son travail, sa famille et son amour pour Chantal.
Ce livre est entièrement « BIO », il n’y a aucun artifice généré par l’Intelligence artificielle. Garanti sans glyphosate, cet ouvrage a été écrit avec le cœur et avec le discernement humain de son auteur.
Bien que les faits soient imaginaires, l’auteur du livre a vécu réellement plusieurs scènes décrites dans l’ouvrage, au lecteur de deviner lesquelles.
Bonne lecture !
Prologue
1981, Mitterrand a été élu président de la République, mai 1981, pour 7 ans, c’est l’état de grâce, mais pas au 36 quai des Orfèvres. En effet, l’équipe du Commissaire Raymond Fernandez est sur les dents, le tueur à l’encens court toujours. De fait, 3 femmes ont été découvertes mortes dans leurs domiciles respectifs, faits étalés sur 2 années, depuis 1979. Le mode d’opéré, toujours le même, l’intrusion brutale d’un ou plusieurs individus dans le logis de la victime, poussée brutalement vers l’intérieur alors qu’elle venait à peine d’ouvrir sa porte avec sa clé. La femme était vite bâillonnée et entravée, ne lui laissant guère le loisir de crier « au secours ». Ensuite des sévices étaient perpétrés à son encontre, avec une sauvagerie inédite. La dernière femme en date, Bérénice Gaston, 50 ans, avait été trouvée le vendredi 6 mars 1981, vers 18 h, par son frère cadet Michel dans sa chambre de bonne, isolée au dernier étage de l’immeuble cossu de la Rue d’Artois dans le 8e arrondissement parisien. Le corps entièrement nu était en début de décomposition, allongé sur son lit, et sur le dos les poignées attachées par devant, les chevilles étaient entravées séparément d’une part et d’autre du matelas, par une solide cordelette en nylon. Entre les lividités cadavériques, on pouvait distinguer des hématomes notamment dans la région des côtes, et sur le visage tuméfié. Elle avait été violée tout comme les victimes précédentes. Un bas avait été trouvé serré autour de son cou, cet effet vestimentaire lui appartenait probablement, d’autant plus que le même était découvert dans sa commode. Elle avait probablement été tuée par étranglement, l’autopsie avait été demandée naturellement par le magistrat du Parquet, qui demandait naturellement une ouverture d’Information pour saisir le Juge d’Instruction Dewaer déjà en charge des 2 premiers assassinats.
Un fait curieux avait attiré l’attention des enquêteurs sur place, la présence d’une pomme de terre, dans laquelle étaient fichés 3 bâtons d’encens consommés, dont l’agrégat était devenu une cendre éparpillée, souillant la table basse. De l’encens avait été également utilisé à chaque fois, et sa présence constatée, lors des découvertes de cadavres précédentes, l’odeur persistante des huiles essentielles et de résine avait subsisté avec une intensité variable en fonction de la datation de la mort, plus le meurtre était récent, plus les arômes dégagés par la tige parfumée étaient entêtants, plus la date du décès brutal était éloignée, plus les odeurs de putréfaction couvraient celles de l’encens. À chaque fois ledit artifice épicé de pin ou de patchouli, était utilisé, et pour une bonne tenue, il était fiché sur des objets trouvés sur place (orange, pomme, éponge…) pour y être entièrement consumé.
Le premier cadavre de femme avait été découvert dans le 17e arrondissement, le jeudi 4 janvier 1979 dans un immeuble de l’Avenue de Saint-Ouen, également dans une chambre de bonne du 6e étage, la femme Myriam Lanski, 36 ans, célibataire vivait seule, elle était arrivée de sa province natale, d’Avignon plus précisément pour tenter sa chance dans la capitale, très discrète, cela faisait un an qu’elle vivait là de manière modeste, elle était vendeuse dans une parfumerie sur l’Avenue des Champs Élysées.
Sur place et pour la première fois, il était constaté la présence de deux bâtons d’encens fichés dans une pomme pourrissante avec un développement de moisissures, se mêlant à la cendre parfumée. C’était une collègue de Myriam qui avait donné l’alerte, s’inquiétant de l’absence au travail de cette dernière. Elle avait été ligotée et dénudée, avant d’être frappée au visage et sur le corps, elle avait des zébrures sur la poitrine, comme si elle avait été fouettée, dans sa bouche fichée dans la gorge, il y avait une petite culotte, lui appartenant, elle avait succombé par étouffement.
L’autopsie et les constations médico-légales avaient conclu à un viol suivi d’homicide.
De nombreux prélèvements biologiques avaient été effectués sur place, sous les ongles de la défunte, du sperme sur ses cuisses et sur le vagin, des cheveux blonds lui appartenant probablement, et un poil pubien noir dans un repli du drap. Pas d’empreintes digitales, l’individu portait probablement des gants. Tous ces éléments avaient été placés sous scellés pour les besoins de l’enquête longue et difficile.
C’est lors de la découverte du deuxième cadavre Laurence Kaufman 45 ans, le mercredi 9 mai 1979 Bd Barbes Paris 18 qu’un rapprochement avec le premier crime était effectué par les policiers, en effet le mode d’opéré était le même et surtout, quatre bâtons d’encens complètement consumés étaient fichés dans une orange, posée sur la table de chevet, près du corps inerte allongé demi-nu sur le dos, avec une nuisette relevée en haut du bassin. On avait alors pensé qu’il s’agissait d’un rituel religieux, une odeur de bois aromatique régnait sur la pièce, se mêlant à celle du début de décomposition du cadavre, la mort devait être récente, en attestait la rigidité cadavérique (rigor-mortis) des muscles qui était à son intensité maximale (entre 8 et 12 heures après la mort), quant aux lividités de couleur rougeâtre, comme à chaque fois, elles étaient concentrées vers le dos, en fait le sang ne circulant plus il se déverse et se concentre vers le bas du corps, en l’occurrence pour ces femmes dans le dos, sur les fesses et l’arrière des jambes, en vertu de la loi sur la gravitation.
À partir du 3e cadavre de femme, victime du même modus operandi, on avait bien à faire à un redoutable tueur en série, surnommé « le tueur à l’encens » par la presse avide de sensations et de scoops.
2
Présentation des personnages
Le Commissaire principal Raymond Fernandez était un Français rapatrié d’Algérie, un pied noir exilé vers la France après l’indépendance inéluctable de ce morceau de la France en 1962, avec les accords d’Évian. Il était né à Mostaganem en 1942, ses parents étaient propriétaires de terrains agricoles, plusieurs hectares en Oranie, dans la commune d’AIN-TEMOUCHENT, le principal bassin viticole de l’Algérie coloniale. Dans les années 50, cette région avait connu une densité de population européenne très dense, et l’emploi d’une main-d’œuvre venant d’Espagne et du Maroc notamment.
D’une famille aisée, Raymond, vivait dans une douce quiétude et parlait couramment l’arabe dialectale avec les autochtones ou les membres du personnel de son père : femmes de ménage, fellahs et autre jardinier. Il avait eu une prime enfance heureuse.
L’Algérie était une colonie française depuis 1830, divisée en départements en 1848, un conflit armé entre 1954 et 1962 a abouti à la victoire politique du FLN (Front de libération Nationale) et à l’indépendance. Maurice le père de Raymond, faisait partie de l’OAS (Organisation de l’Armée Secrète) pour tenter de maintenir Française l’Algérie, Maurice comme beaucoup de pieds noirs avaient mené une lutte désespérée, pour garder les biens familiaux, et pour se maintenir dans ce pays qu’il chérissait tant. Malheureusement un million d’entre eux, la quasi-totalité avait dû partir « une main devant une main derrière »,car ils avaient été spoliés de leur patrimoine acquis sur plusieurs générations. Le jeune Raymond 20 ans avait débarqué à Marseille en 1962 avec ses parents, et avait subi l’accueil mitigé des Français de la métropole (mépris, racisme), il avait souffert après avoir connu seulement 10 ans de début de vie agréable à AIN-TEMOUCHENT. Ses premières années à Marseille avaient été très difficiles, ses parents, sa sœur Mireille et lui-même, avaient été hébergés en urgence chez le frère de Maurice, dans des conditions précaires. Maurice avait fini par trouver un poste à responsabilité dans une société viticole marseillaise. La famille Fernandez avait tout recommencé à zéro, Raymond titulaire d’un baccalauréat avait épousé la carrière de policier en devenant Inspecteur en 1964, à l’âge de 22 ans, il faut dire que beaucoup de pieds noirs avaient rejoint le rang de diverses administrations, la police, la poste, les hôpitaux… L’état français n’était pas regardant et le niveau des concours était, il faut le dire, abordable. Plus tard, il passait le concours de Commissaire et était nommé à Paris 20e arrondissement, en 1967, un quartier très animé, notamment avec Ménilmontant et Belleville. Il devait gérer un Commissariat et contrôler la délinquance (vols, rixes, prostitution…). Il avait exercé dans ce premier poste durant 8 ans, son emploi du temps se partageant entre les nombreuses tournées avec les huissiers, lui permettant d’arrondir confortablement ses revenus officiels et entre l’étude des affaires traitées par ses gardiens et inspecteurs. Dans le 20e il avait des rapports très étroits avec le Maire d’arrondissement, à l’instar de ses collègues chefs de service. Le travail de prévention et de répression de la délinquance restant dévolu à ses troupes sur la voie publique et dans les bureaux d’enquête. Sur le 20e c’était son adjoint un vieil Inspecteur divisionnaire qui dirigeait réellement le Commissariat avec toute la confiance de son patron Fernandez. Ce dernier voulant changer d’orientation, en 1975, à sa demande, il était muté à la brigade criminelle sise 36 quai des Orfèvres Paris 1er, en tant qu’adjoint du chef de service, un Commissaire divisionnaire. L’équipe du tôlier Fernandez était composée d’une centaine de fonctionnaires, des inspecteurs et des gardiens de la paix, des enquêteurs plus ou moins chevronnés, parmi eux l’inspecteur Alexandre Lekbir arrivé à la « crim » en 1979, un Français d’origine marocaine de Casablanca, quartier Hay-Mohammedi plus exactement, endroit très populaire (chaâbi) ; d’origine pauvre il avait réussi à infléchir sa destinée par sa détermination sans faille, et par sa volonté d’assimilation à la population française, et en faisant siennes les valeurs républicaines.
3
Lekbir
Un inspecteur originaire du Maroc
Ce garçon, né en 1956 durant la fin du protectorat français sur le Maroc, et le retour du Roi Mohammed V qui était en exil, avait quitté sa patrie dans le cadre d’un regroupement familial en 1959 ; en 1973 il prenait la nationalité de son pays d’accueil, la France. Se prénommant Abdenbi (esclave du prophète), il devenait Alexandre, car il aimait la mythologie et trouvait ce prénom empli de noblesse.
Avec un baccalauréat en poche (1974), il passait avec succès le concours d’Inspecteur de Police, pour être nommé en 1976 (l’été de la grande canicule.) Après une scolarité à l’ESIPN (École supérieure des inspecteurs de police) de Cannes Écluses 77.
Alexandre, fan de moto, possédait une magnifique Honda CB 750 Four, 4 cylindres en ligne, avec 4 pots d’échappement chromés de toute beauté laissant échapper un rugissement doux et caractéristique, summum de la technologie, elle était dotée d’un frein à disque à l’avant, et d’un tambour à l’arrière et surtout d’un démarreur électrique par bouton sur la poignée des gaz ; il venait travailler avec son engin japonais ultramoderne. Il ne passait pas inaperçu, chacune de ses arrivées était commentée, athlétique et de petite taille il menait son destrier avec maestria. Dans le garage familial, Alexandre aimait bichonner sa moto, il faisait lui-même toutes les interventions mécaniques et les révisions.
Il habitait encore chez ses parents à Argenteuil 95, dans le quartier calme des coteaux (rue Robespierre), dans un pavillon, que son père s’efforçait de rénover depuis de nombreuses années. Auparavant il avait vécu dans la cité du Coudray, allée Sisley, où il était très tôt confronté à la violence de jeunes qu’il côtoyait, sans les fréquenter, néanmoins il était respecté, car il savait leur parler, tout en gardant une distance de sécurité. Dès l’âge de 12 ans, il fréquentait un dojo situé dans l’école Pierre Brossolette (résistant français) à Argenteuil, il y pratiquait le karaté « Shotokan » Serge Sirizoki, son professeur, était ceinture noire 4e Dan, Alexandre durant plusieurs années progressait dans cet art martial, jusqu’à obtenir la ceinture noire, il était également bon judoka, sport qu’il pratiquait de longue date, c’est fort physiquement et mentalement qu’il affrontait la vie quotidienne. Intellectuellement il n’était non plus pas démuni, en 1974 il obtenait le baccalauréat général avec mention, il entrait à la faculté de Assas, pour renforcer sa culture en droit, idée prolifique et heureuse, puisqu’il réussissait le concours d’Inspecteur de Police en 1975 à l’âge de 19 ans. Après un an de scolarité à l’ESIPN, il choisissait un poste au Commissariat de Police judiciaire du 8e arrondissement de la capitale.
Pas vraiment beau et timide avec les femmes ; il n’en était pas moins dénué de charme, et parfois il faisait des rencontres, notamment dans le cadre de son travail, il était amené à recevoir des usagers et surtout des usagères, en demande d’écoute et de conseils. De temps à autre une alchimie se produisait et des relations extra-professionnelles étaient ainsi nouées, avec des femmes en manque d’amour et de considération. Pour Alexandre elles n’étaient que des intermèdes heureux et souvent éphémères, tant il était focalisé sur sa carrière et sur la volonté de convaincre ses détracteurs qu’il était compétent et utile à la société. Il avait 20 ans, pensant qu’il avait le temps pour fonder un foyer, riche de sa jeunesse, il se sentait invincible.
Son premier poste lui avait permis de se distinguer par ses qualités de procédurier et d’enquêteur sur le terrain, c’était auCommissariat de Police judiciaire du 8e arrondissement de Paris, ouvert au public de 9 h à 19 h rue du Fg St honoré, qui dépendait de la 1re DPJ (Direction de la Police Judiciaire) DPJ recouvrant les arrondissements 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16, et 17e au centre et à l’ouest de Paris. Le Commissariat central sis 1 Avenue du Général Eisenhower Paris 8e, sous le musée du grand palais, dépendait de la DSPP (Direction de la Sécurité Publique de Paris), évidemment ces 2 entités, DPJ et DSPP travaillaient main dans la main.
Son recrutement à ce poste « Inspecteur de Police » (appellation qui était prestigieuse et alimentait les fantasmes romanesques) était très controversé, dans la mesure où il était rarissime de voir un Maghrébin y accéder, il était une sorte de précurseur de la société qui avance. Lorsqu’il recevait les usagers, il ne laissait pas indifférent et suscitait souvent l’étonnement, l’agacement parfois, ou l’admiration également. Il était souvent interrogé sur ses origines ethniques, et sur son prénom, à cause de ce dernier on le prenait parfois pour un Juif séfarade, alors qu’il était musulman. Plus d’une fois, il avait entendu certains de ses collègues peu délicats parler des interpellés d’origine maghrébine ou africaine en leur donnant des sobriquets : « bicots melons, négros… », une fois l’un d’entre eux Philibert A, voulant sans doute plaire à certains de ses camarades, en voyant un service interpellateur lui présenter 2 mis en cause, avait déclamé avec ironie :
PHILIBERT A : Vous nous ramenez encore des bicots ! Sous le regard gêné d’autres fonctionnaires, car ces propos malheureusement banalisés avaient été faits en la présence d’Alexandre, qui avait fait mine de ne pas entendre, car la moindre réaction de sa part aurait été mal interprétée. En tant que policier français il se devait non pas d’accepter, mais seulement de tolérer leur code, qui n’appartenait en fait qu’à une minorité d’entre eux, car en grande majorité les policiers faisaient leur travail avec objectivité.





























