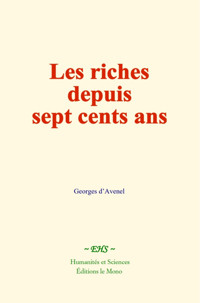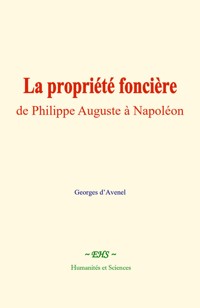Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Il y a quelque cent ans, on était « humain », et volontiers « sensible » ; et, en vérité, l’égoïsme n’y perdait rien, mais on s’honorait de pleurer sur les maux de ses semblables, comme d’une preuve de « philosophie ». De nos jours, cuirassé d’individualisme, chacun a conscience de l’isolement où se meuvent, quoi qu’elles pensent, disent ou fassent, les pauvres créatures que nous sommes. Et cependant, ni le sentiment de cette solitude des âmes, pareilles à peu près les unes aux autres quoique indéfiniment différentes, si douloureusement ressentie par les meilleurs d’entre nous ; ni le pessimisme de notre philosophie ; ni la violence des divisions politiques ou sociales n’empêchent le 19è siècle, auquel on voudrait persuader qu’il est plus égoïste que ses aînés, d’avoir vu naître et grandir une forme du dévouement filial, plus complète qu’aucune de celles que l’on avait jusqu’à lui pratiquées.
Il faut en effet plus d’abnégation pour constituer à vos héritiers, par le paiement d’une prime annuelle, une fortune dont, créateur sacrifié, vous ne verrez jamais un centime, puisqu’elle ne naîtra que par votre mort, qu’il ne fallait de désintéressement pour accumuler dans ses propres mains une épargne dont on avait la satisfaction de jouir, avant de la transmettre à ses successeurs. Cette thésaurisation altruiste revêt le caractère collectif que le temps actuel imprime à ses principales créations...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les assurances sur la vie.
Les assurances sur la vie
Étude historique
Georges d’Avenel
Bailleux de Marisy
EHS
Humanités et Sciences
Les assurances sur la vie{1}
Il y a quelque cent ans, on était « humain », et volontiers « sensible » ; et, en vérité, l’égoïsme n’y perdait rien, mais on s’honorait de pleurer sur les maux de ses semblables, comme d’une preuve de « philosophie ». De nos jours, cuirassé d’individualisme, chacun a conscience de l’isolement où se meuvent, quoi qu’elles pensent, disent ou fassent, les pauvres créatures que nous sommes. Et cependant, ni le sentiment de cette solitude des âmes, pareilles à peu près les unes aux autres quoique indéfiniment différentes, si douloureusement ressentie par les meilleurs d’entre nous ; ni le pessimisme de notre philosophie ; ni la violence des divisions politiques ou sociales n’empêchent notre XIXè siècle, auquel on voudrait persuader qu’il est plus égoïste que ses aînés, d’avoir vu naître et grandir une forme du dévoûment filial, plus complète qu’aucune de celles que l’on avait jusqu’à lui pratiquées.
Il faut en effet plus d’abnégation pour constituer à vos héritiers, par le paiement d’une prime annuelle, une fortune dont, créateur sacrifié, vous ne verrez jamais un centime, — puisqu’elle ne naîtra que par votre mort, — qu’il ne fallait de désintéressement pour accumuler dans ses propres mains une épargne dont on avait la satisfaction de jouir tout le premier, avant de la transmettre à ses successeurs. Cette thésaurisation altruiste revêt le caractère collectif que le temps actuel imprime à ses principales créations. Il se dit aujourd’hui bien des choses folles, mais il se fait bien des choses sages, sans que l’on puisse d’ailleurs apprécier exactement le rapport des premières avec les secondes. A côté du collectivisme obligatoire, qui demeure utopie, s’établit lentement une sorte de collectivisme volontaire. Atome par atome, le monde moderne accomplit sa transformation, insoucieux de ceux qui le voudraient pousser en avant comme de ceux qui s’efforcent de le retenir en arrière.
Qui se serait avisé par exemple, à l’origine des assurances sur la vie, que cette institution pût servir d’instrument au nivellement social ? Depuis la baisse récente du taux de l’intérêt, qui rend difficile l’épargne personnelle, les compagnies se trouvent sollicitées de changer des capitaux en revenus, dans leur rayon de « rentes viagères », presque autant que de transmuer des économies en capitaux. Elles détruisent des fortunes d’une main et en construisent de l’autre, vaporisent des lingots ou cristallisent des parcelles de métal. Le capital parfois se dissout en même temps qu’il se forme, lorsqu’il s’agit de « rentes viagères différées », lorsqu’un individu s’assure, par des versements annuels, un revenu dont il aura la jouissance à partir d’un âge déterminé. Ainsi l’assurance, multipliant l’instabilité naturelle de la propriété, facilite à la fois la constitution de richesses qui n’existent pas encore et la dispersion de richesses qui demain n’existeront plus.
I.
Quelles que soient les combinaisons multiples qu’elle ait inventées, elle n’exploite encore qu’un petit coin de son vaste domaine, en France du moins, et nous le verrons tout à l’heure. Le principe a certes reçu bon nombre d’applications : les assurances contre l’incendie, contre les risques des transports maritimes ou terrestres, contre les accidents, contre la grêle et la mortalité du bétail, sont là pour en témoigner. Il est susceptible d’en recevoir encore beaucoup d’autres, qui toutes ne sont pas également recommandables. Car s’il existe des assurances contre la casse de divers objets, ou contre le vol et le cambriolage, à côté des industriels qui garantissent les honnêtes gens contre les voleurs, il s’en trouve qui garantissent les voleurs contre les hasards de leurs opérations. Les contrebandiers ont eu des assureurs, les braconniers en ont encore.
L’assurance contre le brigandage, sous forme de prime versée aux brigands, fut d’un usage constant au moyen âge. Elle se généralisa même sur notre territoire au milieu de la guerre de Cent ans. Lorsque la Bretagne fut réunie à la couronne, au XVIè siècle, il s’y percevait, sous le nom de « droit de bris », une assurance payée au duc par les caboteurs pour s’affranchir du pillage légal qui attendait leur navire s’il venait à être jeté sur les côtes par la tempête. Pour atténuer partiellement les désastres du feu, on édictait, en quelques provinces, une mutualité singulière : quand un Alsacien de l’époque féodale était victime d’un incendie, tous les habitants de son village devaient l’aider à relever sa maison. L’un d’eux s’y refusait-il, l’incendié avait le droit de s’installer chez lui et de l’expulser de sa propre demeure. On était plus avancé sous le rapport des assurances maritimes, bien qu’elles demeurassent très coûteuses, et qu’un banquier du XVIIè siècle dise que « ce sont le plus souvent des procès et non des effets certains. »
Quant à cet ensemble de contrats aujourd’hui connus, faute d’une appellation meilleure, sous le nom d’ « assurances sur la vie », bien qu’ils n’aient pas la prétention de prolonger l’existence, plusieurs d’entre eux furent dès longtemps en usage d’homme à homme. Tel négociant du XIVè siècle assurait pour six mois la vie d’un chevalier. En cas de décès de l’assuré pendant ce délai, ses héritiers devaient recevoir de l’assureur une somme fixée à l’avance. Dès 1550 fonctionnaient en Flandre, et surtout en Italie, les assurances dotales, dont les « monts-de-piété » se chargeaient : « Celui qui a une fille, dit un contemporain de Charles IX, dépose 100 écus le jour de sa naissance, à la charge d’en recevoir 1000 pour la marier quand elle aura 18 ans. Si elle meurt auparavant, les 100 écus sont acquis au mont-de-piété. » Quelque élevé que fût alors le taux de l’intérêt — environ 8 pour 100 — par le jeu duquel il était possible aux banques de quintupler en dix-huit ans la somme originairement reçue, le succès de l’opération reposait avant tout sur l’excessive mortalité infantile d’autrefois ; de sorte qu’il y avait là plutôt un germe de tontine, ou de loterie funèbre, que d’assurance véritable.
Or la tontine, introduite en France sous Mazarin et baptisée ainsi du nom de l’importateur napolitain Lorenzo Tonti, était tout justement le contraire de notre mécanisme contemporain, fondé sur l’affection et sur l’algèbre. Dans la tontine, les morts payaient pour les vivants : dans l’assurance en cas de décès les vivants paient pour les morts. La première a pour but de tirer un bénéfice des malheurs d’autrui, la seconde a pour objet de les atténuer. Par la tontine un certain nombre de gens formaient entre eux une masse commune, que les survivants convenaient de se partager au-delà d’une date fixée. Pour que l’affaire soit fructueuse, il faut que la mort multiplie les victimes. Ainsi, tandis que l’assuré marche vers un résultat sûr, le tontinier ne sait où il va.
Depuis la tontine royale de 1653, destinée à fournir des fonds au Trésor, une dizaine d’autres furent successivement créées jusqu’en 1759. En 1788 était érigée la première compagnie française d’assurances sur la vie ; mais, pendant que celle-ci disparaissait après quelques années d’existence, une tontine de triste mémoire, la fameuse « Caisse Lafarge », était fondée par un banquier de ce nom. Prônée par Mirabeau, qui fit entendre en sa faveur une éloquente improvisation, elle fut sur le point d’être adoptée par l’Assemblée nationale comme institution d’utilité publique. Plus de 60 millions furent engagés dans cette spéculation grandiose, calculée sur des prévisions de mortalité tellement considérables que, à les supposer exactes, elles devaient amener la fin du monde en quelques siècles. Pour que l’établissement pût tenir ses promesses, il fallait qu’à l’expiration d’une période de douze ans il n’y eût plus que 10 survivants sur 100 ; ce qui, à moins d’une formidable épidémie, était impossible. Avant que cette démonstration réfrigérante n’eût été faite, le succès momentané de Lafarge avait fait éclore d’autres sociétés analogues : la Caisse des Artisans, la Société numéraire, la Tontine du Pacte social. Malgré la surveillance administrative, à laquelle les tontines furent soumises à partir de 1809, les abus incroyables qui s’y donnaient libre essor, et plus encore leur, principe défectueux, les conduisirent presque toutes à des liquidations désastreuses. Elles eurent au XIXè siècle, en matière d’assurances, le même résultat qu’avait eu au XVIIIè, en matière de banques, le Système de Law : celui de compromettre une création bienfaisante et d’en dégoûter pour longtemps le public.
A côté des tontines qui poursuivaient leur carrière aventureuse, et dont la dernière achève présentement de mourir dans l’obscurité, s’étaient cependant créées de véritables compagnies d’assurances, sur le modèle de celles qui fonctionnaient avec succès en Angleterre depuis 1765 : la Générale, première en date, débuta en 1819 ; l’Union vit le jour l’année suivante.
L’un des objets de leur industrie, les rentes viagères, était vieux comme le monde. Les couvons, les hospices, se chargeaient d’en créer sous l’ancien régime. Pour le faire avec méthode, il fallait apprécier les chances de mortalité à tous les âges, calculer l’équation entre un capital déterminé et une annuité temporaire. L’idée était la même que pour l’assurance en cas de décès, mais retournée. De longs siècles néanmoins se passèrent avant que l’on ne conçût la contrepartie du système, que l’on imaginât le contrat d’économie familiale qui sacrifie le présent à l’avenir. Le plus étrange, c’est que ce dernier fut longtemps prohibé par le législateur, qui, l’assimilant à une gageure, défendait en 1681 de faire aucune assurance de ce genre. « La vie de l’homme n’est pas susceptible de commerce, » disaient un siècle plus tard les commentateurs de cette ordonnance ; « il est odieux que sa mort devienne la matière d’une spéculation mercantile. » Celui qui écrivait cette phrase en 1783 ne prenait pas garde que la rente viagère était bien, pour le constituant, une « spéculation » sur la mort du rentier. Certains jurisconsultes ont les préjugés tenaces : un magistrat de nos contemporains, le procureur général Dupin, n’a jamais voulu démordre de cette idée.
Ce ne fut pas du reste contre le mauvais vouloir des légistes que les sociétés naissantes eurent à lutter, mais contre l’indifférence du public. La Générale, qui depuis son origine jusqu’à ce jour, a garanti plus de 2 milliards de capitaux, n’en assurait encore en 1825, cinq ans après sa fondation, que pour 317000 francs. Quinze ans plus tard, en 1840, au lieu d’une augmentation, c’était un déclin. Les assurances « vie entière » se réduisaient au capital dérisoire de 231000 francs. « Il semblait permis de désespérer, a dit M. de Courcy, et de proclamer le tempérament français décidément rebelle à celle importation britannique. »
Un progrès fort lent commence à se dessiner à cette époque, grâce à un perfectionnement apporté à l’institution : la participation des assurés aux bénéfices. Les souscriptions atteignirent 7 millions en 1860 ; en 1865, quoique les concurrents se fussent multipliés, elles dépassaient 30 millions ; elles arrivèrent à 60 millions en 1869. Économistes, mathématiciens, romanciers, journalistes, s’occupèrent des assurances ; une revue mensuelle était fondée, puis une librairie spéciale, dont le catalogue grossissait chaque mois. Les capitaux souscrits par l’ensemble des compagnies depuis leur fondation jusqu’à 1859 étaient de 354 millions ; le total des contrats était de 400000 ; en 1880, les contrats étaient au nombre de 400000, et les capitaux se chiffraient à 4 milliards. A la fin de l’année dernière ils s’élevaient à 10 milliards et demi ; les assurances en cours, à cette date, dans les dix-huit sociétés françaises, montaient à 3 milliards 550 millions, les rentes viagères à plus de 53 millions.
S’il a fallu, comme on voit, presque trois quarts de siècle pour que les générations nouvelles comprissent la portée de cette arithmétique de la mortalité, elle est aujourd’hui solidement assise sur ses bases scientifiques, dont le propre est d’affranchir l’assuré des risques qu’il redoute, pour les transférer à l’assureur, qui les recueille, les pèse, les classe dans ses cartons, où ils deviennent sans danger par leur nombre même, leur division, leur équilibre. Ces bureaux, où griffonnent paisiblement des employés sédentaires, sont un laboratoire de confection et de vente d’un vaccin contre le hasard. Cette expression, angoissée d’espérance ou de crainte, qui si souvent revient sur nos lèvres : « Si le hasard veut…», est-il donc possible qu’elle disparaisse ? Le dieu Hasard, l’ancienne Fortuna, capricieux et rebelle par définition à tout calcul, cessera-t-il d’en faire à sa volonté ? Les hommes du XXe siècle parviendront-ils à le mettre en cage, à le domestiquer comme ces autres forces de la nature, indomptées naguère, que les hommes du XIXe siècle ont su réduire en esclavage ? Toujours est-il que l’assurance sur la vie a su quelque peu l’apprivoiser, surprendre quelques-uns de ses secrets, et, l’opposant à lui-même, de cinquante mille hasards contraires tirer un millier de certitudes.
C’est là toute l’économie des combinaisons presque innombrables qui garantissent à celui-ci un héritage pour les siens, à celui-là une fortune pour lui-même, ou une dot pour ses enfants, ou un gage pour ses créanciers ; les sommes ou les revenus devant être payés, suivant le gré de chacun, aux uns en cas de vie, aux autres en cas de mort, à moins qu’ils ne préfèrent stipuler une échéance fixe, qu’ils soient morts ou vivants. Toutes les suppositions sont possibles, tous les types d’arrangements sont acceptables, tellement la machine à assurer se prête, docile et comme flexible, à tous les mouvements que l’on exige d’elle. Les deux branches auxquelles se rattachent les divers contrats, — assurances en cas de vie ou en cas de décès, — ont ceci de commun que le dernier soupir des intéressés amène toujours la liquidation de leur engagement et met fin au paiement de leurs cotisations ; ce qu’on exprime par cette formule : « En assurance sur la vie, la mort libère. »
L’assurance en cas de décès, dite de « vie entière », la plus connue, la plus féconde, a pour objet la constitution immédiate du patrimoine de la famille. Elle s’adresse à la classe immense des maris et des pères qui vivent plus ou moins largement, au jour le jour, du produit de leur travail : toute la force intellectuelle de la nation, tous ceux qui sont en train de grandir. La disparition du chef serait pour la femme et les enfants le signal de la décadence, le bail résilié, le mobilier vendu, les serviteurs congédiés, les éducations interrompues, la ruine greffée sur le deuil. L’individu qui, placé dans cette situation périlleuse, n’assure pas aux siens, par des primes annuelles, un capital payable à sa mort est aujourd’hui une exception coupable.
L’épargne ne remplit pas le même rôle : en versant au commencement de chaque année un millier de francs d’assurance, l’homme de 30 ans garantit dès le premier jour à ses héritiers plus de 40000 francs. Il lui faudrait 24 ans pour amasser une somme équivalente, en économisant 1000 francs par an, qu’il placerait à intérêts composés au taux de 4 pour 100. Qui donc ose se flatter d’avoir devant lui 24 ans de vie ? Durant cette période de 24 années, sur 100 jeunes hommes, âgés aujourd’hui de 30 ans, il en mourra 27. Qui peut avoir la certitude d’être parmi les survivants ? Un calcul analogue est faisable à tous les âges, avec cette nuance qu’à 45 ans par exemple une prime de 1000 francs n’assure plus tout à fait 26000 francs, et que, pour épargner ce capital dans les mêmes conditions que ci-dessus, 18 années devraient suffire. Mais à 45 ans on est depuis longtemps engagé sur le mauvais versant de la vie, celui de la descente, de plus en plus rapide et fertile en chutes. A deux sur trois seulement, — 67 pour 100, — parmi ces hommes de 45 ans, il sera donné de passer encore 18 ans sur la terre.
Dans le contrat « vie entière », au lieu de payer annuellement la même somme jusqu’à sa mort, l’assuré peut stipuler des primes variables, croissantes ou décroissantes d’année en année, suivant qu’il prévoit l’augmentation ou la diminution de ses ressources. Il lui est loisible, en ce dernier cas, de borner ses versements à un laps de temps plus ou moins court, — 10, le et 20 ans, — ou convenir que le paiement cessera soit lorsqu’il atteindra lui-même un certain âge, soit lorsqu’une incapacité de travail le réduirait à la gêne. Ce sont là des assurances « à primes temporaires, » qui ne profiteront pourtant qu’aux successeurs de l’assuré. S’il s’agit d’établir ses enfants, il se procurera par le contrat « à terme fixe » des capitaux à une date connue d’avance. Par l’« assurance mixte » il s’en fera garantir le paiement, soit dans le délai convenu, soit à sa mort s’il meurt avant l’expiration du délai. Au lieu d’assurer à d’autres des capitaux, il peut leur assurer des rentes, viagères ou passagères. Au lieu de s’assurer soi-même pour toute la durée de sa vie, on a aussi le droit de n’assurer qu’une tranche de son existence : cinq ou dix ans. Ainsi fera le débiteur au profit d’un créancier, qu’il ne saurait rembourser autrement si la mort survenait avant une certaine époque ; combinaison d’autant moins chère que la période prévue, et par conséquent la responsabilité de la compagnie, sera plus courte.