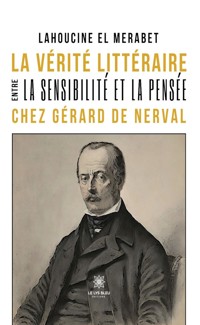
La vérité littéraire entre la sensibilité et la pensée chez Gérard de Nerval E-Book
Lahoucine El Merabet
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Gérard de Nerval harmonise avec finesse la sensibilité et la pensée au travers de ses ouvrages, notamment "Les Filles du feu" et "Les Chimères". En adoptant une approche poétique,
Lahoucine El Merabet ouvre de nouvelles perspectives sur la compréhension globale de ces textes et explore un cheminement esthétique qui vise à élever le pouvoir du langage et sa dimension littéraire. Son étude accorde une attention particulière aux modèles philosophiques et aux figures d’autorité, soulignant ainsi l’importance de la littérature comme espace où l’auteur façonne une réflexion intégrant l’univers intime et subjectif.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Docteur et agrégé de lettres modernes,
Lahoucine El Merabet est auteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels "L’écriture du temps dans Sylvie de Gérard de Nerval" publié en 2016 aux éditions Édilivre et "La sensibilité pensante à l’œuvre dans Le livre du sang de Khatibi" paru en 2018 aux éditions L’Harmattan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lahoucine El Merabet
La vérité littéraire
entre la sensibilité et la pensée
chez Gérard de Nerval
Essai
© Lys Bleu Éditions – Lahoucine El Merabet
ISBN : 979-10-422-3172-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À mes chers parents,
À ma petite famille,
À mes frères, à mes cousins et à mes oncles,
À tous mes amis, dont le souci principal est d’égayer la vie
par leur jeu intellectuel et leur plaisanterie sérieuse,
À tous mes professeurs qui, tout au long de mon parcours scolaire, ont illuminé de leur savoir les ténèbres de l’ignorance,
À tous mes étudiants, à tous mes collègues et à ceux
qui me côtoient et m’aiment sincèrement et loyalement.
La littérature est à vrai dire le sacerdoce d’un temps qui ne croit plus aux prêtres, qui n’accepte le divin que sous bénéfice de doute et de liberté critique (…). La hauteur nouvelle de ses prétentions et l’imitation des caractères traditionnels du sacerdoce ont pu l’incliner parfois à proclamer sa mission avec une emphase excessive. Cet accent, qu’on entend si souvent dans le romantisme, sonne creux. Le siècle, qui sait où sont les vrais prêtres, et qui ne s’en remet plus beaucoup à eux pour son salut, n’est pas prêt accorder aux nouveaux venus un genre d’autorité qu’il dénie à leurs prédécesseurs. À la limite, il se demande s’il est vrai qu’un écrivain ou un poète soit qualifié pour guider les hommes ; une telle prétention, dès qu’elle prend une forme trop péremptoire ou précise, peut paraître absurde à l’homme moyen. Le poète et l’écrivain n’ont été promus que parce qu’il n’y avait justement plus place pour une autorité proprement dite dans l’ordre spirituel.
Paul Bénichou, Le Sacre de l’écrivain,
José Corti, 1985, pp. 473-474
Résumé
La réflexion porte généralement sur le mode d’articulation de la sensibilité et la pensée, par le biais d’une analyse qui s’attachera à des pertinences susceptibles de clarifier les postures intellectuelles de Gérard de Nerval dans Les Filles du feu et dans Les Chimères (1854). Il s’agira précisémentde suivre l’itinéraire sensible de l’auteur qui sortira de son insularité pour s’ouvrir sur une réalité transcendante dans la société et dans une pensée orientée vers l’anthropos et le cosmos. Le travail d’élucidation nous permettra de nous appesantir sur une pensée qui s’évertue à s’ériger en valeurs appelées à supplanter un ordre en passe de s’éclipser. L’instance poétique et littéraire dessinera ainsi des sentiers sensibles, matériels, concrets au bout desquels il y a lieu de trouver un nouvel ordre, une cosmogonie autre, avec des signes démarcatifs dignes d’une vision globale des choses. L’auteur s’attribuera des postures jugées aptes à le faire aboutir à une altitude qui rendra loisible la mission de représenter, conformément à une pensée fulgurante, incandescente et frénétique, une tutelle d’obédience isiaque, orphique, mystique et ésotérique, permettant d’accorder à la littérature une force de création, de recréation, de transcendance et de sublimation. L’intérêt ne sera d’ailleurs accordé à des modèles littéraires et à des autorités prépondérantes que pour induire la conviction selon laquelle la littérature doit être un creuset où l’auteur peut s’arroger le droit d’orchestrer les éléments d’une pensée qui ne peut faire l’impasse sur l’univers intime et subjectif dont la prégnance reste déterminante.
Abstract
Generally, reflection concerns the articulation mode of sensitivity and thought, by means of an analysis which will be linked to relevance likely to clarify the intellectual postures of Gérard de Nerval in the Girls of the fire and the Chimeras (1854). It will be precisely a question of following the sensitive itinerary of the author who will leave his insularity to open himself to a transcendent reality in society and in a thought directed towards the anthropos and the cosmos. The work of elucidation will allow us to dwell on a thought that strives to set itself up in values called to supplant an order in the process of disappearing. In this way, the poetic and literary instance will draw sensitive, material, concrete paths at the end of which it is necessary to find a new order, a different cosmogony, with demarcating signs worthy of a global vision of things. The author will assign himself postures judged able to make it reach an altitude that will make the mission possible to represent, according to a lightning, incandescent and frenetic thought, a tutelage of isiacal, orphic, mystical and esoteric obedience, allowing to give literature a force of creation, recreation, transcendence and sublimation. Interest will, besides, be given to literary models and preponderant authorities only to induce the conviction that literature must be a crucible where the author can arrogate to himself the right to orchestrate the elements of a thought, which can not ignore the intimate and subjective world whose importance remains decisive.
Introduction générale
La littérature, dès qu’elle est mise en question dans ses virtualités et ses faits, ne peut tarder à manifester cette dualité qui lui confère une double dimension : elle tend à interroger la réalité et à la dévoiler, comme elle se laisse aisément interroger à partir de l’usage qu’elle fait du répertoire verbal commun. Dans ce sens, le langage est avant tout défini par ses usages et ses abus. Il s’agit de formuler sa pensée, l’exprimer, instruire, agir sur autrui ; mais aussi parler sans savoir ce que l’on dit à cause de l’inconstance des mots, abuser des métaphores, se tromper sur ses propres volontés et nuire à autrui. Le bien-dire serait la seule garantie dont nous disposions pour parvenir au vrai : La vérité consiste en l’exacte mise en ordre des noms dans nos affirmations.1 Il faut, selon Hobbes, procéder à la manière des géomètres et partir de définitions claires, afin de ne pas s’empêtrer dans la glue des mots vagues et des expressions insensées telles que les sophistes en ont abusé. Redonner un vrai sens aux mots de la tribu, revêt donc une portée éminemment politique, sociale et avant tout littéraire : c’est faire correspondre un univers verbal à un univers mental. C’est assurer par le langage une transition d’une intériorité vers une extériorité sociale, ce qui n’est pas sans incidences sur le message transmis et la pensée disposée à l’intention d’un récepteur.
Le substantif « parole » vient d’ailleurs du latin ecclésiastique parabola, « parabole, discours inspiré », dont il constitue le doublet populaire : par définition, la parole donne une représentation métaphorique du réel, elle en fournit une image symbolique et, selon certains, ressemblante, du moins à l’origine. Elle appartient au domaine de la figure et non de l’être. Elle transpose le réel et la pensée sans garantir la coïncidence entre le langage et les choses ou entre le discours et la pensée. La fonction poétique du langage, en effet, leste le mot de connotations, d’évocations associées qui en enrichissent d’autant plus le sens que l’orateur use de la parole de manière suggestive et subjective. La littérature ne vise pas l’univocité du sens, dont la fixation lui paraît relever de l’illusion : usant de fictions, elle en éclaire le mystère. En effet, les dispositifs littéraires travaillent le matériau linguistique de manière à lui faire dire ce qu’on ne veut pas entendre ou reconnaître. On pourrait a priori croire que la philosophie se différencie de la littérature en ce qu’elle vise l’établissement de la vérité.
Dans le cadre de cette démarcation de la parole à partir de la vérité qu’elle pourrait véhiculer, Georges Gusdorf s’est bien appuyé, dans son essai La Parole, sur la référence au langage du mystique, afin de traduire la primauté du silence sur la parole. Le besoin de parler, estime-t-il dans le droit sillage de Plotin, est la sanction d’une déchéance qui a privé la créature de sa perfection originaire. Selon ce dernier philosophe néoplatonicien : là-haut, tout corps est pur, chacun est comme un œil ; rien de caché ni de simulé ; en voyant quelqu’un, on connaît sa pensée avant qu’il ait parlé.2 Rien qu’à partir de cette introduction théorique de la parole en tant que pendant à un silence essentiel, l’on peut dire que le langage humain est le reflet imparfait d’un langage primordial, ou que la parole humaine peine à réaliser ce langage originel à travers lequel s’exprime la vérité des choses. L’exemple du Colloque sentimental, dernier poème des Fêtes Galantes3de Verlaine qui fait penser aux Correspondances de Baudelaire, montre bien queles paroles des amants ne sont pas accessibles au commun des mortels : Et l’on entend à peine leur parole, La nuit seule entendit leur parole.
On en comprend aisément que la pratique de la parole chez l’homme est dans le meilleur des cas une incidence imparfaite par rapport au « Verbe premier ». C’est le discours tel qu’il est analysé et soupçonné par Roland Barthes dans La leçon : Le pouvoir est là, tapi dans tout discours, fût-ce à partir d’un lieu hors pouvoir.4Nous oublions que toute langue est un classement, et que tout classement est oppressif : ordo veut dire à la fois répartition et commination.5 Il faut en retenir le pouvoir d’assujettissement et d’inféodation qu’implique toute prise de parole. Dans le même contexte et dans la même œuvre, Barthes renchérit : parler, et à plus forte raison discourir, ce n’est pas communiquer comme on le répète souvent, c’est assujettir.6
Dans ce sens, il faut noter ce qui a démarqué le XIXe siècle, à savoir cette stratification de la société en esthètes et en bourgeois. Entendons que l’artiste cherche par tous les moyens à ne pas s’assujettir à l’autorité et aux goûts bourgeois. Les choix littéraires seront donc effectués dans ce sens et vont se cristalliser autour de ce qui amènera à tenir lieu d’une pratique distinctive et sublime. Bref, tout est conçu de manière à fuir le langage, ensuite la langue et son extension littéraire et à s’en déprendre en tant que parole grégaire, inféodante et asservissante. Il s’agit d’une parole où le sujet va surgir en tant que tel pour échapper à une parole sociale.
Martin Heidegger va établir une distinction entre la parole parlante et la parole parlée. Dans son essai Pourquoi des poètes ?7 il a centré l’intérêt en grande partie sur le commentaire d’un poème de Hölderlin, Pain et Vin auquel il emprunte un vers Pourquoi des poètes en temps de détresse ? Le philosophe lit les poèmes de Hölderlin (1770-1843) et de Rilke (1875-1926) comme des exercices de méditation poétique. À cet égard, pour penser l’être, la poésie est d’une grande aide, car, selon le philosophe allemand, l’objet de la poésie est précisément cet événement de l’être qui a lieu uniquement dans et par la parole :
L’être mesure, en tant que lui-même, son enceinte par cela qu’il se déploie dans la parole. La parole est l’enceinte (templum), c’est-à-dire la demeure de l’être. […] Parce que le langage est la demeure de l’être, nous n’accédons à l’étant qu’en passant par cette demeure.8
C’est bien dans cette perspective qui n’est pas loin de notre sujet qu’il importe d’évoquer cette distinction entre « langage », « langue » et « parole » qui vient prinipa1ement du linguiste Ferdinand de Saussure, et force est de rappeler que la parole est encore plus spécifique que le langage et la langue : elle est toujours définie par la personne qui l’énonce, et par leur contexte d’énonciation commun. Dès lors qu’un mot est lié intégralement et inéluctablement à la personne qui l’exprime ou qui l’accueille, même en son for intérieur, il se transforme en parole, c’est-à-dire en une affirmation qui n’a pas simplement pour tâche de communiquer un message, mais qui est aussi douée d’une puissance symbolique et subjective.
Une langue est donc faite de mots, car comme le dit Saussure : La langue n’est pas une fonction du sujet parlant, elle est le produit que l’individu enregistre passivement […]. La parole est au contraire un acte individuel de volonté et d’intelligence.9
En outre, la pensée peut nous sembler a priori antérieure à la parole. Après tout, n’avons-nous pas souvent l’impression de penser des choses que nous n’arrivons pas, dans un second temps, à exprimer ? Il faut pourtant se méfier de cette évidence apparente d’antériorité de la pensée. On a ainsi longtemps associé la parole et l’intelligence, une association présente dans les deux sens du terme logos, à la fois langage et raison, au point de considérer ceux qui ne pouvaient s’exprimer par les mots comme mentalement défaillants.
Dans ce sens, toute la question consiste à déterminer si c’est la parole ou la pensée qui précède dès qu’il s’agit de parler, mais aussi pour livrer des messages et des idées. Si la problématique est ancienne, elle trouve chez le psychanalyste Jacques Lacan une nouvelle formulation.10 Si notre inconscient même est structuré comme un langage, il est alors impossible de penser sans que cette pensée prenne une forme langagière, sans qu’elle soit déjà imprégnée par les qualités de la parole avant même d’être exprimée. Y a-t-il donc des choses à l’extérieur du langage ? Y a-t-il des choses dans le monde ou chez les autres qui ne dépendent pas de la parole ? Est-il possible de percevoir une chose sans avoir à l’esprit la parole qui la nomme ?
Le théoricien Jean Paulhan va encore plus loin quand il insiste non seulement sur l’antériorité de la parole à la pensée, mais sur l’inexistence de la pensée : Comme je ne crois pas à la pensée, mais au seul langage – créant la pensée en l’exprimant – en ceci plus radical que, à la fois, Freud et Boileau, j’ai de la peine à m’aventurer dans tes labyrinthes.11 Cette réflexion soulève une question essentielle du point de vue philosophique. Y a-t-il une extériorité absolue du langage, un lieu où la parole s’avère impuissante, où les choses du monde existent sans pour autant pouvoir être nommées ? Des philosophes tels que Platon et Plotin expriment souvent le désir ou la nostalgie du monde intelligible, où l’on serait en contact immédiat avec les idées sans passer par les formes du langage. Pour eux, la parole est donc un médiateur imparfait entre le sujet et la réalité.
Bien que la transmission d’un message entre différents interlocuteurs représente l’un des aspects cruciaux de l’usage social de la parole, ses aspects symboliques, qui vont bien au-delà de l’échange d’information, ne doivent pas être négligés.
En effet, nombreux sont les usages de la parole débordant la simple fonction communicative. Et ce sont autant d’usages qui soulignent que la parole est bien plus qu’un simple instrument de communication : elle est aussi une affirmation symbolique, personnelle, qui représente un engagement du sujet individuel. Comme l’affirme le critique et écrivain Roland Barthes, la parole n’est pas uniquement : Un instrument de communication, elle n’est pas une voie ouverte où passerait seulement une intention de langage. C’est tout un désordre qui s’écoule à travers la parole, et lui donne ce mouvement dévoré qui le maintient en éternel sursis. 12 Autrement dit, quand nous lisons ou entendons la parole, les associations sont si nombreuses, voire infinies, que la perception visuelle, orale ou sensible de la parole, qui est forcément limitée, prend d’emblée une signification sans limites.
Si la parole est donc en éternel sursis, sans doute est-ce la raison pour laquelle elle semble si souvent prise entre des pôles contraires : entre la nature et la culture, entre le personnel et le partagé, entre le sacré et le profane, entre le soi et l’autre, entre la vérité et le mensonge. Et pour cause : la parole nous relie à l’entendement et à l’intellection du monde.
Par les sens et le corps, nous ne faisons que nous égarer et nous perdre dans l’erreur et l’approximation et, partant, dans l’immoralité. Il arrive fréquemment que les mots nous manquent pour décrire le plaisir, la douleur, l’angoisse, ce qui nous arrive par les sens, car ce qui nous émeut reste dans la confusion : nous évoquons alors un « je-ne-sais-quoi », une forme d’indicible que nous associons au caractère inouï et volatil du sensible.
Pour ceux qui privilégient la raison, la seule boussole valable et vertueuse pour l’homme demeure l’esprit qui se développe par le langage. Pour les Grecs, raison et langage sont une et même chose, ressaisie sous la notion de logique, d’ordre raisonné et rationnel. Les mots disposent le monde de manière ordonnée, le rendant soudain déchiffrable et intelligible, nous sortant alors de l’obscurité et du relatif de la sensibilité. Chez l’enfant, on peut clairement observer une corrélation entre l’apprentissage de la parole et la compréhension du monde qui l’entoure : savoir formuler et nommer lui permet de mettre les choses en place, à leur place, et de les comprendre dans toute leur complexité logique. Le mot peut alors créer la pensée. Par exemple, lorsqu’il sait utiliser correctement le mot « demain », l’enfant a compris que le temps passe d’un avant à un après et qu’un mot peut exprimer une idée (un référent) et non pas seulement un état ou une chose présente (un signifié).
Refuser la parole, c’est rejeter le monde tel qu’il est, donc la réalité instituée par la société humaine. Le philosophe contemporain Clément Rosset l’exprime on ne peut mieux lorsqu’il écrit : Le choix des mots est affaire sérieuse, il signale toujours une certaine forme d’adoption – ou de refus des choses, d’intelligence ou de mésintelligence de la réalité.13 Quand on est en dehors de la parole, c’est comme si on restait en dehors du monde. Mais puisqu’il y a en l’homme une dialectique entre raison et sensibilité, entre parole et musique, on ne saurait en rester à une vision purement rationaliste du monde : certains s’opposent à ce primat donné à la parole pour approcher le réel, pour autant qu’il récuse l’importance de notre partie sensible. Ces tenants de la sensibilité diraient que le langage parlé n’est pas le seul moyen d’appréhender ce qui nous entoure, en tout cas, qu’il nous en offre une compréhension faussée, artificielle, élaborée par les hommes et par la société, donc conventionnelle et infidèle à ce que nous sommes et ressentons, à notre nature. Le choix des signes qui constituent la parole est pour eux arbitraire, donc il nous désolidarise d’un authentique rapport à la chose et au sentiment que l’on cherche à traduire. Ainsi, l’enfant qui refuse certains mots, qui se méfie de la parole voit-il juste en refusant une convention qui n’a rien de naturel et de vrai.
L’on peut dire ainsi que la parole en tant que moyen de communication participe de la réalité, c’est-à-dire qu’elle a aussi un pouvoir de création et pas seulement de représentation. Exister en tant que conscience parlante, c’est collaborer à la création du monde et non pas l’acquérir tout créé et constitué. On entre alors, par cette philosophie, dans une conception plus poétique, au sens étymologique d’ailleurs que rationnelle du langage. Plus que jamais la parole est alors comprise comme un lien à autrui et au monde : la parole est ce tissu de sens jamais clos, fermé ou définitif, dans lequel nous sommes tous pris. Nous laisserons Merleau-Ponty l’écrire mieux que nous :
Parler n’est pas seulement une initiative mienne, écouter n’est pas subir l’initiative de l’autre, et cela, en dernière analyse, parce que nous sommes sujets parlants, nous continuons, nous reprenons un même effort, plus vieux que nous, sur lequel nous sommes entés l’un et l’autre, et qui est la manifestation, le devenir de la vérité.14
En parlant, c’est comme si nous participions à l’immense dialogue interhumain qui ne cessera jamais entre les hommes et qui bâtit le monde, à nous situer, à donner du sens à notre existence. C’est peut-être de notre devoir d’homme de comprendre ce geste ambigu qui nous situe dans le monde et d’en faire le meilleur usage. D’autre part, si pour Georges Gusdorf parler c’est venir au monde, il importe de se demander ce qu’il en est de l’acte d’écriture comme second usage de la parole, selon d’autres modalités communicatives.
Dans ce sillage, le vécu expérientiel d’une pensée devenue sensible entre en résonance avec la dimension corporelle et fonde les principes du raisonnement consécutif à cette perception. À ce propos, la notion de sensibilité, sous la plume de Rousseau, est à noter dans ce contexte : c’esttout ce qui, en nous, relève de la réceptivité et qui est, à juste titre, appelé « sensible ». Ainsi en va-t-il du pur sentir, des émois de l’amour, de toute émotion, comme de la passion et, corrélativement, du sentiment que certaines passions engendrent. Tout ce qui prend sa source dans l’homme sensible serait selon Rousseau, vérace, alors que les masques, convenances et rôles sociaux s’acharnent à faire taire les mouvements immédiats de l’âme et du cœur. Cette opposition traverse toute l’œuvre de Rousseau, ainsi que l’a montré Starobinski en s’efforçant de la déchiffrer tout entière, sous le signe de la transparence et l’obstacle15. On comprend comment Rousseau a pu supposer que les hommes ont dû commencer par le chant à communiquer leurs émois, parce que le souffle porte aussitôt les émotions ; Homère fut, selon lui, sûrement un rhapsode et non un écrivain.
L’écriture de Rousseau, quant à elle, moins cérébrale, résolument consacrée à maintenir la voix d’une inspiration, se fait brasier éloquent dans tous ses essais, et musicalité fluide dans tous les moments de pure prose poétique, comme si le Rousseau musicien était toujours présent.
Accorder la priorité à la sensibilité ne signifie aucunement rejeter la rationalité16 : il faut répéter que, selon Rousseau, si la raison ne naît et ne se développe qu’avec le développement des passions, ces dernières, inversement, s’enrichissent et se nourrissent du développement de l’intelligence et de la raison. Mais, de même que Rousseau dénonce la sensiblerie mondaine, comme une fausse sensibilité, de même ne cesse-t-il d’attaquer une raison desséchée et raisonneuse telle qu’elle lui paraît régner chez la plupart de ses contemporains. Comment dès lors faire de l’auteur du Contrat social un précurseur du romantisme, s’il est vrai que tout un pan de celui-ci sera remarquablement hostile aux idéaux de la Révolution française et effectuera, un siècle après Rousseau, un grand retour à la religion chrétienne pour chanter l’intuition mystique et les mystères transcendants. Ce serait dire que c’est par le biais d’une sensibilité individuelle et intimement personnelle que l’auteur arrive finalement à délivrer des leçons articulées autour des idées qui dépasse le cadre exigu du moi et de sa sphère d’action réduite à bien des égards.
Qui plus est, l’intelligence que Rousseau appelle par ailleurs raison n’est pas une faculté immuable, achevée qui aurait été donnée une bonne fois pour toutes à l’homme. Elle est au contraire quelque chose qui se développe progressivement grâce aux facteurs internes et externes (milieu physique, social, culturel). Elle se révèle comme une puissance d’exploration de l’espace avec comme organes les sens. C’est par les sens en effet que le sujet s’ouvre au monde, l’explore, le connaît. Ensuite elle se manifeste comme puissance de compréhension et d’inventivité. Nous apprenons alors que la raison intellectuelle, forme supérieure de l’intelligence, ne peut advenir que si elle s’arc-boute sur la raison sensible qui lui sert alors de socle. C’est pour cela que Rousseau insiste pour que son disciple soit éduqué à la campagne afin qu’il puisse développer au maximum cette raison sensitive, condition de possibilité de la « raison intellectuelle ». Comme il le dit lui-même : […] pour apprendre à penser, il faut donc exercer nos membres, nos sens, nos organes qui sont les instruments de notre intelligence.17
Ce qui est ici remarquable, c’est bien la façon dont Rousseau valorise le sensible. Précisons tout de même que, dans la perspective de notre analyse, cette sensibilité est à rattacher à l’art qui en révèle la matérialité. Ce dernier, qui consiste moins à imiter le réel qu’à en souligner la radicale étrangeté, le caractère externe, s’accomplit à rebours de la perception : alors que la perception est toujours perception de quelque chose, est renvoi à l’objet, rattachement de la qualité sensible à une substance.
Le mouvement de l’art consiste à quitter la perception pour réhabiliter la sensation, à détacher la qualité de ce renvoi à l’objet. Au lieu de parvenir jusqu’à l’objet, l’intention s’égare dans la sensation elle-même, et c’est cet égarement dans la sensation, dans l’aisthesis, qui produit l’effet esthétique. Elle n’est pas la voie qui conduit à l’objet, mais l’obstacle qui en éloigne ; elle n’est pas non plus de l’ordre subjectif. La sensation n’est pas le matériel de la perception. Dans l’art elle ressort en tant qu’élément nouveau. Mieux encore, elle retourne à l’impersonnalité d’élément.18
C’est bien entendu entre ces deux pôles constitutifs du mouvement du langage dans son investissement social, quotidien et littéraire que se perdent des significations qu’il importe de se mettre à déceler. L’œuvre littéraire, tous genres confondus, met en œuvre la langue, sous son aspect collectif et normatif, mais aussi bien à partir d’une exploitation individuelle qui fait de la parole le truchement à même d’induire une pensée qui passe par un cheminement sensible.
Dans le cadre de notre travail, il sied de noter initialement que l’usage littéraire des fonctions du langage peut bien permettre de transmettre une certaine vérité qui fera l’objet de la quête de toute lecture utilitaire.
Dans cet ordre d’idées, face à une œuvre littéraire, le lecteur pose une série de questions à travers lesquelles il cherche à s’éclairer sur le fonctionnement du texte d’une part et sur la finalité d’une lecture d’autre part. Il va donc sans dire qu’il est conditionné par un tissu de rapports établis entre les différentes catégories d’un texte et, de ce fait, cherchera à mener une lecture utilitaire.
En effet, lors d’une lecture, on cherche un sens, en se soumettant à l’autorité d’une voix qui rend sensible et manifeste le sens qu’on essaie de saisir et que le texte livre à travers ses différentes composantes. Ceci semble d’autant plus évident que la fiction propose des modèles de pensée et d’action et établit des correspondances entre l’univers imaginaire et fictif mis en scène par l’œuvre et la réalité avec ses différents avatars et ses différentes facettes.
Cela nous amène à signaler au passage le grand débat soulevé autour du rapport à établir entre la fiction et la pensée et montrer dans quelle mesure le roman par ses catégories propres et intrinsèques, véhicule une signification explicite et illustre une pensée. Notre propos n’ira pas dans le sens de l’existence d’un contenu ou d’un message, mais plutôt l’existence fine, subtile et structurelle d’une pensée constructive du récit.
Soulever cette question n’est pas sans faire allusion au roman à thèse qui a été important dans des contextes historiques particuliers et pendant des conjonctures spéciales. Cette forme d’écriture romanesque, considérée comme une « autorité fictive »,19 constitue un genre doctrinaire, monologique et didactique et favorise la transmission d’une certaine pensée. Il s’agit bien d’un genre où s’institue une autorité qui compte délivrer un message à travers un texte littéraire qui est nettement structuré selon des stratégies d’écriture spécifiques.
Cependant, on a tendance à se méfier de ce genre d’écrits mus par la nécessité de véhiculer des idées et à lui substituer la conception de Mallarmé du langage, qui consiste à assujettir le langage à aucune cause autre que son fonctionnement. C’est ainsi que s’est amorcée cette opposition entre un genre littéraire, aussi didactique que le roman à thèse, mais aussi toute écriture fondée sur l’esthétique de la représentation et de la vraisemblance d’une part et une écriture dite moderne qui se tourne vers elle-même et se ressource dans son propre fonds, d’autre part. Cette opposition entraîne la dévalorisation d’un genre d’écrits littéraire exploité à des fins didactiques. L’exemple illustratif du roman à thèse amène à considérer l’acte littéraire comme une communication entre celui qui écrit et celui qui lit. En effet, le roman à thèse est une illustration particulièrement claire du souci réaliste et didactique qui est à l’origine du genre romanesque ayant émergé de l’enseignement en même temps que du récit épique et de la poésie courtoise, comme l’affirme Julia Kristeva.20 L’un des principes de la loi de la structuration du roman est qu’avant d’être une histoire, il est une instruction, un enseignement, un savoir21. Ceci revient à dire que ce qui est connu sous le nom du roman à thèse est une forme extrême de la tendance didactique qui est à la source du roman, c’est cette portée doctrinaire que les théoriciens de la critique moderne et de la littérature d’avant-garde cherchent à battre en brèche.
Dans ce sens, R. Barthes accentue cette opposition dont le texte littéraire est l’objet. Les deux conceptions du texte littéraire sont tributaires du fonctionnement du langage qui est orienté tantôt vers le pôle communicatif, tantôt vers le pôle poétique. Néanmoins, Barthes précise comment les deux conceptions de l’acte littéraire font bon ménage au sein d’un texte. Nous voulons écrire quelque chose et en même temps, nous écrivons tout court. Bref, notre époque accouche d’un type hybride : l’écrivain-écrivant.
Aussi est-il pertinent d’avancer l’idée qu’un récit littéraire, tout en s’interrogeant sur « la dramatisation de son propre fonctionnement » selon les termes de Jean Ricardou, sert de support organique à un travail réflexif effectué à partir de la fiction qui déploie tout un univers axiologique. À cet égard, Milan Kundera précise que le roman n’est qu’une longue interrogation22, et ajoute : L’interrogation méditative (méditation interrogative) est la base sur laquelle tous mes romans sont construits23.
Il en ressort que la fiction est intimement liée au processus interrogatif déclenché par l’écrivain, et tout le travail consiste à matérialiser une pensée au sein du récit. Celui-ci, ne serait-ce que par discrétion, cherche à se dissimuler dans l’épaisseur romanesque24. C’est grâce à cette épaisseur offerte par le roman par exemple qu’il est possible de développer des idées, de matérialiser des abstractions et à faire de l’espace romanesque un réceptacle où vient se concrétiser, entre autres éléments, l’intellect et ce qui a trait à l’activité cérébrale.
À l’encontre de la philosophie qui développe sa pensée dans un espace abstrait, sans personnages et sans situations, l’œuvre littéraire vise à dégager une pensée d’un « code existentiel » qui ne doit pas être étudié in abstracto. On peut confirmer cette idée d’autant plus que le roman offre des possibilités d’intégration. Alors que la poésie et les traités philosophiques ne sont pas en mesure d’intégrer le roman, celui-ci se caractérise précisément par la tendance à embrasser le savoir philosophique et scientifique et à intégrer d’autres genres. C’est pour cette raison que tout récit est inévitablement conduit à des découvertes, à englober sa propre mathesis25. Et Milan Kundera d’affirmer : je ne me lasserai jamais de répéter avec Broch : la seule raison du roman est de dire ce que seul le roman peut dire.26
L’exemple de l’écrivain allemand Hermann Broch est apprécié par Kundera, précisément parce qu’il fait entrer sur la scène du roman une intelligence, et ceci non pas pour transformer le roman en un traité philosophique, mais pour mobiliser sur les bases du récit tous les moyens rationnels et irrationnels, narratifs et méditatifs, susceptibles d’éclairer l’être de l’homme, de faire du roman la suprême synthèse intellectuelle27.
Effectivement, on trouve que Broch mobilise tous les moyens et toutes les formes pour éclairer ce que seul le roman peut découvrir l’être de l’homme. Il fait de son œuvre un travail intellectuel d’autant plus éclatant qu’il ne fut pas un romancier d’une part, un poète d’autre part et, à d’autres instants, un écrivain de pensée. Il fut cela tout à la fois et dans le même livre.28
Les différents éléments qui sont exploités pour faire d’un récit une synthèse intellectuelle à partir d’un ancrage fictif sont soutenus par la force sous-jacente à l’acte littéraire tendant à briser toutes les limites et ne souffrant aucune distinction des genres. Il ne faut pas pour autant croire que le travail de Broch est exclusivement dévoué à l’esprit comme chez Paul Valéry, mais ses différentes activités sont tournées vers la complexité de son temps, et ce qui fait l’unité de son œuvre, c’est l’homme confronté au processus de dégradation des valeurs. Aussi cherche-t-il sur le mode de l’imaginaire et de la fiction, à déterminer le rôle que jouent le rationnel et l’irrationnel dans la vie et les différentes décisions. Il ne voit pas moins de danger dans le rationnel que dans l’irrationnel. Dans Les Somnambules, les pensées de Broch ont ceci de particulier qu’elles se développent et se concrétisent en s’intégrant au monde fictif investi par le récit. Il est question de l’homme au cœur du néant, « métaphysiquement exclu et physiquement dépossédé »29, un somnambule qui est chassé du rêve et qui se trouve jeté dans l’angoisse de la nuit sans pouvoir dormir.
C’est ainsi que s’illustrent, à travers l’exemple de Broch, les modalités du travail de l’écrivain cherchant à intégrer une pensée à un récit fictif qui offre des possibilités propres à assurer cette synthèse. De fait, le texte littéraire se définit comme lieu d’entrecroisement de plusieurs préoccupations qui hantent l’écrivain. Celui-ci détient une pensée qu’il cherche à faire passer sous le couvert d’une fiction. Le lecteur, de son côté, met en œuvre diverses stratégies interprétatives et tente de voir clair dans le texte dont il cherche à déceler les significations. De ce fait, une communication s’établit entre l’auteur et le lecteur, ce qui ne veut pas dire pour autant que parmi toutes les fonctions verbales définies par Roman Jakobson, seule la fonction communicative et référentielle apparaît. Notons, au reste, que le texte acquiert sa littérarité d’un dosage différentiel de fonctions, corroboré par une superposition de symboles. Et tout cela rend possible l’élaboration d’un récit qui intègre aisément une pensée par le biais de diverses formes et de différents procédés narratifs. Toutefois, signalons au passage que dans une œuvre d’art s’accentue une concurrence entre les fonctions communicatives d’une part et les fonctions esthétiques de l’autre. Le règne absolu d’un pôle réduit le texte à une extrémité où l’autre est totalement laissé de côté. Dans le cas de la domination de la fonction esthétique, le texte se referme sur lui-même, se fonde sur son immanence et sa clôture, et devient « autotélique ».30 De ce fait, il ne se laisse pas facilement aborder. À l’encontre de ce cas, quand la fonction référentielle règne sans partage dans le texte, celui-ci se trouve réduit au langage ordinaire, banal et délesté de la charge poétique qui pourrait lui conférer sa littérarité, ou tout simplement sa forme expressive. Il en ressort que l’interférence de ces fonctions fonde le texte littéraire qui devient par conséquent protéiforme et véhicule une pensée en même temps qu’il permet à des subjectivités de se confesser.
Cela dit, notons que la littérature participe bel et bien, par des moyens qui lui appartiennent en propre, à l’entreprise générale de la connaissance. C’est dans cet esprit qu’on lit cette déclaration hautement significative de Jacques Bouveresse qui n’est pas moins conscient de la manière dont s’orchestrent le poétique et le réflexif dans un même texte :
Ceux qui pourraient être tentés de soupçonner Proust de commettre le péché d’esthétisme et de subordonner non seulement la question du bien, mais également celle du vrai, à celle du beau ne devraient pas oublier les avertissements multiples dans lesquels la connaissance de la vérité est présentée comme étant le seul but qui compte réellement aux yeux de l’écrivain. Ce qui est important dans la beauté ne peut justement pas être autre chose que la vérité qu’elle comporte.31
Le critique corrobore dans ce contexte qu’il n’y a pas à parler de beauté tout à fait mensongère, car ce plaisir esthétique est précisément celui qui accompagne la découverte d’une vérité.32 Si la critique littéraire s’occupe de textes et d’auteurs particuliers, continue, naturellement, à parler des questions éthiques et sociales qui sont au centre des intérêts des auteurs en question, c’est parce qu’elle pourrait, bien entendu, difficilement faire autrement. Lisons dans ce sens ce propos de Martha Nussbaum :
Même cette sorte d’intérêt a été contraint par la pression de la pensée en vigueur selon laquelle discuter le contenu éthique ou social d’un texte revient d’une certaine façon à négliger la « textualité », les relations complexes de ce texte avec d’autres textes ; et par la pensée reliée à celle-là, même si elle est plus extrême, que les textes ne se réfèrent pas du tout à la vie humaine, mais seulement à d’autres textes et à eux-mêmes. Et si on passe de la critique aux écrits plus généraux et théoriques, l’élément éthique disparaît plus ou moins dans sa totalité.33
L’exemple de Musil peut également être révélateur à cet égard, d’autant plus qu’il est en même temps un penseur et même un penseur de tout premier ordre, ce qui rend malaisé d’espérer échapper à l’accusation d’ignorer ou de négliger avec lui l’essentiel qui est constitué par ce qu’on appelle la « littérarité » du texte et celle de la littérature en général. L’auteur a passé beaucoup de temps à s’opposer à un courant anti-intellectualiste, très puissant à l’époque, qui soutenait que la littérature et l’art en général ne doivent pas penser, mais seulement sentir et exprimer des vécus immédiats, des sentiments et des émotions.
Réagissant toujours à l’idée selon laquelle ce que nous communiquent les textes littéraires a trait en premier lieu au langage dans lequel ils sont écrits, Bouveresse renchérit et table sur cette connaissance qui finit par surgir d’une œuvre littéraire, même au-delà de ses strates esthétiques, langagières, et spéculaires :
Même s’il est peut-être vrai que le texte littéraire est toujours aussi, et d’abord une réflexion en acte sur la langue, il ne résulte pas de cela que ce que l’auteur communique en premier lieu au lecteur est cette réflexion ou le résultat auquel elle a abouti. Qu’elle soit comprise de cette façon-là ou d’une autre, l’idée que le texte littéraire est autoréférentiel et nous parle essentiellement de lui-même ou de la façon dont le langage y est utilisé me semble reposer sur une illusion complète ou sur le genre de cécité délibérée dont les théoriciens se montrent souvent capables.34
Le propos du critique français a pris appui sur cette assertion significative de la pertinence intellectuelle d’un texte littéraire, celle de Ronald Schusterman : On ne peut guère prétendre que le contenu sociomoral de textes comme La Divine Comédie, Germinal ou La Peste est secondaire par rapport à leur message métalinguistique.35
En bref, pour accentuer les liens étroits qui rattachent la pensée à la fiction, il faut faire remarquer qu’un récit est considéré fort à propos comme une mise en forme d’une pensée qui se coule dans un moule fictif construit par l’écrivain. En effet, tout au long de parcours narratif l’écrivain, soucieux de développer sa pensée, peut recourir à des allégories, à des proverbes, à des maximes, à des aphorismes qui, selon Kundera, permettent de présenter des définitions sous une forme poétique. D’où, en somme, la « téléologie » des écrivains dans leurs activités littéraires.
De surcroît, il est à noter que le roman à thèse qui est une manifestation claire de la communication à travers les différentes composantes du récit trouve son intérêt dans le sens qu’il cherche à délivrer.36
Toutefois, on note que le roman cherchant à déployer une pensée se trouve pris entre les exigences de la vie quotidienne dont il cherche à rendre la complexité, et les principes d’une pensée qui le mettent face à des besoins démonstratifs. Ces exigences sont difficilement conciliables, et la simplification et la symbolisation trouvent mieux leur place dans une écriture fondée sur l’allégorie, le mythe, le lyrisme et tous les écarts qui rendent l’espace d’écriture propice au déploiement des vérités.
Le travail de réflexion envisagé dans la présente étude prendra appui sur toutes ses considérations théoriques et gravitera principalement autour de ce mode d’articulation entre la parole dans une communication ordinaire, et ce qui s’ajoute dans une transposition dans un univers littéraire où les instances s’investissent, certes avec des intentions de communication bien déterminées, mais non sans écrans imposés par la dimension fictive, la pluralité des univers, la plurivocité des sens et des orientations que le littéraire autorise. L’analyse nous amènera à nous inscrire dans le droit sillage du procès qui est fait par Platon de l’écriture dans Phèdre, ce qui rendra loisible de poser la question de savoir si la communication littéraire ne s’avère pas plus efficace et efficiente dans un échange où le sujet parlant et énonciateur principal dispose d’une prépondérance qui relègue le récepteur, le lecteur à un rang où les sens est dans une certaine mesure, imposé.
Partant du constat selon lequel l’échange verbal est fondamentalement orienté vers une référentialité que les interlocuteurs partagent, il importe aussi de se demander si le passage de l’usage ordinaire de la parole, de la langue, à une mise en œuvre esthétique, n’est pas sans incidence sur la composante communicative. Autrement dit, la communication littéraire ne multiplie-t-elle pas les strates rhétoriques, narratives, herméneutiques, qui rendent les interprétations malaisées et moins univoques ?
La perspective retenue dans ce sens est bien d’interroger la dichotomie de l’intelligible et du sensible, opposition primordiale dont découlent d’autres oppositions qui ne prennent leur sens qu’à partir d’elle : opposition entre être et devenir et entre être et paraître, entre savoir et opinion ou bien encore entre idée et simulacre, âme et corps, vérité et erreur, etc. Ce dualisme qui raisonne à partir de couples d’opposés est déclinable à l’infini.
C’est également à partir de cette opposition que se comprend, sur le terrain de l’écriture, l’opposition entre la parole philosophique, réflexive et l’ensemble de ses autres modalités poétique, mythique, rhétorique, etc., puisqu’elles ne font qu’imiter, avec plus ou moins de bonheur, les réalités intelligibles. C’est donc à partir de cette redéfinition de la réalité, que l’on pourrait nommer révolution platonicienne, qu’il faut aborder la question de la parole. Le mode philosophique de la parole devient la parole en elle-même et, bientôt, la pensée elle-même, par opposition à tous les modes dégradés de cette parole qui ne sont que de l’imitation imparfaite.
Le travail d’analyse sera principalement centré sur un corpus qui est loin d’être anodin et fortuit. C’est une œuvre où le primat du sensible n’est pas à démontrer, mais c’est aussi une œuvre où la pensée et les idées sont prégnantes. Il s’agit des Filles du feu et des Chimères de Gérard de Nerval37, publiés en 1854.
Dans ce cadre, il faut noter que 1853 et 1854 furent des années productives, même si l’état de la seconde partie d’Aurélia reste incertain, même si nous ne saurons jamais quel devait être l’aboutissement réel de Promenades et Souvenirs. Jamais peut-être Nerval n’avait autant réfléchi à sa fonction d’écrivain et aux possibilités de dire le vrai et la vérité par le récit et la poésie.
On peut s’interroger ainsi sur l’inscription des Filles du Feu suivies des Chimères dans la dimension existentielle de l’écriture, d’autant que l’expérience personnelle de Nerval, aux portes de la vie et de la mort, et la complexité d’une œuvre dont la réception reste ambiguë, risquent d’être désorientées par les circonstances finales de la vie qui a marqué un devenir particulier chez l’auteur. Inversement, on peut considérer que cette inscription est l’occasion pour notre travail de recherche de mieux situer la place de Nerval dans le patrimoine littéraire français, et de mettre peut-être fin aux images d’Épinal qui écartèlent une identité littéraire sensible, modeste et exceptionnelle, entre un « gentil rêveur », auteur d’Odelettes38 et de nouvelles « idylliques », dont la plus célèbre reste Sylvie, et un écrivain alchimiste tourmenté, auteur de poèmes et de récits hermétiques – Les Chimères et Aurélia – qui révèlent des perturbations identitaires dans un imaginaire où les visions délirantes rivalisent avec le syncrétisme religieux et les références littéraires, philosophiques et picturales hétéroclites.
Que ce soit dans la fortune contraire ou dans les terribles épreuves que lui imposa la maladie mentale, Gérard de Nerval reste avant tout un créateur d’exception : il cherche, dans ce tournant décisif de sa vie, à montrer une lucidité par le biais de laquelle il pourrait jeter le discrédit sur l’idée de la folie qui le poursuit et qui lui est imputée par ces contemporains après ses crises périodiques. Son œuvre fut romantique, non seulement pour avoir fait partie des troupes hugoliennes dans la bataille d’Hernani, mais parce qu’elle s’inscrit dans la grande tradition du Romantisme allemand ; elle fut aussi moderne et elle le reste, car elle ouvre sur Proust, qui lui rendit hommage, dans le cadre du Nouveau Roman au même titre que Gracq qui lui rendit aussi hommage, à partir du surréalisme et de la poésie actuelle. Indépendamment des questions de cohésion qui peuvent se poser, à propos de chaque texte, de chaque recueil, de l’ensemble de l’œuvre, toutes les grandes questions concernant la littérature sont au cœur de la production nervalienne : organisation du temps et de l’espace, errance et voyage, poésie et vérité, récit et réalité, personnages et identité, structure générique, frontières de la prose et de la poésie, langage et origine, raison et déraison, dédoublement du « moi », fragmentation de l’être et du dire… Sans le moindre dogmatisme et sans absolue certitude, Nerval s’inscrit dans les modèles de son époque, qu’il interroge, inspecte, prospecte, questionne, détruit, pour les transformer tout en les reformulant.
Le recueil retenu comme corpus de notre analyse est constitué de sept nouvelles et de douze sonnets. Les chiffres pourraient interpeller et gagneraient à être interprétés dans le sens de leur symbolique. D’ailleurs, Nerval mettait autant de soin à ordonner son recueil qu’à polir le style de Sylvie ou à faire de sa nouvelle un modèle de composition subtile. Il faut admettre que le sens de la composition qui faisait défaut au moment où il choisissait et rangeait les morceaux de son recueil permet de faire la part des choses et de discerner le malade inquiet de l’artiste toujours lucide.
La mise en place des nouvelles des Filles du feu obéit en effet à un ordre savant, et les douze sonnets des Chimères répondent aux sept nouvelles. Après la préface qui souligne l’unité du recueil, deux nouvelles, Angélique et Sylvie, se rattachent au Valois, et au monde de l’enfance que prolonge le trésor des contes et des vieilles chansons. La nouvelle humoristique Jemmy établit une séparation entre le premier groupe et le second formé par les trois nouvelles campaniennes,39Octavie, Isis et Corilla. La vieille France et la vieille Italie sont donc séparées par un récit situé au Nouveau Monde. La dernière nouvelle, Emilie, l’histoire la plus tragique, contrastant donc avec l’humour de Jemmy, et qui introduit un décor nouveau : l’Allemagne, au témoignage de Nerval lui-même qui y tenait beaucoup et la jugeait très intéressante, finit bien le volume.
Les douze sonnets des Chimères, El Desdichado, Myrto, Horus, Antéros, Delfica, Artémis, les cinq poèmes placés sous l’intitulé Le Christ aux oliviers et enfin Vers dorés, ne suivent pas l’ordre chronologique de leur composition ; ils sont ordonnés selon une architecture secrète, qui n’est pas sans rappeler celle du recueil posthume d’Alfred de Vigny, les Destinées. Au poème liminaire présentant les Destinées, Déesses fatales, correspond le premier sonnet El Desdichado intitulé d’abord Le Destin. À l’Esprit pur qui clôt le recueil de Vigny correspond le sonnet Vers dorés, au dernier vers remarquable : Un pur esprit s’accroît sous l’écorce des pierres !
Entre ces deux portants, le premier mélancolique, le second serein, se déploie, disposé en diptyque (les cinq sonnets païens – les cinq sonnets chrétiens), le drame du monde qui reflète à l’échelle cosmique le drame intime du poète : crépuscule des dieux et union des civilisations, recours à l’abîme et retour éternel. Le volet personnel et individuel entre dans un dialogue qui donne un relief particulier à cette tension entre le destin collectif et l’expérience commune. C’est bien ce qui peut autoriser à interroger l’œuvre de Nerval à partir du prisme littéraire qui orchestre selon des subtilités précises le passage de la sphère individuelle à la sphère collective, entre lesquelles il sied d’appréhender la vérité de la littérature. D’autant que le grand souci du littéraire a toujours été la réalité. Non pas exactement pour la représenter et encore moins pour l’évoquer de manière réaliste, mais pour saisir de la réalité cela seul qui fait d’elle la réalité : l’évidence irrécusable de ce qui est, l’autorité irréfutable de sa logique et de son espèce de discours. Ce faisant :
La littérature veut dresser contre cette puissance unique du réel la seule preuve qui vaille, celle du désir : chacune de ses affirmations et de ses représentations, chaque discours de sa pensée, empruntent à la réalité sa puissance inégalable, mais pour la retourner ironiquement contre ce qui est. Car l’affirmation de ce qui devrait être ou de ce qui doit être ne tire sa force et sa crédibilité que du caractère indubitable de ce qui est et contre quoi cette affirmation proteste.40
C’est bien dans cet esprit qu’il s’agira d’examiner Nerval, syncrétiste et cosmopolite invétéré, dans sa propension à mêler les temps et les lieux, à concentrer en un même point les civilisations et les paysages. Jemmy est une Irlandaise qui a épousé aux États-Unis un Allemand, avant de devenir la femme légitime d’un Peau Rouge. Gérard le Français a rendez-vous dans Octavie à Portici avec une Anglaise, et sa maîtresse d’un soir est une bohémienne dont la mère parle une langue inconnue et qui a pour amant en titre un garde suisse. Comme Angélique quittant le Valois pour l’Italie et l’Italie pour le Valois, Gérard qui revient d’Italie, va de Paris à Loisy, de Loisy à Paris, mais le lendemain est sur la route d’Allemagne. Si le syncrétisme religieux est exalté à Pompéi sous la forme du culte rendu partout et toujours à la Vierge mère, le Valois, cœur de la France, est un étrange carrefour où se succèdent les fils d’Armen, les cardinaux de la maison d’Este, et le citoyen de Genève hôte du marquis de Girardin. Tout cela porte à dire que le texte choisi pour notre réflexion offre les possibilités d’exploitation, par lesquelles nous nous ne peinerons à saisir le cheminement lyrique, subjectif et sensible dans un élan portant vers une pensée qui transcende le cadre étriqué de l’atome individuel et du cadre affectif et pathétique. La question revêt une importance telle que dans la littérature lyrique, à titre d’exemple, peut être ramenée à cette formule qui s’énonce en substance, selon Jankélévitch, comme affirmation humaine adressée par un humain, concernant un humain (lui-même), à travers un moyen humain, à tous humains.41
C’est à partir de ce constat que l’on peut avancer notre problématique d’ensemble consistant à voir dans quelle mesure l’écriture nervalienne dans les deux textes retenus instaure un réseau de rapports où la communication est remarquablement rompue à l’égard de son temps, mais aussi au sein de l’univers littéraire investi. Certes, le besoin d’écrire se fait sentir dès lors que l’on ressent l’envie de transmettre et de partager des idées avec les lecteurs potentiels, mais il s’agit de voir paradoxalement à quel point bien des truchements sont choisis et bien des paravents sont élus, justement pour faire de l’auteur un incompris, un « ténébreux, un veuf et un inconsolé » pour employer le fameux vers d’El desdichado, poème liminaire des Chimères.
L’intelligibilité et la sensibilité retenues dans cette étude auront ceci de particulier qu’elles nous autoriseront à pénétrer l’intimité du monde créé par l’auteur, où de nettes lignes de démarcation sont tracées entre un réseau de significations intellectuelles qui relèvent d’un certain ordre philosophique, littéraire, mental ou social ; et, d’autre part, des tableaux, des topoï, des scènes, des indices où c’est beaucoup plus l’émotivité de l’auteur qui est mise en relief.
Plus précisément, il est question d’explorer le littéraire autrement, loin de se cantonner dans les catégories traditionnelles où la dimension mimétique règne en valeur prépondérante. Ainsi le choix de la problématique citée est dicté par la nécessité de distinguer la dimension objective, homogène, communément perçue, du réel tel qu’il est vécu par chacun, l’univers subjectif, qui se déploie selon ce que Bergson nomme la durée.
Ce réel vécu est retenu, à l’antipode de sa dimension discursive, dans un ancrage sensible, intime, subjectif intuitif où la littérature prend ses racines. Entendons par là que si l’acte littéraire oscille toujours entre ce que Valéry appelle l’extranéité et l’expérience intérieure et intime, l’hypothèse de notre travail est précisément de montrer, à partir de l’œuvre de Gérard de Nerval, comment se développe une pensée qui se livre à partir d’un ancrage spatial et temporel dont les accents sensibles dotent l’écriture d’une dynamique à même de livrer des idées destinées à régir l’individu dans son devenir personnel et dans sa tendance à s’inscrire dans une société. Ainsi, le temps véritablement vécu est-il toujours un temps qui a déjà été vécu ; un temps revisité par une mémoire forcément sélective. Cette mémoire est souvent involontaire, c’est-à-dire enclenchée par le flux des remémorations personnelles et par leurs résonances sur le présent, et s’emploie à reconstruire le passé en lui conférant un sens. La complexité de la structure des nouvelles et des sonnets en témoigne, qui mêle plusieurs strates du passé et souligne les correspondances qu’elle révèle : entre les lieux, entre les êtres, entre les événements. Le temps effectivement vécu est toujours un temps recréé par l’imaginaire et l’affectivité d’un sujet.
C’est à la lumière de cette manière de voir la sensibilité chez Nerval comme vecteur de démarcation, que nous entendons analyser dans l’ensemble du travail comment le sujet de l’écriture s’inscrit en faux contre les données réellement vécues par le commun des mortels, et notre hypothèse serait bien entendu que la densité intellectuelle des nouvelles n’est pas de nature à occulter leur dimension solipsiste, égotiste et intimiste, au point de faire de l’auteur et des narrateurs qui s’entremettent à travers des écrans énonciatifs, des instances appelées à endosser les conditions dont l’auteur se réclame en dernière analyse.
C’est précisément autour de cette problématique de la sensibilité et de la pensée que nous éluciderons le texte de Gérard de Nerval et la vérité dont il pourrait se réclamer. Dans un premier parcours analytique, l’intérêt sera prioritairement centré sur la tendance du texte littéraire à établir un échange qui demeure l’une des raisons d’être principale du verbe dont se ressource le littéraire. Entendons par là que l’auteur, en plein romantisme, impute à l’acte d’écriture une communication, qui n’est envisagée que pour fonder un édifice sur des ruines et des vestiges qu’il s’agit d’interroger à travers une sensibilité personnelle. Cette dernière, si elle marque une tendance à s’inscrire dans les paysages, les signes, les lieux, les dates, les faits et les événements, c’est bien entendu pour conférer à l’expérience intime une force de nature à scander lyriquement et individuellement un legs commun sur lequel porte le choix du poète et de l’écrivain. D’autant plus que le contexte à appréhender est bien celui de l’effondrement mental, intellectuel et moral qui a fait la spécificité de l’ère nervalienne. C’était l’ère du désenchantement, de la déception et de la décadence, où il incombe à l’auteur de s’inscrire dans une quête placée sous le signe du livre, des mythes tutélaires et des autorités philosophiques et littéraires, appelées à intercéder en faveur des êtres en mal d’identité et des écrivains en quête d’enracinement et de valeurs salutaires.
En second lieu, la réflexion nous portera à montrer en quoi consiste le mode d’articulation de la sensibilité et de la pensée, par le biais d’une analyse qui s’attachera à des pertinences susceptibles de clarifier les postures intellectuelles de Gérard de Nerval dans Les Filles du feu et dans Les Chimères. Il s’agira précisémentde suivre l’itinéraire de l’auteur qui sortira de son insularité pour s’ouvrir sur une réalité transcendante dans la société et dans une pensée orientée vers l’anthropos et le cosmos. Le travail d’élucidation nous permettra de nous appesantir sur une pensée qui s’évertue à s’ériger en valeurs appelées à supplanter un ordre en passe de s’éclipser. L’instance poétique et littéraire dessinera ainsi des sentiers au bout desquels il y a lieu de trouver un nouvel ordre, une cosmogonie autre, avec des signes démarcatifs dignes d’une vision globale des choses. L’auteur s’attribuera des postures jugées aptes à le faire aboutir à une altitude qui rendra loisible la mission de représenter, conformément à une pensée fulgurante, incandescente et frénétique, une tutelle d’obédience isiaque, orphique, mystique et ésotérique, permettant d’accorder à la littérature une force de création, de recréation, de transcendance et de sublimation. L’intérêt ne sera d’ailleurs accordé à des modèles littéraires et à des autorités prépondérantes, que pour induire la conviction selon laquelle la littérature doit être un creuset où l’auteur peut s’arroger le droit d’orchestrer les éléments d’une pensée qui ne peut faire l’impasse sur l’univers intime et subjectif dont la prégnance reste déterminante.
Ce travail d’analyse, conçu en deux moments essentiels, celui du pôle sensible de l’écriture et celui d’une pensée que ce dernier se charge de transmettre, s’assigne comme objectif particulier de faire vivre Nerval à partir de cette bipolarité du sensible et de l’intelligible et de mesurer les pertinences qui sont celles de son texte, à l’aune de cette dualité à laquelle nul auteur ne peut déroger et, partant, qui mérite de servir d’éclairage aux subtilités et aux nuances de la globalité de la création nervalienne. C’est pour cela que dans cette introduction nous avons tenu à favoriser, au rythme lent d’explications à partir de l’enjeu de l’expérience, la concordance du textuel avec la sensibilité pensante pour aboutir à l’imaginaire, à l’identité littéraire de l’auteur.
Première partie
Du « Verbe » à l’écriture sensible
Introduction





























