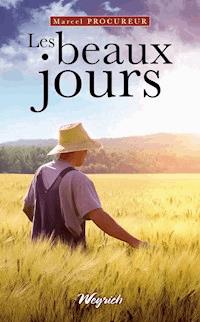
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une immersion au coeur de la campagne belge, à la rencontre de personnages hauts en couleur !
Marcel ne vit que pour les moments qu’il passe dans son village natal en Hesbaye, où il retrouve avec plaisir ses grands-parents ainsi que sa marraine Julia et l’oncle Victor, qui ont la charge d’un grand et beau domaine appartenant à un couple d’anciens coloniaux.
Avec beaucoup de nostalgie, de malice et de poésie, Marcel Procureur nous conte son patelin et les événements qui rythment la vie à la campagne : les concours de pigeons, la messe, les moissons, le baptême de la petite Jeanne, l’école communale, la procession du 15 août, les visites au cimetière, l’abattage du vieux chêne, le café Le Coulonneux…
Avec ses habitants hauts en couleur, la vie au village n’est pas si paisible pourtant : le colonel Dacheville, homme dur et strict, Adeline, sa douce épouse et son secret, Paul et Léontine – vraie grenouille de bénitier –, Simon le garçon de ferme qui apprend à Marcel la conduite du tracteur, Annie, la petite blonde qui vient de Moha, Théophile Vieujean, le curé de la paroisse, et le Coq Daout.
La mort suspecte de celui-ci alimentera les conversations pendant des semaines…
Que se passe-t-il lorsqu'une mort suspecte touche l'un des habitants d'un paisible village ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À ma petite-fille Émilie.
Chapitre 1
La maison de mon enfance était blottie au fond d’une vaste propriété, ombragée par d’épais feuillages d’arbres aux essences variées.
À l’entrée, les rameaux errants d’un haut frêne encadraient une grille en fer forgé, finement ciselée et toujours bien entretenue.
Souvent fermée, elle sommeillait sur ses gonds, dans la chaleur de l’été.
Au crépuscule, elle soupirait enfin, lorsque mon grand-oncle l’ouvrait, en écartant les derniers rayons de soleil qui s’effaçaient entre les barreaux torsadés. Une douce fraîcheur pénétrait alors partout, avant de s’installer paresseusement sur un rustique banc de bois vermoulu, adossé à la façade du logis. Un chèvrefeuille recouvrait la devanture de l’imposante demeure, appartenant à un couple de coloniaux retraités, et qui venaient au mois d’août, comme ils disaient, « attendre l’automne à la campagne ».
Oncle Victor gardait toute l’année les bâtiments, le parc, le jardin jouxtant un verger, descendant en larges bonds vers un capricieux ruisseau qui s’évadait, moqueur, sous le bruissement de quelques saules.
Marraine Julia veillait jalousement sur le salon des maîtres, et elle en interdisait la porte, surtout à cette époque, parce que, répétait-elle, Monsieur et Madame Dacheville ne tarderaient pas à arriver.
Juillet finissait doucement dans la tiédeur d’une saison qui promettait une généreuse moisson. J’avais douze ans, et j’étais, tels les enfants de mon âge, curieux de tout et de rien. Pendant les vacances, moi aussi, je délaissais les rumeurs de la ville pour retrouver la quiétude des massifs boisés et les couleurs des plantes odorantes de ce domaine que j’aimais tant.
J’avais pris place ce soir-là, comme à l’accoutumée, sur le banc de la veillée, entre l’apaisant sourire de marraine et les traits un peu sombres de mon oncle. L’air s’enivrait du subtil parfum de toutes les fleurs qui égayaient les parterres.
Nous restions silencieux, guettant l’arrivée de nos voisins.
Et je suivais, d’un œil amusé, les cheminements d’une colonie de fourmis dans un minuscule sillon d’une terre asséchée.
— Il fera encore beau demain, dit mon oncle, en levant la tête vers le ciel légèrement voilé.
L’homme parlait peu, ce n’était pas dans ses habitudes. Toute sa vie, il avait besogné dur chez un marchand de charbon.
Il avait rempli de nombreux sacs du précieux combustible, avant de les soulever, puis de les asseoir sur le dos d’une vieille bascule, de les hisser dans la benne d’un camion, de les vider dans les soupiraux de toute la région.
On l’avait pensionné, les reins brisés, les mains durcies, les genoux fatigués par des efforts toujours intenses. Son visage, buriné par le temps, marquait bien son âge : il allait avoir septante-quatre ans.
Souvent, il promenait une perceptible nostalgie entre les noisetiers qui peuplaient élégamment un enclos où l’on entendait des poules caqueter et gratter la paille du fumier.
Il y avait là une étable, des clapiers, un poulailler et, sous un abri de fortune, des branchages d’où s’exhalait une forte odeur de résine.
Lorsque j’avais envie de rencontrer son sourire caressant, son front hâlé et ses cheveux d’argent, alors je courais vers le claquement sec de la serpe qui frappait une branche tordue, assise sur un billot rudimentaire. Et je prenais un plaisir, chaque fois renouvelé, à regarder ses doigts noueux tenir fermement le bois qu’il allait débiter par petits coups vifs et précis.
Il restait là, des heures durant, avec sa solitude, ne l’abandonnant que lorsque midi sonnait à l’église du village. Alors, il revenait, les jambes lourdes, le tronc un peu plus courbé vers la table de la salle à manger.
Nous déjeunions dans un sobre silence, à peine troublé par la pose des couverts sur les bords ébréchés des assiettes creuses.
J’appréciais cet instant. Le temps semblait s’arrêter, même si, au mur en face de moi, le balancier cuivré d’une horloge dessinait une ombre qui faisait les cent pas devant un cadre où jaunissaient des portraits d’hommes, de femmes, d’enfants.
Cette vitre patinée était le reliquaire de marraine Julia. Vers la fin de l’après-midi, elle s’en approchait presque religieusement. Quand elle se sentait seule, elle sortait, d’une poche de son tablier gris, un mouchoir blanc, repassé avec soin. Et elle frottait l’encadrement d’abord, puis le verre dépoli, avec beaucoup de douceur, de grâce aussi…
Le tissu chantonnait sur les « chers disparus » qu’elle s’obstinait à rendre à la lumière, à la vie peut-être…
J’observais parfois cet étrange rituel, dissimulé derrière un robuste dressoir.
Un jour cependant, je fis craquer le parquet.
Marraine, surprise, s’était retournée, les yeux remplis de larmes. Elle m’aperçut, froissa son chiffon devant son regard embué, et disparut dans la cuisine, en trottinant dans ses sabots usés.
Plus tard, j’appris que Julia et Victor avaient eu un fils qui était décédé dans sa dixième année.
Je porte sur ma carte d’identité, comme second prénom, celui de ce garçon : Alphonse.
Chapitre 2
Mes fourmis continuaient leur incessant va-et-vient. Certaines rentraient précipitamment dans un trou à peine visible, entouré par quelques boursouflures de fine poussière. D’autres transportaient de petits œufs blancs. Sous leur charge, elles s’arrêtaient parfois un bref instant, près d’une brindille, un peu comme les laboureurs d’autrefois, avec leurs lourds sacs de grain, au pied de l’échelle du moulin qui écartait ses ailes pour accueillir le vent de la plaine.
La grille avait gémi.
— Voici Paul et Léontine, dit marraine.
Les voisins s’avançaient dans une allée bordée de pivoines jaune d’or.
Petite et grassouillette, Léontine soufflait à chacun de ses pas. Sa respiration courte et haletante lui rappelait que son embonpoint ne l’aidait pas dans ses tâches journalières, liées à la rigueur campagnarde.
Car Léontine, depuis bientôt trente ans, vivait avec Paul de la production agricole, de l’élevage de quelques bovins, de la vente d’œufs, de produits laitiers. Ils n’étaient pas riches, devaient travailler dur, le jour dans les champs, le soir dans les étables. Leur fermette, à deux pas de chez marraine, leur appartenait. Elle alignait quelques dépendances devant une venelle étroite et sinueuse qui conduisait au lieu-dit la Fontaine.
Dès l’aube, Léontine menait ses quelques vaches dans la prairie entourant l’enclos de mon oncle. Au couchant, on l’entendait rappeler ses bêtes qui tendaient le museau à la clôture, en meuglant et bavant. Et l’on voyait le bâton de la fermière frapper la croupe de quelques animaux attardés, peu pressés de piétiner le foin odorant, fraîchement retourné.
Léontine nouait alors un fichu à pois sur ses cheveux frisés, avant de s’asseoir lourdement sur un trépied, à côté d’un pis gonflé.
La fermière trayait avec les mêmes gestes, chaque jour répétés. Le lait surgissait, comme d’une gourde vivante, remplissait, avec sa chanson, le seau d’aluminium. Une onctueuse couronne de crème jaunâtre se formait, allumant la convoitise d’un vilain chat roux qui ne dormait que d’un œil, sous le plancher défoncé d’une huche abandonnée.
La femme de Paul tirait sur le pis presque mécaniquement. Parfois, elle laissait échapper un gros mot, lorsque la vache, agacée par les mouches, balançait sa queue devant son visage déjà bien rouge.
Il arrivait aussi, mais c’était heureusement plus rare, que l’animal, pincé par un taon, fasse un écart, et qu’un peu de lait se répande sur le pavé humide. Alors, le matou bondissait sur la tache écumeuse, tandis que Léontine, empoignant le seau à pleines mains, envoyait aux quatre coins des murs chaulés une litanie de jurons, à faire pâlir tous les saints de l’église du village.
Sa colère passée, la fermière se signait très vite, avant de reprendre, avec application, sa besogne quotidienne.
Léontine était une fervente chrétienne, pratiquante, assidue au confessionnal du vendredi après-midi et fidèle à la grand-messe du dimanche matin.
Paul ne croyait en rien.
S’il observait le ciel, c’était pour augurer la pluie qui pourrirait les semences ou le soleil qui gonflerait les épis. Son horizon se limitait à la borne des champs, à la lisière des forêts.
Il admettait cependant que Léontine enfile sa robe à fleurs, qui la grossissait un peu plus encore, pour se rendre à l’office dominical ou aller réciter, une fois par mois, le chapelet, avec quelques vieilles, à la chapelle de la Vallée.
Sa relative tolérance permettait aussi la présence d’un crucifix et d’une statuette en plâtre de saint Donat, d’un goût douteux, car recollée et repeinte après une dispute, en rose et vert. Le saint protégeait des orages. Or le paysan craignait les colères du ciel et, tant qu’à faire, il valait mieux se préserver également de celles de sa sainte femme, surtout lorsqu’il rentrait trop tard, les soirs d’amples libations. Alors, prévoyant, le fermier avait accordé une petite place à Donat, sur la cheminée de la cuisine, à côté de sa boîte de cigarillos.
Mais Paul ne supportait pas les sermons de Théophile Vieujean, curé de la paroisse, qui avait la fâcheuse habitude de teinter tous ses propos de virulents reproches à l’égard des gens de la terre, de plus en plus discrets sur les bancs de son sanctuaire.
L’homme en soutane affichait d’ailleurs, depuis peu, une certaine nervosité, à mesure qu’approchait un évènement qu’il devait préparer et qui s’inscrirait pour l’éternité dans l’histoire de la commune. Du haut de sa chaire, il avait ainsi annoncé, très fièrement, le retour définitif au pays de Monseigneur Dechany, évêque de Léopoldville.
Et le diocèse avait chargé le brave et dévoué curé d’organiser le dimanche du 15 août de solennelles festivités pour le primat, tout auréolé d’une vie sacerdotale prestigieuse.
— Quelle journée suffocante ! souffla Léontine, en s’épongeant le front.
Et elle ajouta, entre de profondes respirations :
— Pourvu que le temps tienne jusqu’à la fête de Monseigneur !
— Assieds-toi, Léontine, dit marraine.
Celle-ci prolongea, avec un brin de malice, le souhait de la fermière :
— Je crois, en effet, que grâce à Dieu, il fera beau pour les réjouissances et… pour la moisson, naturellement. Qu’en penses-tu Paul ?
— Monseigneur, répliqua l’époux contrit, bénira peut-être les blés que nos mains ont semés ; il est plus aisé de tenir le goupillon qui asperge que de manier la faux qui coupe !
L’homme, visiblement satisfait de ses mots, tira longuement sur son cigarillo, avant d’envoyer vers le clocher d’épaisses volutes de fumée qu’il voulut noires, très noires même… Marraine Julia, qui connaissait mieux ses voisins que la Bible, comprit très vite que les vibrantes ardeurs religieuses de Léontine allaient heurter l’anticléricalisme tenace de Paul, et ce, sous une voûte céleste pourtant si clémente, à ce moment où les ultimes rayons du soleil rougissaient l’horizon.
Mais Julia avait senti qu’elle tenait là le sujet de conversation de la soirée, et annonça gravement :
— On raconte que notre curé a bien houspillé les hommes dimanche, à la première messe. Lucien y assistait ; il bavardait, comme d’habitude, avec ses amis colombophiles, au bout de la nef, près du confessionnal. Et c’est alors que François, le champion provincial, avoua qu’il avait misé énormément d’argent sur un vieux mâle, séparé de sa concubine, restée sagement au pigeonnier ; il avait joué le veuvage !
Le confessionnal rapporta la chose à monsieur le curé qui nota le délit dans son bréviaire.
— Et alors ! ? s’exclama le fermier.
Marraine continua :
— L’abbé, après l’Évangile selon saint Paul, a subtilement parlé d’impénitents joueurs qui finiraient par perdre tout leur avoir et n’obtiendraient plus de crédit auprès de Dieu…
Le fermier intervint :
— Qu’il m’en donne, lui, du crédit, j’en ai bien besoin, moi !
Et nerveusement, il empoigna sa casquette, la fit tourner sur son crâne dégarni, la laissa glisser sur l’une de ses oreilles qu’il avait poilues et décollées, la frappa enfin sur un genou, en proférant, au milieu de beaucoup de poussière, un innommable blasphème.
Julia reprit :
— Pour encourager au repentir, le prêtre a invité les pécheurs à offrir les services de leurs bœufs ou la puissance de leur tracteur pour tirer les chars du cortège.
Le visage du cultivateur s’assombrit :
— Moi, j’ai le souci de Noirette, ma vache qui a bien des difficultés à mettre bas, alors… le défilé.
Il demeura un instant pensif, puis demanda :
— Dis-moi, Julia, est-ce que l’apôtre des Écritures, qui comme moi doit être tolérant et miséricordieux, a arrangé les affaires de François ?
— Pas vraiment ! précisa Julia. À mon avis, c’est un saint assez faiblard, car le pigeon a manqué d’énergie, et, lorsqu’il est rentré, trois heures après les autres, il a trouvé sa femelle dans le nid avec un autre, un jeune celui-là ! Si ce n’est pas malheureux…
On rit très fort, excepté Léontine.
Paul se montra superbe :
— Malgré tout le respect que j’éprouve pour Monseigneur et ses noirs corbeaux, j’ai beau feuilleter le livre de ma vie, je ne trouve pas un chapitre où j’aurais pu lire une page de l’Évangile, même celui de saint Paul.
Léontine s’enfonça un peu plus dans son corsage en même temps qu’elle lançait vers l’au-delà des yeux suppliants de miséricorde.
— Tenez, en parlant de corbeau, en voilà un rare ! décréta Paul, en indiquant du menton celui qu’il avait reconnu et qui venait d’appuyer son vélo contre le frêne.
— Mais, c’est Simon ! lança mon oncle, qui voyait là l’opportunité d’éloigner Paul, Léontine et Julia du clergé omnipotent.
Je distinguai une silhouette dans la pénombre, parmi les premières étoiles que la nuit avait allumées entre les arbres.
— Bonsoir à tous, dit l’homme, en soulevant un chapeau de paille aux bords rongés par l’usage.
De longs cheveux grisonnants pendaient de chaque côté d’un visage mal rasé. Je reculai, un peu effrayé, et me blottis contre le châle de marraine.
— Prends place, suggéra mon oncle.
Et tout le monde se poussa, ce dont profita Léontine pour envoyer un perfide coup de coude dans l’estomac de Paul.
Victor demanda :
— Quelle nouvelle, Simon ? et ton maître André ?
D’une voix posée, le nouveau venu répondit :
— Nous allons bien, merci. Je suis occupé à la ferme ; je range, nettoie, en attendant les récoltes. Nous devrions moissonner d’ici peu, sauf s’il pleut évidemment. Ici sur la terre, c’est toujours le ciel qui décide…
Simon avait prononcé cette étrange phrase si gentiment que je m’enhardis à le dévisager. Il devait avoir une quarantaine d’années. Un large front, des joues flasques encadraient des yeux clairs, fatigués et qui me paraissaient tristes. Il portait une chemise à carreaux, un foulard autour du cou et un pantalon de flanelle tombant sur des bottines qui avaient beaucoup marché. Il y eut un silence, un instant troublé par un ululement.
— Un oiseau de nuit, sans doute, murmura mon oncle. Et le vent, qui rôdait, emporta ce cri dans le lointain. Simon s’était tu, brusquement. Il remuait seulement entre ses lèvres un brin de paille et écoutait, songeur, la plainte s’évanouir…
Paul reprit évasivement :
— Bah, pour vous toutes les saisons sont bonnes !
Le cultivateur dissimulait mal son amertume. Outre son aisance, André pouvait compter sur l’efficacité de Simon. Lui, Paul, possédait juste deux bœufs, usés jusqu’aux sabots, pour tirer ses chariots défoncés sur des terres assez maigres.
Paul appelait Simon « le corbeau » parce qu’on le voyait parfois, au crépuscule, errer dans les campagnes, enveloppé d’un manteau aussi sombre que le soir descendu maintenant dans tout le domaine.
On ne parlait plus sur le banc vermoulu. Un silence étrange et pénétrant entourait les paysans fatigués.
On se souhaita la bonne nuit. Léontine et Paul partirent en songeant à la vache qui allait mettre bas.
Julia et Victor délaissèrent le chèvrefeuille encore bourdonnant. Simon enfourcha sa bicyclette et s’enfonça dans l’obscurité, sous les étoiles, en sifflotant.
Je fis signe à mes fourmis qui rentraient, comme ces campagnards fourbus.
Marraine m’avait pétri un doux lit plein de plumes. Je me glissai entre les draps frais, parfumés de lavande, et j’attendis le sommeil.
Ne sachant pas dormir, je me levai, et vins m’appuyer à la fenêtre. Un peu de lumière filtrait de la vitre cassée de l’étable de la Noirette. J’entendis les bêtes remuer et les chaînes tinter. Dans le fond de la prairie, je devinai les frêles silhouettes des roseaux, penchés vers le ruisseau pour s’y mirer, rencontrer la lune et bavarder avec elle. Je perçus alors le cri d’un oiseau perdu dans la brume vespérale qui doucement couvrait les noisetiers de l’enclos, les pommiers du verger, les joncs frissonnant dans l’eau glacée.
Les paupières enfin lourdes, je retournai me coucher. La lune avait mis un peu de clarté sur le mur de la chambre.
Un nuage passa entre les fleurs d’un papier peint défraîchi.
J’y vis un corbeau, et je fermai les yeux, en pensant très fortement à… Simon.
Chapitre 3
Le rideau en coton écru qui voilait la fenêtre de ma chambre était resté entrouvert. Dans un ciel sans nuages, le soleil avait éteint les étoiles de la nuit, et tentait de percer la brume matinale.
Je me levai et me dirigeai vers la clarté. À travers la vitre, je distinguai, dans la rosée, les vaches de Léontine. Certaines, couchées dans l’herbe humide, ruminaient paresseusement ; d’autres, taquinées par des insectes, frottaient leur mufle baveux sur le tronc rugueux des pommiers.
J’aimais toujours rêvasser devant la nature qui s’éveillait. Ce matin-là, je ne sais pourquoi, je glissai un doigt sur le carreau embué et traçai doucement, en un trait continu, le contour d’un visage.
Puis j’y mis deux yeux profonds, un nez assez fin, et des joues que je fis retomber mollement sur une bouche pincée. Je reculai pour juger : c’était bien, sans plus. Je revins vers mon ébauche et j’ajoutai un peu de barbe dans le creux du menton, avant de fixer un brin de paille à la commissure des lèvres. Je coiffai le tout d’un chapeau à larges bords, en hérissant sur les oreilles quelques touffes de cheveux bien hirsutes. Satisfait, je signai naïvement mon œuvre.
Je traversai la pièce, ouvris la porte, me retournai : Simon me souriait dans son cadre de verre. J’empruntai un immense escalier, en sifflotant, comme lui.
Une bonne odeur d’œufs brouillés et de lard se répandait dans le sombre couloir qui conduisait au salon de la famille Dacheville. Il fallait traverser cette pièce pour rejoindre la cuisine, le petit-déjeuner appétissant, et le sourire de marraine qui m’attendait, penchée sur l’œil rond du poêle.
Je ne m’attardais jamais dans le lieu interdit.
Je longeais furtivement les murs lugubres où pendaient des lances aux pointes acérées, des machettes aux lames affilées, et toujours sous le regard fixe d’une statuette en ivoire, assise sur un piano à queue. Je quittais très vite cet endroit, fuyant des masques effrayants, des tapisseries chargées de grands oiseaux colorés, des malles fermées par des serrures de cuivre et qui s’ennuyaient dans l’odeur de la cire faisant reluire le parquet de chêne.
Je déjeunais alors, silencieusement, en songeant à de lointaines contrées, peuplées, comme dans mon livre de géographie, de redoutables animaux sauvages et de tribus terrifiantes. Mais mon pays à moi voisinait avec le jardin de mon oncle.
Le repas terminé, je dévalais le verger qui descendait avec ses colchiques vers le ruisseau de mon enfance.
Il prenait sa source à la Fontaine, coulant d’abord dans des bacs de pierre bleue que les paysannes remplissaient de linge le vendredi, jour de la lessive.
Et nous étions vendredi.
Dès l’aube, les villageoises, sur le sentier caillouteux de la ruelle voisine, poussaient, devant leur tablier, les bras de leur brouette chargée de lourdes mannes.
Et à chaque fois que les roues trébuchaient dans les ornières, on voyait les tissus entremêlés sursauter au-dessus de l’osier, et disperser des taches de couleurs sur le feuillage des haies d’où s’envolaient des hannetons apeurés.
J’abandonnai alors ma rêverie, et me mêlai aux parlotes des lavandières.
Les femmes se retrouvaient là pour rincer le linge qui avait tourné la veille dans le vieux tonneau de bois. Et elles secouaient dans l’eau claire et vive les amples couvertures, les draps pesants, les épais vêtements encore remplis de savon.
Les troncs se pliaient, se relevaient, avec les manches gonflées et les poignets glacés.
— Alors Marcel, tu viens nous aider ? demanda une voix que je reconnus.
C’était celle de Raymonde, une grosse et grasse fille de ferme, gentille, mais un peu simple.
Et Raymonde plongea ses mains potelées dans le bac, puis m’éclaboussa de gouttes froides et de menus ricanements. Je me séchai un peu à l’écart, sur un talus broussailleux. Et je dénichai, au milieu de détritus, une planche garnie de clous tout rouillés, d’éparses boîtes de conserve remplies de cloportes et une cordelette à moitié pourrie. J’étais assez riche pour être l’armateur d’un grand navire.
Celui-ci mouillait à présent dans une rade, blottie au fond d’une île à la végétation luxuriante. Sous les rhubarbes géantes qui ombrageaient la plage, mes cloportes montèrent à bord, en faisant signe à Raymonde qui rêvait de voyager, elle aussi. Elle répondit en jetant à la mer une couronne de mousse blanche. Je mis le bateau à flot et gagnai mon embarcadère.
C’était, au bout de la prairie, là où les bovins s’abreuvaient entre des roches glissantes. J’y pataugeais souvent, entre les branches que je rassemblais pour ériger un barrage, et un rideau de prêles qui frissonnaient à la moindre brise.
À leur pied, quelques cousins ridaient, avec leurs pattes étonnement longues, une eau étale, car stagnant dans un repli de la berge.
Le ruisseau grimaçait… gentiment.
Mais voilà qu’une vaguelette chassa les insectes et la grimace.
Mon navire arrivait.
Il s’approcha, les ponts grouillant de passagers bruyants. Des hommes, en bel uniforme, me saluèrent. Des mères agitèrent leur mouchoir en surveillant leurs enfants qui se poursuivaient entre les cordages. Je perçus des cris joyeux, des ordres lancés de partout, et l’appel d’une sirène me surprit, lorsque le paquebot, très lentement, passa devant moi. Des barques repeintes, vernies, reluisaient sur ses flancs éclaboussés d’écume. Les hublots des cabines arrondissaient leurs yeux cuivrés entre les passerelles étroites, pentues, tordues, reliant tous les étages où flottaient les fumées des cheminées joufflues qui hurlaient dans le vent du large.
L’onde s’estompa, et la coque fendit une ombre qui, à l’instant, s’était posée sur un nénuphar assoupi.
Je levai la tête et croisai le regard curieux d’une fillette. Elle me dévisageait étrangement. De la boue grimpait sur mes bottines et je criai à mes cloportes de bien se cramponner au bastingage.
Je voulus lui parler, lorsqu’on froissa les feuilles séchées de la haie fermant le domaine. Une silhouette s’accrocha aux épines et on entendit une voix aigrelette :
— Annie, veux-tu bien revenir immédiatement !
La fillette tressaillit, fit demi-tour, courut à pas légers, évitant la fange, avant de disparaître derrière les plis d’une longue jupe brune.
La haie se referma avec toutes ses épines. Je demeurai près du ruisselet qui vagabondait, en oubliant, déjà très loin, derrière mon bateau, une petite couronne de mousse blanche.
Chapitre 4
Je flânai durant la matinée du lendemain sur mon ponton désert et embrumé.
Je cherchai mon navire et son fier équipage parmi les filandreuses plantes aquatiques qui ondulaient dans l’eau vive. Je ne le trouvai pas, et, fouillant l’horizon, je l’imaginai voguant sur une mer déchaînée vers une île inconnue.
J’espérais aussi rencontrer, entre les roseaux, le regard curieux de la fillette ; je remarquai seulement l’œil perçant et fouinard d’un busard solitaire.
J’abandonnai mon embarcadère à l’heure du déjeuner.
— Marcel, me dit marraine, vos genoux sont bien sales. Vous les décrotterez avant de passer à table, et de vous rendre chez votre parrain cet après-midi !
Elle avait rappelé cette visite très gentiment, en posant un seau sur la margelle d’un puits qui s’arrondissait, avec ses moellons, sur une terrasse allongée devant l’office. Je la regardai nouer une grosse corde de chanvre à l’anse et jeter le tout dans un trou immensément noir. On entendit toucher une eau qu’on ne voyait jamais. Avec des mouvements saccadés, elle tira alors sur la corde tendue, serrée dans la gorge d’une roue qui grinçait sous le toit d’ardoises.
Et le seau revint vers elle, se balançant et semant de fines gouttelettes qui rafraîchirent les fleurs de son nouveau tablier.
Je pris du savon vert, une brosse à poils durs, et je grattai mes croûtes de terre, sans rechigner. Marraine pouvait tout me dire. Je l’aimais beaucoup. Souvent, le dimanche après-midi, nous nous promenions dans le domaine, et elle souriait, parlant aux oiseaux et me tenant la main. Quand elle s’arrêtait, c’était pour reprendre son souffle, ou me montrer, du bout de sa canne, un nid abandonné, un terrier qu’une herbe folle nous dissimulait. Et nos rires se mêlaient joyeusement, lorsqu’un lapin, apeuré, bondissait devant ses sabots, avant de fuir vers un vaste champ qui se perdait dans la campagne.
Mais nous n’étions pas dimanche, et je m’impatientais d’encore attendre ce précieux moment.
Le repas terminé, je descendis à bicyclette une route assez fréquentée, à la pente raide, et qui me conduisait très vite chez mes grands-parents. Lucien et Fernande occupaient une aile de la demeure appartenant à Marie Gonay, une institutrice retraitée et veuve. Marie vivotait avec ses souvenirs et son chat Pitou dans un salon spacieux, meublé avec goût, et tourné vers une pelouse garnie de rosiers, impatients de fleurir. Mes grands-parents vivaient un peu à l’écart, dans des pièces au plafond bas, placées en enfilade et longées d’un discret corridor toujours triste, car il n’apercevait jamais, même furtivement, le soleil.
J’avais appris à écouter le bruit de mes pas dans la maison assoupie à cet instant de la sieste.
Mon grand-père, lui, ne dormait pas. Je le savais. Il m’avait promis de l’accompagner au bourg voisin, pour déposer, au local colombophile, un panier de pigeons. J’ouvris doucement la porte de la cuisine, et je le devinai dans la buée qui couvrait à demi la face d’un vieux miroir fendu, posé à côté d’une écuelle fumante. Un sourire écarta la mousse épaisse, cachant sa barbe, et, d’un geste avec son rasoir effilé, il me fit signe d’entrer.
Je m’approchai alors de la lame menaçante qui allait racler une peau plissée et toute durcie par le temps et la souffrance. C’est que l’homme avait eu un grave accident, il y a quatre ans déjà.
À l’époque, il travaillait dans un entrepôt où l’on conditionnait des sacs d’engrais. Il quittait son labeur, éreinté, reprenait son vélo, pédalait longtemps entre les cultures, et retrouvait, enfin, son logis, fatigué, mais heureux. Il habitait avec Fernande une imposante bâtisse, installée sur la place du village. Sitôt rentré, il commentait sa journée, puis il enfilait une salopette usagée, chaussait ses galoches et montait au pigeonnier où il remplissait les mangeoires de graines de millet et de féveroles. Les pigeons roucoulaient près de lui, s’envolaient à grands coups d’ailes, et décrivaient jusqu’à la nuit tombante de larges cercles autour du clocher de l’église.
Mais un soir, on ne vit pas les oiseaux tourner dans le ciel.
Lucien n’était pas encore rentré et le crépuscule rôdait déjà entre les toits et les arbres. Fernande s’activait, inquiète, dans la vapeur qui soulevait le couvercle d’une marmite. La voiture du docteur Leduc s’arrêta devant la maison. Le médecin en descendit gravement, une trousse de cuir à la main.
Il tira sur la chaîne d’une clochette qui tinta clairement, ôta son couvre-chef, patienta en rectifiant sa redingote de velours côtelé, de couleur ocre.
Un battant s’ouvrit et le crâne du praticien, poli comme un caillou, disparut dans la pénombre du vestibule. Il y eut des cris, des pleurs.
Il faisait nuit quand ma grand-mère et maman se retrouvèrent dans la chambre du blessé, à l’hôpital Saint-Maur de Huy. Parrain gémissait, prisonnier d’un corset de plâtre : il avait la colonne vertébrale brisée. Des sacs d’engrais, mal empilés sous un hangar, avaient glissé et s’étaient abattus lourdement sur le dos du malheureux.
Ce furent pour l’épouse et la fille, pendant de longs mois, d’angoissantes visites à la clinique.
Je n’eus pas le droit de les accompagner, du moins au début, car la victime, chuchotait-on, se trouvait dans un état critique. Chaque soir, je guettais leur retour, assis sagement à côté de ma sœur Liliane, de deux ans mon aînée, à qui l’on avait confié une tâche bien ingrate : elle devait surveiller mes devoirs et mes leçons. Je détestais l’école et son maître acariâtre qui m’accablait de reproches. Sur mon banc, je rêvais beaucoup, en suivant les aiguilles de la pendule qui tictaquait au-dessus du tableau. Elle ne hâtait jamais le pas pour sonner la fin de la classe. Je n’aimais qu’un seul exercice : celui de conjuguer le verbe jouer, pourvu que ce soit avec mes amis, dans le terrain vague bordant notre rue. Nous y avions nos forêts impénétrables, nos souterrains secrets, nos châteaux maléfiques, et nous étions tous des héros au milieu des broussailles et de quelques tas d’ordures. Je rentrais avant la nuit pour me débarbouiller, souper. Liliane tentait alors de m’expliquer le développement de la pyramide à base carrée, ou de me sensibiliser aux subtilités des problèmes de partages inégaux. J’étais encore très souvent le nez dans mes chiffres lorsque les deux femmes revenaient avec leurs tourments. Malgré ma lamentable faiblesse en mathématique, j’évaluais cependant assez bien le poids de leurs soupirs, mesurais avec précision l’étendue de leurs silences.





























