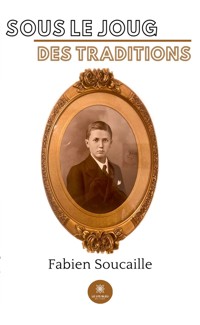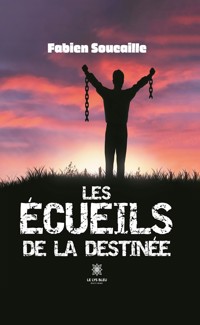
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, Jérôme n’a que cinq ans. Fils unique d’une famille de mineurs de Douai, il grandit dans une maison d’accueil, où sa mère lui rend régulièrement visite pour maintenir leurs liens affectifs, tandis que son père combat l’occupant allemand au sein de la Résistance. À l’âge de 14 ans, Jérôme perd ses parents et se retrouve confronté à de nombreux défis. Parviendra-t-il à surmonter les tragédies de sa vie ? Comment ses expériences façonneront-elles son avenir ? Suivons attentivement son incroyable voyage de survie et de dépassement de soi.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fabien Soucaille, adepte du style romanesque, est l’auteur de "La révolte des Moujiks" et "Sous le joug des traditions", publiés aux Lys Bleu Éditions. Ses œuvres, empreintes de profondeur et de vivacité, promettent une immersion dans des univers bouleversants.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fabien Soucaille
Les écueils de la destinée
Roman
© Lys Bleu Éditions – Fabien Soucaille
ISBN :979-10-422-4162-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Chapitre I
Le trois septembre 1939, la France entrait en guerre contre l’Allemagne. La Deuxième Guerre mondiale débutait. Jérôme avait alors cinq ans. Il était fils unique d’une famille prolétaire de Douai dans le Nord-Pas-de-Calais. Son père, mineur de fond dans une mine de houille, fut immédiatement réquisitionné par l’armée pour participer à la guerre. Il devint ensuite canonnier du 58e régiment d’artillerie. Jérôme fut alors élevé exclusivement par sa mère.
Antoine s’avéra être un soldat intrépide. Il combattit vaillamment sur le front et transmit régulièrement de ses nouvelles à sa famille par le biais des services postaux. Au début, la France opposait une certaine résistance face aux troupes allemandes. Au cours d’une bataille, Antoine parvint, à l’aide de son canon, à déloger une dizaine de blindés ennemis bloquant l’accès à la ville de Reims. Il fut récompensé par l’armée en obtenant le grade de caporal. Sa femme, en apprenant la nouvelle, fut très fière. Cependant, les conditions d’existence dans lesquelles se déroulait le combat étaient très éprouvantes. Les soldats dormaient mal et disposaient de peu de nourriture (sous-alimentation) et surtout étaient insuffisamment équipés de tanks. Comme l’avait prédit le Général de Gaulle, le rapport de force n’était pas équilibré. Les chars allemands, beaucoup plus nombreux et plus mobiles, gagnaient rapidement du terrain et coupaient les « transmissions » de l’armée française. Celle-ci s’en trouvait désorganisée. La vie des soldats français devenait terrifiante. Ils n’avaient plus de quoi reprendre force grâce au café ou au tabac. Leur stratégie militaire s’effritait peu à peu. Ils se sentaient voués à l’échec. Rapidement, ils perdirent le contrôle de nombreuses grandes villes et de leurs régions, malgré la résistance héroïque de quelques unités. Entre la fin du mois de mai et le courant du mois de juin 1940, la France fut finalement vaincue. Le dix juillet le Maréchal Pétain reçut les pleins pouvoirs et instaura le « Gouvernement de Vichy »1. Dès lors la France fut coupée en deux par la ligne de démarcation. Au nord de cette ligne, c’était la zone occupée où stationnaient les troupes allemandes. Au sud, c’était la zone dans laquelle les habitants étaient encore libres et pouvaient vivre quasiment normalement, dite « zone libre ». Antoine, qui était parvenu à s’échapper d’un camp de prisonniers et habitait en zone occupée, fut tout comme sa femme, recruté par l’administration pétainiste. Ils travaillaient dix heures par jour dans une usine d’usinage de boîtes de conserve. Elles étaient, hélas, conçues en priorité pour alimenter les troupes allemandes. La garde de Jérôme était confiée à une maison d’accueil et d’éducation à Amiens. Antoine et Marthe n’étaient autorisés à lui rendre visite qu’une fois par mois. Ce mode de fonctionnement était difficile à supporter. Leur mécontentement était d’autant plus grand que leurs mères respectives, à 80 ans, avaient été recrutées de force pour travailler dans une usine qui recyclait les piles utilisées dans l’armée. Ils ne pouvaient les voir elles aussi que très occasionnellement. Mais la coercition qu’exerçait ce régime sur leurs existences ne s’arrêtait pas là. Malgré les efforts déployés au travail, aucun d’eux n’était rémunéré. C’était tout juste s’ils recevaient des tickets de rationnement alimentaire pour se sustenter. Ils étaient ensuite obligés de se rendre dans des épiceries, des boulangeries, des boucheries ayant obtenu l’agrément de l’état. Seuls, ces commerces avaient le droit de leur vendre des denrées. Pire encore, ils furent obligés de cohabiter avec les soldats allemands dans la demeure familiale qui avait été réquisitionnée à cet effet. Dès le début de cette collaboration, une dispute éclata entre Antoine et le sergent allemand. Celui-ci avait effrontément mis la main aux fesses de Marthe, et ce plusieurs fois d’affilée, car il se croyait tout permis, en terrain conquis. Comme Antoine s’en était aperçu, il avait rudement mis fin à cette tentative, dont il ne doutait pas qu’elle irait plus loin. L’ambiance était rapidement devenue conflictuelle.
Le sergent ne voulait pas malgré ce entendre raison et continuait d’effectuer des gestes irrévérencieux. La discussion tourna court et ils en vinrent aux mains. Antoine provoqua lui-même ce combat en assénant un violent coup de poing sur le visage du sergent. Celui-ci eut les lèvres entaillées et perdit son couvre-chef. Pris d’une fureur frénétique, il saisit son arme de service, un pistolet Beretta, et mit en joue son agresseur. Il lui ordonna alors de se mettre à genoux devant lui sinon il lui tirait dessus. Il lui enjoignit de répéter à haute et intelligible voix : « je suis un paltoquet qui n’est bon qu’à lécher la pisse allemande et le monde ». Comme Antoine refusait d’obéir, il lui assena violemment un coup de crosse sur le cou, puis un autre dans le ventre. Plié par la douleur, Antoine tomba à genoux et se répandit en plaintes. Le sergent continua ensuite à l’humilier et le maltraiter, mais Marthe intervint pour le secourir. Elle ne pouvait pas le faire physiquement, car elle était bien trop menue et gracile, mais moralement elle en était capable. Avec beaucoup de diplomatie, elle parvint à persuader le sergent de mettre un terme à leur discorde. Le sergent Schneider libéra Antoine en l’exhortant à ne plus jamais se mettre en travers de son chemin, car si cela se reproduisait il n’aurait aucune hésitation à lui loger une balle en pleine tête. Antoine, pour donner suite à cet épisode, dut reconnaître la domination qu’exerçait le sergent sur les membres de sa famille. Les tudesques exerçaient un pouvoir sans partage. Ils ne laissaient même pas aux vaincus la possibilité de se divertir. Les soldats allemands les surveillaient étroitement, ils s’assuraient principalement qu’ils ne fomentaient pas de troubles contre le régime nazi. La liberté physique des Français était très restreinte. Toute tentative d’évasion était passible de la peine de mort. Antoine avait longuement réfléchi à des stratagèmes pour essayer d’infléchir l’attitude obscène du sergent allemand. Il finit par en trouver un qui s’avéra efficace. Il achetait chez son ami d’enfance, au marché noir de la ville de Douai, une fois tous les quinze jours, des morceaux de viande qu’il offrait au sergent et aux officiers allemands. Ces derniers en raffolaient et en guise de remerciement cessèrent de « peloter » Marthe. Ils accordèrent en plus quelques libéralités à Antoine. C’est ainsi qu’Antoine fut autorisé à jouer deux ou trois fois par semaine du piano dans le salon ; il pratiquait cet instrument depuis quelques mois grâce à un ami qui l’avait initié. Il s’était ensuite perfectionné en autodidacte. Il ne jouait certes pas les grands classiques, ne plaquait pas toujours les accords euphoniques qu’on eut aimé entendre, mais il se débrouillait bien, et grâce à son « oreille », il reconstituait la plupart des morceaux de musique populaire de cette époque. Parfois le sergent se laissait aller à la complaisance et à la fin d’un morceau d’Aznavour ou d’Edith Piaf, il applaudissait avec exaltation. Antoine avait également obtenu la permission de rendre visite à son fils deux fois par mois au lieu d’une. C’était pour lui un avantage considérable, car il pâtissait énormément d’en être séparé.
Le vingt octobre 1940, une entrevue entre Pétain et Hitler eut lieu dans la gare de Mont-sur-Le-Loir pour évaluer les résultats de leur politique de collaboration. Elle servit surtout à engager officiellement le régime de Vichy dans la collaboration. Une semaine plus tard, au cours d’un discours radiodiffusé, le chef de l’état informa le peuple français des nouvelles résolutions qu’il avait prises. Il s’efforça de démontrer qu’une nouvelle ère s’ouvrait, que de nation vaincue, la France devait à présent accéder à un statut respectable et devenir partenaire du vainqueur. L’Allemagne nazie souhaitait construire un nouvel empire européen auquel la France devait se subordonner.
Chapitre II
Pendant ce temps, Jérôme continuait de grandir loin de ses parents et de ses grands-parents. Antoine amadouait toujours les officiers allemands qui résidaient chez lui en leur offrant de bons morceaux de viande. Il parvint ainsi à obtenir un nouveau passe-droit : écouter et disposer d’un poste radio T.S.F. En vérité depuis plusieurs mois, il nourrissait subrepticement l’espoir de rejoindre la résistance intérieure française que le général de Gaulle avait instaurée lors de l’appel du 18 juin 1940. Il était tombé fortuitement sur une coupure de journal de « Libération » que le sergent avait négligemment laissée traîner sur la table de chevet ; il y était question de cet appel et de la constitution d’unités militaires rebelles. Quelques semaines plus tard, le 1er juillet 1941, en écoutant sa radio, Antoine fut mis au courant de la création d’un groupement de résistants dans la région du Pas-de-Calais. Ce fut alors l’occasion pour lui de le rallier au plus vite et au péril de sa vie et de celle des membres de sa famille. Par chance, aucun incident ne se produisit. Antoine ne tarda pas à participer à des opérations de sabotage sur des convois blindés allemands puis sur des avions, et à prendre part à des embuscades. Le but était de fragiliser la domination territoriale des nazis. Au cours d’une de ces opérations, le chef de son unité élabora un plan très concis. Il connaissait à l’avance les horaires de la ligne empruntée par un train transportant une grande quantité de minerais précieux destinés à la fabrication d’armes. Il avait l’intention de le faire dérailler pour soustraire son contenu à l’ennemi. Dans un endroit isolé, ses hommes avaient au préalable « plastiqué » la voie ferrée et, grâce à un détonateur, pouvaient la faire exploser le moment venu. L’arrivée du convoi était proche. On entendait au loin le sifflement caractéristique de la locomotive. L’artificier était très concentré, il devait déclencher précisément l’explosion au bon moment. Vingt-cinq camarades dont Antoine, armés de « Mauser » étaient tapis de part et d’autre de la voie ferrée et attendaient avec impatience que la déflagration se produisit pour neutraliser ensuite l’ennemi et s’emparer de la marchandise. Le chef de l’unité supervisait de manière intransigeante l’opération avec ses jumelles. Désormais le train n’allait pas tarder à arriver. À l’instant « T » l’artificier ne trembla pas ; il actionna la manette de son détonateur et provoqua l’explosion et le déraillement du train. Quelques soldats allemands, abasourdis par le choc, en sortirent, mais ils étaient incapables de se défendre. Le chef des résistants ordonna rapidement qu’on s’en empare et qu’on les fasse prisonniers. Les autres résistants n’eurent aucune difficulté pour accaparer le butin et le charger quelques dizaines de mètres plus loin dans la plateforme bâchée de leur camion. Le groupe de résistants auquel appartenait Antoine avait rempli sa mission, son piège avait fonctionné. Les minerais qu’ils avaient dérobés seraient autant d’armes en moins pour l’ennemi. Il n’y avait aucun doute à avoir à ce sujet. Au même moment, la Gestapo avait remonté la piste d’Antoine et le recherchait diligemment. Elle perquisitionna le domicile où il était hébergé avec ses compagnons, une vieille bâtisse de la périphérie de la ville d’Amiens. Par chance, suite à un contretemps logistique, son unité ne s’y trouvait pas et son arrestation n’eut donc pas lieu. Antoine voulait absolument donner de ses nouvelles à ses proches. Il rédigea donc un courrier qu’il leur envoya au domicile par la poste afin de les informer qu’il était bien portant. Il se consacra ensuite entièrement à son rôle de résistant.
Chapitre III
Mais la Gestapo n’abandonna pas ses recherches. Elle se rendit dans la demeure familiale d’Antoine pour interroger son épouse. Comme Marthe refusait de parler, elle fut passée d’emblée à tabac. Enfin, comme Marthe ne voulait toujours pas parler, il lui fit du chantage. Le colonel Becker affirma : « je vous conseille de cesser de jouer au plus malin avec moi, si vous continuez à vous obstiner ainsi, je vais devoir vous séparer définitivement de votre fils et vous empêcher de le revoir à jamais. Est-ce vraiment ce que vous souhaitez ? »
« Non, répliqua-t-elle surtout pas, je vous jure que je ne sais rien. Vous devez me croire. Après les coups que je viens de recevoir, vous doutez bien que si je savais quelque chose, je n’hésiterais pas à vous le dire. Je vous supplie de ne pas toucher à mon petit Jérôme. C’est le “trésor” de ma vie ! Il n’est pas responsable de mes problèmes. Il ne mérite pas de se voir séparé de sa mère. Il n’a que cinq ans, c’est un être vulnérable. Vous n’avez pas le droit de lui faire subir un tel malheur. » Le colonel Becker avait l’impression que Marthe continuait de lui cacher la vérité. Il décida de se montrer plus cruel et lui affirma : « puisque vous ne voulez toujours pas collaborer, les choses vont aller encore plus mal. Si d’ici la fin de l’après-midi, vous ne m’avez pas dit où se trouve votre mari et donné des renseignements sur ses opérations au sein de la résistance, j’ordonnerai à mes hommes de brûler les yeux de votre petit Jérôme. Ai-je été suffisamment clair ? » « Oui », lui répondit Marthe dans un cri déchirant. Puis elle se mit à pleurer abondamment et supplia encore une fois le colonel de ne pas perpétrer un tel crime. « Je vous jure que je ne sais rien, poursuivit-elle, vous devez me croire. »
« Je vais donc donner l’ordre à mes soldats de brûler les yeux du petit. Cela semble vous convenir, puisque vous vous entêtez à ne rien dire ! » Marthe, mue subitement par son profond instinct maternel, retrouva d’un seul coup ses esprits et chercha à protéger sa progéniture. Elle dit au colonel : « ne touchez pas à mon fils. Je vais tout vous dire ; la dernière lettre que j’ai reçue d’Antoine a été postée à Amiens. »
« Dites-m’en plus, car vos renseignements sont ridiculement insignifiants. »
« Mon mari est hébergé dans le mas du “Château de Chirac” à vingt kilomètres au sud d’Amiens. C’est là-bas qu’il se trouve, vous pouvez me croire. »
« D’où tenez-vous ces informations ? »
« Dans sa première lettre, Antoine m’en a fait part. »
« Puis-je avoir et lire cette lettre ? »
« Non, je suis désolée, mais je l’ai déchirée par précaution. »
« Je ne vous remercie pas pour votre collaboration, mais j’étais sûr que vous alliez finir tôt ou tard par me dire la vérité. Il suffisait d’y mettre une peu de bonne volonté ; navré de vous avoir amochée. Je vais dépêcher mes milices à l’endroit que vous m’avez indiqué, et je vous tiendrai au courant, croyez-moi ».