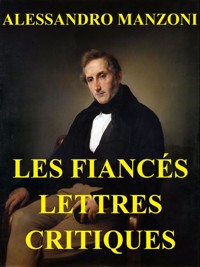
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Youcanprint
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Alessandro Manzoni est un poète, dramaturge et prosateur, considéré comme l'un des écrivains italiens les plus importants de la période romantique. Son roman Les Fiancés est considéré comme l'un des écrits majeurs de la littérature italienne, qui eut aussi une grande influence sur la définition d'une langue nationale italienne. Œuvres: Les Fiancés (I promessi sposi). Lettre à Victor Cousin. Lettre à M.C.*** sur l'unité de temps et de lieu dans la tragedie. Critiques: Revue des Romans par Eusèbe G*****, analyse raisonnée des principaux romans. Poètes et romanciers de l'Italie. — Manzoni. Manzoni, sa vie et ses oeuvres.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Francesco Hayez - Ritratto di Alessandro Manzoni
Œuvres
Lettre à M.C.*** sur l’unité de temps et de lieu dans la tragedie
Lettre à Victor Cousin
Les Fiancés
I promessi sposi
Critiques
Revue des Romans
Poètes et romanciers de l’Italie. — I. Manzoni
Manzoni, sa vie et ses œuvres
Alessandro Manzoni
LETTRE À M. C. ***sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie
1820
LETTRE A M. C***
SUR
L’UNITÉ DE TEMPS ET DE LIEUDANS LA TRAGÉDIE___________
Monsieur,
C’est une tentation à laquelle il est difficile de résister, que celle d’expliquer son opinion à un homme qui soutient l’opinion contraire avec beaucoup d’esprit et de politesse, avec une grande connaissance de la matière et une ferme conviction. Cette tentation, vous me l’avez donnée, Monsieur, en exposant les raisons qui vous portent à condamner le système dramatique que j’ai suivi dans la tragédie intitulée, Il conte dí Carmagnola, dont vous m’avez fait l’honneur de rendre compte dans le Lycée français. Veuillez donc bien subir les conséquences de cette faveur, en lisant les observations que vous m’avez suggérées.
Je me garderai bien de prendre la défense de ma tragédie contre vos bienveillantes censures, mêlées d’ailleurs d’encouragemens qui font plus, pour moi, que les compenser. Vouloir prouver que l’on a fait une tragédie bonne de tout point est une thèse toujours insoutenable, et qui serait ridicule ici, à propos d’une tragédie écrite en italien, par un homme dont elle est le coup d’essai, et qui ne peut, par conséquent, exciter en France aucune attention. Je me tiendrai donc dans la question générale des deux unités; et lorsqu’il me faudra des exemples, je les chercherai dans d’autres ouvrages dont le mérite est constaté par le jugement des siècles et des nations. Que s’il m’arrive parfois d’être obligé de parler de Carmagnola, pour raisonner sur l’application que vous faites de vos principes à ce sujet particulier de tragédie, je tâcherai de la considérer comme un sujet encore à traiter.
Dans une question aussi rebattue que celle des deux unités, il est bien difficile de rien dire d’important qui n’ait été di: vous avez cependant envisagé la question sous un aspect en partie nouveau; et je la prends envisagé volontiers telle que vous l’avez posée: c’est, je crois, un moyen de la rendre moins ennuyeuse et moins superflue.
J’avais dit que le seul fondement sur lequel on a pendant long-temps établi la règle des deux unités est l’impossibilité de sauver autrement la loi essentielle de la vraisemblance; car, selon les partisans les plus accrédités de la règle, toute illusion est détruite dès que l’on s’avise de tranporter d’un lieu dans un autre, et de prolonger au-delà d’un jour, une action représentée devant des spectateurs qui n’y assistent que pendant deux ou trois heures, et sans changer de place. Vous paraissez donner peu d’importance à ce raisonnement. «C’est moins encore,» dites-vous, «sous le rapport de la vraisembiance qu’il faut considérer l’unité de jour et de lieu, que sous celui de l’unité d’action et de la fixité des caraetères». J’admettrai donc, ces deux conditions comme essentielles à la nature même du drame, et j’essaierai de voir s’il est possible d’en déduire la nécessité de la règle.
J’aurais toutefois, je l’avoue, désiré que vous vous fussiez énoncés d’une manière plus explicite sur la question spéciale de la vraisemblance. Comme c’est le grand argument que l’on a opposé jusqu’ici à tous ceux qui ont voulu s’affranchir de la règle, il aurait été important pour moi de savoir si vous le tenez aujourd’hui pour aussi solide qu’il l’a toujours paru, ou si vous avez consenti à l’abandonner. Il arrive quelquefois que des principes soutenus long-temps par des raisonnemens faux se démontrent ensuite par d’autres raisonnemens. Mais, comme le cas est rare, et comme la variation dans les preuves d’un système est toujours une forte présomption contre la vérité de son principe, j’aurais aimé à savoir si c’est pour avoir trouvé insuffisantes ou fausses les anciennes raisons alléguées en faveur du système établi, que vous en avez cherché de nouvelles.
Avant d’examiner la règle de l’unité de temps et de lieu dans ses rapports avec l’unité d’action, il serait bon de s’entendre sur la signification de ce dernier terme. Par l’unité d’action, on ne veut sûrement pas dire la représentation d’un fait, simple et isolé, mais bien la représentation d’une suite d’événemens liés entre eux.[1]. Or cette liaison entre plusieurs événemens, qui les fait considérer comme une action unique, est-elle arbitraire? Non, certes; autrement l’art n’aurait plus de fondement dans la nature et dans la vérité. Il existe donc, ce lien; et il est dans la nature même de notre intelligence. C’est, en effet, une des plus importantes facultés de l’esprit humain, que celle de saisir, entre les événemens, les rapports de cause et d’effet, d’antériorité et de conséquence, qui les lient; de ramener à un point de vue unique, et comme par une seule intuition, plusieurs faits séparés par les conditions du temps et de l’espace, en écartant les autres faits qui n’y tiennent que par des coïncidences accidentelles. C’est là le travail de l’historien. Il fait, pour ainsi dire, dans les événemens, le triage nécessaire pour arriver à cette unité de vue; il laisse de côté tout ce qui n’a aucun rapport avec les faits les plus importans; et, se prévalant ainsi de la rapidité de la pensée, il rapproche le plus possible ces derniers entre eux, pour les présenter dans cet ordre que l’esprit aime à y trouver, et dont il porte le type en lui-même.
Mais il y a, entre le but du poëte et celui de l’historien, une différence qui s’étend nécessairement au choix de leurs moyens respectifs. Et, pour ne parler de cette différence qu’en ce qui regarde proprement l’unité d’action, l’historien se propose de faire connaître une suite indéfinie d’événemens: le poëte dramatique veut bien aussi représenter des événemens, mais avec un degré de développement exclusivement propre à son art: il cherche à mettre en scène une partie détachée de l’histoire, un group d’événemens dont l’accomplissement puisse avoir lieu dans un temps à peu près déterminé. Or, pour séparer ainsi quelques faits particuliers de la chaîne générale de l’histoire, et les offrir isolés, il faut qu’il soit décidé, dirigé par une raison; il faut que cette raison soit dans les faits eux-mêmes, et que l’esprit du spectateur puisse sans effort, et même avec plaisir, s’arrêter sur cette partie détachée de l’histoire qu’on lui met sous les yeux. Il faut enfin que l’action soit une; mais cette unité existe-t-elle réellement dans la nature des faits historiques? Elle n’y est pas d’une manière absolue, parce que dans le monde moral, comme dans le monde physique, toute existence touche à d’autres, se complique avec d’autres existences; mais elle y est d’une manière approximative, qui suffit à l’intention du poëte, et lui sert de point de direction dans son travail. Que fait donc le poëte? Il choisit, dans l’histoire, des événemens intéressans et dramatiques, qui soient liés si fortement l’un à l’autre, et si faiblement avec ce qui les à précédés et suivis, que l’esprit, vivement frappé du rapport qu’ils ont entre eux, se complaise à s’en former un spectacle unique, et s’applique avidement à saisir toute l’étendue, toute la profondeur de ce rapport qui les unit, à démêler aussi nettement que possible ces lois de cause et d’effet qui les gouvernent. Cette unité est encore plus marquée et plus facile à saisir, lorsqu’entre plusieurs faits liés entre eux il se trouve un événement principal, autour duquel tous les autres viennent se grouper, comme moyens ou comme obstacles; un événement qui se présente quelquefois comme l’accomplissement des desseins des hommes, quelquefois, au contraire, comme un coup de la Providence qui les anéantit; comme un terme signalé ou entrevu de loin, que l’on voulait éviter, et vers lequel en se précipite par le chemin même où l’on s’était jeté pour courir au but opposé. C’est cet événement principal que l’on appelle catastrophe, et que l’on a trop souvent confondu avec l’action, qui est proprement l’ensemble et la progression de tous les faits représentés.
Ces idées sur l’unité d’action me paraissent si indépendantes de tout système particulier, si conformes à la nature de l’art dramatique, à ses principes universellement reconnus, si analogues aux principes même énoncés par vous, que j’ose présumer que vous ne les rejetterez pas. En ce cas, voyez, Monsieur, s’il est possible d’en rien conclure en faveur de la règle qui restreint l’action dramatique à la durée d’un jour et à un lieu invariablement fixé. Que l’on dise que plus une action prend d’espace et plus elle risque de perdre ce caractère d’unité si délicat et sous le rapport de l’art, et l’on aura raison; mais, de ce qu’il faut à l’action des bornes de temps et de lieu, conclure que l’on peut établir d’avance ces bornes, d’une manière uniforme et précise, pour toutes les actions possibles; aller même jusqu’à les fixer, le compas et la montre à la main, voilà ce qui ne pourra jamais avoir lieu qu’en vertu d’une convention purement arbitraire. Pour tirer la règle des deux unités de l’unité d’action, il faudrait démontrer que les événemens qui arrivent dans un espace plus étendu que la scène, ou, si vous voulez, dans un espace trop vaste pour que l’œil puisse l’embrasser tout entier, et qui durent au-delà de vingt-quatre heures, ne peuvent avoir ce lien commun, cette indépendance du reste des événemens collatéraux et contemporains, qui en constituent l’unité réelle; et cela ne serait pas aisé. Aussi ceux qui ont fait la règle n'ont ils songé à rien de tel: c'est pour l'illusion, pour la vraisemblance, qu'ils l'ont imaginée; et il y avait déja long-temps qu'elle était établie sur cette base quand Voltaire a cherché à lui donner un nouvel appui; car s'est lui qui a voulu, le premier, déduiré l'unite de temps et de lien de l'unité d'action, et cela par un raisonnement dont M. Guillaume Schlegel a fait voir la faiblesse et même la bizarrerie, dans son excellent cours de littérature dramatique.
J’avoue, du reste, que cette manière de considérer l'unité d'action comme existante dans chaque sujet de tragédie, semble ajouter à l'art de grandes difficultés. Il est, certes, plus commode d’imposer et d’adopter des limites arbitraires. Tout le monde y trouve son compte: c'est pour les critiques une occasion d'exercer de l'autorité; pour les poëtes, un moyen sûr d’être en règle, en même temps qu'une source d’excuses; et enfin pour le spectateur, un moyen de juger, qui, sans exiger un grand effort d'esprit, favorise cependant la douce conviction que l’on a jugé en connaissance de cause, et selon les principes de l'art. Mais l'art même, qu'y gagne-t-il sous le rapport de l'unité d'action? Comment lui sera-t-il plus facile de l'atteindre, en adoptant des mesures détermínées de lieu et de temps, qui ne sont données en aucune manière par l’ìdée que l'esprit se forme de cette unité? Voilà, Monsieur, les raisons qui me font croire, en thèse générale, que l'unité d'action est tout-à-fait indépéndante des deux autres. Je vais à présent vous soumettre quelques réf[exions sur les raisonnemens par lesquels vous avez voulu les y associer: je prendrai la liberté de transcrire vos paroles, pour éviter le risque de dénaturer vos idées.
"Pour que cette unité (d'action) existe dans le drame, il faut, " dites-vous, "que, dès le premier acte, la position et les desseins de chaque personnacre soient déterminés. " Quand même on admettrait cette necessité, il ne s'ensuivrait pas, à mon avis, que la règle des deux unités dût être adoptée. On peut fort bien, annoncer tout cela dans l'exposition de la pièce, y mettre tous les germes du développement de l'action, et donner cependant à l'action une durée fictive très considérable, de trois mois par exemple. Ainsi, je ne conteste lei cette nouvelle règle que parce qu'elle me semble arbitraire. Car où est la raison de sa nécessité? Certes, il faut que, pour s'intéresser à l'action, le spectateur connaisse la position de ceux qui y prennent part; mais pourquoi absolument dès le premier acte? Que l'action , en se déroulant, fasse connaître les personnages à mesure qu'il s'y raffient naturellement, il y aura intérêt, continuité, progression, et pourquoi pas unité? Aussi cette necessité de les annoncer tous dès le premier acte n'a-t-elle pas été reconnue ni même soupçonnée par plusieurs poètes dramatiques, qui cependant n'auraient jamais conçu la tragédie sans l'unité d'action. Je ne vous en citerai qu'un exemple, et ce n'est pas dans un théâtre romantique que j'irai le chercher: c'est Sophocle qui me le fournit. Hémon est un personnage très intéréssé dans l'action de l'Antigone; il l'est même par une circonstance rare sur le thèàtre grec ; c'est le héros amoureux de la pi èce : et cepndant, non-sculement il n'est pas annoneé dès le premier acte, si acte il y a, mais c'est après deux cliceurs, c'est vers la moitié de la pièce, qu'on trouve la première indication de ce personnage. Sophocle pouvait néanmoins le faire connaître dès l'exposition; il le pouvait d'une manière très naturelle, et dans une occasion qu'un poëte moderne n'aurait sûrement pas nègligée. La tragédie s'ouvre par l'invitation qu’Antigone fait à sa soeur Ismène d'aller, avec elle, ensevelir Polynice leur frère , malgré la défense de Créon. Ismène objecte les difficultés insurmontables de l'entreprise, leur commune faiblesse, la force, prête à soutenir la loi injuste, et la peine qui en suivra l'infraction. Quelle heureuse occasion Sophocle n'avait-il pas là de mettre dans le bouche d'Antigone les plus beaux discours au sujet d'Ilémon, son amant, son futur époux, le fils du tyran! de jeter en avant l’idée du secours que les deux soeurs auraient pu attendre de lui! Le poête ne trouvait pas seulement, dans ce parti, un moyen commode et simple d'annoncer un personnage, mais bien d'autres avantages plus précieux encore dans un certain système de tragédie. Il nouait fortement, par là, l'intrigue dès la première scène; en signalant des obstacles, il faisait entrevoir des ressources, et tempérait, par quelques espérances, le sentiment du péril des personnages vertueux; il annonçait une lutte inévitable entre le tyran jaloux de son pouvoir et le fils chéri de ce tyran; en un mot, il excitait vivement la curiosité. Eh bien! tous ces avantages, Sophocle les a négligés; ou, pour mieux dire, il n'y avait dans tout cela, rien, non, rien que Sophocle eût regardé comme avantageux, comme digne d'entrer dans son plan.
Vous vous souvenez, Monsieur, de la réponse qu'il fait faire par Antigone à Ismène? "Je n'invoque plus votre secours," dit-elle; "et si vous me l'offriez maintenant, je, ne l'agréerais pas. Soyez ce qu'il vous plait d'être: moi, j’ensevelirai Polynice, et il me sera beau de mourir pour l’avoir enseveli. Punie d'une action sainte, je reposerai avec ce frère chéri, chérie par lui; car nous avons plus longtemps à plaire aux morts qu'aux habitans de la terre." Voyez, Monsieur, comme tout souvenir d'Hémon aurait été déplacé dans une telle situation; comment, à cóté d'un tel sentiment, il l'aurait dénaturé, affaibli, profané! C'est un devoir religieux qu’Antigone va remplir: une loi supérieure lui dit de braver la loi imposée par le caprice et par la force. Ismène seule, à ses yeux, a le droit de partager son péril, parce qu'elle est sous le même devoir. Qu'est-ce qu'un amant serait venu faire dans tout cela? et comment les chances d'un secours humain pouvaient-elles entrer dans les motifs d'une telle entreprise ?
Ainsi donc, comme toute cette partie de l'action marche naturellement, sans l'intervention d'Hémon, comme sa présence et son souvenir même y seraient inutiles et d'une effet vulgaire, le poëte s'est bien gardé d’y avoir recours. Mais, lorsqu’Hémon commence à être intéressé à l'action, Sophocle le fait annoncer et paraître un moment après. Antigone est condamnée, l'épouse d'Hémon va périr; celui-ci est appelé par l'action même, et il se montre. Sa situation est comprise et sentie aussitôt qu'enoncée, parce qu'elle est on ne peut plus simple. Hémon vient devant son père défendre la vierge qu'il aime, et qui va mourir pour avoir fait une action commandée par la religion et par la nature; c'est alors et alors seulement qu'il doit être question de lui.
Faudra-t-il dire, après cela, que l'Antigone de Sophocle manque d'unité d'action, par la raison que la position et les desseins de tous les personnages ne sont pas établis dès le premier acte? Dans un certain système de tragédie, qui est, à mes yeux, plutôt l'ouvrage successif et laborieux des critiques, que le résultat de la pratique des grands poëtes, on attache une très grande importance à toutes ces préparations de personnages et d'événemens. Mais cette importance même me paraît indiquer le faible du système; elle dérive d'une attention excessive et presque exclusive à la forme, je dirais presque aux dehors du drame. Il semblerait que le plus grand charme d'une tragédie vienne de la connaissance des moyens, dont le poëte s'est servi pour la conduire à bout; qu'on est là pour admirer la finesse de son jeu, et son adresse à se tirer des piéges qu'un art hostile a dressés sur son chemin. On le laisse faire ses conditions dans l'exposition; mais on est, pendant tout le reste de la pièce, aux aguets pour voir s'il les tient. Qu'une situation non préparée trouve place, qu'un personnage non annoncé arrive dans le courant de la tragédie, le spectateur, façonné par les critiques, se révoltera contro le poëte; il lui dira: Je vous comprends fort bien, cette situation n'est nullement ernbrouillée , nullement obscure pour moi; mais je ne veux pas m’y intéresser, parce que j'avais le droit d'y être disposé d'une autre manière. De là encore cette admiration si petite, je dirais presque cette admiration injurieuse pour ce qu'il y a de moins important dans les ouvrages des grands poëtes. Il est pénible de voir les critiques recherelier avec un souci minutieux quelques vers jetés au commencement d'une tragédie, pour faire connaître d'avance un personnage qui jouera un grand rôle, pour annoncer un incident qui amènera la catastrophe: il est triste de les entendre s'émerveiller sur ces petits appréts et vous commander, dans leur froide extase, d'admirer l'art, le grand art de Racine. Ah! le grand art de Racine ne tient pas à si peu de chose; et ce n'est pas par ces graves écoliers que sont dignement attestées les beautés supérieures de la poésie: c'est bien plutôt par les hommes qu'elles transportent hors d'eux mêmes, qu’elles jettent dans un état de charme et d'illusion où ils oublient et la critique et la poésie elle-même, pleinement, uniquement dominés par la puissance de ses effets.
Les autres conditions que vous exigez dans une tragédie, pour que l'unité d'action s'y trouve, sont "que les desseins des personnages se renferment toujours dans le plan que l'auteur s'est tracé, qu’il soit rendu compte au spectateur de tous les résultats qu'ils amènent, non seulement dans le cours de chaque acte, mais encore pendant chaque entr'acte, l’action devant toujours marcher, même, hors de ses yeux; enfin que cette action soit rapide, dégagée d'accessoires superflus, et conduite à un dénouement analogue à l'attente excitée par l'exposition."
Certes, il n'y a, dans ces conditions, rien que de juste. Mais vous prétendez encore, Monsieur, que, pour obtenir ces effets, les deux unités sont nécessaires. "Si maintenant," ajoutez-vous, "de longs intervalles de temps et de lieux séparent vos actes, et quelquefois même vos scènes, les événemens intermédiaires relâcheront tous les ressorts de l'action; plus ces événemens seront nombreux et importans, plus il sera difficile de les rettacher à ce qui précède et à ce qui suit; et les parties du drame, ainsi disloquées, présenteront, au lieu d'un seul fait, les lambeaux de la vie entière du héros."
Veuillez avant tout observer, Monsieur, que, dans le système qui rejette les deux unités, et que, pour abréger, j'appellerai dorénavant le systéme historique, dans ce système, dis-je, le poëte ne s'impose nullement l'obligation de créer à plaisir de longs intervalle de temps et de lieux: il les prend dans l'action même, tels qu'ils lui sont donnés par la réalité. Que si une action historique est partout si entrecoupée, si morcelée qu'elle n'admette pas l'unité dramatique, que si les faits sont épars à de trop grandes distances, et trop faiblement liés entro eux, le poëte en conclut que cette action n'est pas propre à devenir un sujet de tragédie, et l'abandonne.
Permettez-moi de vous dire ensuite qu'il est bien de l'essence du système historique de supposer entre les actes des intervalles de temps plus ou moins longs, mais non des intervalles remplis d'événemens nombreux et importans relativement à l'action. C'est au contraire la portion de temps et d'espace que l’on peut franchir, éliminer ou réduire, comme indifferente à l’action, et sans blesser la vérité dramatique.
On peut aussi, on doit même assez souvent rejeter dans les entr'actes quelques faits relatifs à l'action, et en donner connaissance au spectateur par les récits des personnages; mais cela n'est nullement particulier au système de tragédie que je nomme historique: c'est une condition générale du poëme dramatique, également adoptée par le système des deux unités. Dans l'un comme dans l'autro, on présente à la -ue un certain nombre d'événemens, on en indique quelques autres, et l'en fait abstraction de tout ce qui, étant étranger à l'action, ne s'y trouve mêlé que par les circonstances fortuites de la contemporanéité. A cet égard, la différance entre les deux systèmes n’est que du plus au moins. Dans celui que je nomme historique, le poëte se fie pleinement à l'aptitude, à la tendance qu’a naturellement notre esprit à rapprocher des faits épars dans l'espace, dès qu'il peut apercevoir entre eux une raison qui les lie, et à traverser rapidement des temps et des lieux en quelque sorte vides pour lui, pour arriver des causes aux effets. Dans le système des deux unités, le poëte demande de même des concessions à l'imagination du spectateur, puisqu'il veut qu'elle donne à trois heures le cours fictif de vingt-quatre. Seulement il suppose qu'elle ne peut se prêter à rien de plus, et que, quelque rapport qu’il y ait entre deux faits, il lui en coûte un effort désagreable et pénible pour les concevoir à la suite l'un de l'autre, s'il y a de l’un à l'autre un intervall, de deux ou trois jours , et de plus d'une centaine de pas.
Cela posé, quel est maintenant celui des deux systèmes qui donne au poëte le plus de facilités pour démêler, dans un sujet dramatique, les élémens de l'action, pour les disposer à la place qui leur appartient, et les développer dans les proportions qui leur conviennent? C'est assurément celui qui, ne l'astreignant à aucune condition arbitraire et prise en dehors de ce sujet même, laisse à son génie le choix raisonné de toutes le données, de tous les moyens qu'il renferme. Que si, malgré ces avantages, le poëte ne sait point discerner les points saillans de son action, ni les mettre en évidence; s'il se borne à indiquer des événemens qui auraient besoin d’être développés; si ces événemens relégués dans les entr'actes, au lieu de former des anneaux qui entrent dans la chaine de l'action, ne tendent, au contraire, qu'à isoler ceux qui sont mis sous les yeux du spectateur, si, par leur importance ou par leur multiplicité, ils n'aboutissent qu'à produire une distraction importune de ce qui se passe sur la scène; si, en un mot, l’action est disloquée, la faute en est toute au poëte. Quelque graves qu'ils soient, de tels inconvéniens ne peuvent donc jamais être une raison d'adopter la règle en discussion, puisque l'en peut éviter ces inconvéniens sans se soumettre à cette règle: car je me borne, pour le moment, à prouver qu'elle est inutile.
Vous avez trouvé, Monsieur, dans la tragédie de Carmagnola la preuve de ces mauvais effets, que vous avez attribués au système qui exclut les deux unités; et je n'en parle ici que pour rendre justice à votre critique, et pour ne pas laisser tomber sur ce pauvre système le fardeau des erreurs personnelles de ses partisans. "On voit," dites-vous, "qu'il existe "entre le troisième et le quatrième acte l'intervalle d’une campagne tout entière: comment suivre à de telles distances la marche et les progrès de l'action?" J'accorde volontiers que c'est un véritable defaut; seulement faut-il voir à qui l'on doit l'imputer. C'est un peu au sujet, beaucoup à l'auteur; mais nullement au système.
Je passe à l'examen de la règle sous le rapport de la fixité des caractères, et je continue à citer "Ajoutez à ces inconvéniens l'apparition et la disparition fréquentes, dans ce système, de personnages avec lesquels le spectateur a à peine le temps de faire connaissance. "
Il est certes, dans tout sujet, un point audelà duquel l'apparition et la disparition des personnages devient trop fréquente, et dès lors vicieuse, en ce qu’elle fatigue l'attention et la transporte brusquement d'un objet à un autre, sans lui donner le temps de se fixer sur aucun. Mais ce point peut-il être déterminé d'avance, et par une formule également applicable à tous les sujets? Existe-t-il une limite précise audelà de laquelle l'inconvénient commence? On peut d'abord affirmer que la règle des deux unité n'est pas cette limite; car il est impossible de prouver que ce n'est que dans une action bornée à un jour et a un petit espace que les personnages peuvent se montrer et se dessiner de manière à être compris par le spectateur et à l'interesser. Où donc chercher cette limite absolue? Il ne faut la chercher nulle part, car elle n'existe pas. C'est une singulière disposition que celle que nous avons à nous forger des règles abstraites applicables à tous les cas, pour nous dispenser de chercher dans chaque cas particulier sa raison propre, sa convenance particulière. Que le poëte choisisse toujours une action dans laquelle il n'y ait qu'un nombre de personnages proportionné à l'attention qu'il est possible de leur donner, que ces personnages restent en présence du spectateur assez long-temps pour lui montrer la part quiils ont à l’action, et ce qu'il y a de dramatique dans leur caractère; voilà, je crois, tout ce qu'on peut lui prescrire sur ce point. Or, quel système, encore une fois, peut mieux se prêter à ce but que le système où l'action elle-même règle tout, où elle prend les personnages quand elle les trouve, pour ainsi dire, sur sa route, et les abandonne au moment où ils n'ont plus avec elle de relation intéressante? Et que l'on n'objecte pas que ce système, en admettant beaucoup d'événemens, exige naturellement l'intervention trop rapide de trop de personnages: on répondrait qu'il n'admet juste que les événemens dans lesquels le caractère des personnages peut se développer d'une manière attachante.
Du reste, j’obsorverai et peut-être conviendrez-vous que l'habitude et l'esprit systématique peuvent facilement faire paraître vicieux ce qui ne l'est pas pour des hommes autrement disposés. Des spectateurs ou des lecteurs instruits, éclairés et se croyant impartiaux, peuvent trouver que les personnages d'une action tragique disparaissent trop vite et reviennent trop souvent, par la seule raison qu'ils sont accoutumés à voir, dans des tragédies qu'ils admirent avec justice, les mêmes personnages occuper la scène jusqu’à la fin. Il regardent ce qui les choque comme un vice réel, comme une opposition aux lois naturelles de leur intelligence; et ce ne sera néanmoins que l'opposition, à un type artificiel de tragédie qu'ils ont admis et auquel ils ramènent toute tragédie possible. Car recevoir l’impression pure et franche des ouvrages de l'art, se prêter a ce qu'ils peuvent offrir de vrai et de beau indépendamment de toute théorie, est un effort difficile et bien rare pour ceux qui en ont une fois adopté une.
Si, accoutumés, comme ils le sont, à trouver dans la tragédie une action qui marche toujours sur les mêmes échasses, qui se replie, pour ainsi dire, à chaque instant, et toujours à peu près de la même manière sur elle-même, ils assistent, par hasard, à une tragédie conçue dans un système tout différent, à une tragédie où l'action se déroulera d'une manière plus conforme à la réalité, il est fort a présumer qu'ils ne seront pas dans la disposition la plus favorable pour l'examiner impartialement, pour y voir ce qui y est et n'y voir que cela. Tout leur examen ne sera qu'une comparaison pénible entre la tragédie d'un nouveau genre qu'ils ont sous les yeux, et l'idée abstraite qu'ils se sont faite de la tragédie. Dites-leur que l'habitude a une grande part à leur jugement, ils se révolteront, parce qu'il savent que l’habitude affaiblit la liberté et que nous sommes portés à nier tout ce qui asservit notre esprit. Ils ne manqueront pas de déclarer que c'est pour obéir aux lois de l'éternelle raison, à l'inspiration de la nature, qu'ils jugent comme ils jugent, qu'ils sentent comme ils sentent. Mais quoi qu'ils disent, il n'en sera pas moins vrai que toute leur critique a été fondée sur un étroit empirisme, qu'elle à été toute déduite de faits spéciaux; et c'est probablement cela même qui la fait paraître à tant d’hommes une connaissance éminemment philosophique.
Mais, pour revenir au point précis de la discussion, si un personnage se montre lorsqu'il est nécessaire; si dans le temps long ou court qu'il passe sur la scène, il dit des choses qui caractérisent une époque, une classe d'hommes, une passion individuelle, et qui les caractérisent dans le rapport qu’elles ont avec l'action principale à laquelle elles se rattachent; si l'on voit comment ces choses influent sur la marche des événemens; si elles entrent, pour leur part, dans l'impression totale de l'ouvrage, ce personnage ne se sera-t-il pas fait assez connaître? Qu'il disparaisse ensuite, quand l'action ne le réclame plus, quel inconvénient y a-t-il?
Mais voici, selon vous, Monsieur, un effet bien plus grave de la transgression de la règle: en outrepassant ses limites, il serait impossible de combiner la vraisemblance et l'intérêt dans le caractère des principaux personnages, avec sa fixité. "Et quant à ceux (des personnages) sur lesquels vous fixez particulièrement l'attention du spectateur, si vous les montrez toujours animés du même dessein, il en résultera langueur, froideur, invraisemblance, souvent même inconvenance choquante. Comment, par exemple, offrir, sans exciter le dègoût, un meurtre prémédité pendant plusieurs années et en plusieurs pays diffèrens? Si au contraire les desseins des personnages varient, l'unité d'action disparait, et l'intérêt s'affeiblit."
Permettez-moi de remonter à un principe bien commun, mais toujours sûr dans l'application. La vraisemblance et l'intérêt dans les caractères dramatiques, comme dans toutes les parties de la poésie, dérivent de la vérité. Or, cette vérité est justement la base du système historique. Le poëte qui l'a adopté ne crée pas les distances pour le plaisir d’étendre son action; il les prend dans l'histoire même. Pour prouver que la persistance d'un personnage dans un même dessein sort de la vraisemblance lorsqu'elle se prolonge au delà des limites de la règles, il foudrait prouver qu'il n'arrive jamais aux hommes d'aspirer à un but éloigné de plus de vingt-quatre heures, dans le temps, et de plus de quelques centaines de pas, dans l'espace; et, pour avoir le droit de soutenir que le degré de persistance dont il s'agit produit la langueur et la froideur, il faudrait avoir démontré que l'esprit humain est constitué de manière à se dégoûter et à se fatiguer d’être oublié de suivre les desseins d'un homme au delà d'un seul jour et d'un seul lieu. Mais l'expérience atteste suffisamment le contraire: il n'y a pas une histoire, pas un conte peut-être qui n'excède de si étroites limites. Il y a plus; et l'on pourrait affirmer que, plus la volonté de l'homme traverse, si l'on peut le dire, de durée et d’étondue, et plus elle excite en nous de curiosité et d'intérêt; que plus les événemens qui sont le produit de sa force se prolongent et se diversifient, pourvu toutefois qu'ils ne perdent pas l'unité, et qu'ils ne se compliquent pas jusqu'à fatiguer l'attention, et plus ils ont de prise sur l'imagination. Loin de se déplaire à voir beaucoup de résultats naître d'une seule resolution humaine, l'esprit ne trouve, dans cette vue, que de la satisfaction et du charme. La langueur et la froideur ne surviennent que dans le cas où cette résolution est mal motivée, ou n'a pas un objet important; ce qui est tout-à-fait indépendant de la durée de ses suites.
Quant au changement de desseins dans les personnages, je ne vois pas comment son effet serait d'affaiblir l'intérêt. Il fournit au contraire un moyen de l'exciter, en donnant lieu de peindre les modifications de l’âme, et la puissance des choses extérieures sur la volonté. Il favorise le développment des caractères, sans obliger à les dénaturer, parce que les desseins ne sont pas le caractère même, mais plutôt des indices, des conséquences da caractère. Je ne vois pas davantage comment le changement dont il s'agit détruirait l'unité dramatique. Cette unité ne consiste pas dans la fixité des vues et des projets des personnages tragiques; elle est dans les idées du spectateur sur l'esemble de l'action. En voici une preuve de fait, qui me paraît sans réplique: les desseins de personnages importans, souvent principaux, varient dans des tragédies auxquelles assurément vous ne refuserez pas l'unité d'action; et pour n'en chercher d'exemples que dans un seul auteur, Pyrrhus, Néron, Titus, Bajazet, Agamemnon, passent d'une résolution à la résolution opposée. Leur caractère n'en est pas, pour cela, moins constant: il y a plus; ces variations sont nécessaires pour le mettre pleinement à découvert. Celui de Néron, par exemple, se compose d'un certain goût pour la justice et pour la gloire, d'une pudeur qui est le fruit de l'éducation, de l'habitude de céder aux volontés des personnes à qui une haute réputation de vertu, ou une grande force d'âme, les droits de la nature, ou des services signalè ont donné de l'ascendant: avec cela se combinent la haine de toute supériorité, un grande amour de l’indépendance, le goût de la domination, et la vanité même de paraître dominer. Une passion que Néron ne peut satisfaire sans commettre un crime vient mettre en collision ces élémens contraires, ces deux moitiés, pour ainsi dire, de son áme. Les mauvais penchans triomphent, le crime est résolu, il est commandé: l'admirable discours de Burrhus fait varier le projet de Néron; l'indigne Narcisse, précisément parce qu'il connaît le caractère de son maitre, sait trouver, dans ses passions les plus vives et les plus basses, que Burrhus avait en quelque façon étouffées, les motifs d'une nouvelle variation, qui produit le dénoument de l'action. Il en est de même d'Agamemnon; si ces desseins étaient invariablement arrêtés, son caractère ne serait plus ce qu'il est, un mélange d'ambition et de sentimens naturels.
Que la représentation d'un meurtre prémédité pendant plusieurs années, et en plusieurs pays différens, ne soit propre qu'à exciter le degoût, je suis fort disposé à le croire. Mais le dégoût dérive du sujet même, indépendamment du système suivant lequel on pourrait le traiter. Je crois, par exemple, que tout le monde à peu près s'accorde à trover l'Atrée de Crébillon un personnage révoltant, et néanmoins le poëte ne fait pas parcourir à son action le temps réel qui s'est écoulé entre le tort et la vengeance; il ne représente que la dernière journée: mais qu'importe? le temps est énoncé dans la pièce, et il n'en faut pas davantage pour motiver le dégoût de l'auditoire. L'idée de tant d'années qui n'ont pas calmé la haine, qui n'ont pas affaibli le souvenir de l'injure, qui n'ont rien changé à des projets d'une atrocité ingénieuse et romanesque, n'en est pas moins présenté à la pensée du spectateur, malgré l'abstraction que fait le poëte du temps écoulé; la préméditation du crime n’en est pas moins sentie.
La determination arrêtée et constante de tuer son semblable suppose nécessairement l’état de l’âme le plus dépravé, j’ajouterais, et le plus dégradé, le moins poétique. Si une telle détermination est en harmonie avec le caractère du personnage; si c'est un intérêt privé, un passion égoïste qui la lui ont inspirée; s'il n'a pas eu de grandes répugnances à vaincre pour se résoudre à l'assassinat, c'est le caractère même qui est misérable, dégoûtant et peut-être incapable de devenir un sujet d'imitation poétique. Si, au contraire, ce n'est pas seulement avec de profondes souffrances, mais par la séduction d'une grande pensée, d'un dessein extraordinaire, d'une illusion puissante, qu'un homme a pris cette horrible résolution; si le sentiment du devoir et la voix de l’innocence qui cherche à triompher y ont opposé des obstacles; si cet homme a combattu, pour ainsi dire, sur tous le degrés de l'abime, c'étaient alors ces pensées, ces illusions, ces combats et la chute par laquelle ils ont fini, qu'il fallait représenter. C'est cela qui était profond, instructif et dramatique. Mais lorsque la lutte morale est terminée, lorsque la conscience est vaincue, et que l'homme n'a plus à surmonter que des résistances hors de lui, il est peut-être impossible d'en faire un spectacle intéressant; et peut-être le meurtre prémédité est-il un de ces sujets que le poëte tragique doit s'interdire.
Je dis peut-être, parce que toutes ces règles exclusives et absolues sont trop sujettes à être démenties par des expériences contraires et que l'on n'avait pu prévoir: on peut bien, sans péril, condamner a priori tout sujet qui n'aurait pas la vérité pour base: mais il me semble trop hardi de décider, pour tous les cas possibles, que tel ou tel genre de vérité est à jamais interdit à l'imitation poétique; car il y a dans la vérité un intérêt si puissant, qu’il peut nous attacher à la considérer malgré une douleur véritable, malgré une cortaine horreur voisine du dégoût. Si donc le poëte réussit, à force d’intérêt, à faire supporter au spectateur ces sentimens pénibles, -l faudra bien reconnaître qu'il a su mettre en ceuvre les moyens de l’art les plus forts et les plus sûrs. Il ne restera plus qu'à juger les effets de cette puissance qu'il aura exercée sur les âmes. Or, si l'impression qu'il a produite est éminemment morale, si le dégoût qu'il a excité est le dégoût du mal; si, en associant au crime des idées révoltantes, il l'a rendu plus odieux; s'il a réveillé dans les coeurs une aversion salutaire pour les passions qui entrainent à le commettre, pourra-t-on raisonnablement lui reprocher de n'avoir pas assez ménagé la délicatesse du spectateur? Je crois qu'on a imposé trop d'égards au poétes pour cette susceptibilité du public; qu'on leur a trop fait un dévoir d'éviter tout ce qui pouvait déplaire: il y a des douleurs qui perfectionnent l'âme; et c'est une des plus belles facultés de la poèsie que celle d'arrêter, a l'aide d'un grand intérêt, l'attention sur des phénomènes moraux que l’on ne peut observer sans répugnance.
Au reste, cela est indifférent à la question des deux unités; car le système historique, se prètant admirablement à la peinture graduée des évenemens et des passions qui peuvent porter au meurtre, donne les moyens d'écarter, dans tous les sujets où le meurtre est représenté, cette longue et dégoûtante préméditation. Je ne sais si le système des deux unités présente à cet égard les mêmes facilitès, et s’il ne met pas le poëte dans l'alternative de supposer le meurtre prémédité, ou de ramener d'une manière invraisemblable et forcée. On pourrait peut-être, pour la solution de ce doute, tirer quelque lumière de l'examen comparatif de deux tragédies traitées dans deux systèmes différens, et dont le sujet est foncièrement à peu près le même: ce sont l'Othello de Shakespeare et la Zaïre de Voltaire. Dans l'une et dans l'autre pièce, c'est un homme qui tue la femme qu'il aime, la croyant infidèle. Shakespeare a pris tout le temp dont il avait bésoin; il l’a pris de l'histoire même qui lui a furni son sujet. On voit, dans Othello, le soupçon conçu, combattu, chassé, revenant sur de nouveaux indices, excité et dirigé, chaque fois qu'il se manifeste, par l'art abominable d'un ami perfide; en voit ce soupçon arriver jusqu'à la certitude par des degrés aussi vraisemblable que terribles. La tâche de Voltaire était bien plus difficile. Il fallait qu’Orosmane, généreux et humain, fût assez difficile sur les preuves de son malheur pour n’être pas d'une crédulité presque comique; que, plein, le matin, de confiance et d'estime pour Zaïre, il fût poussé, le soir du même jour, à la poignarder, avec la conviction d'en être trahi. Il fallait des preuves assez fortes pour produire une telle conviction, pour changer l’amour en fureur, et porter la colère jusqu'au délire. Le poëte ne pouvant, dans un si court intervalle, rassembler les faux indices qui nourrissent lentement les soupçons de la jalousie, ne pouvant conduire par degrés l'âme d'Orosmane à ce point de passion où tout peut tenir lieu de preuve, a été obligé de faire naître l'erreur de son héros d'un fait dont l'interprétation fût suffisante pour produire la certitude de la trahison. Il a fallu, pour cela, règler la marche fortuite des événemens de manière que tout concourût à consommer l'illusion d'Orosmane, et mettre à l'écart tout ce qui aurait pu lui révéler la vérité. Il a fallu qu'on écrivit a Zaïre une lettre équivoque, que cette lettre tombât dans les mains d'Orosmane, et qu'il pût y voir que Zaïre lui préférait un autre amant. Ce moyen, qui n'est ni naturel, ni instructif, ni touchant, ni même sérieux, est cependant une invention très ingénieuse, le système donné, parce qu'il est peut-être le seul qui pût motiver, dans Orosmane, l'horrible résolution dont le poëte avait besoin.
La force croissante d'une passion jálouse dans un caractère violent, l'adresse malheureuse de cette passion à interpréter en sa faveur, si on peut le dire, les incidens les plus naturels, les actions les plus simples, les paroles les plus innocentes, l'habileté épouvantable d'un traitre à faire naître et à nourrir le soupçon dans un àme offensée, la puissance infernale qu'un scélérat de sang-froid exerce ainsi sur un naturel ardent et généreux; voilà quelques-unes des terribles leçons qui naissent de la tragédie d'Othello: mais que nous apprend l'action de Zaïre? que les incidens de la vie peuvent se combiner parfois d'une manière si étrange, qu'une expression équivoque, insérée par hasard dans une lettre qui a manqué son adresse, vienne à occasioner les plus grands crimes et les derniers malheurs? A la bonne heure: ce sera là une leçon, si l'on veut; mais une leçon qui n'aura rien de bien impérieux, rien de bien grave. La prévoyance et la morale humaines ont trop à faire aux choses habituelles et réelles pour se mettre en grand souci d'accidens si fortuits, et, pour ainsi dire, si merveilleux. Ce qu'il y a, dans Zaïre, de vrai, de touchant, de poétique, est dû au beau talent de Voltaire; ce qu'il y a dans son plan de forcé et de factice me semble devoir être attribué, en grande partie, à la contrainte d'e la règle des deux unitès.
L'intervention de Jago, que j’ai indiquée - rapidement tout à l'heure mérite une attention plus expresse: elle est en effet, dans la tragédie d'Othello, un grand moyen et peut-être un moyen indispensable pour produire la vraisemblance. Jago est le mauvais génie de la pièce; il arrange une partie des événemens, et les empoisonne tous; il écarte ou dénature toutes les réflexions qui pouvaient amener Othello à reconnaître l'innocence de Desdemona. Voltaire à été obligé de faire naître des accidens pour confirmer les soupçons auxquels tient la catastrophe de sa pièce: il fallait bien qu'Orosmane eût aussi un mauvais conseiller pour l'égarer; et ce mauvais conseiller, c'est le hasard: car, si l'on recherche la cause du meurtre auquel il se laisse emporter, elle est tout entière dans un jeu bizarre de circonstances que l'auteur n'a pas même eu la pensée de rattacher à l'idée de la fatalité, et qui n'ont point en effet le caractère au moyen duquel elles auraient été susceptibles d'y être ramenées. Dans Othello, le crime découle naturellement, et comme j’ai son propre poids, de la source impure d'une volonté perverse; ce qui me paaraît aussi poétique que moral. On voudrait exclure de la scène les scélérats subalternes, parce qu'on trouve que la bassesse dans le crime est dégoûtante: soit; mais, ne faudrait-il pas en exclure aussi le crime même? Cependant, puisque le crime a une si grande part dans la tragédie, je ne vois pas quel mal il y a à le représenter accompagné toujours de quelque chose de bas. Il n'arrive guère, heureusement, que les affaires où ne prennent part que de belles âme se terminent par un meurtre; et je crois que cette indication de l'expérience est bonne à consacrer dans les compositions poétiques.
Voilà, Monsieur, les observations que j'avais à vous soumettre sur les nouveaux fondemens que vous voudriez donner à la règle des deux unités. Je n’examinerai point ici les autres objections que l'on fait au système historique: il ne serait pas juste de vous ennuyer par la discussion formelle d’opinions qui ne sont peut-être pas les vôtres. Mais, puisque j'ai déjà perdu l'espoir de faire cette lettre courte, permettez-moi d'y joindre encore quelques réflexions sur la manière dont on pose et dont on traite généralement la question des unités dans le drame. Si ces réflexions étaient fondées, elles pourraient faciliter la solution de la question elle-même.
Plusieurs d’entre ceux qui soutiennent la nécessité de la règle emploient souvent, pour qualifier les deux opinions contraires, des mots qui expriment des idées on ne peut plus graves, mais qui, au fond, n'ajoutent rien à la force de leurs argumens. Ce sont, pour eux, d'un côté, la nature, la belle nature, le goût, le bon sens, la raison, la sagesse, et, peu s'en faut, la probité; de l'autre côté, ce sont l'extravagance, la barbarie, la monstruosité, la licence, et que sais-je encore? Certes, si, de tous ces grands mots, les premiers peuvent s'appliquer au système des deux unités, et les autres au système contraire, le procès est jugé. Il est hors de doute que la sagesse vaut mieux que l'extravagance, et même que celle-ci ne vaut rien du tout; et quand Horace ne l'aurait pas formellement prescrit, tout le monde conviendrait de bonne gràce qu'il ne faut pas loger les dauphins dans les bois. Mais lorsque les adversaires de la règle soutiennent que la tragédie, telle qu'ils l'a conçoivent, n'est pas un bois, et qu'ils n'y transportent pas des dauphins; lorsqu'ils prétendent que c'est pour ne pas blesser la nature et la raison qu'ils récusent la règle, lorsqu'ils veulent prouver que c’est celle-ci qui est bizarre parce-qu'elle est arbitraire; c'est là-dessus qu'il faut les attaquer, et les réfuter, si l’on peut: Au reste, on doit le savoir et en prendre son parti, ceux qui défendent des opinions établies ont l'avantage de parler au nom da grand nombre; ils peuvent, sans témérité, employer le langage le plus affirmatif, le plus-sentencieux, et c'est un avantage auquel il est rare que l'on veuille renoncer. Jugez, d'après cela, Monsieur, si je me félicite d'ávoir trouvé l’occasion de justifier une opinion nouvelle devant un critique qui, au lieu de se prévaloir de la force que le consentement de la majorité et une espèce de prescription peuvent donner à la sienne, ne cherche, au contraire, qu'à l’appuyer sur le raisonnement!
Une autre méthode, à peu près aussi expèditive, aussi usitée et aussi concluant que la précédente, de prouver la nécessité de l’unité de temps et de lieu dans la tragédie, c'est de montrer que, sar certains théâtres où la règle n'est pas admise, on a donné souvent à l’action une étendue excessive; c'est de citer avec un mépris triomphant ces tragédies dans lesquelles un personnage,
" Enfant
au premier acte, est barbon au dernier. "
Cela est absurde, sans doute: et ceux qui ne veulant pas de la règle font mieux qua de reconnaître simplement cela pour absurde; ils en prouvent l’absurdité par des raisons tirées de leur système. Ce qu’ils contestent, c’est la règle:
Qu’en un lieu, qu’en un jour, etc.
On peut très aisément éviter l’excès signalé dans les vers de Boileau, sans adopter la limite posée par lui. Se fonder sur cet excès pour établir cette limite, c’est faire comme celui qui, après avoir sans peine démontré que l’anarchie est une fort manvaise chose , voudrait en conclure qu’il n’y a rien de mieux, en fait de gouvernement, que le gouvernement de Constantinople.
Enfin, après avoir désapprouvé, à raison ou à tort, tel ou tel exemple donné par quelque poëte qui s’est affranchi de la règle, on s’en prend au système historique, sans examiner si ce qu’un poëte a fait, dans un cas donné, est ou n’est pas une conséquence de son système. Ainsi, par exemple, Shakespeare à souvent mêlé le comique aux événemens le plus sérieux. Un critique moderne, à qui l’on ne pourrait refaser sans injustice beaucoup de sagacité et de profondeur, a prétendu justifier cette pratique de Shakespeare, et en donner de bonnes raisons. Quoique puisées dans une philosophie plus élevée que ne l’est en général celle que l’on a appliquée j’usqu’ici à l’art dramatique, ces raisons ne m’ont jamais persuadé; et je pense, comme un bon et loyal partisan du classique, que le mélange de deux affets contraires détruit l’unité d’impression nécessaire pour produire l’émotion et la sympathie; ou, pour parler plus raisonnablement, il me semble qua ce mélange, tel qu’il a été employé par Shakespeare, a tout-à-fait cet inconvénient. Car, qu’il soit réellement et à jamais impossible de produire une impression harmonique,et agréable par le rapprochement de ces deux moyens, c’est ce que je n’ai ni le courage d’affirmer, ni la docilité de répéter. Il n’y a qu’un genre dans lequel on puisse refaser d’avance tout espoir de succès durable, même au génie, et ce genre c’est le faux: mais interdire au génie d’employer des matériaux qui sont dans la nature, par la raison qu’il ne pourra pas en tirer un bon parti, c’est évidemment pousser la critique au delà de son emploi et de ses forces. Que sait-on? Ne relit-on pas tous les jours des ouvrages dans le genre narratif, il est vrai, mais des ouvrages où ce mélange se retrouve bien souvent , et sans qu’il ait été besoin de le justifier, parce qu’il est tellement fondu dans la vérité entrainante de l’ensemble, que personne ne l’a remarqué pour en faire un sujet de censure? Et le genre dramatique lui-même n’a-t-il pas produit un ouvrage étonnant, dans lequel on trouve des impressions bien autrement diverses et nombrouses, des rapprochemens bien autrement imprévus que ceux qui tiennent à la simple combinaison du tragique et du plaisant? et cet ouvrage, n’a-t-on pas consenti à l’admirer, à la seule condition qu’on ne lui donnerait pas, le nom de tragédie? condition du reste assez douce de la part des critiques, puisqu’elle n’exige que les sacrifice d’un mot, et accorde, sans s’en apercevoir, que l’auteur, en produisant un chef-d’euvre, a de plus inventé un genre. Mais, pour rester plus strictement dans la question, le mélange du plaisant et du serieux pourra-t-il être transporté heureusement dans le genre dramatique d’une manière stable, et dans des ouvrages qui ne soient pas une exception? C’est, encore une fois, ce que je n’ose pas savoir. Quoi qu’il en soit, c’est un point particulier à discuter, si l’on croit avoir assez des données pour le faire; mais bien certainement un point dont il n’y a pas de conséquences à tirer contre le système historique que Shakespeare a suivi: car ce n’est pas la violation de la règle qui l’a entrainé à ce mélange du grave et du burlesque, du touchant et du bas; c’est qu’il avait observé ce mélange dans la réalité, et qu’il voulait rendre la forte impression qu’il en avait reçue.
Jusqu’ici je me suis efforcé de prouver que le système historique non seulement n’est pas sujet aux inconvéniens que vous lui attribuez, en ce qui concerne l’unité d’action et la fixité des caractères; mais qu’il offre, sous ces rapports, les moyens les plus aisés et les plus sûrs d’approcher de la perfection de l’art. Du reste, quand je n’aurais pas réussi, quand il serait bien démontré que ces inconvéniens sont réels, la condamnation du système ne s’ensuivrait pas encore. Il faudrait auparavant les comparer, à ceux qui naissent de l’observance de la règle, et choisir le système qui en offre le moins; car on ne saurait, penser que le système des deux unités soit sans inconvéniens, et qu’une règle, qui impose à l’art qui imite des conditions qui ne sont pas dans la nature que l’on veut imiter, aplanisso d’elle-même toutes les difficultés de l’imitation.
Sans prétendre examiner à fond l’influence que les deux unités ont exercé sur la poésie dramatique, qu’il me soit permis d’examiner quelques-uns de leurs effets qui me semblent défavorables; et, pour m’éloigner le moins possible du point de vue que vous avez choisi, je noterai de préférence ceux qui me paraissent résulter du plan que vous avez proposé pour le sujet de Carmagnola. Vous ne verrez, je l’espère , dans le choix de ce texte, ni une intention hostile, ni une misérable représaille. Je voudrais être aussi sûr que cette lettre ne sera pas ennuyeuse, que je le suis d’avoir été déterminé à l’écrire par un sentiment d’estime pour vous, et de respect pour ce qui me parait la vérité. Si les règles factices n’induisaient en erreur que des esprits faux et dépourvus du sens du beau, on pourrait les laisser faire et s’épargner la peine de les combattre: ce sont les mauvais effets de leur tyrannie sur les grands poëtes et sur les critiques judicieux qu’il importerait de constater, pour les prévenir; je transcris donc la partie de votre article que j’ai ici en vue: " Supposons, maintenant, qu’un auteur asservi aux, règles, eût eu ce sujet à traiter. Il eût d’abord rejeté dans l’Avant-scène, et l’election de Carmagnola au généralat vénitien, et la bataille de Maclodio, et la déroute de la flotte, et l’affaire de Crémone. Tout cela est antérieur à l’action proprement dite, et un récit pouvait l’exposer parfaitement. La pièce eût commencé au moment où le comte, rappelé par le sénat, est attendu à Venise. Le premier acte eût peint les alarmes de sa famille, excitées par les bruits qui circulent sur les intentions perfides du sénat. Mais bientôt l’arrivée du comte, et sa réception triomphale changent les craintes en joie, et l’acte finit au moment où il se rend au conseil pour délibérer sur la paix. Ainsi la pièce était aussi avancée à la fin du premier acte qu’elle l’est chez M. Manzoni à la fin du quatrième; et l’auteur, pour fornir sa carrière, se trouvait comme forcé de créer une action, un noeud, des péripéties, de mettre en jeu les passions, d’exciter la terreur et la pitié. Mais quelles ressources n’avait-il pas pour cela? Et les révélations de Marco, et les intrigues du duc de Milan, et les divisions dans le sénat, et les mécontentemens populaires, et le pouvoir du comte sur l’armée, et enfin tout le trouble et tous les dangers d’une république qui a conflé sa défense à des troupes mercenaires. Ce grand tableau est à peine ébauché dans la pièce de M. Manzoni. Ne pouvait-on pas d’ailleurs faire en sorte que Carmagnola, sollicité par le duc de Milan, se trouvât un moment maitre du sort de la république? La parenté de sa femme avec le duc, son empire sur les autres condottieri, et l’assistance du peuple, pouvaient amener naturellement cette situation. Le poëte eût ainsi mis en présence dans l’âme du héros les sentimens de l’homme d’honneur avec l’imagination turbulente du chef d’aventuriers, et Carmagnola, abandonnant par vertu le projet de livrer Venise qui veut le perdre, n’en eût été que plus intéressant lorsqu’il succombe; tandis que ce même projet eút servi à motiver et à peindre la timide eternelle politique du sénat. C’est ainsi que les limites de l’art donnent l’essor à l’imagination de l’artiste, et le forcent à devenir créateur. Que M. Manzoni se le persuade bien; franchir ces limites, ce n’est point agrandir l’art, c’est le ramener à son enfance."
Voici, Monsieur, les principaux inconvéniens qui me semblent résulter de cette manière de traiter dramatiquement les sujets historiques:1.° On se règle, dans le choix à faire entre les événemens que l’on représente devant le spectateur, et ceux que l’on se borne à lui faire connaître par des récits, sur une mesure arbitraire, et non sur la nature des événemens mêmes et sur leurs rapports avec l’action.2.° On resserre, dans l’espace fixé par la règle, un plus grand nombre de faits que la vraisemblance ne le permet.3° On n’en omet pas moins, malgré cela, beaucoup de matériaux très poétiques, fournis par l’histoire.4.° Et c’est là le plus grave, on substitue des causes de pure invention aux causes qui ont réellement déterminé l’action représentée.
Et d’abord, pour ce qui regarde le premier inconvénient, il est sûr que, dans chaque partie de l’action, le poëte peut découvrir le caractère et les raisons qui la rendent propre à être mise en scène, ou qui exigent qu’elle ne soit donnée qu’en narration. Or, ces raisons tirées de la nature des événemens, et de leur rapport avec l’ensemble de l’action et avec le but de l’art dramatique, le poëte se trouve obligé de les négliger dans une partie souvent très importante de l’action, je veux dire en ce qui concerne les faits qui ont précédé le jour de la catastrophe, et n’ont pu se passer dans le lieu choisi pour la scène. Indépendamment de toute considération sur leur importance et sur leur intérêt poétique, ces faits doivent être relégués dans l’avant-scène, et supposés avoir eu lieu loin du spectateur. Je conçois fort bien que, lorsqu’on a adopté les deux unités, en soit disposé à regarder ces sortes de faits, dans tout sujet dramatique, comme antérieurs à l’action proprement dite; mais, Monsieur, sans incidenter sur votre opinion dans l’exemple particulier que vous citez, je me permets de vous faire observer qu’il est en général fort difficile de déterminer le point où commence une action théâtrale, et qu’il serait contraire à toute raison et à toute expérience d’affirmer que toutes les actions historiques qui peuvent être, sous les autres rapports, de bons sujet de tragédie, ont eu leur véritable commencement dans les vingt-quatre heures qui ont précédé leur accomplissement. Je crois même que ce cas est très rare, et voilà pourquoi le poëte asservi aux règles, obligé, d’un côté, de reconnaître que plusieurs de ces faits, antérieurs au jour qu’il a choisi ne le sont cependant pas à l’action, mais en font partie, se trouve réduit à la gène des expositions, de ces expositions si souvent froides, inertes, compliquées, à l’ennui des quelles en se résigne, avec justice, comme à une condition rigoureuse du système accredité. On est si bien convenu de la difficulté des expositions tragiques, que l’on sait gré, même aux poëtes da premier ordre, de réussir quelquefois à en faire d’intéressantes et de dramatiques. Celle de Bajazet, par exemple, passe pour un chef-d’oeuvre de difficulté vaincue. Elle est fort belle, en effet; mais qu’est-ce qu’un système qui oblige d’admirer, dans un poëte tel que Racine, une exposition en action? Qu’est-ce qu’un système dans lequel il a fallu en venir a accorder au poëte tout le premier acte, pour préparer l’effet des quatre suivans, et dans lequel le spectateur n’a pas lieu de se plaindre si la partie dramatique du drame commence au second, quelquefois même au troisième acte?
Maintenant veut-on se faire une idée de tout ce qu’une telle méthode a de désavantageux pour l’art en général? Rien n’est plus facile: il n’y a, pour cela, qu’à considérer quelles beautés perdraient à être assujetties à cette règle des unités, des sujets largement et simplement conçus d’après le système contraire. Que l’on prenne les pièces historiques de Shakespeare, et de Goethe; que l’on voie ce qu’il en faudrait ôter à la représentation, ou remplacer par des récits, et que l’on décide si l’on ga-nerait au change! Mais, pour appliquer ici ces réflexions à un exemple particulier, je ne saurais mieux faire que de traduire un passage d’un écrit où cette application est on ne peut plus heureusement faite. Il s’agit d’un dialogue italien sur les deux unités, par mon ami. M. Hermès Visconti, qui, dans quelques essais de critique littéraire, a déjà donné au public la preuve d’une haute capacité, et qui promet d’illustrer l’Italie par les travaux philosophiques auxquels il s’est particulièrement voué. Il suppose, dans ce dialogue, qu’un partisan des règles, qui n’a pas cependant le courage de contester au sujet de Macbeth le mérite d’être admirablement tragique, propose les moyens de l’assujettir aux deux unités.





























