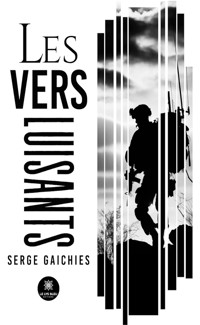
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Au cœur de la France en pleine guerre de 1944, les maquisards, emplis d’espoir et de désir de liberté, se rassemblent dans la vieille grange d’Astous, cherchant un repos éphémère sous le ciel étoilé. Pendant ce temps, une mystérieuse femme tisse sa toile dans l’ombre, plongée dans un déshabillé de soie noire. Entre les pénombres de la nuit et les secrets qui les enveloppent, la question demeure : qui a trahi ces lueurs fugaces de résistance ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Fort de son expérience en tant que cadre supérieur et manager,
Serge Gaichies intègre les enseignements de sa carrière à sa plume. Résidant dans les magnifiques Baronnies des Hautes-Pyrénées, son inspiration littéraire est également nourrie par les souvenirs d’enfance et les récits transmis par son grand-père, ancrés dans cette terre pittoresque.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Serge Gaichies
Les vers luisants
Roman
© Lys Bleu Éditions – Serge Gaichies
ISBN : 979-10-422-3694-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Tout ce que vous lirez dans ces pages repose sur des évènements et des faits malheureusement bien réels à partir desquels, par contre, tout a été romancé.
Il fallait bien trouver une explication à ce qui n’avait jamais été élucidé.
Sur la base d’une véritable réalité historique, tous les personnages sont donc fictifs.
Préface
Éléments de contexte
Quelques éléments précis nous sont nécessaires pour respecter une chronologie des faits conforme à ce qu’a été la réalité des évènements.
Nous disposons du témoignage du principal acteur, Bernard, ancien chef de la Résistance, qui raconte les différentes étapes des évènements survenus auparavant et qui nous permettent de remettre les choses dans leur contexte :
Le débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin 1944, suscita, à Bagnères, comme ailleurs, un immense espoir et l’extrême tentation de participer activement à la Libération du pays.
De Gaulle disait dans un message à la BBC : « Pour les fils de la France, où qu’ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre l’ennemi par tous les moyens dont ils disposent ».
Le 8 juin, Compagnet est réveillé par les bruits de la rue. Il constate une effervescence considérable et apprend que la Résistance occupe la sous-préfecture. Il vient aussitôt me prévenir. Les gens sont dans la rue, les drapeaux claquent aux fenêtres. Je suis abasourdi. Les ouvriers de Soulé et de Lorraine quittent leurs postes. Les agents de liaison partent vers Orignac où une section existe, on commence à distribuer de l’armement… Sur le plan militaire, j’installe des postes avancés à Montgaillard, Ordizan, Cieutat et vers Mauvezin. La mission de ces postes est exclusivement une action d’alerte.
Je fais lire par le crieur public que notre ville est une de celles qui viennent de recouvrer la liberté. Le Représentant du Gouvernement Provisoire de la République invite la population à observer le plus grand calme. Nous avons encore dans le département des troupes allemandes, et il n’est pas exclu qu’elles tentent une action sur Bagnères.
Le 10 juin au matin, aucun élément nouveau ne permet de penser que les Allemands vont passer à l’action.
Vers dix heures, je reçois dans le bureau du sous-préfet deux agents de Londres ; un officier anglais et son adjoint. Ils viennent de Pau se rendre compte de la situation à Bagnères, et me proposer un appui logistique.
Ils sont provisoirement installés au Presbytère de Pouzac, où ils ont leur radio. Les effectifs ne manquent pas et les volontaires affluent. Le 11 juin au matin, aucune information particulière ne me fait craindre une attaque allemande. Vers 11 heures, le poste de Montgaillard me fait savoir qu’un petit détachement allemand est entré dans le village, et s’est replié. Un certain flottement se produit dans la population.
Mais rien encore ne permet d’imaginer l’attaque de l’après-midi.
Vers 13 heures, les Allemands se présentent devant le poste de Montgaillard, qui se replie aussitôt, sans aucun coup de feu, de part et d’autre. Devant Trébons, un fusil-mitrailleur servi par Marquez, ouvre le feu sur les attaquants. Marquez est tué net à son poste.
Le massacre des innocents commence alors.
Les nazis tuent, dans le village de Trébons, 17 personnes, des enfants, des femmes, des vieillards. Monsieur Verdoux, le receveur des Postes est tué sur son lieu de travail, sa femme blessée. Un peu plus tard, à Pouzac, bien qu’aucun coup de feu n’ait été tiré, le massacre continue.
Treize personnes, toutes étrangères à la Résistance, sont exécutées, avec une sauvagerie inimaginable. Arrivés à Bagnères, les assaillants tirent au canon sur les wagons mis en travers de la route, ils atteignent la librairie Dejean qu’ils pulvérisent.
Là encore, aucun coup de feu n’est tiré, mais la sauvagerie nazie poursuit son œuvre, au hasard des rencontres, sans raison, les Allemands tuent 32 personnes. Ils poursuivirent leurs exactions jusqu’à Beaudéan, mais n’allèrent pas plus haut ce jour-là.
Pour la vérité historique, je précise que le corps allemand qui exerça cette terrible répression était le 3e bataillon de la Division Das Reich. Ce même bataillon accumula les destructions de bâtiments et les assassinats dans l’Ariège et dans le Gers.
Le 25 juin, un fort contingent allemand attaque Lesponne et le Chiroulet. L’attaque allemande est sévère, six civils de Lesponne, dont une vieille femme de 75 ans assise devant sa cheminée, sont néanmoins abattus.
Le 10 juillet, c’est l’attaque de ce qu’il reste du maquis de Payolle (14 maquisards tués). Dans l’après-midi, avec plus de 30 tués, les Allemands quittent alors la position.
Quelques mois plus tôt, en février 1944, l’autre moitié du Groupe Bernard s’était repliée depuis Payolle, dans les bois surplombant le village de Banios. Le petit village, dont Eugène Sarrat est maire, compte près de cent cinquante âmes et est situé sur l’autre versant de la vallée à une quinzaine de kilomètres.
Payolle est un petit village d’une vallée voisine au-dessus de Bagnères-de-Bigorre. Le Groupe Bernard comptait une cinquantaine de maquisards aguerris.
Le fondateur en est le Capitaine Maurice Benezech (nom de code : Bernard).
Le groupe mène la vie dure à l’ennemi depuis des mois : sabotage de ponts et de routes, attaque de convois, destruction de matériel militaire…
En conséquence, l’envahisseur a décidé d’en finir et déclenche sans tarder une attaque de nuit en règle à laquelle la moitié des maquisards n’ont pas survécu.
Le groupe Bernard doit alors abandonner provisoirement les sites d’Antayente (vallée de Lesponne), à 1285 mètres d’altitude et du Courbet (1300 m).
Bernard porte alors son choix pour un repli au sud-est de Bagnères, dans la région des Baronnies, une zone boisée, au-dessus du village de Banios le 20 février 1944.
Eugène Sarrat, maire du village (ancien Officier de la guerre 1914-18), et Jean Dabat, son cousin et conseiller municipal, offrent deux granges, d’accès difficile, en lisière de forêt et proche d’un petit torrent pour l’hébergement du Groupe Bernard.
Chapitre I
1942-1944
La résistance – Les dénonciations
Comme Leclerc entra aux Invalides, avec son cortège d’exaltation dans le soleil d’Afrique, entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé, comme toi ; et même, ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé ; avec tous les rayés et tous les tondus des camps de concentration, avec le dernier corps trébuchant des affreuses files de Nuit et Brouillard, enfin tombé sous les crosses ; avec les huit mille Françaises qui ne sont pas revenues des bagnes, avec la dernière femme morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l’un des nôtres. Entre avec le peuple né de l’ombre et disparu avec elle – nos frères dans l’ordre de la Nuit…
Extrait du discours d’André Malraux
pour le transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon,
Paris, le 19 décembre 1964
I
Eugène Sarrat, Jean Dabat, Paul Mathou
C’était le matin du 30 mars 1944. L’air respirait l’enchantement et la lumière scintillait sur les reliefs des collines des baronnies, le temps était beau et frais.
Il venait juste de pleuvoir en fin de nuit et un soleil chassait les dernières traces de l’averse. C’était une belle journée de début de printemps, une de celles qui donne envie de respirer à pleins poumons les yeux fermés.
Jean Dabat enchaînait les petits virages sur les derniers kilomètres qui le séparaient encore de Banios.
Dans l’ignorance du drame qu’il allait vivre, il admirait, sans doute pour la millième fois et toujours avec le même ravissement, les ondulations des vallées et des montagnes qui se découpaient sur sa gauche. Quelques milans traçaient des ronds réguliers dans le ciel, dans l’espoir d’apercevoir un mulot imprudent qui aurait pu agrémenter leur petit déjeuner.
Tout était calme, profond, beau.
Le ronronnement du moteur de sa Citroën 11 Légère accompagnait ses pensées et se mêlait au bruissement du vent dans sa galerie de toit.
Il avait réglé la carburation de son moteur hier en même temps qu’il en avait terminé l’entretien. Il faisait tout cela lui-même.
En tant qu’ancien garagiste, et avec le peu de temps libre que lui laissait l’exploitation de sa ferme, il avait toujours les mains dans la mécanique. Il savourait le son de son moteur, celui du travail bien fait. Il roulait vitre ouverte, son bras gauche sur la portière. L’air vivifiant caressait doucement sa peau et remplissait ses poumons. Jamais il n’aurait pu vivre ailleurs.
Il aimait son pays depuis toujours d’un amour véritable.
Il ne laissait rien au hasard, et rendait de nombreux services à tous.
Jean était le cousin du maire de Banios. Toujours actif, disponible, engagé dans son métier, il était aimé de tous.
Bien que plus en activité, son garage ressemblait à s’y méprendre à celui d’un professionnel, il savait et pouvait tout faire sur une voiture. En ces temps de guerre et de pénuries, il était en cela un des hommes clés du village…
Il vivait seul avec son fils de quatorze ans et sa mère Antoinette. Son épouse était décédée de maladie depuis bientôt dix ans.
Il avait fermé sa petite entreprise au décès de son père afin d’aider sa mère à conserver la ferme familiale. Souvent, dans le pays, il en était ainsi.
Rendre service était, pour lui, une deuxième nature. Il était en permanence occupé : ses vaches, ses obligations de conseiller municipal, la mécanique, tout cela lui prenait beaucoup de son temps.
Jean était un gaillard solide, grand et fort. Ses cheveux coupés en brosse laissaient deviner quelques cicatrices sur le côté gauche de sa tempe, souvenir d’un accident de ferme qui avait bien failli lui coûter la vie. Ses mains calleuses racontaient son histoire, sans qu’il ait besoin d’ouvrir sa bouche : une vie de labeur. Son troupeau de quinze gasconnes aux cornes relevées et au caractère bien trempé, conforme à celui de la race, était sa fierté. Il possédait aussi un taureau, du nom de Taranis, placide et fier, une bonne bête, comme disait sa mère. Une dizaine de cochons, des porcs noirs de Bigorre, complétaient son cheptel. Comme chez la plupart des paysans, la cour de la ferme était remplie de poules, canards et oies, destinés à une consommation domestique. Il avait aussi un magnifique potager en terrasse juste à l’arrière de l’étable. Exposé plein sud, il donnait bien, et produisait haricots tarbais, haricots verts, choux, salades, carottes, radis noirs, oignons, pommes de terre, pommes, poires. En fond de terrain, un grand noyer séculaire protégeait de son ombre l’abreuvoir des bêtes et produisait plusieurs sacs de noix pour l’hiver. La ferme était, comme beaucoup d’autres à cette époque, en quasi-autarcie. Sa mère faisait son pain une fois par semaine dans le four à bois et aller à la ville deux fois par mois suffisait largement pour acquérir ce que l’on ne produisait ni ne fabriquait sur place.
Ce matin, il était justement descendu à Lannemezan pour effectuer quelques achats pour son atelier : pièces détachées de la marque, vis, lubrifiants, sa liste de courses était toute rayée, posée à côté de lui sur le siège passager.
C’était le cœur léger qu’il revenait au village, non sans avoir pris un verre à la terrasse du Café des sports comme à son habitude.
Il n’aimait pas la ville, mais elle lui manquait parfois, il n’y aurait pas vécu, mais il appréciait d’y aller de temps en temps. À près de quarante ans, sa carrière de rugbyman amateur était à présent terminée, mais il lui en demeurait pas mal de connaissances et surtout beaucoup de souvenirs. Il était connu et connaissait aussi beaucoup de ce petit monde des vallées. Il rencontrait en ville quelques anciens coéquipiers, avec lesquels il prenait plaisir à prendre des nouvelles.
C’est ce jour-là que Jean fit semblant d’apprendre la dissolution du maquis de Payolle et le repli de ce même maquis sur la forêt de Banios. Il avait bien sûr eu cette information quelques semaines avant les autres.
Jean Dabat était aussi le cousin du maire du village, Eugène Sarrat.
Que dire d’Eugène ? Une figure, un homme respecté. Il en était à son troisième mandat de Maire. Habitué à rendre service et à se plier en quatre pour la petite communauté de Banios, il administrait le village comme on s’occupe de sa propre famille. C’était un homme puissant et fort, à la carrure imposante, toujours en pantalon à bretelles.
Le dimanche et les jours de cérémonies, ses chemises en coton blanc étaient toujours impeccables. Dans ses sabots en châtaigniers, il portait, été comme hiver, des chaussons tricotés en laine grise. La chaînette en argent de sa montre gousset dépassait toujours de son gilet et disparaissait ensuite dans une petite poche plaquée sur le côté de son torse. Son béret de feutre noir, porté bas sur son oreille droite, venait peaufiner l’autorité d’ensemble de son allure.
Il était propriétaire exploitant, de père en fils, de la scierie du village et en semaine il travaillait dur comme tout le monde ici. La grande scie à ruban fonctionnait continuellement dans un ronronnement régulier. La machine était mise en mouvement par une belle roue à aubes en bois, située juste en dessous sur le bief du moulin. Toute sa famille vivait ici de père en fils.
Les forestiers lui apportaient chaque jour les grumes de chênes, de frênes et de châtaigniers qu’il débitait en planches, planchettes et voliges et revendait ensuite aux villageois. De fait, dans la petite commune, on produisait sur place les matériaux essentiels pour construire. Dans la rivière, on trouvait en abondance de beaux galets bien ronds capables de monter et de soutenir de solides édifices.
Une fois par mois, le camion marchand de la société Alsacienne Stoltz venait sur la place du village proposer le complément de quincaillerie nécessaire.
Leur ami et troisième comparse, Paul Mathou, était ouvrier menuisier forestier. Il avait quitté l’école comme beaucoup au village, avec son certificat d’études primaires en poche. Son institutrice, Mademoiselle Yvette Soulé, une vieille fille de Tarbes, installée à Banios, suite à sa mutation de fin de carrière, l’adorait. Paul était orphelin et avait été élevé par son oncle et sa tante, les Castera, de braves gens. C’était un garçon vaillant, droit et honnête comme se plaisait à le dire Mademoiselle Soulé. Il dut travailler jeune, dès l’âge de quatorze ans et il sera embauché comme compagnon à la scierie du maire, Eugène Sarrat.
Très tôt, sa fibre patriotique le poussa à s’engager en résistance. Un matin de janvier 1943, il ne se présenta plus jamais à son travail. Il rejoindra définitivement le maquis du groupe Bernard à Payolle et prendra la clandestinité.
II
Henri et Eva
Dans le village, un autre personnage deviendra important pour la suite des évènements : Henri Dulac.
C’était un jeune habitant de Banios, enseignant en français de son état au Lycée de Bagnères, il était un des rares à avoir réussi à s’extirper de la ferme familiale. Il faisait figure d’intellectuel, ou en tout cas il incarnait une certaine réussite au milieu des jeunes de son âge.
C’était un homme intelligent, charitable et bienveillant.
Il fréquentait une jeune femme habitant Bagnères-de-Bigorre à une dizaine de kilomètres du village. Ils s’étaient rencontrés à la ville, Henri y allait chaque jour de la semaine, car il enseignait le français au collège et animait bénévolement des cours destinés aux réfugiés de toutes origines auprès de deux associations. Il y rencontrait des personnes de tous les pays proches, tous plus ou moins impactés par la guerre : Polonais, Italiens, Espagnols et Allemands…
C’est comme cela qu’il avait rencontré Eva Kolerski.
Un matin de juin 1943, elle était venue s’inscrire au cours de français d’Henri. Henri Dulac n’avait jamais vu une femme aussi belle : elle ne ressemblait à aucune jeune femme des environs, c’était une vraie jeune femme de la ville.
Le jour de leur rencontre fut comme une véritable illumination. On rentrait dans l’hiver et sitôt assise devant Henri, elle avait enlevé son bonnet de laine et laissé échapper d’un geste ample ses cheveux blonds bouclés sur ses épaules. Elle avait ouvert de grands yeux bleus étonnés devant la gentillesse d’Henri.
Elle disait arriver d’Autriche et avoir fui le régime nazi. Elle se sentit tout de suite à l’aise et en confiance, en expliquant comment elle était arrivée à Bagnères-de-Bigorre en cette période de guerre.
Elle expliqua à Henri son mariage avec un certain Otto Von Layer, officier de la Wehrmacht, son côté violent qui ne lui avait donné, selon elle, d’autre choix que de le fuir pour survivre.
Sa grande tante détenait depuis sa jeunesse un appartement au centre du bourg, depuis l’époque où elle venait en cure à Bagnères. Elle lui avait proposé de s’y installer quelque temps pour se reposer, prendre un peu de recul et réfléchir à son avenir.
Voilà tout ce qu’Henri savait d’Eva.





























