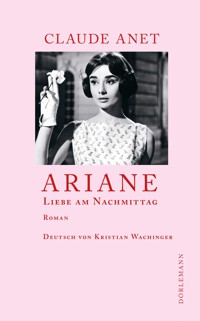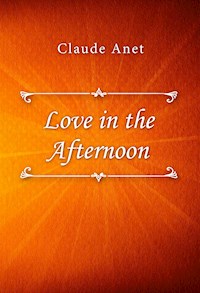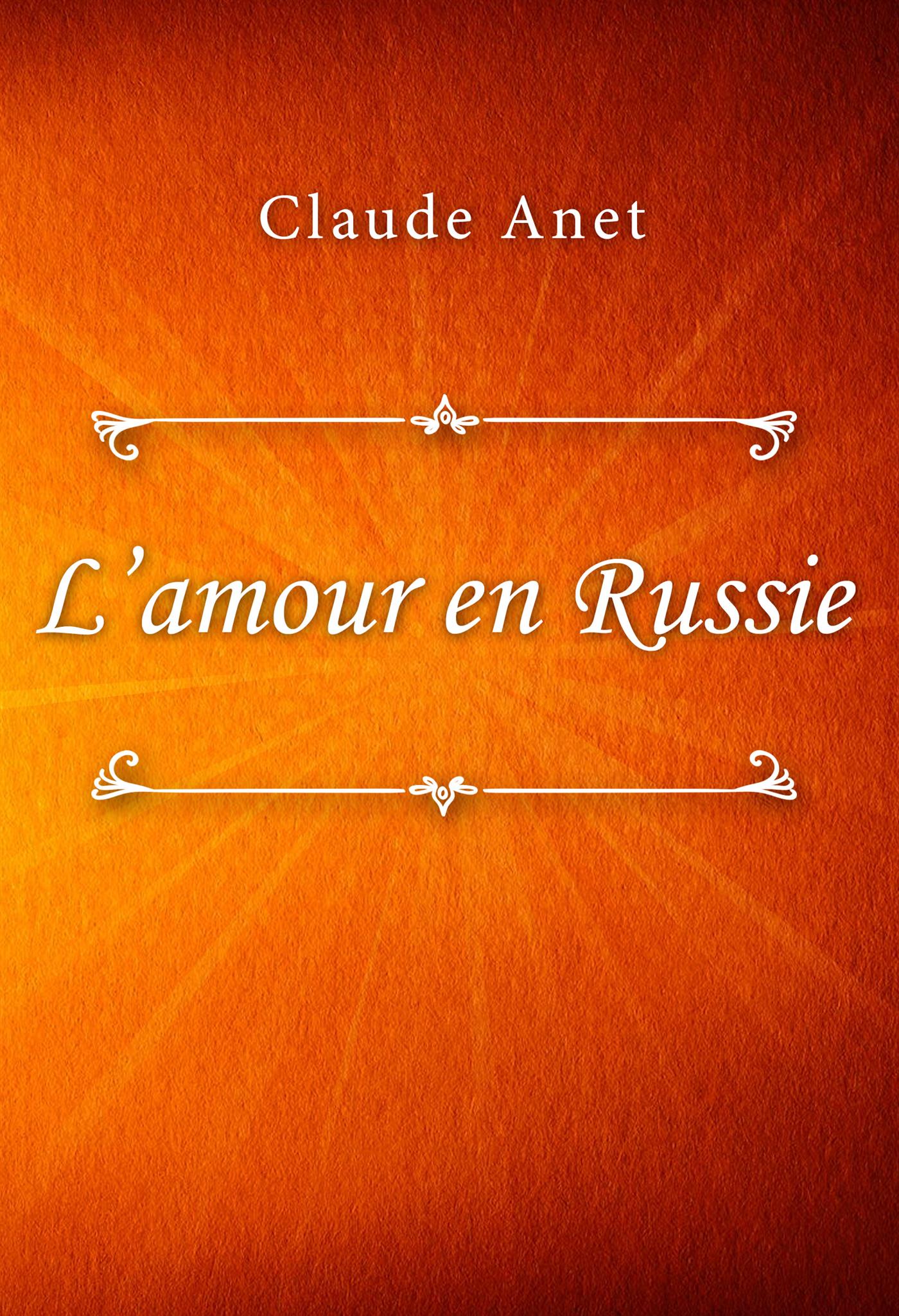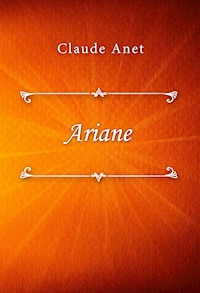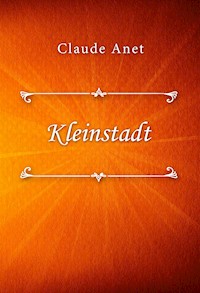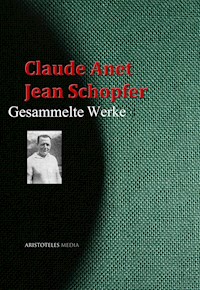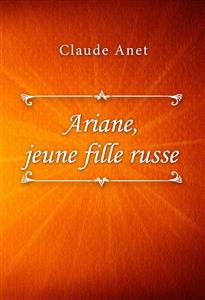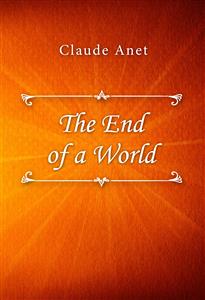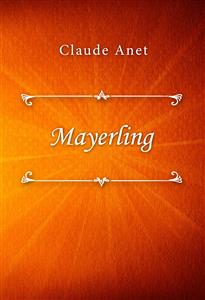
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un jour, aux courses, l’archiduc Rodolphe remarque une jeune fille dont la grâce sérieuse le frappe plus encore que sa beauté. Il demande son nom : c’est la baronne Marie Vetsera. Leurs regards se sont croisés et Marie s’est rendu compte de l’attention qu’on lui porte, mais n’en tire pas vanité. Que peut-il exister de commun entre le fils unique de l’empereur François-Joseph héritier du trône d’Autriche-Hongrie et elle-même qui, tout en appartenant à la haute société de Vienne, ne possède cependant pas assez de quartiers de noblesse pour être reçue au palais de la Hofburg? En dépit de ces réflexions raisonnables, Marie s’éprend du prince impérial. Elle a seize ans, l’âge de ces enfantillages, et sa passion soigneusement tenue secrète resterait peut-être un simple amour de tête si la comtesse Larisch, amie de sa mère et cousine de Rodolphe, n’entrait en scène et faisait disparaître tous les obstacles. La rêve commencé le 12 avril 1888 prend corps, mais c’est pour s’achever en tragédie le 29 janvier 1889 par les coups de feu tirés au pavillon de chasse de Mayerling. S’appuyant sur les archives officielles, Claude Anet a reconstitué la brève idylle de Marie Vetsera avec un talent qui donne l’éclat du roman à ce qui est une page de l’histoire de la Maison d’Autriche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Claude Anet
MAYERLING
Copyright
First published in 1930
Copyright © 2019 Classica Libris
Prologue
Une grande pièce, haute de plafond, richement meublée, dont les deux fenêtres ouvraient sur un parc aux arbres élevés, trop proches. Un paravent séparait mal du reste de la chambre un lit de milieu sur lequel une jeune femme était couchée. Ses cheveux bruns soigneusement nattés, étendus sur l’oreiller, lui faisaient une auréole. Le visage, bien que les traits en fussent contractés par la douleur, était beau ; les sourcils froncés traçaient une ligne droite. De la bouche fine et bien dessinée s’échappait parfois un gémissement et, sous le drap qui le recouvrait, on voyait le corps se tendre. Près du lit se tenait un groupe de personnes attentives, un vieillard en frac, une décoration piquée sur le revers de son habit, un homme plus jeune à la figure intelligente, en blouse blanche, et deux infirmières. À l’heure où toute femme froissée dans son corps et dans sa pudeur a le droit d’être seule, plusieurs personnes étaient réunies autour de cette femme qui souffrait. Elle appartenait, en effet, à une caste où ni douleur, ni joie ne peuvent être gardées secrètes et l’impératrice d’Autriche, Élisabeth, âgée de vingt ans, était contrainte à faire ses couches en public.
Dans une des fenêtres se tenait un petit homme rotond sur des jambes courtes, S. A. I. et R. l’archiduc Renier. Il s’entretenait à voix basse avec le conseiller intime Charles-Ferdinand, comte de Buol Schauenstein. Trois autres personnages en uniforme regardaient silencieux le parc aux allées droites sur lesquelles tombait l’ombre. Deux dames assises dans un coin chuchotaient. Un homme d’une trentaine d’années en uniforme vert foncé de général des uhlans, s’appuyait à la cheminée. Il était de taille moyenne, mince, les jambes longues ; le visage était encadré par de longs favoris blonds qu’unissaient des moustaches épaisses. Les cheveux, coupés courts, déjà se creusaient sur les tempes, le nez était un peu gros du bout, les yeux sans grande expression. Quelque maître qu’il fût de lui – et la vie qu’il menait depuis dix ans comme empereur d’Autriche et roi de Hongrie l’avait obligé à contrôler et à dissimuler ses sentiments – il ne pouvait cacher une grande nervosité qu’il traduisait en faisant claquer sur sa main droite les doigts de sa main gauche. Lorsque le claquement devenait trop fort, il s’en apercevait, s’arrêtait soudain et, tirant vivement ses moustaches, marchait vite de la cheminée à la fenêtre. Ses bottes craquaient sur le parquet. À la longue ce bruit énerva la jeune femme couchée et, de la main, elle lui fit signe de se tenir tranquille…
Il s’immobilisa aussitôt.
— Je te demande pardon, chérie, murmura-t-il.
Sur la pointe des pieds, comme un enfant pris en faute, il regagna la cheminée.
Une heure passa ainsi. La nuit venait et la gêne qui pesait sur les personnes présentes s’était accrue au point de devenir insupportable. Chacun comprenait, sans qu’il fût nécessaire de l’exprimer, qu’il assistait non pas à une cérémonie de cour, mais au plus émouvant des drames humains. Les habits chamarrés, les uniformes semblaient insulter à ce pauvre corps de femme tressaillant dans la peine. Le silence n’était troublé que par les gémissements qui, à intervalles plus rapprochés, montaient du lit de la patiente. L’empereur, toujours à la cheminée, ne pouvait s’empêcher par moment de faire craquer ses bottes. Des valets de pied chamarrés et indifférents apportèrent des candélabres où brûlaient des bougies. Leur flamme alluma quelques éclats sur les diamants des décorations et les dorures des boiseries.
Il y eut un mouvement dans le groupe des docteurs autour du lit. L’un d’eux se pencha sur la jeune femme qui se tordait dans les dernières douleurs ; un instant encore s’écoula, puis un gémissement plus fort fit tressaillir les témoins de cette scène dramatique ; l’empereur, n’en pouvant supporter davantage, laissa échapper un « Mein Gott » suppliant et se prit la tête entre les mains. Il y eut un cri, puis un silence si total que chacun entendait les battements de son cœur, et un vagissement s’éleva tout à coup, si simple, si humain, si frais, si inattendu malgré tout, que les yeux des assistants s’emplirent de larmes.
— C’est un garçon ! dit la voix forte du docteur.
— Dieu soit loué ! répondit l’empereur en se redressant.
Pendant que les médecins s’affairaient derrière le paravent, les portes furent ouvertes à deux battants sur le salon voisin et la joyeuse nouvelle communiquée. Le prénom choisi pour l’héritier fut annoncé. Il s’appellerait Rodolphe, en l’honneur du fondateur de la dynastie dix fois centenaire des Faucons qui avaient quitté les forêts de la Suisse pour venir planer sur l’Autriche. Une heure plus tard, le nouveau-né ondoyé, l’acte de naissance rédigé suivant les formes et daté du 21 août 1858, il ne restait plus au château de Laxenbourg que les médecins et les fonctionnaires de la Cour en service.
L’impératrice demanda alors que l’enfant lui fût apporté. Il venait d’être baigné et la nourrice le lui tendit, enveloppé dans des serviettes chaudes.
Longtemps l’impératrice le regarda. Il était si frêle, chétif, qu’il semblait ne pas devoir vivre. Les heures qu’elle venait de traverser lui revinrent à la mémoire. Tant de pompe, tant d’intérêts et de vanités réunis autour d’elle – et là cet enfant, qui n’avait que le souffle. Elle sentit peser sur lui le poids d’un passé lourd et tragique. Il appartenait à une race fine, sensible, trop faible pour supporter, non pas seulement le fardeau du pouvoir, mais celui de la vie, race d’êtres mélancoliques, inégaux à leur destinée, que parfois la folie emmenait loin du monde des humains. Quel cadeau avait-elle fait à ce petit être vagissant en lui donnant le jour ? Sur lui s’appesantiraient plus tard des responsabilités immenses. Il en serait écrasé.
À ce moment, on entendit crier sur le parquet les bottes de l’empereur. Il s’approcha et, se penchant vers sa femme et l’enfant, il dit d’une voix sonore :
— Il est superbe, notre fils. Ce sera un heureux gaillard.
Mais les yeux de la mère s’emplirent de larmes ; d’un mouvement passionné, elle serra le petit contre son cœur.
Première partie
1
PRINCE IMPÉRIAL
Trente ans plus tard, un officier galopait un pur-sang dans les allées du Prater dont les arbres commençaient à pousser de verts bourgeons. Malgré son jeune âge, il portait la petite tenue de général de dragons. Arrivé à l’extrémité de l’allée, il ralentit son cheval et le mit au pas. C’était un homme mince, de taille moyenne et bien prise, les yeux beaux, la moustache longue. Des cavaliers le croisèrent et le saluèrent avec déférence. Il leur retourna gracieusement leur salut.
Il mit pied à terre à l’endroit où l’allée principale arrive à la place que l’on appelle l’Étoile du Prater et qui est bordée de maisons. Il donna son cheval à un groom et il resta seul un instant sur le trottoir, attendant le phaéton qui devait venir le prendre. Bientôt il l’aperçut de l’autre côté de la place et fit quelques pas sa rencontre. Comme il longeait une maison de modes, de jeunes ouvrières sortirent, courant, se bousculant. L’une d’elles vint étourdiment le heurter et manqua de tomber. Il la retint, la remit sur ses pieds, eut un sourire aimable à son adresse, et continua sa route. La petite ouvrière le regardait ébahie.
Cependant les autres se moquaient d’elle.
— C’est ainsi que tu te jettes dans les bras des gens !
Mais une de ses compagnes, plus âgée, suivant des yeux l’officier qui s’éloignait lui dit sur un ton de reproche :
— Tu n’as pas honte, Greta, tu bouscules le prince impérial !
Toutes les jeunes filles restèrent stupéfaites. Elles se retournaient pour regarder le prince fameux dans Vienne. Était-ce vraiment lui qui était apparu au milieu d’elles comme par miracle ? À quelques, pas plus loin, ce héros montait dans un phaéton et le cocher lui tendait les rênes. Les chevaux se cabrèrent et partirent. Comme l’équipage passait près des ouvrières, immobiles maintenant et bouche bée, le prince les salua. Des mains se levèrent dans le groupe, des sourires joyeux éclairèrent de jeunes visages. « Qu’il est beau ! qu’il est aimable ! » entendait-on.
— Vous entendrai-je en confession, madame ?
Cette question était posée par le père Bernsdorf, supérieur des collèges jésuites en Autriche, à une dame un peu grande, à la taille épaisse, habillée sans trop d’élégance et qui n’était autre que S. A. I. et R., la princesse Stéphanie, femme du prince impérial.
Elle se trouvait dans le cabinet du père Bernsdorf au couvent des jésuites de la rue des Bernardins. Rien de plus simple que cette pièce blanchie à la chaux, au sol dallé de briques rouges. Une table de bois, deux fauteuils couverts de reps, deux chaises de paille, un prie-Dieu, en composaient tout l’ameublement.
À la question du jésuite la princesse répondit avec un rien de gêne :
— Non, mon père, je suis simplement venue causer avec vous.
Elle s’assit dans un des fauteuils et fit signe au père jésuite de prendre l’autre. La table les séparait.
Il faut croire que le sujet dont elle avait à entretenir le père jésuite était délicat, car la princesse hésita un peu avant de l’aborder. Ce que voyant, son interlocuteur lui vint en aide et mit la conversation sur le prince impérial. La santé du prince était-elle bonne ?
— Il abuse de lui-même, dit la princesse. Comment y résiste-t-il ? Vous le savez, mon père, il fait toutes choses avec passion, le travail, la chasse, le cheval. Ses journées sont pleines…
— Sa santé nous est fort précieuse à tous, dit le jésuite. Mais ne pourriez-vous exercer ici une bonne influence et obtenir de lui une heure ou deux de repos ?
La figure de la princesse se contracta.
— Je ne le vois jamais.
Elle s’arrêta brusquement comme si elle regrettait d’avoir parlé trop vite. Le ton de cette brève phrase éclaira le jésuite. Il n’en montra rien et poursuivit :
— Le soir, pourtant…
— Le soir, dit, la princesse avec embarras… nous sortons. S’il me mène à l’Opéra ou au Burgthéâtre, il ne reste guère avec moi ; il va dans les couloirs, dans les coulisses. Puis soupe avec des amis… Il ne m’invite pas, et pour cause.
Il y eut de la colère dans le regard de la princesse. Mais le père suivait sa pensée et d’une voix indifférente :
— Et plus tard ?
À cette question trop précise, il n’obtint pas de réponse… Il fallait éclaircir un autre point et le père ajouta après quelques secondes :
— Depuis longtemps ?
Un silence encore, et qui se prolongea. Le père qui avait parlé les yeux baissés les leva. Il vit devant lui une femme embarrassée, qui rougissait et dont le regard le fuyait. Une minute au moins s’écoula avec lenteur et poids. La princesse enfin parla ; s’adressant à la table, elle murmura :
— Depuis un an.
Si maître qu’il fût de lui, le père ne put retenir un mouvement. Une brouille d’un an dans le ménage du prince impérial, la chose était grave, les conséquences incalculables… Il faudrait y réfléchir dans le calme, aviser… Lorsqu’il reprit la parole, sa voix ne montrait aucune agitation.
— Pourquoi ne m’en avez-vous pas parlé plus tôt ? demanda-t-il.
— Cela était si délicat, mon père, dit la princesse toujours gênée. La situation pouvait changer d’un jour à l’autre. Il n’y avait rien eu entre nous, vous comprenez, qui pût nous séparer. Chaque soir, je pensais que peut-être Rodolphe reviendrait…
La chaleur avec laquelle elle prononça ces mots montrait quels étaient ses sentiments pour un mari infidèle.
— Un an, répéta le père en hochant la tête, un an. Et votre fille à quel âge aujourd’hui, mon enfant ?
C’était la première fois qu’il l’appelait ainsi ce jour-là.
— Elle aura bientôt cinq ans, mon père.
Le jésuite réfléchissait.
— Je partage vos inquiétudes, dit-il enfin. La couronne est sans héritier… Mais les voies de Dieu sont impénétrables. À l’heure qu’Il choisira, Il vous ramènera votre époux. Dieu n’abandonnera pas cet empire sur lequel Il veille spécialement, j’en ai la preuve. Il faut de la patience, mon enfant. Vous saurez agir comme une épouse chrétienne ; vous ne montrerez pas d’humeur – il glissa cette phrase sans avoir l’air d’y toucher – il faut beaucoup de mansuétude. Vous préparerez ainsi les voies de Dieu. Il faut prier aussi. Ah ! là, je pourrai vous venir en aide… (sa voix était forte et confiante à l’idée du secours qu’il apportait), je vais ordonner une neuvaine, dit-il en scandant les mots, dans tous nos collèges pour que l’antique maison des Habsbourg refleurisse en un jeune héritier…
La princesse ne parut pas aussi sensible qu’il l’espérait à la grandeur de l’appui qu’il lui offrait. Elle le remercia pourtant, puis elle ajouta :
— Je voulais vous demander, mon père, de voir le prince et de lui parler.
Le père eut un geste d’effroi.
— C’est difficile, mon enfant, c’est délicat…
— Rien n’est difficile pour vous, mon père, continua la princesse.
— Il faut demander une audience, dit le jésuite, et indiquer le motif de cette audience… Je ne puis dire…
— Vous ne serez pas en peine pour trouver une raison de voir le prince, dit-elle. Vous savez comme moi quels intérêts sont en jeu.
Le père réfléchit un instant.
— Vous avez raison, mon enfant, dit-il. Je verrai le prince.
Quelques instants plus tard, la princesse et sa dame d’honneur remontaient en voiture.
La figure du père Bernsdorf, comme il regagnait son cabinet, était soucieuse. « Un an, pensait-il, un an déjà ! Pourquoi me l’a-t-elle caché ? Quelle est la femme qui va prendre de l’influence sur le prince ? Il est plus faible qu’on ne le croit. Que d’intrigues autour de lui ! Que d’influences pernicieuses ! La place est-elle déjà occupée ? » Il haussa les épaules. « Je le saurais… ; en tous cas il faut voir. »
Ce même jour, vers midi, deux personnes causaient dans une petite pièce attenante au cabinet de direction du Neues Wiener Tagblatt. L’un était le rédacteur en chef de ce journal, Monsieur Szeps, homme de taille moyenne, maigre, les cheveux ras déjà blancs, quoiqu’il ne fût pas âgé, le teint un peu jaune ; la seule partie charnue de sa figure osseuse était l’extrémité de son nez qui avait une courbe nettement sémite. Journaliste bien connu à Vienne, il dirigeait avec habileté, dans un temps difficile, un organe d’opposition libérale au gouvernement conservateur et quasi autocratique du comte Taaffe. Ses confrères et les gens bien renseignés des cercles gouvernementaux s’étonnaient de voir le Neues Wiener Tagblatt publier de temps à autre, des nouvelles exactes et inattendues sur telle question aiguë de la politique. Mais elles étaient toujours présentées sous une forme si modérée, si inoffensive, que le bureau de la presse ne trouvait pas le moyen de lancer ses foudres et de suspendre le journal. « Où diable Szeps prend-il ses informations ? » se demandait-on. Il y avait de quoi exercer la sagacité des connaisseurs. Mais aucune réponse satisfaisante n’avait été trouvée. Aussi Szeps jouissait-il d’un prestige et d’une influence que n’eût pas justifié le tirage assez réduit de son journal.
Ce jour-là, il avait en face de lui un vieillard de ses coreligionnaires, Monsieur Blum, directeur et propriétaire du Neues Wiener Tagblatt, pour lequel il n’avait pas de secret. Les deux hommes avaient discuté avec cette subtilité et ce goût pour la dialectique qui est cher à leur race un des problèmes compliqués de la politique intérieure austro-hongroise. Ils en vinrent à parler de l’empereur. Il n’y avait aucun changement heureux à espérer tant qu’il serait en vie.
— Il paraît déjà un vieillard, dit Szeps.
— Il n’a pourtant que cinquante-huit ans et peut durer dix ans encore, reprit Blum. Il n’est pas intelligent ; il ne comprend rien à ce qui nous passionne, mais reconnaissons qu’il est adroit et qu’avec ses pauvres moyens il s’arrange pour suivre son chemin qui n’est pas le nôtre et obtenir ce qu’il veut, malgré les obstacles amoncelés sur la route.
— Lorsqu’il disparaîtra, dit Szeps, il laissera les choses dans un tel état que nous pouvons prévoir le pire, une révolution, du sang, un mouvement séparatiste qui détruira l’empire. Et quand je pense à qui il a près de lui, à ce fils admirable !… Ah ! Blum, un tel prince impérial, l’Autriche n’en a jamais eu et j’oserai presque dire qu’elle ne le mérite pas. Nous aurions enfin un empereur moderne, ouvert aux idées les plus généreuses, les plus nobles. Quel avenir pour l’Europe ! Frédéric III sur le trône d’Allemagne, Rodolphe sur ceux d’Autriche et de Hongrie, c’en serait fait de la réaction dans le monde. La Russie elle-même… Quels espoirs, mon cher Blum, mais aussi… il baissa la voix… que de craintes ! Un si grand avenir suspendu à la vie d’un seul homme !… Tout m’inquiète. Il n’est pas heureux en ménage, en conflit perpétuel avec une femme bornée, au caractère difficile. Il aurait besoin d’une grande paix chez lui, d’un soutien affectueux de toutes les heures. Au lieu de cela des querelles dont le bruit perce les murs épais de la Hofburg. Le résultat ?… la voix baissa encore… le prince cherche l’oubli dans la dissipation…
Ici le bon gros rire de Blum interrompit Szeps.
— Allons, mon petit Szeps, de quoi vous effrayez-vous ? Est-ce le premier prince héritier qui ait été un peu débauché ? Sa jeunesse orageuse – il en avait fait mille fois plus que Rodolphe – n’a pas empêché Henri V d’Angleterre d’être un grand souverain. Bien d’autres encore ont suivi et suivront la même voie. C’est presqu’une école pour ceux qui sont appelés à régner. Cela prouve que notre prince impérial est vivant et réagit.
— Mais il peut y avoir scandale, reprit Szeps qui ne se laissait pas convaincre.
Le rire de Blum redoubla.
— Personne ne sait mieux étouffer un scandale que les maîtres de la Hofburg. Ils n’en sont pas à leur première école. Laissez donc notre ami s’amuser à sa guise tant qu’il est jeune… Gaudeamus igitur dum juvenes sumus, chanta le vieillard. Et puisque nous avons quelques moyens d’être bien informés, suivons-le de près pour que personne de nuisible ne se glisse dans son intimité. Tant qu’il se borne à souper avec de jolies filles, le danger n’est pas grand. Si une femme adroite prenait de l’influence sur lui, il faudrait voir… Il ne vous a jamais parlé de sa vie intime ?
— Jamais, et je ne le souhaite pas. C’est un terrain glissant sur lequel je craindrais de m’aventurer.
— Tâchez tout de même de savoir quelque chose si l’occasion se présente. Quand pensez-vous le voir ?
— Il part pour Buda-Pesth demain. Dès son retour, il me fixera un rendez-vous… Ah ! ces rendez-vous à la Hofburg, avec quelle joie j’y cours, et aussi avec quelle peur !… Songez au tapage affreux si j’étais rencontré et reconnu. Mais le prince est habile et à chaque nouvelle entrevue, je redouble de précautions. La prochaine fois je porterai des lunettes noires…
2
LA HOFBURG
Pourquoi y a-t-il si souvent quelque chose de triste dans l’aspect d’un palais royal ? Est-ce l’impersonnalité et la monotonie des façades qui ne laisse rien deviner de la vie qui se déroule derrière elles ? est-ce la répétition uniforme et qualifiée noble des fenêtres, l’absence de toute fantaisie, de toute individualité ? On ne sait. Mais la Hofburg, où Rodolphe avait été élevé et où il vivait, était peut-être le plus triste palais royal d’Europe. Tous les appartements y donnent sur des cours plus ou moins vastes, mais également mornes, sans un arbre, sans un coin de verdure, sans une fleur. Le vent n’y pénètre pas, les oiseaux ne s’y arrêtent point et, comme aucune fenêtre jamais ne s’ouvre pour leur jeter des miettes, même les effrontés moineaux ne viennent pas animer de leurs piaillements les hauts murs de la Hofburg.
La vie qu’y menaient ses augustes habitants n’était faite ni pour l’égayer, ni pour l’embellir. L’empereur et l’impératrice occupaient deux suites d’appartements sur la cour dite Franzens Platz. Ceux de l’empereur auxquels on accédait par la grande porte sous la voûte menant à la Michaeler Platz comprenaient une série de salons uniformément revêtus de boiseries blanc et or, de style rococo, avec des meubles lourds où l’or dominait. Dans un angle de chaque pièce, un grand poêle de faïence, également blanc et or, répandait en hiver une chaleur modérée, mais égale. Il y avait là un salon pour les aides de camp, deux pour les hauts personnages admis à l’honneur d’une audience, le cabinet particulier de l’empereur avec deux fenêtres et deux bureaux, l’un élevé, l’autre à hauteur ordinaire ; puis la chambre à coucher avec un lit étroit en cuivre, un salon encore, et l’on arrivait à l’extrémité de l’aile dont les fenêtres regardent le midi.
En angle droit commençaient les appartements de l’impératrice qui n’étaient pas au même niveau. Un escalier de quatre marches les réunissait à ceux de l’empereur. On passait de la chambre à coucher dans un salon de réception, venaient ensuite le salon des dames d’honneur et une salle à manger, le tout meublé avec plus de grâce et de goût que ceux de l’empereur, mais de dimensions telles qu’il était impossible, malgré les fleurs et les arbustes qui les emplissaient, de les rendre intimes et agréables. Dans l’aile en retour, se trouvaient les appartements de grande réception, puis ceux des archiducs et ceux des hôtes de l’empereur.
L’empereur avait maintenant cinquante-huit ans. Une vie de travail acharné l’avait prématurément vieilli. Il était blanc et le devant et le sommet de son crâne entièrement chauves. Sa figure était couverte de rides et son nez avait grossi. Il restait assez leste cependant et avait conservé ses jambes longues et minces de cavalier. Ses goûts étaient devenus ceux d’un vieux bureaucrate ; il avait le respect de la besogne quotidienne expédiée sans retard et sans à-coups et ne s’en remettait à personne pour les affaires qui lui paraissaient relever directement de lui. Aussi, couché tôt, s’attelait-il à ses dossiers bien avant l’aube et les noctambules qui en hiver traversaient la Franzens Platz voyaient dès cinq heures du matin une fenêtre s’éclairer dans les appartements de l’empereur. Une lampe était posée à ce moment-là sur le bureau de François-Joseph et l’aide de camp de service – qui peut-être rentrait d’un bal et ne s’était pas couché – prenait, à demi-incliné, les ordres de Sa Majesté. En été, l’empereur commençait sa besogne – le plus souvent il était alors à Schönbrunn – dès quatre heures du matin. Il allait ainsi minutieusement à travers les documents que lui apportaient tour à tour soit un aide de camp, soit un chef de service, lisait chaque page avec application, et mettait lentement sa signature au bas d’un acte. Le plus souvent, il travaillait debout au bureau près de la fenêtre. Plus tard dans la matinée venaient, suivant l’occasion, le ministre président, ou tel ministre spécialement mandé, le préfet de police, et toujours des officiers supérieurs, chef de la maison militaire, chef d’état-major ; l’empereur étant avant tout un soldat, les choses les plus insignifiantes relatives à l’armée avaient à ses yeux une importance extrême. Commençaient enfin les audiences privées, en petit nombre, et brèves. L’empereur recevait les personnes qui avaient été admises à l’honneur d’une audience avec une grande simplicité, mais qui excluait, quels que fussent les liens qu’il pouvait avoir avec son interlocuteur, toute familiarité. C’était l’art personnel de François-Joseph de tenir les gens à distance, sans jamais être obligé d’employer pour cela de la morgue ou un appareil théâtral. Il avait l’air bonhomme, mais il ne souffrait aucun manquement aux règles minutieuses qu’il avait établies. Chef de la maison de Habsbourg, il menait sa famille de façon dictatoriale et faisait manœuvrer les archiducs comme un caporal un peloton de soldats. Il était d’une ponctualité telle que ceux qui devaient le rencontrer prenaient toujours une marge d’un quart d’heure de peur de se mettre en retard. Lorsqu’il devait se rendre à un endroit donné pour une cérémonie publique, les écuries recevaient l’ordre de faire le trajet la veille avec une voiture attelée de chevaux ayant la même allure que ceux qui seraient employés le lendemain et de mesurer le temps qu’elle y mettrait.