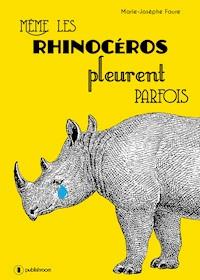
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
D’après une histoire vraie, la vie dans toute sa mesure, tour à tour brutale et drôle.
Les répercussions de la Seconde Guerre mondiale au cœur des familles, l’évolution de la société, les rapports hommes-femmes, vus avec des yeux d’enfant, avec un sens aigu de l’observation et du ressenti.
Le cahin-caha de l’enfance, les violences conjugales, la maladie, la spirale des dettes, rien ne parviendra à mettre à terre notre héroïne.
C’est une femme maintenant. Mais c’est une femme qui veut rester, coûte que coûte, une fille. Une fille sous la seule influence de la dictature du grand maître de l’esthétique.
D’expériences « beauté » cocasses en de furtifs lâcher-prises, finalement cette femme ne renonce jamais.
Résister par tous les moyens. Encaisser. Faire comme si tout allait bien.
Maître dans l’art du camouflage, dans l’art de porter le masque, mi caméléon mi Commedia dell’arte, l’auteur, tour à tour, se laisse prendre au piège des apparences et le dénonce.
Pourtant aucune hypocrisie dans ce texte, écrit avec une sincérité touchante.
C’est le récit d’une femme qui doit parfois tricher dans un seul but : rester fidèle à son serment.
Ce récit poignant vous propose de suivre le parcours semé d'embûches d'une femme qui ne cesse jamais de se battre.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Marie-Josèphe Faure est née le 14 mars 1959 dans la Loire, de parents de nationalité différente, résultat du brassage extraordinaire des populations au cours de la Seconde Guerre mondiale.
À l’école primaire, sa rencontre avec un instituteur de légende a une influence définitive sur le plaisir d’apprendre, le goût de la langue française et de l’écriture.
Après une première tentative ratée à l’université à 18 ans, sa reprise d’études universitaires est couronnée de succès à 28 ans, avec enfant et boulot. C’est ce chemin d’embûches et de persévérance qui définissent son existence. Si elle avait vécu chez les Indiens d’Amérique, elle se serait appelée « celle qui ne renonce jamais ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marie-Josèphe Faure
Même les
rhinocéros
pleurent
parfois
À ma mère, évidemment
Qui d’autre ?
Intro
La peur ne m’avait jamais quittée. Une peur viscérale, du fin fond de l’enfance. 50 ans et encore une gamine terrorisée. Toute cette violence. Une mère à moitié cinglée, un père qui l’était complètement, une hérédité pesante comme une enclume.
« C’est cadeau ma fille. Bon courage ! Tu vas en avoir besoin. »
Entre eux les ingrédients de la passion et, bien sûr, ça a viré au cauchemar. Des parents dont on se passerait volontiers et pourtant oui, mes parents, impossible d’y échapper. Parents : je rêve un peu, beaucoup… à une image d’unité. Réveille-toi ma fille, tu rêves beaucoup trop ici tout n’est que déchirure.
Ils s’étaient rencontrés en Bavière pendant ce qu’on a appelé avec absurdité « la Seconde Guerre mondiale », espérant vainement qu’elle serait la dernière.
Un amour d’urgence, un amour qui rend vivant l’instant, qu’il faut vivre à tout prix quand on ne sait pas ce que l’on sera demain, ce soir, dans une heure. Toujours en vie, déporté ailleurs, arraché à l’être qu’on aime, arraché à nos compagnons d’infortune ? Un amour entre deux gamins déracinés. Un amour pour échapper au sordide de la détention, aux baraquements insalubres. Pour échapper à la promiscuité, aux poux, aux maladies, à la faim. Un amour entre deux êtres qui ne parlaient que quelques mots d’allemand, appris sous la contrainte. Un amour pour s’évader.
Ma mère avait été déportée à 16 ans. Elle était issue d’une famille paysanne qui, ayant fui l’Ukraine et vendu une ferme pour un montant de 3 000 zlotys, se trouvait dans une situation plutôt aisée pour l’époque. Pourtant, entre guerre et exode, le pactole avait rapidement fondu. Ma grand-mère, Maria Oleg, s’était remariée et avait pris le nom de Kuzel. Sur les photos grand-mère Maria semblait redoutable. Elle l’était. Une petite bonne femme aux yeux noirs impitoyables qui donnaient froid dans le dos. Une mise des plus pauvres, des habits sombres, des croquenots impeccablement cirés, mais des croquenots quand même. Aucune place à la coquetterie. Quand le salaire hebdomadaire d’un ouvrier permettait l’achat d’un peu de beurre, et encore, après avoir fait la queue fallait-il que le magasin en dispose. Alors l’élégance, la féminité, quelle indécence !
Grand-mère avait un concept très particulier de l’éducation des enfants. À la ceinture. Malgré leurs origines paysannes, ma mère la vouvoyait. Distance abyssale entre parents et enfants, pas de place pour les cajoleries. En ce début de xxe siècle le mythe de l’enfant bonheur n’était pas d’actualité. Dans les familles pauvres, les parents étaient craints et les enfants considérés comme une charge qui justifiait leur exploitation. Dans les familles riches, ils étaient confiés à la gouvernante ou au pensionnat.
Pour grand-père, qui avait servi dans l’armée prussienne, la déportation de son empotée de fille, à peine bonne à aider un peu à la maison, fut la source d’une incompréhension abominable. Il croyait que son passé exonérerait sa famille. Il était, comme tous ces Polonais, réfugié dans sa naïveté, et pensait que le régime nazi l’épargnerait. Il supplia qu’on lui laisse sa fille, si jeune. Rien n’y fit. Ma mère fut déportée.
À partir de mon arrière-grand-mère, la famille s’était convertie au catholicisme. Pour ma mère ce fut une immersion complète, du genre baptême de Clovis. Sa foi était une évidence et j’admirais cette croyance absolue et limpide dont j’étais incapable. Trop de questions. Pas assez de réponses. Éternel schéma. Je porte cette foi ou cette croix, je ne sais plus très bien, par procuration. J’explique.
Ma mère m’a affublée d’un prénom dissuasif, Marie-Josèphe. « Pour être toujours protégée », disait-elle. Superstition quand tu nous tiens. Un prénom qui vous classe d’emblée parmi les chieuses, les moches, les pas aidées par la nature, les promises vieilles filles, les ennuyeuses. Un prénom qui met à l’écart dans la cour de récré et oblige à compenser par une sociabilité forcenée. Épuisant. Prénom unique, pas de seconde chance. « Je m’appelle Marinette, mais tout le monde m’appelle Ambre, mon deuxième prénom. » Marinette et Ambre, pas du tout le même registre, de quoi développer une bonne schizophrénie.
« Qui suis-je ? »
Aucune chance en fait que des parents puissent opter pour des prénoms si opposés, prolo versus volupté.
Pour les mecs, eh bien ! ce n’est pas très romantique. Pas le genre de prénom qu’on susurre à l’oreille ou qu’on crie en plein orgasme. Trop long, trop froid. Ça sonne comme un rappel à l’ordre. Un prénom qui les glace, qui les persuade que je ne pourrais faire l’amour qu’après avoir récité trois « Notre Père » et deux « Je vous salue Marie », et qu’après, eh bien ! après j’expierais en me flagellant des heures durant.
Il y a ceux qui, après de longues années d’hésitations, finissent par choisir « Marie ». Plus simple. Plus docile. Plus doux, plus féminin. Plus nunuche aussi. Il y a les avant-gardistes, rock’n’roll qui préfèrent « Joseph ». Ce ne sont pas les plus nombreux. Marie emporte presque tous les suffrages. Avec les prénoms composés, personne n’est à l’abri. De prime abord, je ressemble plutôt à Marie, mais il ne faut pas s’y fier. Joseph n’est jamais bien loin et il n’est pas commode. Il est carré, intransigeant. Généralement ça en surprend plus d’un, tout le monde ayant une fâcheuse tendance à confondre gentillesse avec prêt-à-berner. Erreur colossale. On peut être gentil sincèrement et exigeant. Pas d’incompatibilité. La gentillesse est une vertu du cœur, c’est l’empathie, la faculté de placer tout le monde à égalité. Peu importe qu’on soit riche ou pauvre, percutant ou con, et pour les cons le choix est infini, quel, vieux, gros, sale, grand, petit… con. Le con est un caméléon.
« Comment le définir, alors ?
–Élémentaire mon cher W., le con, c’est toujours l’autre. »
Un prénom only for the brave, ceux qui voient au-delà des apparences, ceux qui aiment les défis, ceux qui sont dignes d’intérêt. Les autres… Pff restez où vous êtes les mecs !
Chapitre I – Une rhinocéros en Suisse
Les apparences. On se laisse tous piéger par les apparences, par nos a priori. Le village paisible qui cache son lot de sordide. Le mec brushing, bronzé, dents blanches qu’on a volontairement zappé pendant dix ans. Un mec que les copains encensaient. Le tombeur aux multiples conquêtes. Je répondais :
« Attendez ! Vous ne parlez quand même pas de ce mec-là ? Si ? Parce que vous allez me dire que ce genre de mec ça marche encore avec les nanas ? Qu’il y en a qui tombent encore dans le panneau ? Rappelez-moi les mecs, on est bien là au xxie siècle ? On n’a pas changé d’époque ? Si ? Et on ne m’a pas prévenue ? »
Les potes me regardent, interloqués.
Un jour pourtant le mec brushing, bronzé, dents blanches, me prend la main. Je suis troublée. Tellement troublée qu’enfin je m’intéresse à lui et découvre derrière ce cliché que je ne pouvais qu’associer au Club Med, un mec, un vrai, avec un cerveau et beaucoup de sensibilité. Pas juste un sex-toy, même si dans cette catégorie il est plutôt très, très doué. Non, un mec qui aime la nature, les balades. Un mec, capable de s’arrêter devant une façade d’immeuble, de contempler les détails d’architecture à Paris, Bangkok, n’importe où dans le monde. Un mec capable d’enchaîner deux documentaires d’Arte. Un mec qui aime les fleurs. Un mec qui aime la déconne, le champagne, la fête. Un mec qui aime boire son café au bord d’une rivière. Un mec qui aime les choses rares, les antiquités et qui a l’élégance de me ranger dans la première catégorie. Un mec que je découvre le matin, qui passe seulement la main dans ses cheveux. Finalement, il ne fait jamais de brushing. Moi, si, tout le temps. Un mec qui m’aide à enfiler mon manteau, qui m’ouvre la portière. Un mec qui dit :
« Je vais te chouchouter. »
Je pense alors : « Ouais, on verra bien, ils disent tous ça au début, non ? »
Finalement un mec qui, oui, me chouchoute. Un mec qui tient ses promesses. Finalement, finalement, je m’étais trompée sur toute la ligne.
« Les filles, on se calme. Et non je ne vais pas vous filer son numéro de téléphone, mais bon la prochaine fois que vous croisez un mec qui vous paraît loin, très loin du modèle que vous aimez, réfléchissez bien avant de zapper. Parce qu’“Oh oui ! Ça marche super bien avec les nanas”. Un putain de piège à filles. »
Il y a ceux qui ne vous demandent pas votre prénom. Les rencontres d’un soir, d’une nuit. J’ai 18 ans.
OK, on a tous eu 18 ans et fait des trucs improbables. Non ? Pas toi ? Dommage. Parce que tôt ou tard tu es o-bli-gé d’en passer par là et crois-moi il vaut mieux tôt que tard. Pourquoi ? Pasque sinon tu t’appelles démon de midi ou cougar et franchement t’as l’air de quoi là ?
Je travaille pendant les vacances d’été. Haute-Savoie, loin de ma mère. La liberté. Je me fais une super copine du genre de celle avec qui on part en stop, on part en boîte danser jusqu’au matin, on prend force vitamine C après pour assurer au boulot. Bref une super copine, tu vois de quoi je parle.
« Où sont les femmes ? » chante Patrick Juvet.
C’est pas pour nous, on n’est pas encore des femmes, juste des filles avec une furieuse envie de vivre. Coucher ? Bien sûr qu’on couche. On ne sait rien faire d’autre. On ne sait pas faire l’amour. Alors on couche, pas par plaisir, non, juste pour ne pas passer pour une fille coincée. Après la dictature du prolétariat, celle de la femme libérée en quelque sorte.
Ma copine trouve assez vite un copain qui a un copain qui ne me plaît pas du tout, donc nothing happened. Logique.
Un soir, on décide tous les quatre d’aller faire un tour en Suisse. Nous sommes à 200 mètres de la frontière. On y va. En stop naturellement.
Le stop. Tu vois ce que c’est ? Le stop c’est l’adrénaline. Tu connais le covoiturage. Tu t’inscris sur Internet, tu choisis. Le stop, rien à voir. C’est le courage. C’est la peur et le risque. Le stop c’est quand t’as pas de fric, pas de caisse, que papa et maman ne te payent pas le permis. Le stop c’est la démerde.
On passe la frontière et c’est l’enchantement des prairies clôturées de barrières blanches, des pelouses impeccables, des fleurs aux balcons. Tout est propret et a un air de village de conte de fées.
On arrive à Montreux. Avions-nous vraiment voulu aller à Montreux ? Pas sûre. Mais les hasards du stop faisant, nous y arrivons. Bord de lac. Classe. Festival. Montreux. Tribulations de la soirée. Un bar quelconque, un Balto suisse. Néons, billard, juke-box.
Un mec joue au billard. Nous sommes une bande. Il fait une partie, je ne me souviens pas des autres. Il n’est pas vraiment avec des potes. Il semble seul et pourtant traité comme une guest-star. Les mecs l’entourent, le patron du bar le couve des yeux. J’ai en face de moi le sosie de David Bowie. David dans sa période blonde. David d’après la première période, rousse, maquillée, étrange, ensorcelante. David que je découvre à 14 ans. Son côté féminin me rassure. Âge où les garçons font peur, prof de gym, peau qui pique. On n’a pas envie. David, maquillé comme on se maquille à 14 ans, d’un maquillage qui se voit bien, correspond beaucoup mieux à nos critères de beauté.
Là d’un coup, 18 ans. Le temps a passé et j’ai David Bowie en face de moi. On se parle. Le mec s’appelle vraiment David et ne parle qu’anglais. Je parle très mal anglais. Enseignement de seconde langue au collège, un cauchemar. Je n’avais pas eu le choix. Ma mère m’avait imposé allemand première langue et il ne m’était pas venu à l’esprit de pouvoir dire non. Très peu d’anglais, donc. Pas tellement nécessaire d’en dire plus. Je comprenais très bien « Baby, baby » et « Blue eyes » et franchement ça suffisait.
Il nous invita à terminer la soirée chez lui, enfin inviter c’est un mot de vioc. À 18 ans on ne dit pas : « Je t’invite à terminer la soirée chez moi. » On ne dit rien. On sort d’un café, on monte dans une caisse et on atterrit quelque part.
On monte dans la caisse. Superbe voiture américaine blanche. Capot de deux mètres de long, sièges cuir bordeaux, spacieuse à l’avant, riquiqui à l’arrière. Je monte à l’avant parce que t’as pas oublié quand même « Baby, baby, blueeyes ».
Les trois autres s’entassent à l’arrière. On démarre et on se fracasse dans une cabine téléphonique.
Tu ne connais pas les cabines téléphoniques ? T’as 18 ans aujourd’hui ou quoi ?
Quand j’avais 18 ans, il y avait des cabines téléphoniques et même que ouais c’était vachement moderne. La cabine était en verre. C’était super on te voyait de loin en train de téléphoner et toi tu voyais bien que des gens attendaient pour téléphoner en te maudissant à l’unanimité. Réciprocité. Transparence totale.
J’imagine les énarques et les techniciens se pencher sur l’accès égalitaire aux télécommunications.
« Messieurs, il m’est venu une idée. »
Oui, eux ne disent pas « les mecs, j’ai eu une putain de bonne idée ». Pour eux les idées se baladent et se disent « tiens, quelqu’un de réceptif, je vais aller vers lui ».
Ils disent plutôt : « Messieurs, chers collègues. » Oui il n’y a pas de femmes dans les hautes sphères du pouvoir et ne te fie pas à leur aimable confrérie. Ces mecs-là ont les dents qui rayent le plancher. Comme les starlettes de Cannes, leur seul objectif est de se faire repérer et devenir ministre, un jour, ou en cas de karma exceptionnel, khalife à la place du khalife.
Peut-être faudrait-il qu’ils aient leur émission de téléréalité. « Êtes-vous prêts à prendre le pouvoir ? », « Jusqu’où iriez-vous ? ». Ça serait très intéressant. Il faudrait simplement veiller à leur faire livrer des plats tous les jours. Surtout pas de cuisine équipée pour ces lanceurs de couteaux, habitués à faire tomber les corps sur les somptueux tapis Aubusson, témoins silencieux des intrigues de palais.
« Messieurs, disent-ils, en dotant l’ensemble du territoire de moyens modernes de communication, nous œuvrons pour l’égalité des citoyens. Je demande à mon directeur de cabinet de prendre l’attache des services concernés. »
Oui, ces gens-là ne font jamais rien eux-mêmes, c’est aussi très commode pour se sortir des situations compliquées. Tout un savoir-faire, une expertise des rapports humains. La politique.
Et nous voilà avec une multitude de cabines téléphoniques, transparentes comme la vie publique aimerait l’être. Où on se gèle l’hiver. Où on suffoque l’été. Où on ramasse les microbes de l’usager précédent qui a saisi le combiné avec des mains douteuses, a crachoté, a transpiré et rendu l’appareil luisant, a laissé sa vie dans ce téléphone.
Si tu survis à la cabine téléphonique, tu peux aller n’importe où dans le monde, tu es im-mu-ni-sé. C’est pour ça qu’il n’y en a plus une seule. Tu crois que c’est parce que tout le monde est passé au portable ? Erreur. C’est parce que les labos pharmaceutiques, le lobby le plus puissant au monde, ne savent plus quoi faire de leurs antibiotiques. Déjà que c’était pas automatique. Les labos pharmaceutiques te font avaler n’importe quoi. D’ailleurs t’as sûrement remarqué quand tu vas à la pharmacie juste pour des médocs ça a l’air de les surprendre.
« C’est tout ? demandent-ils. Et avec ça, qu’est-ce que ce sera ? »
Même l’épicier du coin te pose plus cette question. Tu fais tes courses tout seul. Il encaisse, point barre, et toi, en découvrant l’addition, tu manques t’évanouir à chaque fois.
Non la pharmacie c’est devenu comme chez le charcutier. « Et avec ça, qu’est-ce que ce sera ? » Imparable. D’ailleurs je ne sais pas si t’as remarqué la différence entre le nombre de pharmacies et le nombre de charcuteries. C’est bien simple, des charcuteries il n’y en a presque plus. Pourquoi ? Parce que les pharmacies ne se sont pas contentées d’en vampiriser les méthodes de vente et les emplacements. Non, tout ce que la pharmacie te vend, les crèmes minceurs, les produits détox, les pilules coupe-faim, c’est pour te dire qu’à la charcuterie, faut pas y aller.
Bon là pour le coup, la cabine téléphonique, prise de plein fouet, elle fait une drôle de gueule. Une femme à sa fenêtre gesticule et crie « les jeunes, tous des vauriens », un truc comme ça, un truc que les viocs disent à propos des jeunes, dans toutes les cultures, à toutes les époques. Sauf qu’on est en Suisse et qu’entendre crier avec un débit qui reste un peu lent, eh bien ! ça nous fait rire. Sûr qu’elle nous en veut. Une cabine téléphonique sous tes fenêtres, c’est le spectacle permanent, du pain béni pour les concierges.
Malgré le choc, j’ai à peine décollé de mon siège d’un centimètre. Capot, confort, la voiture a quelques égratignures à l’avant. T’as deviné, on ne descend pas compter les éclats de verre, il y en a beaucoup trop et vraiment on a autre chose à faire. Marche arrière, on s’en va, laissant la vioque à ses récriminations.
Hauteurs de Montreux. Presque une route de campagne, étroite, bordée d’arbres. Arrivée dans une propriété. Parc, demeure ancienne. Superbe. On pénètre dans la maison. Cuisine ultramoderne. On a faim. On mange quelques gâteaux du type Chocos-BN, étouffes-chrétiens. Pareils qu’en France. Le type qui a inventé les Chocos-BN je n’ai jamais compris ce qu’il pouvait avoir à la place du palais. C’est sûrement un mec capable de bouffer du sable.
On monte à l’étage. Escalier majestueux. Arrivée dans une galerie qui dessert un nombre incalculable de pièces. Dernières marches… me fait face un portrait de David Bowie. Portrait de sa première période, rousse, cheveux en brosse. Un portrait qui trône là au milieu des toiles impressionnistes. Pas un poster, pas le genre de la maison, on n’est pas dans une chambre d’ado. Galerie à droite, la suite de David. Salon. Une sono digne d’un studio d’enregistrement et toujours « Baby, baby, blue eyes ». Oui, je sais, c’est assez limité. La chambre, le lit. Les trois autres dans une chambre d’amis. La nuit. Le matin. Je me lève, ma copine est venue me réveiller. David qui tend le bras, essaie de retenir ma taille « Baby, baby », je m’enfuis déjà.
On se retrouve dans la so chic galerie, nez à nez avec une femme splendide. Rousse, somptueuse tenue d’intérieur. Soie chamarrée. Dame courroucée. Très courroucée. La mère ? Pas sûre. Maîtresse des lieux, ça, c’est sûr. Chaque millimètre de son apparence l’indique. Pas besoin de parler anglais pour comprendre à quel point on est indésirables. Comme si tout à coup des cafards avaient envahi les tapis persans. On dévale l’escalier. Aucun mot n’a été échangé. Pas nécessaire. Traversée de la propriété, à pied cette fois, au jour, les pelouses, les fleurs, la pièce d’eau et les cygnes. On passe les hauts murs qui ceignent le domaine par une modeste porte en bois à demi masquée par la végétation, réservée aux domestiques et aux livreurs, réservée à la caste des « Incognito » autant méprisée que celle des « Intouchables ».
Nous sommes à nouveau sur cette jolie route de campagne. Hauteurs de Montreux, le lac scintille. Je tourne la tête pour voir le nom de la villa « Les mésanges ». Je n’ai pas rêvé. Je grave ce nom dans ma mémoire pour me souvenir, toujours. Troublée. Je resterai troublée. Mais avec les années beaucoup moins que par le mec brushing, bronzé, dents blanches qui me prend la main, le seul à m’appeler par mon prénom.
Chapitre II – Les pattes dans le plat
Ma mère avait été déportée à la place de sa sœur qui s’était enfuie en Australie. De cette sœur Brunia, on gardait une photographie sur laquelle elle posait comme une actrice de cinéma. Magnifique, du genre Lise Taylor. Rêve américain oblige, elle empruntait la posture des starlettes en fumant une cigarette. Brune, bouclée, des yeux immenses et malgré le noir et blanc de la photo on devinait le rouge à lèvres franc, on voyait la taille fine, les habits du dimanche, le chemisier impeccable, la jupe plissée au tomber parfait, la cheville délicate.
Ma mère était le négatif de cette sœur aînée. Joli visage, petit nez et yeux noisette. Pour le reste c’était brouillon, nature, brut et généreux. À l’église sa voix s’envolait dans les aigus et dominait l’ensemble. Soprano, naturellement. Créative, entreprenante, elle aimait décorer, chiner des objets anciens, récupérer, assembler. Reine de l’upcycling avec une longueur d’avance.
Au cours des années 1970, Brunia était revenue en Pologne. L’abondance de l’Australie, son immensité, son soleil, n’avaient pas réussi à gommer la nostalgie des dures années de jeunesse. Ce lien particulier avec le pays natal, sa culture, son empreinte.
La guerre et les deux mariages de grand-mère avaient éparpillé la fratrie. Amérique du Sud, Connecticut, Italie, Australie. Les lettres arrivaient, on voyageait. Une des sœurs s’était installée dans le nord de la France, à Lens, où cette immigration bon marché d’après-guerre avait fait les beaux jours des industriels miniers. Le frère, marié cinq fois, et grand-mère n’avaient jamais quitté la Pologne.
Des années plus tard Brunia vint nous rendre visite avec l’un de ses fils. C’était une vieille femme aux traits lourds, portant d’épaisses lunettes et autant de lassitude.
Le voyage de Pologne en France dans l’exiguïté de la Fiat Polski, c’est-à-dire le concept miniaturisé du célèbre pot de yaourt, n’avait pas arrangé les choses. Trop forts ces Polonais, ils étaient déjà passés aux nanotechnologies, pour l’automobile, pour le logement, pour les salaires, pour se nourrir, ils étaient déjà à l’infiniment petit.
Elle fumait toujours, mais ce n’était plus la légèreté des blondes, c’étaient des cigarettes grossières, des cigarettes d’homme. Deux tresses encadraient son visage tanné et avec la cigarette aux lèvres, elle ressemblait à une vieille squaw venue fumer le calumet de la paix. Entre les deux sœurs, pas de rancœur. La guerre avait décidé de leur sort. Cette guerre qui au mieux avait dispersé les familles, au pire, les avait décimées.
De son exil en Bavière, ma mère nous racontait les conditions de survie. La crasse, les poux, la faim. Un morceau de pain pour la semaine, juste de quoi tenir debout pour travailler. Contraste des conditions. Elle travaillait dans la très délicate Rosenthal Fabrik à peindre des fleurettes sur de la porcelaine. Le raffinement et l’innommable.
Comme tous les captifs, elle avait développé à l’égard de ses geôliers des sentiments mêlés de crainte et d’admiration et nous bassinait avec la supériorité de la technologie allemande, la beauté de la Bavière et du Tyrol, l’impeccable mise des officiers.
Ça ne devait pas être trop difficile de paraître nickel dans ces circonstances.
« Bel officier allemand, quel gouffre entre nous ! Pourquoi suis-je pouilleuse, affamée, terrorisée ?
–C’est pour mieux te désespérer mon enfant ! »
Elle rencontra mon père. STO. Il y a des rimes embarrassantes, STO et collabo en font partie. Plus personne pour s’en soucier aujourd’hui. Propagande allemande. Les plus courageux gagnaient le maquis. Mon père n’était pas courageux. Destination les camps de travail. Pas le Club Med. Pas de salaire. La promiscuité, l’animalité. Enfin bientôt tout le monde s’accorderait sur la France résistante, alors quelle importance tout cela ? Quelle importance les morts, les jeunesses brisées, les familles déracinées, les haines ?
Mes parents se sont évadés de Bavière et ont regagné la France. À pied. Quand ma mère racontait son périple des années plus tard, du haut de mes 8 ans, ça me paraissait suffisamment romanesque pour ne demander aucun détail. D’ailleurs il était mal élevé de poser des questions, elle me le répétait assez souvent.
Je n’en posais pas. Elle racontait la traversée de la Forêt noire. La peur qui la tenaillait. Ce voyage avait duré trois mois. Trois mois à se cacher le jour, à marcher le plus possible de nuit. Trois mois de faim, de froid et de terreur. Une plaque de neige qui se détache de la cime des arbres en un « woof ! » assourdissant, les cheveux dressés sur la tête, tout le corps qui sue la peur.
Il fallait voler, mentir. Pour survivre. Un jour pourtant, un petit village de Bavière, le boulanger embauche. L’odeur du pain cuit, la chaleur des fours, la faim qui fait tourner la tête. Mon père entre.
« Ich habe die Anzeige für die Bäckerstelle gesehen. (J’ai vu l’annonce, pour l’emploi de boulanger).
–Sind Sie Bäcker ? (Vous êtes boulanger ?)
–Ja, natürlich.
–Zeigen Sie mir, was Sie tun können. (Montrez-moi ce que vous savez faire.) »
Naïvement mon père pensait que c’était simple de faire du pain. Il prend sans hésitation le sac de farine, le seau et l’eau, fait un mélange. Rien de bien sorcier. Il ne savait pas. Il ne savait pas le plus élémentaire des gestes, se fariner les mains. Il se retrouve bientôt empêtré avec une pâte qui colle et s’étire comme un chewing-gum entre ses doigts. Impossible de lui donner forme. Impossible de faire illusion. Impossible de dire :
« C’est vrai, je ne suis pas boulanger, mais je peux apprendre, et vite. Je suis un très bon ouvrier. J’ai faim, je n’ai pas d’argent. J’ai besoin de ce boulot, vous ne le regretterez pas. »
Trop tard pour ça.
« Du bist nicht Bäcker ! (Tu n’es pas boulanger !)
Mon père est mortifié. Son bluff n’a pas tenu un round.
–Wir sind nicht Bäcker, wir sind entkommen », dit ma mère. (On n’est pas boulangers, on est évadés.)
Ma mère. Franchise totale. Abrupte.
Silence de mort. Mon père, peur et colère. Ma mère, peur et soulagement d’avoir dit la vérité. Tous les deux imaginant déjà la dénonciation, l’arrestation, la mort probable.
Inspiration. Le boulanger saisit un sac en grossière toile de jute, y jette trois pains et leur dit :
« Weg ! Sofort ! » (Partez ! Tout de suite !)
Des épisodes racontés qui me suffisaient. Pourtant des années plus tard, je ne sais rien, je ne me suis pas assez intéressée à leur histoire. On ne s’intéresse jamais assez aux vivants et après, bien après, plus de réponses possibles, on reste avec ce vide douloureux. Histoire presque banale de survivants, tellement contents de s’en être tirés, tellement pressés d’oublier et qui laissent les générations suivantes frustrées et parfois révoltées.
Ma famille, inclassable. Un défi pour l’INSEE. Paysanne, prolo, mais pas seulement. Une avant-garde à elle seule de la mixité sociale.
Tout cela me distinguait de mes petits camarades. Ma mère recevait du courrier « par avion », avec la petite étiquette bleue, l’enveloppe fine périmétrée bleu, blanc, rouge, constellée de timbres lointains. Nous n’avions pas de voiture et là on parlait d’avion. Top classe. Dans notre village des années 1960, cette mondialisation avant l’heure me paraissait extraordinaire. J’en éprouvais une immense fierté et la grisante sensation d’être différente.
C’était un vrai village avec des fermes, des paysans avec vaches, brebis et basses-cours, des ouvriers aussi, un lavoir. La population était homogène. Nous étions les Jourdain de l’écologie, une vie quasi autarcique, des jardins, des poules, des lapins, un chien et des chats. Peu de déchets produits, aussitôt recyclés. Les animaux se chargeaient des restes, os de poulet, lait de la veille, fanes de carottes. Période bénie où leur nourriture n’avait pas encore envahi de son odeur nauséabonde les rayons des supermarchés, d’ailleurs il n’y avait pas encore de supermarchés. Période bénie où les animaux n’étaient pas difficiles et faisaient leur petit job en échange de nourriture.
Les chats se chargeaient des souris et aussi, il faut bien le dire, des oiseaux. La campagne. La vie animale dans sa brutalité.
Les poules, contrairement au cliché de la poule mouillée, se révélaient de braves petites bêtes. Elles éloignaient les reptiles.
Le chien, eh bien ! le chien montait la garde. Y avait-il quelque chose à voler ? Pas sûre. D’ailleurs il ne serait venu à l’idée de personne de souscrire une assurance pour se protéger d’éventuels larcins.
Mon chien. Nous avions un chien sur lequel mon père n’exerçait pas sa hargne. Pourquoi avions-nous recueilli ce chien ? Tout simplement parce qu’un compatriote Polonais nous l’avait amené. On ne pouvait rien refuser à un compatriote, n’est-ce pas ? Quelqu’un subtilement méprisé, qui ne parle pas bien la langue, qui a un drôle d’accent, objet de moqueries, qu’on feint de ne pas comprendre, employé aux tâches les plus rudes.
On prit le chien. Il avait un pelage beige et son corps formait deux masses oblongues. Un débat avait eu lieu : il fallait lui trouver un nom. Finalement nous l’avions appelé Cacahuète. L’un d’entre nous avait lancé Johnny, après tout ce chien était presque blond et c’était la mode des yéyés. Pourtant Cacahuète, le nom le plus absurde, l’emporta. J’étais certaine que ce nom lui déplaisait. C’était un nom aussi ridicule pour un chien que le mien relevait de l’enclume pour une fillette. Ça nous a rapprochés. Ce chien et moi, on était potes.
Il avait une attitude destructrice, d’automutilation. À l’extérieur, dans une niche. Ça n’était pas une époque où les chiens-chiens étaient à l’intérieur avec un coussin exprès, bien au chaud, avec toilettage, garde-robe froufroutante, colliers scintillants et menus choisis. Non. Les chiens devaient faire un petit boulot, garder, donner l’alerte. En contrepartie on les nourrissait.
Mon chien était attaché. La propriété n’était pas clôturée et il était totalement incontrôlable quand le facteur passait. Je ne sais pas si c’était l’uniforme, la casquette, la 4L jaune, mais il était déchaîné et le facteur en avait une peur bleue. Aucune boîte aux lettres à la campagne. Tout juste un nom sur le bord du chemin. Si nous avions du courrier, le facteur gravissait quelques marches en terre, grossièrement retenues par des planches de bois et nous allions à sa rencontre. C’était une remise en mains propres, digne d’une mission ultra-confidentielle.
Le chien était confiné dans le haut de la propriété, avec un épais collier de cuir et une lourde chaîne fixée à un poteau haute tension. Les études sur les effets délétères des ondes n’étaient pas à la mode et on n’en soupçonnait pas les ravages. Avec le recul je suspecte le bombardement constant de ces ondes invisibles d’avoir eu raison de l’équilibre mental de mon pauvre chien, exposé 24h/24 au grésillement permanent de la ligne haute tension. Toute la journée il tournait inlassablement autour du poteau, le derviche tourneur des chiens. La chaîne suivait sans relâche ce mouvement de compas. Aucun brin d’herbe dans ce périmètre, pas même un terrain vague, non de la terre battue au sens premier du terme, tassée par les allées et venues du chien, rythmées par la chaîne. Une sorte d’Attila du chien.
Mon père lui construisait de solides niches. Le chien n’en avait cure. Ce chien détestait le confort. L’hiver on garnissait la niche de paille pour lui procurer un peu de chaleur, il la virait illico. Le facteur passait, il s’attaquait à la niche, arrachant des planches, se massacrant la truffe au passage. Il saisissait sa gamelle, la faisait tournoyer jusqu’à la mettre sur la tête. Ça lui faisait une sorte de casque allemand qui le rendait parfaitement ridicule. Ce n’était pas une gamelle en plastique, tu t’en doutes, mais une cocotte en fonte, de bonne taille, il était bien nourri. Sans doute avait-il trouvé ce moyen pour se protéger des ondes. Finalement ce chien était peut-être un scientifique.
Un jour, excédé par les déprédations du chien, mon père voulut lui construire un refuge qui serait une sorte de Titanic de la niche, une niche spacieuse, confortable, en planches doublées de plaques de tôle pour la pluie, inattaquables par les canines de l’animal. La conception et la réalisation de ce very strong home avaient pris du temps. Pas assez cependant, pas assez réfléchi, juste pensé à faire du lourd. Il avait vu un peu trop grand et n’était pas parvenu à sortir la niche par la porte de l’atelier. Ses nombreux jurons n’y changèrent rien. La niche ne passa pas davantage par la fenêtre. Quand je vous dis qu’il avait vu trop grand. Il fallut enlever le toit, sortir la niche et remonter les éléments à l’extérieur.
La niche fut installée et, comme le Titanic, elle ne tint pas ses promesses. Peu à peu la gueule du chien en vint à bout. Ce chien était une force de la nature.
Un jour je crus avoir une hallucination, un peu avant le passage du facteur, je vis mon chien à travers la porte vitrée laissée ouverte en rez-de-jardin. C’était l’été. Toute la maison était ouverte. Il était là, campé sur ses pattes et attendait le facteur. Il était parvenu à briser sa lourde chaîne, prêt à en découdre. J’évitai le pire et le maîtrisai, non que j’étais assez forte pour cela, mais simplement parce que ce chien m’aimait et que je l’aimais.
Chapitre III – La nourriture des mammifères
Le village. Son épicerie buvette, déjà à l’ancienne. L’épicière, Mme Jacquet, encore plus à l’ancienne, un nuage de chantilly. Chignon blanc à la Goulue, tablier blanc, binocles. Tout était rond chez Mme Jacquet. Elle était vieille et semblait toujours l’avoir été. Elle se déplaçait avec difficulté. Le beurre était présenté en une énorme motte enveloppée de mousseline blanche que Mme Jacquet découpait avec le fameux fil. En vitrine, les bonbons dans les bocaux de verre, arcs-en-ciel séduisants. Têtes de nègre, boules coco, mistrals gagnants. Des bonbons justement acidulés qui n’arrachaient pas le palais au passage. L’été, les pailles coco, mélangées à l’eau, saveur de réglisse, vacances exotiques.
La buvette était typique. Des tables à pieds de fonte et plateau de marbre, d’authentiques chaises bistro, des verres anciens et des cuillères à absinthe. Mobilier d’origine certifiée sur lequel ma mère lancera une OPA en règle, plus tard, lorsque notre épicière cessa son activité.
Elle semblait vouloir continuer pourtant. Elle ne savait pas vivre autrement, autrement qu’au son de la clochette qui tintait à l’ouverture de la porte, autrement qu’avec les habitués qui buvaient leur rouge à même le comptoir de l’épicerie, autrement qu’avec les gamins qui faisaient les courses et écarquillaient les yeux devant les friandises. Non, elle ne savait pas. Toute sa vie était là, simple, paisible, réglée comme du papier à musique.
Un neveu en décida autrement. Il décida pour elle que ça suffisait, qu’elle avait assez travaillé, qu’elle n’avait plus la santé. Nobles pensées. Pas si nobles cependant. Le neveu transforma l’épicerie buvette en habitation, s’y installa. Bientôt on n’aperçut plus Mme Jacquet que derrière un rideau qu’elle levait furtivement pour voir la vie dehors. Pas la humer, non, la fenêtre restait close. Au village, on ne l’appelait plus l’épicière, mais la prisonnière.
Des années plus tard j’ai croisé le regard d’un prisonnier conduit au Palais de Justice, debout dans le camion de police, les doigts qui semblaient vouloir s’accrocher au grillage avec force et qui ne pouvaient que se poser sur la vitre lisse et blindée. Le regard, ce regard noir, profond et sans espoir, un regard perdu, lointain, le fond d’un puits. La vie était là pourtant. Le bus avec la fille en face qui croisait son regard. La ville, Paris, la Seine, le carrefour Saint-Michel, le temps morose et pourtant c’était la vie. Il ne pouvait que l’apercevoir. Pour lui tout semblait fini. La vie… sa vie lui avait échappé.
Mme Jacquet pouvait juste voir, les gens, tous ces gens, si peu de gens somme toute qui faisaient ce village, mais ces gens, elle les connaissait tous. Elle les avait servis, leur avait fait crédit, pour certains, au quotidien, pour d’autres, eh bien ! ce fut en ce terrible mois de mai 1968 quand tout finit par manquer.
Mai 68. Comme la bise dans la fable, mai 1968 nous prit au dépourvu. Dans cette torpeur du bien-être économique, voilà que les étudiants manifestaient, cherchant un sens à la vie, bousculant les codes et les hiérarchies, bousculant l’autorité, bousculant le savoir, bousculant le pouvoir. Les ouvriers avaient suivi avec réticence, c’était pour la plupart des pères de famille, responsables, apportant l’unique salaire du foyer. Des chefs de famille comme on disait.
Tout d’un coup, la vie s’arrêta. Plus d’essence dans les stations-service, les voitures, les bus ne roulèrent plus. Notre campagne n’était plus desservie. Nous étions confinés. Une panique nous avait saisis. Nous nous étions précipités à l’épicerie pour faire des réserves de sucre et d’huile. Époque bénie où les gourous de la diététique ne nous interdisaient pas encore toute nourriture terrestre, où l’on pouvait manger du gras, du sucré, du salé, à satiété.
Les stocks de Mme Jacquet furent rapidement à sec, comme nos finances. En temps normal déjà il n’y avait pas un choix exubérant de produits, là d’un coup plus rien sur les étagères. Ma mère pensa, horrifiée, qu’elle était retournée chez les Soviets. Cauchemar. Mais ici pas la peine de faire la queue, il n’y avait rien et il n’y aurait rien.
Les cousins de la ville étaient venus nous voir. Ils avaient une voiture et un peu d’essence. Ils ne venaient jamais d’habitude, occupés à d’autres loisirs le week-end. Faut-il le préciser ? Nous n’avions pas de loisirs. Les fins de semaine ressemblaient à s’y méprendre à la semaine, à part la messe du dimanche matin. La messe où il fallait être à jeun si l’on voulait communier. Bien sûr j’étais à jeun, et bien sûr à la sortie de la messe, en hypoglycémie totale.
Magie de mai 1968. Là, d’un coup, nous les culs-terreux, retrouvions un peu d’intérêt à leurs yeux. L’intérêt dicté par la faim. Nous avions toujours des œufs. Grâce à Dieu, les poules n’étaient pas syndiquées et n’avaient pas cessé de pondre. Nous avions des légumes, mais pas encore de fruits. Trop tôt. Nos fruits provenaient uniquement du verger. Les cousins étaient venus et nous avions fait une grande balade, objectif : la cueillette de champignons. C’était toujours ça de pris et avec quelques œufs il y avait de quoi faire un repas. On n’était pas tout à fait revenus à l’époque du chasseur-cueilleur, mais nous nous apprêtions à entrer dans celle de l’éleveur-cueilleur, celle du système D.
Bien sûr on continuait d’aller à l’école. L’instituteur ne faisait pas grève et n’avait pas été séduit par la revendication de nouveaux codes sociaux. Invariablement la classe commençait par une histoire de morale. On nous enseignait la modestie, la politesse, le savoir-vivre, le savoir-être.
Mai 68, une révolte d’enfants gâtés. Le pouvoir aux autodidactes et après quarante ans sans repères, le recours aux coachs en tout genre. Pour le sport, OK, ça va de soi. Qui a assez de volonté pour faire du sport sans quelqu’un pour dire « Allez ! Encore quatre », « Allez ! On reste tonique » ? Les coachs sportifs disent toujours « Allez ! Quelque chose » pendant qu’ils restent peinards en te regardant suffoquer. Coach pour maigrir, pour faire la cuisine, pour s’habiller, pour s’aimer, pour élever son enfant, pour élever son chien, pour arrêter de picoler, pour gérer ses comptes, pour gérer son business, pour rencontrer l’amour, pour s’épiler les sourcils… Coachs toujours.
Nous n’avions pas de frigo, juste un garde-manger grillagé.
« Oui c’est le truc que tu trouves dans les brocantes et tu te demandes à quoi ça sert. »
Ça servait à mettre les aliments à l’abri des mouches.
Entre le beurre acheté à la découpe, le lait que j’allais chercher tous les jours à la ferme, pas de moyens de conservation et jamais de gastro. Une offre alimentaire peu diversifiée, récoltes du jardin, de saison évidemment, fait maison, pâtisseries, yaourts, du furieusement tendance aujourd’hui.
Nous n’avions pas la télé, mais j’avais un réseau de copains et copines qui me permettait de voir mes séries préférées. La télé des années 1960 était géniale. Peu de programmes, la mire comblait le vide de l’écran très, très longtemps. Les programmes démarraient avec une musique de fanfare. Des chaînes sous le contrôle de l’État. Les débuts timides de la publicité et surtout, surtout pas de météo.
« T’as remarqué l’importance de la météo aujourd’hui ? La météo, c’est le nouvel opium du peuple. Marx doit se retourner dans sa tombe.
–On a deux minutes à combler, vas-y envoie la météo. Cinq minutes ? Bon alors la pub. »
La météo, c’est le sujet de conversation du xxie siècle. Les gens ne parlent que de ça.
« ‘Fait beau aujourd’hui, ‘fait pas beau aujourd’hui.
–Ils se sont encore trompés à la météo. Faudrait qu’ils sortent le nez de leur studio de temps en temps, qu’ils regardent le ciel. »
Des conversations super intéressantes, tu vois. Une fois que tu as parlé de la pluie et de la pluie, puisque le beau temps t’oublies, y’en a pas, et qu’aucun autre sujet ne te vient à l’esprit, tu te dis que c’est un sacré progrès de parler de la météo. Pour sûr, comme on dit à la campagne, que vraiment sans la météo, les relations sociales, c’est bien simple, elles n’existeraient pas.
La météo, ça scotche les gens chez eux, surtout les vieux. Le message est clair : « Sortez pas de chez vous, y’a trop de pluie, y’a trop de vent, y’a trop de verglas et même exceptionnellement y’a trop de soleil. » La météo, la télévision, un super tandem.
Les programmes télé c’était à certaines heures seulement. Il y avait le film du lundi après-midi pour les mères au foyer, généralement du style « la mégère apprivoisée ». Le message était clair : « Autant te résigner ma fille, ta rébellion restera vaine. » Ce film montrait ce qu’il ne fallait surtout pas faire dans la catégorie ménagère de moins de 35 ans. Parce que quand t’avais 35 ans dans ces années-là et que tu étais à la casa, eh bien ! tu te fringuais pour en paraître déjà 50. De fait, tu échappais aux requins du marketing et à leur cible, la ménagère de moins de 50 ans. Pas si mal.
Le jeudi après-midi, on avait Zorro. Zorro c’était culte. Il était vêtu de noir, sur un cheval noir. Rusé, ça va de soi avec un nom pareil. Il portait de drôles de pantalons moulants à paillettes, des boléros de torero, des chemises à frou-frou.
Ce qui faisait un peu jaser sur Luis Mariano, avec Zorro ça passait. C’est le pouvoir de la télévision : nous faire gober n’importe quoi. Ce n’était pas les rochers en carton des décors hollywoodiens qui nous gênaient le plus. De toute façon c’était noir et blanc, alors qu’importe. Zorro triomphait toujours et l’air de rien déjouait tous les coups tordus. Il appelait son père « Père » et le vouvoyait. Zorro c’était la classe. C’était un héros.
Nos yeux d’enfants avaient vu juste. Ce n’était pas un feuilleton de cape et d’épée d’opérette. L’acteur froufroutant n’était pas homme de pacotille. Il avait obtenu le rôle pour ses talents d’escrimeur et livrait de véritables duels. Aujourd’hui encore, malgré la simplicité récurrente des intrigues, confinant au cucul, tout le monde déclare a-do-rer la série.
Thierry La Fronde. On adorait Thierry La Fronde, sa chemise en peau ouverte sur une imposante médaille, des symboles de virilité largement copiés. Thierry La Fronde était un précurseur, un Magnum version moyenâgeuse. Codes de rebelles identiques, cheval de l’écusson Ferrari, médaille sur la poitrine, et chemise, hawaïenne, cette fois. Magnum ne se gèle pas dans les forêts françaises, lui.
Thierry La Fronde, ses compagnons et Isabelle. Malgré notre jeune âge, on voyait bien que quelque chose clochait. L’épisode terminé, il était impossible d’en retenir l’histoire qui se répétait pourtant inlassablement.
Défendre son territoire contre l’envahisseur anglais, avec une fiancée enlevée un épisode sur deux, c’était pas facile tous les jours. Occupé à autre chose qu’à chasser les Anglais, le Thierry. Bon le scénariste, « peut mieux faire », franchement.
Ce qu’il y avait de bien avec Thierry La Fronde c’est justement la fronde. Il la faisait tournoyer dans un sifflement qui n’augurait rien de bon pour ses adversaires. Nous restions scotchés à l’écran par ce rituel fascinant.
Nounours et « Bonne nuit les petits ». Nounours c’était un peu comme Thierry La Fronde, un programme sans consistance, sauf que ça durait moins longtemps. Avec Nounours il y avait Nicolas et Pimprenelle.
Pour faire simple, Nounours c’était la préhistoire des effets spéciaux. Résultat, on ne comprenait rien à ce qu’il disait, à part « bonne nuit les petits » et « pom pom pom pom » quand il arrivait.
Il envoyait du sable magique sûrement parce qu’aussitôt Nicolas et Pimprenelle s’endormaient. Il nous souhaitait bonne nuit à 5 heures de l’après-midi et franchement, même dans les années 1960, c’était un peu tôt pour se coucher.
Belle et Sébastien. Le grand-père, le chien, la neige. Norbert, le play-boy de service, le fourbe qu’on adorait détester. L’ancêtre de J. R. en quelque sorte. Sébastien, les yeux brillants. La montagne, splendide.
Ensuite il y eut les Américains. Les vrais. Zorro bien sûr c’était américain, Los Angeles, mais pour nous il s’agissait d’Espagnols, un point c’est tout. Nous ne pensions pas aux États-Unis.
Arrivèrent les Américains blondinets ou rouquins, on ne savait pas trop, la couleur n’était pas très au point, mais joufflus, oui ça on le voyait bien. Flipper le dauphin nous faisait découvrir la Floride, pas encore les Everglades, non ça, ce serait plus tard. Flipper le dauphin, une espèce de Zorro aquatique.
Pour regarder Flipper le dauphin, j’allais chez Roseline. Sa mère tenait un café accessible par un sentier, un café tellement perdu dans la campagne que je me demandais quels clients pouvaient y venir. Il n’était connu que des gens du village. La recette du jour devait être maigrichonne. N’empêche, Roseline était passée à l’heure américaine. Une autre dimension. On regardait Flipper et on jouait à la Barbie.
C’était la seule du village à en posséder une. Ma mère ne voulut jamais m’en offrir.
« Pas authentique », disait-elle.
Pour tout le reste, j’allais chez Gilles. Pas les mêmes programmes, mais l’assurance du gâteau Vandame au chocolat.





























