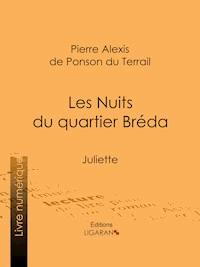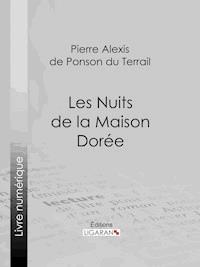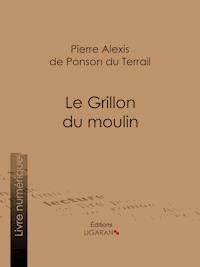Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Extrait : "J'avais promis, l'année dernière, au père Sautereau le brigadier de gendarmerie, d'écrire un jour ses mémoires. Il y a trois jours, c'est-à-dire vendredi soir, au coucher du soleil, comme nous revenions de faire l'ouverture de la chasse en plaine, le jeune docteur L... et moi, nous avons trouvé le brigadier aux Charmilles."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335040395
©Ligaran 2015
Saint-Donat, 4 septembre.
J’avais promis, l’année dernière, au père Sautereau le brigadier de gendarmerie, d’écrire un jour ses mémoires. Il y a trois jours, c’est-à-dire vendredi soir, au coucher du soleil, comme nous revenions de faire l’ouverture de la chasse en plaine, le jeune docteur L… et moi, nous avons trouvé le brigadier aux Charmilles.
Jean-Nicolas Sautereau n’est plus gendarme ; il a pris sa retraite et il vient d’être décoré.
Il s’est retiré dans son petit bien de l’autre côté de la Loire, dans le Val ; c’est une maisonnette blanche, entourée d’un côté d’un clos de vigne et de l’autre d’un arpent de prairie.
Ce modeste héritage appartient à sa femme. Il a fait, lui, quelques économies sur son traitement de trente-cinq années et acheté une inscription au grand-livre.
Sautereau et sa femme ont de quinze à dix-huit cents francs de revenu.
Le petit bourg de Saint-Gratien-au-Val, qui touche à la maisonnette, voudrait bien avoir l’ancien brigadier pour maire ; mais il a refusé :
– Non, non, mes enfants, a-t-il répondu à ceux qui sont venus le lui proposer. J’ai été toute ma vie l’incarnation vivante et populaire de la loi, je suis las de l’autorité et je veux me reposer. Si vous avez besoin d’un conseil, venez, mais ne me demandez pas autre, chose.
Or, vendredi soir, l’ancien brigadier est venu me sommer de tenir ma promesse ; il m’a du reste singulièrement abrégé la besogne, en me remettant un gros manuscrit dans lequel, presque jour par jour, il a consigné les évènements importants de sa vie. Et c’est en le suivant au jour le jour, me bornant au rôle de rédacteur et d’arrangeur, que je vais raconter cette singulière existence.
Il y a quarante ans, la Sologne était un pays tout à fait sauvage.
On n’avait encore rien défriché ni assaini.
Sous les ajoncs dormait une eau bourbeuse ; les bois qui se succédaient sans interruption ne laissant à découvert çà et là que de maigres landes de terre sablonneuse et improductive.
Les hameaux étaient clairsemés ; les villages situés à de grandes distances les uns des autres ; les communications difficiles, pour ne pas dire impossibles.
La population, chétive et malaisée, avait grand mal à vivre.
Le fermier ne se tirait d’affaire qu’en ne payant pas ses fermages.
Le paysan braconnait au fusil, au collet, avec toutes sortes d’engins, et personne n’y trouvait à redire.
Le braconnage était passé, en Sologne, depuis 1789, à l’état de profession avouée, et quelle profession, grand Dieu ! Le gibier assez bon marché quand il arrivait dans les villes, se payait un morceau de pain à celui qui le prenait.
Un de ces industriels qu’on nomme dans le centre poulaillers et qui font le commerce des œufs, du beurre et des volailles, parcourait les campagnes, les fermes, les huttes de charbonniers et de bûcherons, et payait un lièvre de dix-huit à vingt-cinq sous, un perdreau rouge six sous, un gris quatre ou cinq.
Il donnait une livre de poudre pour un chevreuil. Le braconnage était donc un moyen d’existence à peu près avéré, et les quelques grands propriétaires de Sologne, qui étaient chasseurs, ne songeaient même pas aux moyens de le réprimer, lorsque le préfet du Loir-et-Cher fut changé à peu près à la même époque où M. le marquis de Vaux champs fut nommé député.
Tout cela se passait sous la Restauration, et tout au commencement.
Le nouveau préfet, M. de B…, était chasseur, et très à cheval sur les privilèges de chasse ; le marquis de Vaux champs, qui avait une terre considérable en pleine Sologne, entre Romorantin et Salbris, avait une haine violente du braconnage.
Le préfet et le député s’entendirent ; en moins d’un an, toutes les brigades de gendarmerie furent doublées, tous les gardes champêtres et forestiers, destitués et remplacés par des gens étrangers au pays.
Le tribunal de Romorantin entra dans la confédération et se montra sévère ; les pauvres Solognots furent traqués, condamnés.
On confisqua les fusils ; il y eut de la prison pour les récidivistes.
Dans un pays méridional, il y eût eu des révoltes à main armée ; mais le Solognot à la fièvre, il est doux et inoffensif.
Les plus enragés braconniers se soumirent un à un ; et il n’en resta bientôt plus qu’un très petit nombre.
Mais à l’époque où commence cette histoire, il en était quelques-uns encore qui bravaient toute autorité, et, de ce nombre, le plus hardi, le plus enragé, et celui qui, bien que Solognot de naissance, paraissait appartenir à une toute autre race, par la violence et l’irascibilité de son caractère, Martin l’Anguille.
D’où venait ce surnom bizarre ?
Martin habitait avec sa femme et ses cinq enfants une horrible hutte en torchis, couverte de branches de sapin, en guise de toit, en plein bois, au bord d’un étang qu’on appelle la mare aux Ragots.
Dans cet étang d’où s’exhalaient, en automne, de pestilentielles émanations, les anguilles étaient assez communes, et pendant bien longtemps le braconnier Martin avait joint à sa première industrie celle de pêcheur et on avait fini par lui donner le nom du poisson qu’il capturait.
Martin était un homme de petite taille, mais fort, trapu, énergique.
Basané comme un maure, l’œil noir, les dents aiguës et blanches comme un carnassier, il avait une beauté sauvage sous ses haillons.
Sa maison, un bout de champ, quelques nippes et le produit du braconnage de forêt et d’eau, c’était tout ce qu’il possédait.
Il s’était marié à vingt ans, avec une femme plus âgée que lui et qui était devenue aveugle.
Martin avait eu cinq enfants, quatre fils et une fille.
La fille était l’aînée.
À douze ans, pleine de courage, elle s’en était allée dans le Val où les fermiers sont plus aisés, se louer comme gardeuse d’oies.
Les quatre, garçons étaient restés au logis, vivant de la vie du père, c’est-à-dire braconnant le gibier et le poisson, allant avec lui le dimanche jusqu’à Salbris, où ils buvaient et se querellaient dans les cabarets.
Ils étaient jumeaux deux par deux.
Martinet et Martin avaient alors seize ans ; Jacques et Victor quatorze.
Ce dernier restait souvent à la maison, prenait soin de la mère aveugle et faisait la soupe. Il était plus doux que ses frères et disait bien souvent :
« En place de courir les bois, est-ce que nous ne ferions pas mieux de travailler notre champ et d’aller en journée dans le Val ! »
À quoi les frères répondaient par des injures et le père par un coup de pied. Martin-l’Anguille souriait même parfois :
« Si je n’avais pas vu naître le garçon, je croirais qu’il est le fils d’un garde ou d’un gendarme !
– Il est bien à toi, répondait la femme aveugle ; seulement, il a plus de bon sens que vous tous. »
Un soir de novembre, que la querelle recommençait sur ce point, Martin prit son fusil et dit à ses fils :
– Il a neigé la nuit dernière. J’ai connaissance d’une biche et de son faon ; nous les suivrons au pied jusqu’à leur viandis. Il y a longtemps que nous n’avons fait un coup de fusil sur de gros gibier.
– Eh ! mon homme, dit la femme aveugle, tu as déjà eu deux procès cet été ; tu sais bien que M. Sober, le garde-chef, t’a dit que si on te reprenait, tu irais en prison…
– Eh bien ! répondit le braconnier, les enfants te resteront pendant que je mangerai le pain du Gouvernement. Venez les gars !
– Je n’y vais pas, dit Nicolas.
– Tu viendras, brigand ! s’écria Martin l’Anguille en levant la crosse de son fusil sur son fils. Vas-tu pas renier le métier de ta famille à présent !
Et il le poussa rudement dehors, le forçant à marcher devant lui.
La neige couvrait la terre, et il faisait ce qu’on nomme vulgairement un froid de loup.
Le ciel était clair et la lune y brillait de tout son éclat.
– Nous y verrons tirer comme en plein jour, dit Martin l’Anguille en s’engageant le premier dans un petit sentier qui courait sous bois.
Lui seul avait, en apparence du moins, un fusil.
C’était une arme de gros calibre à deux coups.
Mathieu et Martinet, les deux aînés, avaient eux, quelque chose d’entortillé sous leur blouse. C’était ce classique fusil brisé en trois morceaux, à peu près dis par aujourd’hui, mais dont les braconniers se sont servis bien longtemps.
Jacques et Nicolas, les deux plus jeunes fils, avaient spécialité des collets.
Le premier surtout excellait à courber une branche d’arbre sur le passage d’un chevreuil. Quant à Nicolas, le métier ne lui plaisait guère, car il n’en savait pas moins panneauter les lièvres et les lapins et construire le piège ingénieux de l’abreuvoir où se prennent si sottement les bécasses.
Quand ils furent à une certaine distance de leur habitation, le père dit à ses fils :
– Je vous ai tous emmenés, parce que je voulais que la vieille vous laissât tranquilles avec ses gendarmes, ses procès et sa prison ; mais nous n’avons pas besoin de nous en aller de compagnie, comme une barde de marcassins.
La neige est dure : ça fait du bruit en marchant. Mathieu répondit :
– Je vais aller voir du côté de la mare aux Chevrettes. Il doit y avoir un coup à faire.
– Moi, dit Jacques, je vais aller relever mes collets à lapin.
– Je vais avec toi, fit Nicolas.
– Oh ! toi, non, s’écria Martin l’Anguille qui était toujours irrité contre son fils. Tu ne me quitteras pas, gredin ! et bon gré, mal gré, il faudra bien que tu deviennes un vrai braconnier de plaine et de forêt.
– Puisque vous gardez le feignant, dit Martinet, l’un des grands frères de Nicolas, vous n’avez pas besoin de moi.
– Où vas-tu donc ?
– Je vais faire un tour du côté de la ferme des Trois Chênes.
– Ah ! et qu’est-ce que tu veux y, faire, gars ?
– J’ai idée que la fillette à Jean Féru, le fermier, me trouve à son goût.
– C’est possible, grommela Martin l’Anguille ; mais comme Jean Féru a du bien et qu’il pourra peut-être donner quatre ou cinq cents francs en beaux écus à la fille elle ne sera pas pour toi.
– À savoir, dit Martinet.
– C’est tout su, dit brutalement le père.
– La Madeline estime tête chaude ! ce qu’elle veut, elle le veut bien ! je l’enlèverai et nous nous en irons dans le Val, ou bien encore de l’autre côté de la Loire. Alors faudra bien que Jean Pierre consente !
– Ce que tu dis là est mal, murmura le petit Nicolas. Mais son père lui allongea une taloche :
– Mêle-toi donc de ce qui te regarde, affreux gamin ! lui dit-il. Et toi, le gars, fais ce que tu voudras. Après ça nous aurions tout de même besoin d’une femme à la maison.
Martinet s’en alla, tirant de son côté, comme avaient fait les deux frères, et Martin l’Anguille resta seul avec son fils Nicolas.
Ce dernier était tout tremblant.
C’était une nature nerveuse, délicate, impressionnable et fort bonne au fond, car elle avait résisté jusque-là aux exemples déplorables de son père et de ses frères.
– Mais, père, dit-il encore, savez-vous bien que ma mère avait raison tout à l’heure.
– Raison, de quoi ?
– Les gardes, les gendarmes, tout cela s’entend contre vous, depuis quelque temps.
– Oui, mais je suis un bon gibier de change. N’aie pas peur… ils ne me pinceront pas.
– Tenez, père, reprit Nicolas d’une voix suppliante, si vous m’en croyez…
– Eh bien ?
– Nous retournerions à la maison.
– Marche, bandit, ou je te casse la crosse de mon fusil sur le dos ! répondit durement le braconnier.
La lune tamisait sa clarté à travers le feuillage et resplendissait sur la neige. Tout à coup Martin l’Anguille s’arrêta :
– Tiens ! dit-il, connais-tu ça ?
Et il montrait à son fils de larges, empreintes sur la neige.
– C’est un piquet de chevreuil, répondit l’enfant.
– Aussi vrai que tu es un fin braconnier et moi un imbécile ! répondit dédaigneusement Martin l’Aguille. Ne reconnais-tu donc pas les foulées d’un cerf ?
– L’enfant se pencha avec curiosité. Alors Martin l’Anguille, qui tenait à faire l’éducation de son fils, lui dit :
– La foulée est profonde et bien marquée ; le pied est rond et gros ; c’est un cerf de passage. Il n’est pas de ces cantons ; je crois bien qu’il vient des forêts d’Orléans ou de Montargis. Mais comme ses allures ne sont pas régulières et que le pied de derrière est à côté de celui de devant ce n’est pas un vieux six-cors ; c’est un cerf à sa deuxième tétée tout au plus.
Nous allons le suivre, je parie que nous le trouverons à la reposée avant un quart d’heure. La trace du cerf se continuait sur la neige, traversant les taillis et les petites futaies de sapin, qui sont très nombreuses en Sologne.
Martin et son fils cheminaient toujours.
Le premier, qui avait coulé deux balles mariées dans son canon gauche et une balle franche dans son canon droit, s’arrêta tout à coup.
– Qu’avez-vous, père ? demanda Nicolas.
– J’ai entendu du bruit, il me semble.
Et le braconnier se coucha, l’oreille contre terre pour mieux écouter.
– C’est le vent, dit-il enfin en se relevant. Il n’y a personne en forêt… Les gardes trouvent qu’il fait trop froid, et les gendarmes sont couchés.
Les allures du cerf devenaient plus irrégulières encore et l’animal paraissait fatigué, à en juger par la profondeur de ses empreintes.
Martin l’Anguille s’arrêta encore.
– Tiens, dit-il à son fils en lui montrant un fourré de broussailles devant lequel s’ouvrait une étroite éclaircie, pour sûr le cerf est là-dedans. J’ai mon plan. Je vais aller de l’autre côté du buisson et je me posterai.
– Bon !
– Toi, tu vas rester ici. Tu prendras deux cailloux et tu les frapperas l’un contre l’autre en marchant droit sur moi.
– Oui, père, répondit l’enfant, chez qui l’intérêt de cette chasse dominait momentanément les répugnances que lui inspirait le métier de braconnier.
Martin se glissa le long des arbres jusqu’à l’endroit indiqué et s’accroupit au bord du gros buisson qu’il jugeait renfermer le cerf.
Muet, immobile, le fusil à l’épaule, le doigt sur la détente, il attendit.
Alors l’enfant marcha droit sur le buisson en faisant claquer ses cailloux et criant de temps en temps : Are ! are ! are !
Martin ne s’était pas trompé.
Le cerf était dans le buisson ; au bruit, il se dressa inquiet, hésita un moment, car, ainsi que l’avait jugé le braconnier, c’était un cerf de passage et qui était épuisé de fatigue ; puis il bondit hors du buisson et s’arrêta de nouveau, en pleine clairière, cette fois la tête haute, prêt à affronter le danger.
Il était en pleine lumière, à soixante mètres du braconnier.
Martin pressa la détente, le coup partit ; le cerf fit un bond prodigieux et retomba mort. La balle franche l’avait frappé au cœur.
Mais comme le braconnier joyeux s’élançait sur sa victime, un pas précipité retentit sous bois et Martin vit apparaître le tricorne d’un gendarme au clair de lune.
– Ah ! cette fois, Martin l’Anguille, cria le gendarme, il fait assez clair pour qu’on te reconnaisse.
Martin voulut prendre la fuite et cria :
– Sauve-toi ! petiot ! Le gendarme le poursuivit :
– J’ai ordre de t’arrêter, continua le gendarme et tu iras finir ta nuit dans la prison de Romorantin.
Martin courait toujours ; mais le gendarme était jeune, agile, et connaissait parfaitement la forêt.
– On t’a pourtant prévenu, continua le gendarme qui gagnait du terrain, mais tu es incorrigible !… tu auras tes six mois de prison… En courant, Martin fit un faux pas, donna tête baissée contre un tronc d’arbre et tomba.
– Ah ! canaille ! murmura-t-il, imputant au gendarme le mal qu’il venait de se faire. Son front s’était ouvert et le sang en coulait.
– Rends-toi ! cria le gendarme en arrivant sur lui. Mais le braconnier qui n’avait pas lâché son fusil dont le canon gauche était toujours chargé, aveuglé par le sang, ivre de rage et de douleur, répondit :
– Tiens ! voilà comme je me rends !
Et il épaula et fit feu presque à bout portant sur le gendarme, qui tomba à son tour comme était tombé le pauvre cerf.
Martin l’Anguille n’avait jamais commis de crime jusque-là. Jamais, même, il ne s’était approprié le bien d’autrui, hormis le gibier.
Mais, dans l’esprit du braconnier, le gibier est à tout le monde.
À peine le malheureux eut-il vu tomber le gendarme que la peur le prit.
Ses cheveux se hérissèrent, ses yeux s’injectèrent de sang, son cœur cessa de battre.
Il vit se dresser l’échafaud devant lui, et oubliant son fils, oubliant le cerf, cause de son forfait, il prit la fuite, sans même songer à s’assurer si le gendarme était mort ou non.
Or ce dernier avait reçu l’une des deux balles mariées dans la poitrine.
L’autre avait dévié et s’était enfoncée dans un tronc d’arbre.
Le malheureux soldat de la loi était tombé privé de connaissance et baignant dans son sang.
Cependant il n’était pas mort, et il ne tarda point à revenir à lui sous une impression du froid qui avait des transitions de chaleur subite.
Un homme, un enfant plutôt, essayait de le ranimer, en le frottant aux tempes et au visage, avec de la neige mise en boule.
De là ces alternatives de froid et de chaud.
Cet enfant, on l’a deviné déjà, c’était le petit Nicolas, le fils du braconnier.
Nicolas n’avait point calculé que donner des soins au gendarme et chercher à le sauver, c’était perdre son père.
Nicolas n’avait vu qu’un homme en danger de mort, et il était accouru, laissant son père prendre lâchement la fuite après son ignoble action.
La vie se traduisit chez le gendarme par un soupir ; puis il rouvrit les yeux, regarda autour de lui et vit le petit braconnier.
– Qui es-tu donc, toi ? lui dit-il.
L’enfant ne répondit pas.
Il avait déchiré sa chemise et la déchiquetait avec ses dents ; il en avait fait une sorte de charpie avec laquelle il bouchait le trou fait par la balle et essayait d’étancher le sang qui coulait avec abondance.
– Monsieur, dit l’enfant, si vous pouviez seulement marcher cinquante pas, il y a une hutte de bûcherons tout près, où il n’y a personne… Je vous y ferais du feu, et je pourrais ensuite aller chercher du secours.
Le gendarme essaya de se lever ; mais il retomba et murmura d’une voix éteinte :
– J’ai froid…
Et ses yeux se fermèrent de nouveau.
Le petit Nicolas était de taille exiguë, mais, comme tous les gens nerveux, il devenait très fort quand il obéissait à une grande surexcitation.
Il prit le gendarme à bras le corps, fit un effort sur humain et le chargea sur son épaule.
Il comprenait bien que si le gendarme demeurait une heure encore exposé au froid glacial de la nuit, c’était un homme mort.
Alors, pliant sous le faix, mais se-raidissant et puisant dans son courage des forces presque surhumaines, il se mit en route.
Le gendarme s’était évanoui de nouveau.
Ainsi qu’il l’avait dit, Nicolas n’eût guère plus d’une cinquantaine de pas à faire pour arriver à la hutte des bûcherons.
C’était une sorte de hangar bâti avec des madriers réunis les uns aux autres par de la terre glaise et couvert de branches d’arbres.
Les charbonniers y trouvaient un gîte les jours de pluie ; ils y avaient même installé une cheminée rustique, formée de trois pierres, et d’un trou dans la toiture pour laisser passer la fumée.
Les derniers hôtes de la hutte qui, du reste, était un peu à tout le monde, y avaient amoncelé des feuilles mortes et de la fougère.
Nicolas coucha le gendarme sur ce lit improvisé.
La lune brillait toujours au ciel, et on y voyait comme en plein jour.
Ensuite l’enfant qui, comme tous les braconniers, avait toujours sur lui un briquet et de l’amadou, entassa quelques branches mortes, quelques poignées de bruyère sèche et y mit le feu. La chaleur ranima le gendarme, plus promptement que ne l’avait fait la neige tout à l’heure.
L’enfant lui avait ôté son uniforme, et, guidé par un merveilleux instinct, il avait mis une couche de neige sur la blessure.
– Brave enfant, murmura le soldat, tu ne veux donc pas que je meure ?
– Si j’étais bien sûr qu’il ne vous arrive rien d’ici mon retour, répondit Nicolas, je descendrais jusqu’à Salbris chercher M. Chipot, le médecin. Il ne me faudrait pas une heure pour faire les deux chemins.
– Non, reste, dit le gendarme.
Et il essaya de se soulever et de se remettre sur son séant.
C’était un homme de trente-cinq ans à peine.
Il avait fait deux congés dans les chasseurs d’Afrique avant d’être gendarme, et sa poitrine était couturée de cicatrices.
– Bah ! dit-il avec un fin sourire, j’en ai vu bien d’autres, va ! et je n’en mourrai pas cette fois encore.
La neige et les lambeaux de chemise, convertis en charpie, avaient arrêté le sang. Le gendarme porta la main à sa blessure et dit :
– Je crois bien que la balle n’est pas entrée et qu’elle a glissé entre les côtes.
– Je vais courir à Salbris, reprit l’enfant.
– Non, attends…
Et le gendarme parvint à se mettre debout et s’approcha du feu.
– J’ai soif ! dit-il.
Nicolas alla prendre de la neige dans ses mains et la lui tendit.
Le blessé en mit une poignée dans sa bouche ; puis, à la lueur du feu, il se prit à regarder son sauveur.
– Mais qui es-tu donc, toi ? répéta-t-il. L’enfant courba de nouveau la tête.
Un vague souvenir illumina tout à coup l’esprit du gendarme :
– Tu es Nicolas ! dit-il.
– Oui, balbutia l’enfant.
– Le fils de Martin !
L’enfant soupira.
– Ah ! malheureux ! s’écria le gendarme, et tu veux aller chercher un médecin à Salbris ?
– Je ne peux pas vous laisser mourir sans secours, balbutia Nicolas.
– Mais tu ne sais donc pas qui a tiré sur moi ? L’enfant se tut.
– C’est ton père, malheureux, et d’un mot je puis l’envoyer à l’échafaud !
Nicolas joignit les mains :
– Grâce pour lui ! murmura-t-il.
– Soit, répondit le gendarme ; mais si tu veux que je me taise, il faut que tu te sauves toi-même.
– Oh ! non, dit l’enfant, je ne peux pas vous laisser seul. Tenez, ne voyez-vous pas que la faiblesse vous reprend…
En effet, le gendarme à bout de forces, se laissa retomber sur la couche de bruyères.
Nicolas avait parfaitement compris, cependant, ce que venait de lui dire le gendarme.
S’il allait à Salbris, le bruit de l’attentat commis sur le gendarme se répandait, on ouvrait une enquête, et sa présence à lui, Nicolas, auprès du blessé, devenait une preuve terrible contre le meurtrier.
Le gendarme lui tendit la main :
– Écoute, mon garçon, lui dit-il, sans toi je serais mort, car le froid m’aurait pris, et peut-être qu’on n’aurait jamais découvert mon assassin.
Il ne faut donc pas que ta bonne action tourne contre toi-même. Reste auprès de moi.
Quand je me sentirai un peu plus fort, je m’appuierai sur toi et je tâcherai de gagner le bord du bois.
L’enfant et le gendarme passèrent le reste de la nuit dans la hutte.
Le premier entretenait le feu ; l’autre étanchait sa soif ardente avec de la neige.
Au matin, un peu avant le jour, la lune quitta l’horizon.
– Maintenant, allons, dit le gendarme.
Et il sortit en chancelant et s’appuyant des deux mains sur les épaules de Nicolas.
La marche fut longue et pénible.
Le blessé trébuchait souvent ; souvent les forces lui manquaient, et il était obligé de s’asseoir.
Nicolas ne le quittait pas.
Enfin, comme le premier rayon du soleil se montrait, ils atteignirent la lisière de la forêt.
On voyait à un quart de lieue de distance les toits et le clocher de Salbris.
– À présent, va-t-en ! dit le gendarme. Je me traînerai comme je pourrai. Et ne crains rien, je ne dénoncerai pas ton père !
Son crime accompli, Martin-l’Anguille s’était sauvé.
Pendant près d’une heure il avait couru au hasard dans la forêt, en proie à une terreur délirante, le front baigné de sang et les yeux injectés.
L’échafaud se dressait devant ses yeux à chaque pas qu’il faisait, et l’épouvante précipitait sa course.
Mais cette surexcitation, facile à comprendre si on songe que, jusque-là, cet homme n’avait jamais commis que des délits de chasse et de pêche, se calma peu à peu avec la douleur de cette blessure qu’il s’était faite à la tête et qui, sans doute, était la cause première de son crime.
Alors vint la réflexion, et avec la réflexion le sentiment de conservation qui s’empare de tous les criminels après la perpétration de leur forfait.
La terre était couverte de neige et chaque pas laissait une empreinte.
Martin, qui d’abord avait couru dans la direction de la maison, s’arrêta et comprit qu’il se perdait inévitablement s’il ne parvenait point à faire perdre sa trace avant de rentrer chez lui.
Il croyait fermement que le gendarme était mort.
Martin n’avait jamais manqué son coup, et sa balle tuait roide d’ordinaire.
Mais les autres gendarmes ne voyant pas revenir leur camarade se mettraient à sa recherche, trouveraient le cadavre et suivraient le meurtrier à la piste.
Martin faisait toutes ces réflexions, arrêté au milieu de la clairière où il avait tué le cerf.
Une sorte d’instinct l’avait ramené en cet endroit.
Cependant il ne fallait plus songer à emporter l’animal.
Le braconnier reparut sous l’assassin.
– C’est dommage ! murmura-t-il.
Alors il eut une ruse étrange ; il se déchaussa d’un pied et mit son soulier à contresens ; puis, comme il ne pouvait plus marcher ainsi que fort difficilement, il se dirigea vers un petit cours d’eau qui traversait la forêt.
La trace ainsi faite, laissait croire à deux hommes qui auraient marché en sens inverse, sur une seule jambe : une véritable énigme !
Il mit près de deux heures pour faire une demi-lieue et arriva au cours d’eau.
C’était un ruisseau assez large et profond en de certains endroits, assez pour qu’un homme s’y pût noyer.
Martin se dit :
– Si on suit ma piste jusqu’ici, on croira que l’assassin du gendarme s’est péri.
Il remit ses souliers, passa la bandoulière de son fusil autour de son cou et se jeta bravement à l’eau, malgré la rigueur extrême de la température.
Tant qu’il ne put prendre pied, il nagea vigoureusement ; puis arrivé en un endroit où l’eau était moins profonde, il continua à marcher dans l’eau.
Le ruisseau aboutissait à l’étang.
L’étang était profond ; Martin se remit à la nage et vint aborder devant sa maison.
Comme il grimpait sur le bord en se cramponnant à des ajoncs, il entendit des voix confuses à quelque distance.
Il prêta l’oreille et demeura blotti dans les ajoncs.
Les voix se rapprochaient ; il y avait une voix d’homme et une voix de femme.
La voix d’homme était celle de Mathieu, un de ses fils.
La voix de femme, en arrivant à son oreille, le fit tressaillir et il se remit à trembler de tous ses membres, saisi d’une étrange et impérieuse émotion.
C’était cependant une voix claire et tendre, fraîche et presque rieuse, une voix de jeune fille.
Mais Martin avait reconnu sa fille.
La Mariette, comme on l’appelait, était alors âgée de dix-sept ou dix-huit ans.
C’était cette enfant courageuse qui s’en était allée cinq ans auparavant du toit paternel pour aller gagner sa vie.
Le départ de sa fille était peut-être le seul chagrin réel que Martin-l’Anguille eût ressenti de sa vie.
Cet homme dur, farouche, taciturne et comme replié en lui-même, n’aimait ni sa femme, ni ses fils, mais il aimait sa fille !…
Devant elle ; il était sans force et sans volonté ; si elle lui avait commandé de ne plus chasser, peut-être bien qu’il eût obéi.
Or, depuis cinq ans, la Mariette était chez les mêmes maîtres, dans le Val.
Chaque année, pour Noël, elle avait huit jours à elle et venait voir, ses parents.
Chaque année aussi, elle leur apportait la moitié de ses gages, dont elle avait touché le montant la veille de Toussaint.
Puis elle s’en retournait, non plus garder les oies, maintenant qu’elle était une grande fille, mais être servante de ferme.
Or, l’émotion qui s’empara de Martin fut d’autant plus grande qu’il se sentit pris à la gorge par le remords de son crime.
Il aurait bien affronté le regard de ses fils, mais supporterait-il celui de sa fille, le regard honnête et limpide ?
Un moment, caché dans les ajoncs, il écouta causeries deux jeunes gens.
Mathieu disait :
– C’est pourtant vrai que c’est après-demain Noël. Ma foi ! il n’y avait que la mère qui s’en souvînt à la maison. Nous autres nous ne savons comment nous vivons. Martinet est allé passer la veillée dans la ferme à Jean Férou, rapport à la Madeline ; moi, j’ai relevé mes collets ; le père et Nicolas sont à l’affût.
– Mon père est incorrigible et vous autres aussi, dit la Mariette avec douceur ; il vous arrivera malheur quelque jour, vous verrez ça…
À ces mots Martin eut froid au cœur.
Mais il fit un effort de courage et se montra tout debout au clair de lune sur la berge de l’étang.
La maison était à vingt pas ; un filet de fumée s’en échappait, et les vitres de papier huilé de l’unique fenêtre laissaient passer un reflet rougeâtre. Bien qu’il fût deux heures du matin, il y avait du feu dans l’âtre et la mère aveugle n’était pas encore couchée.
L’arrivée de sa fille en était cause, car la Mariette était venue heurter à la porte un petit quart d’heure après le départ en forêt de son père et de ses frères.
Cette année, elle avait devancé son arrivée d’un jour.
Elle s’en était venue à pied, à travers bois, pour aller au plus court, un petit paquet de hardes sur la tête, vêtue de sa robe des dimanches et chaussée de bons sabots tout neufs, cheminant gaillardement et ayant fait ses dix lieues dans sa journée.
La mère et la fille s’étaient attardées à causer ; elles avaient tant de choses à se dire depuis un an qu’elles ne s’étaient vues !
Et puis la Mariette ne voulait pas se coucher que son père ne fût de retour.
Mathieu était rentré le premier.
Le frère et la sœur s’étaient remis à jaser.
Mathieu était plus causeur, plus expansif que son frère jumeau Martinet.
Après Mathieu, le petit Jacques était entré à son tour avec un sac de bécasses prises au collet.
Jacques avait embrassé sa sœur et s’était couché.
Mais ni Martinet, ni le père, ni le petit Nicolas n’étaient rentrés.
La Mariette aperçut Martin-l’Anguille qui venait de se dresser au bord de l’étang, jeta un cri de joie et courut à lui les bras ouverts.
Martin était ruisselant.
– Ah ! mon Dieu, exclama la jeune fille, vous êtes donc tombé à l’eau ?
– Oui, répondit Martin, je m’étais posé là-bas, de l’autre côté, pour attendre qu’un chevreuil vint boire ; je me suis laissé endormir par le froid et je suis tombé. Une fois dans l’eau, je suis venu à la nage.
– C’est drôle, tout de même, fit Mathieu en s’approchant ; vous n’avez pas perdu votre fusil ; est-ce que vous l’aviez, comme ça, passé en bandoulière, pour guetter les chevreuils ?
Le père jeta à son fils un regard farouche et ne lui répondit pas.
Puis il dit à sa fille :
– Nous ne t’attendions que demain, petiote. Viens nous-en à la maison, je suis transi.
– Je vas vous faire un bon feu, dit la Mariette ; il y a de la soupe, qui chauffe. C’est moi qui l’ai faite.
– Je n’ai pas faim, murmura le braconnier d’un air sombre.
Puis il dit encore :
– Ton maître t’a laissé venir un jour plus tôt ?
– Oh ! dit la jeune fille avec un sourire, mon maître ne me refuse plus rien, maintenant !
– Et pourquoi donc ça, fit Martin avec inquiétude, comme il mettait la main sur la bobinette de la porte ;
– Eh ! père, dit naïvement la Mariette, si je voulais me marier, est-ce que vous me refuseriez votre consentement ?
La Mariette entra à ces mots dans la maison, et les reflets du feu éclairaient en plein son visage.
– Le fils à mon maître me veut prendre pour femme à tout prix, dit-elle encore.
Martin-l’Anguille regarda sa fille, et ne put se défendre d’un sentiment d’admiration.
La Mariette était vraiment une jolie fille, et on s’expliquait, en la voyant, le goût du fils de son maître.
Mais, comme Martin-l’Anguille entrait à son tour dans la maison et se trouvait pareillement éclairé par le rayonnement du feu, la Mariette eut une exclamation d’effroi.
Elle avait aperçu le front ensanglanté du braconnier.
Martin l’Anguille avait pourtant baigné son front dans l’étang ; mais le sang coulait toujours peu à peu, comme une source à demi tarie, et depuis qu’il était sorti de l’eau, son visage s’était de nouveau rougi.
– Père ! père ! cria la Mariette, vous êtes donc blessé ! Martin tressaillit, mais il ne perdit pas son sang-froid :
– Oui, dit-il ; en tombant dans l’étang, je me suis cogné à un de ces pieux qui sont destinés à retenir nos filets.
– Ah ! fit Mathieu, qui regarda son père d’un air étrange.
– Ce n’est rien, continua Martin-l’Anguille en s’essuyant le front du revers de sa manche.
Et il alla s’asseoir au coin du feu, pour sécher ses habits.
La mère aveugle ne faisait pas grand bruit dans la maison ; elle allait et venait par suite de sa grande habitude, comme si elle avait vu clair, et les plus petits recoins lui étaient familiers.
Son mari l’avait toujours fait trembler, et jamais elle n’osait le questionner.
Elle ne demanda donc point ce que signifiaient les paroles de sa fille ; elle n’osa point s’enquérir de la gravité de la blessure de Martin.
Celui-ci lui dit durement :
– Allons ! femme, puisqu’il y a de la soupe, pose-la sur la table. Je mangerai volontiers un brin.
La Mariette aida sa mère ; au bout de quelques minutes les assiettes furent emplies et Mathieu mit sur la table un pichet de cidre.
Ce dernier observait son père et semblait chercher le mot d’une énigme.
Martin se mit à table, mais il ne mangea pas. Il était sombre et n’osait regarder personne.
Cependant la Mariette s’était mise à jaser, comme une fauvette qui revient au nid et raconte tout ce qu’elle a vu en fendant le bleu du ciel et en courant les buissons voisins.
– Tu vas donc te marier ? disait Mathieu d’un air distrait, car la blessure de son père le préoccupait non moins que le fusil en bandoulière avec lequel, disait-il, il était tombé dans l’étang.
– Oui, répondit la Mariette, si toutefois le père et la mère y consentent.
– Ah ! chère enfant du bon Dieu murmura l’aveugle ; est-ce que nous voudrions faire manquer ton bonheur ?
– Voyons, dit Martin d’un ton bourru qui déguisait mal ses angoisses, faut encore savoir…
– Quoi donc ? fit la Mariette.
– Les tenants et les aboutissants de la chose, pardine !
– C’est mon avis, ajouta Mathieu. Ton maître est-il à son affaire ?
– Vous savez bien que la ferme est à lui ; il aurait soixante mille francs passés que ça ne m’étonnerait pas, répondit la Mariette.
– Et le gars est fils unique ?
– Oui.
Le sombre visage de Martin-l’Anguille s’éclaira subitement.
– Jour de Dieu ! murmura-t-il, une ferme de soixante mille francs ! mais tu seras quasiment une dame.
La Mariette prit la main de son père :
– Vous vous en viendrez tous vivre avec moi, dit-elle. Mes frères aideront mon mari… Vous autres… vous vous reposerez…
– Moi, dit brusquement Mathieu, je reste ici.
– Et pourquoi donc ça ? fit la Mariette.
– Parce que je me suis adonné à la chasse, et qu’il n’y a pas de gibier dans le Val.
– Vous avez tort, dit encore la Mariette, ça vous jouera un mauvais tour votre passion de chasse. Est-ce qu’il ne vaudrait pas mieux travailler honnêtement ?
– C’est peut-être vrai ce que tu dis là, petiote, murmura Martin-l’Anguille avec, un sourire, mais il est trop tard pour changer ses habitudes.
– Et puis, reprit Mathieu, les beaux-frères, ça ne s’accorde pas toujours. C’est pas la peine de nous déranger.
Martin frappa du poing sur la table :
– Mais c’est pas le tout, dit-il, que le garçon ait du bien.
– C’est un travailleur, dit la Mariette.
– Faut encore…
– Son père et lui ont bonne odeur dans le pays, continua la pauvre fille, c’est des braves gens…
– Te plaît-il ?
À cette question posée à brûle-pourpoint, la Mariette se prit à rougir et baissa les yeux.
– Allons ! dit-il, c’est bon en ce cas !
Il avait momentanément oublié son crime pour se repaître du bonheur futur de son enfant.
Mais ce calme fut de courte durée. Il se leva tout à coup et dit à son fils :
– Ah ! ça, où sont donc les autres ?
– Jacques est couché, répondit Mathieu.
– Et Martinet ?
– Dame ! Martinet est comme les lièvres bouquins, il ne rentrera pas avant le jour.
– Et Nicolas ?
– Nous ne l’avons point vu, dit Mathieu. Mais est-ce que vous ne l’avez point emmené avec vous ?
– Nous nous sommes quittés en forêt.
– Tout ça c’est drôle ! murmura Mathieu, qui garda de nouveau le silence.
– Petiote, reprit Martin-l’Anguille, tu dois être lasse. Tu as fait un bon bout de chemin aujourd’hui.
– Ça c’est vrai, répliqua la Mariette, mais rien que de vous voir ça m’a délassée.
– C’est égal, faut aller de coucher.
– Et vous aussi, j’imagine, père, dit la jeune fille.
– Oui ; mais, auparavant, je vais aller fumer une pipe dehors. J’ai mal de tête.
Et Martin-l’Anguille bourra sa pipe, fit signe à Mathieu et sortit avec lui, après avoir mis sur le front de sa fille un fiévreux baiser.
– Mais dites donc, le père, fit Mathieu, lorsqu’ils furent dehors, est-ce que vous n’étiez pas parti sur le pied d’un cerf ?
– Je ne l’ai pas retrouvé, répondit le braconnier.
– Pour sûr, j’ai des bourdonnements dans les oreilles, ricana Mathieu, car je croyais bien avoir entendu un coup de fusil.
– Il n’y a pas que nous en forêt.
– Oui ; mais votre fusil, ça se reconnaît de loin.
– Alors, fit brusquement le braconnier, c’est moi qui ai tiré, en ce cas ?
– J’en mettrais bien ma main au feu, allez !
– Eh bien ! c’est vrai, dit Martin, j’ai tiré le cerf.
– Ah ! vous en convenez ?
– Mais je l’ai manqué.
– Même la seconde fois ?
– Qu’est-ce que tu veux dire ? demanda Martin en regardant son fils de travers.
– Je veux dire qu’à un quart d’heure de distance, vous avez tiré un second coup de fusil.
Martin prit vivement le bras de son fils.
– Tais-toi ! dit-il d’une voix sourde.
– Père, reprit Mathieu, vous avez tort de vous méfier de moi.
– Je ne me méfie de personne…
– Alors, vous feriez mieux de me conter la chose.
– Quelle chose ?
– J’ai idée que vous avez fait un mauvais coup.
– Mais tais-toi donc, pie borgne ! grommela le braconnier.
– Écoutez donc, continua Mathieu, si c’est comme ça, vous feriez bien peut-être de filer en forêt… on ne sait pas…
Martin-l’Anguille, dont les angoisses redoublaient, n’hésita plus à se confier à son fils.
Il lui avoua tout.
Mathieu était un garçon calme ; il ne manquait ni de prudence, ni d’intelligence.
– Vous êtes dans de mauvais draps, père, dit-il.
– Bah ! le gendarme est mort, et j’ai fait perdre ma trace, dit Martin, qui essayait de faire passer dans l’esprit de son fils une sécurité qu’il ne partageait pas lui-même.
– Mais, Nicolas, où est-il ?
– Ah ! le petit brigand, murmura Martin, il est capable de me vendre.
– Tenez, père, dit Mathieu, voulez-vous que je vous donne un conseil ?
– Parle.
– Reprenez votre fusil, mettez un pain dans votre carnassière, et allez-vous-en en forêt du côté, des grottes. Faut tout prévoir, et attendre ce qui arrivera demain.
Martin songea à sa fille !
– Mais… la Mariette ? dit-il d’une voix tremblante.
– On lui fera une histoire…
Martin hésitait encore…
En ce moment, son fils et lui virent se dresser de l’autre côté de l’étang la silhouette de Martinet.
D’où venait Martinet ?
Martinet, ainsi qu’il l’avait annoncé, s’en était allé à la ferme de Jean Féru, passer la veillée, et courtiser la Madeline, une assez jolie fille qui devait avoir quelque bien en mariage.
Le fermier de Sologne n’est pas riche ; miné par la fièvre, il travaille peu ; la plupart du temps, il ne peut payer son fermage, et comme son maître sait bien que s’il le remplace il ne trouvera pas mieux, il se résigne à le garder. Pour les géographes, la Sologne commence à la Loire ; pour les gens bien informés, elle ne commence que sur le plateau, c’est-à-dire à deux ou trois lieues du fleuve.
Entre la Loire et le plateau s’étend une contrée plus saine, et plus fertile qu’on nomme le Val.
Là, le paysan a rarement la fièvre, il est plus à son aise, il se nourrit mieux.
Le Solognot s’en vient volontiers chercher fortune dans le Val ; le paysan du Val, par contre, ne déteste pas monter en Sologne.
Dans le Val, la terre est chère ; on en a peu pour beaucoup d’argent. Sur le plateau, elle est pour rien, et pour 60 000 fr. ou à 5 ou 600 arpents.
Le fermier du Val se laisse toujours tenter par cette étendue. Il quitte la métairie qu’il exploitait pour aller louer en Sologne.
Il part aisé, avec de bons équipages de charroi, du grain pour les semailles, et un outillage complet ; il a de beaux écus neufs dans un sac de cuir, et il arrive chez son nouveau propriétaire, offrant toutes les garanties désirables.
Dès la première année, il cultive avec ardeur, tourne et retourne cette terre ingrate et sablonneuse comme il ferait de la terre brune et grasse du Gâtinais, et il est tout étonné d’obtenir une maigre récolte de blé noir, de seigle et de pommes de terre.
Au bout de trois ans, les économies ont passé à payer le fermage ; au bout de six, le fermier est endetté. La picote décime ses troupeaux, la fièvre gagne ses enfants, sa femme et lui-même.
Alors il songe à sa ferme de quarante arpents dans le Val, sur laquelle une charrue suffisait, et où il récoltait du froment. Mais il est trop tard, il est engrené, comme on dit ; la dette l’enchaîne à la terre de Sologne, et c’est là, désormais, qu’il doit lutter, vaincre ou mourir, c’est à-dire succomber sous la routine, ou triompher par les innovations.
Car, depuis quinze ans, la Sologne se transforme, et la main puissante qui s’est étendue protectrice sur elle, lui a ouvert le chemin du progrès.
On a suivi à peu près partout les exemples de la ferme impériale de la Mothe-Beuvron.
Les étangs sont desséchés peu à peu et la fièvre s’en va ; les plantations de sapin se multiplient, et ces plantations qui commencent à être l’aisance du pays, en seront un jour la fortune.
Mais, à l’époque où remonte notre récit, rien de tout cela n’avait été fait.
Le paysan s’obstinait dans les errements d’une longue routine ; au lieu de planter des bois, il défrichait.
Un seul fermier avait deviné l’avenir.
C’était Jean Féru.
Jean Féru était venu du Val il y avait près de dix ans. Il avait pris sa ferme à bail.
Le propriétaire, chose rare ! était un Orléanais gêné, un pauvre confiseur qui avait mangé en spéculations agricoles tout ce qu’il avait gagné avec ses dragées et son caramel.
Il faisait argent de tout, le pauvre homme ! Et quand, au bout de la première année, Jean Féru vint le payer, il le questionna, apprit que le fermier avait de l’argent et finit par lui emprunter dix mille francs.
L’année suivante, nouvel emprunt. Jean Féru proposa d’acheter la ferme. Le confiseur accepta.
Tous ceux qui virent le fermier se charger pour son propre compte de la sologne du confiseur haussèrent les épaules et pensèrent que jamais il ne pourrait s’acquitter. Il n’avait donné que vingt mille francs, et la ferme lui était vendue quarante-cinq mille. Faire à cinq pour cent l’intérêt d’un argent qui n’en rapporte que deux au plus, c’est courir en poste vers une ruine prochaine.
Mais Jean Féru était intelligent et courageux.
Il fit des semis partout. Le sapin pousse vite et il pousse serré. Tous les ans on éclaircit la plantation, et tandis que les jeunes sapins arrachés constituent un premier revenu, les autres grandissent.
Tout l’argent gagné dans le Val par Jean Féru y passa ; mais le confiseur fut payé intégralement ; et lorsque Martinet, le fils du braconnier, commença à courtiser la Madeline, Jean Féru ne devait plus rien et était propriétaire.
Mais il avait une nombreuse famille ; la Madeline était son septième enfant, et Martinet, en calculant qu’elle n’aurait pour dot que quelques centaines d’écus, calculait juste.
Cependant, pour lui qui n’avait rien, c’était une fortune, et il s’était juré de séduire et d’enlever la jeune fille si on la lui refusait.
Martinet n’était pas vilain garçon ; la Madeline était une fille simple et qui se laissait prendre aisément à un compliment.
Elle avait fini par aimer Martinet ; et, ce soir-là, en quittant son père et en lui disant qu’il enlèverait la Madeline, Martinet ne s’était pas trop avancé.
La neige interrompant les travaux des champs, on avait veillé plus tard que de coutume à la ferme.
Martinet s’était montré rieur : la Madeline s’était laissé lutiner un peu.
Les frères de la jeune fille étaient aussi simples qu’elle, et ils considéraient Martinet, à cause de son habileté de braconnier, comme un être vraiment supérieur.
Il n’y avait que le vieux Jean Féru, qui était un homme d’âge et d’expérience, qui eût deviné le but des assiduités de Martinet.
Or, ce soir-là, comme le jeune homme espérait sortir un peu avec la Madeline, et se faire faire par elle un bout de conduite, Jean Féru lui prit le bras et lui dit :
– J’ai un mot à te dire, mon garçon.
Martinet tressaillit, mais il suivit le fermier.
Celui-ci l’entraîna dans un sentier qui conduisait de la ferme à la forêt, et qui était du reste le chemin ordinaire que Martinet prenait pour s’en retourner chez lui.
– Est-ce que vous auriez besoin d’un lièvre pour votre réveillon ? demanda le jeune homme avec embarras.
– Non, je veux te parler d’affaires, dit le fermier.
– Ah ! voyons !
– Tu fais la cour à ma fille, dit simplement le fermier.
– Je ne dis pas non, dit Martinet, et faut croire que ça ne lui déplaît pas.
– Oui, mais cela me déplaît à moi.
– Bon ! dit Martinet d’un ton insolent, si nous nous convenons pourtant…
– J’ai idée d’établir ma fille autrement, dit froidement le premier.
– Savoir si elle y consentira… ricana Martinet.
– J’ai l’habitude que mes enfants m’obéissent… Madeline comme les autres.
– Eh bien ! c’est à elle qu’il faut dire ça et non à moi…
– Tu te trompes, c’est à toi d’abord. Je te prierai de ne pas revenir à la ferme. On commence à jaser dans le pays, et comme-je n’ai pas l’intention de te donner ma fille, quand même tu aurais des écus…
– Ah ! dit Martinet avec colère, c’est donc que je suis un voleur ?
– Non, je ne dis pas ça.
– Un mauvais sujet ?
– Je ne dis pas ça non plus ; seulement tu fais un métier qui ne me convient pas.
– Et le fermier tourna le dos à Martinet et reprit le chemin de la ferme.
Martinet s’en alla ivre de rage, faisant le serment d’avoir Madeline ou de se venger cruellement.
Comme il quittait les terres de la ferme pour entrer sous bois, il entendit un coup de feu dans les profondeurs de la forêt.
– Eh ! eh ! se dit-il, je reconnais le brutal à papa.
Au bout de dix minutes, un second coup de fusil arriva à ses oreilles, et Martinet s’arrêta tout net.
Les braconniers ont coutume de charger plus fort le canon gauche que le canon droit. La seconde détonation était plus forte que la première.
– C’est le canon gauche de papa, se dit Martinet. Or, comme il y avait eu un intervalle de dix minutes entre les deux détonations, Martinet se demanda pourquoi son père n’avait pas rechargé son canon droit.
Et comme il cherchait la solution de ce problème, il vit une empreinte de pas sur la neige.
Il se baissa pour l’examiner et ne s’y trompa point une seconde.
C’était l’empreinte de la botte d’un gendarme.
– Oh ! oh ! se dit le petit braconnier, est-ce que papa aurait fait un malheur ?
Et il rebroussa chemin.