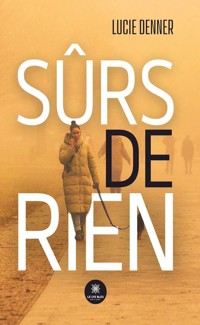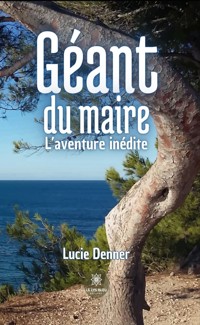Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Pauline se souvient des évènements qui ont marqué son adolescence et impacté parfois négativement sa vie d’adulte, en particulier sur le plan professionnel. Elle porte un regard sans concession sur elle-même, sur sa famille et sur différentes institutions qu’elle a fréquentées. Aujourd’hui retraitée, elle décrit sa propre évolution parallèlement à celle de la société française depuis cinquante ans et vous entraîne au cœur de son parcours de vie.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Lucie Denner a un goût prononcé pour l’art. Avec Mi familia disfuncional… et autres petites agressions sans importance, elle l’utilise pour mettre en avant certaines problématiques sociales et culturelles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lucie Denner
Mi familia disfuncional… et autres petites agressions sans importance
Roman
© Lys Bleu Éditions – Lucie Denner
ISBN : 979-10-377-7055-4
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À Michel, qui m’a sauvé la vie et qui a toujours été présent quand j’allais mal.
À Yolande, ma meilleure amie depuis cinquante ans.
À Jan, mon meilleur ami depuis vingt-cinq ans.
Pauline venait de refermer le livre d’Edouard Louis « En finir avec Eddy Bellegueule » (paru en 2014 mais qu’elle découvrait seulement sept ans après) en réalisant avec surprise qu’il existait quelques similitudes entre la famille de l’écrivain et la sienne. Plusieurs bémols quand même : elle n’était pas issue du même milieu social, ni du côté de son père ni de celui (plus désargenté) de sa mère. Elle n’avait jamais souffert de la faim, du mal-logement ou de violences physiques. Son grand-père paternel n’aurait jamais affirmé en public ou en privé « qu’il avait envie de casser du pédé » mais tout est question de formulation. Il se méfiait par ailleurs des Juifs et des Arabes et pour lui les Noirs ne faisaient pas vraiment partie de la société française (il n’en avait probablement jamais rencontré un seul). Le père de Pauline, qu’elle aimait infiniment mais dont elle ne comprenait pas toujours les réactions, lui avait dit une fois que les homosexuels « n’étaient pas normaux puisqu’ils souffraient d’une pathologie mentale ». Il avait quêté son approbation mais à cette période de sa vie elle n’avait pas une opinion très tranchée sur le sujet bien que la remarque paternelle l’ait mise très mal à l’aise.
Elle avait d’autres souvenirs liés à sa famille paternelle qui la hantaient encore cinquante ans après. Lors d’un déjeuner chez ses grands-parents dans les années 1970 (elle avait treize ans), son grand-père était tombé sur un magazine (sans doute « Rock and Folk ») qu’elle avait apporté. Après l’avoir parcouru, il l’avait jeté rageusement sur la table du salon à cause d’un article sur une chanson de John Lennon « God » dans laquelle le musicien expliquait que « God is a concept by which we mesure our pain » (Dieu est un concept par lequel nous mesurons notre douleur). Elle n’avait pas compris sa colère car elle aimait déjà beaucoup les Beatles et croyait encore en Dieu à cette époque.
Une autre fois, toujours à l’occasion d’un déjeuner familial, il s’était encore emporté contre la politique (trop sociale à ses yeux) du gouvernement (celui de Jacques Chaban-Delmas ou de Pierre Messmer) en déplorant que « même les ouvriers ont deux voitures aujourd’hui ! ». Il ne s’agissait en aucune façon d’un discours écologiste avant l’heure, son grand-père n’ayant jamais été progressiste. Il était simplement le pur produit d’une certaine bourgeoisie de province de son époque, peu éclairée, et pour laquelle les mots « religion », « famille », « patrimoine » et « devoir » étaient les seuls à avoir du sens. Elle ne le condamnait pas : il était persuadé qu’il était dans le droit chemin. Après le décès de son père en 2000, elle avait retrouvé en cherchant un document dans ses papiers une lettre de son grand-père datant de quelques mois avant sa mort dans laquelle il exprimait ses regrets pour « les fautes qu’il avait commises et les personnes qu’il avait blessées au cours de son existence ».
La famille maternelle de Pauline ne brillait pas non plus par sa tolérance et son humanisme. Elle avait essayé en vain de découvrir pourquoi sa tante, l’aînée de la fratrie (une année de différence avec sa mère), avait été « adoptée » à l’adolescence par son oncle par alliance, s’éloignant ainsi définitivement de sa vraie famille. Pauline avait estimé qu’il s’agissait probablement d’un arrangement financier dans la mesure où ses grands-parents maternels avaient cinq enfants et pas un sou. Sa tante avait ainsi bénéficié d’une vie matérielle beaucoup plus facile et avait obtenu un diplôme de docteure en droit qui ne lui avait par ailleurs jamais servi sur le plan professionnel car, en 1950, peu de femmes étaient en mesure d’accéder à des métiers prestigieux. Sa mère en revanche, titulaire d’une licence de droit, avait passé le concours d’inspecteur des impôts avec succès, et régulièrement progressé sur le plan professionnel. Son oncle, de trois ans plus jeune, avait embrassé une carrière d’expert-comptable qu’il avait exercée sur la Côte d’Azur depuis ses débuts dans la profession. Il avait dû se résoudre par la suite à payer l’ISF (impôt sur la fortune) car il possédait à l’époque plusieurs biens immobiliers à Nice et s’était même acheté une Pontiac. Son autre oncle, plus jeune d’une dizaine d’années, n’avait pas aussi bien « réussi » que son frère et ses sœurs aînés : après avoir travaillé comme chef de chantier dans une société du BTP pendant plusieurs années, il avait créé sa propre entreprise qui avait été rapidement mise en liquidation judiciaire. Il avait ensuite trouvé un poste de surveillant dans un lycée professionnel de sa région où il avait travaillé presque jusqu’à sa retraite (il est décédé à 58 ans). Quant au benjamin de la fratrie, Pauline ne l’avait jamais connu car il est mort très jeune d’un cancer avant sa propre naissance. On pouvait dire que, sur les cinq enfants, trois avaient « réussi » au sens que l’on donne encore souvent à ce terme. Dans cette famille, l’argent avait vraiment été un puissant moteur de reconnaissance sociale et avait toujours justifié les décisions individuelles et l’appartenance politique. Rien de très original, mais si l’on examinait de plus près les destinées familiales sur le plan social, culturel et surtout affectif, les choses devenaient beaucoup plus intéressantes.
La relation que Pauline avait eue avec sa mère avait toujours été ambivalente. Elle avait longtemps pensé que cette dernière ne l’aimait pas jusqu’à ce jour de 1983 (elle avait vingt-cinq ans) où son père lui avait expliqué qu’elle l’aimait, mais « à sa façon ». Pauline lui avait rétorqué qu’elle n’appréciait pas « sa façon », il avait fini par lui dire que deux personnes seulement comptaient vraiment pour sa femme : sa mère et son fils. Pauline en avait longtemps voulu à son frère d’être le préféré, alors qu’il n’y était strictement pour rien et qu’il rejetait par ailleurs le trop-plein d’amour maternel dont il faisait l’objet. Leur mère n’avait d’ailleurs jamais cessé de mettre ses deux enfants en concurrence, exacerbant la rivalité (réelle ou supposée) qui les opposait et qui avait fini par se transformer en indifférence pendant quarante ans. Son frère lui avait confié récemment qu’il considérait qu’ils avaient été élevés tous les deux comme deux enfants uniques malgré leurs trois années d’écart.
Pauline s’était construite comme tant d’autres sur les sables mouvants des non-dits et des incompréhensions, ce qui avait engendré dans son cas une adolescente bancale et timorée qui manquait cruellement de confiance en elle. La seule reconnaissance dont elle bénéficiait (de la part de ses enseignants) était sa réussite scolaire, en particulier dans les matières littéraires, mais cet aspect n’avait jamais été vraiment valorisé par ses parents qui devaient trouver cette particularité tout à fait normale. À propos de scolarité, quand sa mère avait décidé de l’envoyer au collège catholique privé de la ville où la famille venait de s’installer alors que son frère était inscrit dans le public, elle n’avait pas compris ses motivations. Comment une mère, qu’elle avait toujours entendu dénigrer violemment les religieuses qui l’avaient instruite, pouvait-elle délibérément choisir ce type d’institution pour sa fille sinon pour s’assurer que celle-ci allait subir le même sort qu’elle ? Cela n’avait pas manqué d’arriver dans cet établissement dont Pauline gardait encore aujourd’hui un souvenir exécrable, à la mesure du harcèlement moral dont elle avait fait l’objet de la part des deux seules religieuses enseignantes du collège.
Un lundi matin, l’une d’elles avait fait une enquête dans la classe pour savoir si certaines élèves avaient regardé le film de Roger Vadim « Le repos du guerrier » diffusé la veille sur le petit écran. Heureusement pour Pauline, elle n’avait pas l’autorisation de regarder la télévision après vingt heures trente. L’idée qu’un tel spectacle puisse être proposé un dimanche soir sur l’unique chaîne de télévision du pays avait rendu la religieuse enragée. Un autre lundi matin (il se passait décidément beaucoup de choses le week-end), sa collègue avait déclaré devant la classe médusée que les 146 victimes de l’incendie du dancing de Saint-Laurent-du-Pont en Isère auraient mieux fait de rester dans leur lit le samedi précédent. Elle se targuait d’enseigner l’anglais et, pour expliquer la signification du mot « stain » (tache), elle avait sorti un mouchoir sale de sa poche qu’elle avait exhibé avec insistance. Les autres enseignantes, des laïques, étaient beaucoup plus tolérantes et certaines avaient réellement donné à Pauline le goût et le plaisir d’apprendre. Les choses s’étaient cependant énormément arrangées pour elle au lycée privé Fénelon de Clermont-Ferrand, la grande ville voisine, qui constituait le prolongement normal du collège et qui n’accueillait à l’époque que les meilleurs éléments de la classe de troisième. À sa grande surprise, elle y avait découvert un monde complètement nouveau, aux antipodes de celui qu’elle connaissait jusqu’alors. Cet établissement catholique, tout en assumant pleinement son engagement religieux, ne formait pas que des têtes bien pleines, mais accueillait volontiers toutes les idées progressistes pouvant contribuer à l’autonomie intellectuelle de ses élèves.
En 1975, alors que la loi Veil était au centre des débats, Pauline était déléguée de sa classe de terminale A. Avec son homologue, elle avait obtenu l’autorisation d’en organiser un sur l’avortement avec la possibilité de choisir librement les intervenants. Elle n’avait plus de souvenir précis de cet évènement mais se rappelait l’intérêt qu’il avait suscité auprès de ses camarades. Quant à ses professeurs, elle estimait qu’elle leur serait toujours reconnaissante pour la qualité de leur enseignement et leur liberté d’esprit. Le professeur d’espagnol lui avait transmis sa passion pour l’œuvre de Federico Garcia Lorca et il était le premier, en 1976, à l’avoir sensibilisée aux catastrophes naturelles susceptibles d’affecter la planète à la suite de la disparition progressive et programmée de la forêt amazonienne. La professeure de Français avait été à l’origine d’une scission dans la classe de première séparant ainsi les rousseauistes et les voltairiennes, tout en autorisant les membres des deux clans à lancer joyeusement leurs arguments à la figure de leurs « adversaires ». Cette femme très cultivée dont le caractère difficile n’était pas apprécié par tout le monde se déclarait ouvertement pro-Voltaire. Elle avait déclaré par ailleurs que les philosophes du siècle des Lumières avaient joué les apprentis sorciers, en sous-estimant l’ampleur des réactions suscitées par leurs idées progressistes qui aboutiraient finalement à la révolution de 1789.
En seconde, les parents de Pauline avaient préféré qu’elle intègre une section C (maths et physique), représentant déjà la voie de l’excellence. Elle avait vraiment « ramé », surtout dans les matières scientifiques qui étaient pourtant enseignées par des professeurs relativement bienveillants par rapport à ses difficultés. Elle trouvait les mathématiques « desséchantes » et trop désincarnées et se retrouvait le plus souvent bloquée face à un problème de résolution d’équation où, tel un papillon enfermé dans un bocal de verre, elle avait le sentiment de tourner longtemps et vainement en se cognant à la paroi sans parvenir à trouver la sortie. La professeure de biologie (aujourd’hui de SVT, « Sciences et Vie de la Terre ») avait réussi à l’intéresser à la structure et à la composition de l’ADN (Acide désoxyribonucléique, acide du noyau des cellules vivantes et constituant essentiel des chromosomes, porteur de caractères génétiques) dont l’analyse permettrait, dès la fin des années 1990, aux enquêteurs de la Police et de la Gendarmerie d’identifier formellement les auteurs d’assassinats ou de meurtres (elle adorait les faits divers et n’avait pas raté par la suite une seule enquête de l’émission « Faites entrer l’accusé »). Lors d’un cours portant sur l’appareil reproductif (de la grenouille), l’enseignante avait conseillé à ses élèves « d’attendre » avant de coucher avec un garçon car elle considérait qu’il s’agissait là d’un acte essentiel et lourd de conséquences pour une jeune fille (en 1975, la contraception était encore difficile d’accès pour les adolescentes). L’une d’elles s’était alors exclamée : « Trop tard pour moi ! », ce qui avait fait glousser toute la classe et provoqué un sourire sur le visage de l’enseignante. Quant à la professeure de physique-chimie, surnommée « ZOE » par plusieurs générations de lycéennes parce qu’elle utilisait systématiquement ces lettres pour nommer les points situés au sommet et à chaque côté de la base du triangle isocèle, elle faisait peur à tout le monde. Quand elle surveillait le devoir sur table qu’elle venait d’infliger au premier groupe de la classe, elle obligeait les élèves du second à se plaquer contre le mur en silence pour laisser sortir leurs camarades qui venaient de « plancher » sur le même sujet. La professeure d’Histoire-Géographie, qui s’était rendue à Moscou quelques mois plus tôt, avait raconté qu’elle avait dû en cours de voyage remplacer précipitamment ses chaussures dont l’un des talons s’était cassé. Elle avait fait le tour des magasins de la ville et s’était vue proposer un seul modèle dans sa taille, une paire ressemblant vaguement à des mocassins, mais de couleur violette. Cette anecdote avait eu le mérite de faire entrevoir aux élèves les limites de la planification autoritaire mise en place par les autorités soviétiques. Pauline se demandait cependant qui aurait osé porter des chaussures de cette couleur à l’époque, sauf peut-être David Bowie, les hippies et quelques artistes emblématiques de la contre-culture américaine. Elle était persuadée que les membres de « la bonne société » que fréquentaient ses parents n’y auraient jamais pensé, même en rêve. Tous ces souvenirs avaient exercé sur elle une forte influence et ce n’était sans doute pas un hasard si elle deviendrait elle aussi enseignante bien des années après.
Malgré ces côtés positifs, son adolescence et une grande partie de sa jeunesse avaient été marquées par de nombreuses frustrations personnelles et autant d’occasions manquées. Pas seulement à cause de son éducation en elle-même (plus personne aujourd’hui n’emploie le terme « judéo-chrétien », trop galvaudé et trop convenu) mais par la manière insidieuse avec laquelle elle avait forgé sa personnalité et ses relations aux autres. Il n’y a pas si longtemps qu’elle avait réalisé que le peu d’estime qu’elle se portait et sa sainte horreur du conflit sous toutes ses formes avaient parfois entraîné pour elle des conséquences disproportionnées et parfois dramatiques par rapport aux enjeux réels.
La première erreur qu’elle avait commise concernait ses études supérieures : après avoir obtenu un bac A (littéraire) avec mention bien, elle souhaitait se diriger vers des études de langues, mais pas vers le professorat, étant convaincue qu’elle n’aurait jamais le niveau requis pour passer les concours réputés difficiles de l’Éducation nationale. De plus, les professeurs n’étaient pas très bien vus dans sa famille car ils avaient « mauvais esprit » (ils votaient majoritairement à gauche à cette époque). Pauline avait donc choisi d’intégrer en 1975 une toute nouvelle filière universitaire (Langues étrangères appliquées), qui présentait beaucoup d’avantages par rapport aux filières universitaires classiques en cette période de chômage élevé : les langues y étaient enseignées avec des méthodes « modernes », incluant la lecture de la presse étrangère, l’utilisation intensive des laboratoires de langues, et… l’enseignement des mathématiques en anglais ! (Ce qui aurait pu la faire fuir étant donné le peu d’intérêt qu’elle portait à cette matière). Elle était particulièrement emballée par la perspective d’entreprendre des études qui allaient sûrement lui permettre d’intégrer le service d’interprétariat de la Communauté Économique Européenne. Elle avait en outre pour la première fois de sa vie bénéficié d’une certaine indépendance dans la chambre d’étudiante dont ses parents payaient le loyer. Le premier semestre s’était déroulé dans un bonheur sans nuages. Les cours la passionnaient et son champ de connaissances s’était élargi puisqu’elle avait choisi d’étudier le Russe en troisième langue, dont il lui restait, hélas, plus grand-chose excepté « Segodnya khoroshaya podoga » en caractères latins (aujourd’hui, il fait beau). La professeure de lettres avait imposé la lecture de « Voyage au bout de la nuit » de Louis-Ferdinand Céline et de « Manhattan Transfer » de John Dos Passos. La professeure d’anglais avait longuement parlé du conflit nord-irlandais et Pauline avait réalisé de manière plus générale que son niveau d’anglais du lycée était perfectible. Par ailleurs, la fréquentation du resto U lui avait permis de rencontrer d’autres étudiants avec lesquels elle discutait beaucoup tout en prenant du bon temps presque une décennie après ce que l’on appelait encore « les évènements de mai 68 ». Les choses s’étaient gâtées dès le mois de février 1976 avec le déclenchement d’une grève générale de trois mois contre la réforme du deuxième cycle universitaire initiée par Jean-Pierre Soisson puis par Alice Saunier-Séité, secrétaires d’État aux universités du gouvernement Chirac.