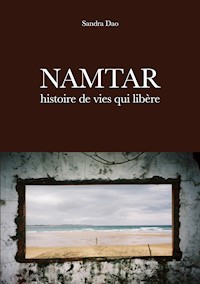
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
« Il ne restait plus qu’une rue à prendre pour se retrouver chez lui quand soudain un sifflement intense pénétra son corps entier et d’instinct ils se jetèrent à terre, les mains sur la tête. Puis ce fut un bruit d’explosion assourdissant, où ses tympans étaient comme pris d’assaut, bouchés à tous les sons, si ce n’est le battement frénétique, de son cœur apeuré au-dedans. Une minute à peine suffit pour que des hurlements déchirants atteignent ses oreilles et que sous l’effet d’un pressentiment néfaste, il se relève d’un bon, pour courir rejoindre sa maison, dans la rue, juste à côté. Juste à côté, il n’y avait plus rien qui ressemble à des maisons, un nuage de poussière s’élevait de la terre qui n’était plus qu’un amas de pierres, de tôles et de vitres, entassées pêle-mêle. Il n’y avait même plus de rue reconnaissable sous ce mot, tout avait été dévasté. »
Namtar, c’est l’histoire entrelacée, de Ahmed, Aya, Arno, Aminata et Anton. Cinq destins qui vont se croiser, s’influencer les uns les autres. Qu’est-ce qui peut bien relier le Palestinien insoumis, la craintive Japonaise, le franco-belge en quête de sens, la Camerounaise déterminée et le doux rêveur américain ? Rien, a priori, sauf cette pointe d’humanité en travers cœur et ce souffle puissant qui secouant leurs pensées, va les pousser à sortir de leurs destins tout tracés, pour suivre un rêve, l’espoir d’une vie meilleure.
Namtar, ou comment à une minute près, le hasard, que certains appellent Dieu, peut tout transformer, nous faire ou nous défaire, suivant les choix qui nous sont donnés et ceux que l’on prend. Namtar, une Histoire de vies qui libère.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Sandra DAO a un parcours atypique de danseuse‑chorégraphe et enseignante depuis 1988, tissé de prises de risques et d’engagements passionnés. De la danse contemporaine, du théâtre aux arts énergétiques, et des voyages comme expérience de déracinement, elle se nourrit de tout et tente de porter le corps et le cœur vers une transformation au quotidien. En 2008, elle quitte Paris pour vivre en pleine nature et développer avec son mari, un lieu écologique, L’espace de La Source, basé sur une vision d’autonomie, où des personnes sont accueillies en retraites personnelles. En 2017, elle publie son premier livre : « On verra la vie ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SandraDAO
N A M T AR
Histoire de vies qui libère
À tous ceux, connus et inconnus, qui ont éclairé mon chemin,à mes deux amours, Kiêt et Dalaï, qui l'illuminent chaque jour.
« Aux humbles dont les choix invisibles guérissent le monde »
–Charles Eisenstein
« Nos vies sont ces étoiles filantes
qui éclairent un instant,
l’obscurité de lanuit,
laissant une trace lumineuse
dans le cœur des êtres,
rencontrés sur les chemins,
au hasard de lavie,
sous le rire de Dieu »
Anton MICHELLE
AHMED
La lumière du jour avait une qualité particulièrement belle ce matin-là, enveloppant de douceur tous les contours, de ce que l’œil papillon venait à toucher à travers cils. Les maisons et les visages semblaient auréolés d’un éclat irisé, ou était-ce sa joie qui rendait tout plus lumineux, se demanda Ahmed en sortant du tunnel ?
Il allait le cœur joyeux, parce que peut-être que cette fois-ci, il avait trouvé un travail qui durerait un peu, Inchallah. Celui qui l’avait embauché l’avait félicité de son efficacité et de son sérieux en lui proposant de revenir le lendemain. Transporter des marchandises qui venaient d’Égypte, pour fournir son pays enclavé, donnait à cet ardu travail tout son sens. Et puis, surtout, il allait pouvoir soulager un peu sa mère, qui réussissait chaque jour le miracle de trouver de quoi faire à manger, pour sa sœur et lui. Il osa même dépenser quelques shekels pour acheter des goyaves dont sa mère et sa petite sœur étaient friandes. Il avait hâte de voir leurs visages réjouis, à la vue des fruits qu’il leur ramenait comme un trophée. Il pressa le pas, tout en jetant un regard admiratif de côté sur le beau visage féminin qui lui avait souri. Ahmed ne vit pas la femme venant juste en face de lui, chargée d’un énorme panier de légumes, en équilibre précaire sur la tête. Le choc fit basculer le panier et Ahmed avec, tous les légumes s’étalèrent largement au sol, sous les cris hystériques de la porteuse en colère.
Des rires fusèrent tout autour d’eux, au son d’une voix éraillée qui venait de s’exclamer :
–Et oui, c’est ça mon fils, à regarder les gazelles on ne voit pas venir les légumes !
Ahmed rougit, s’excusa fébrilement et s’apprêtait à repartir au plus vite, gêné d’avoir été surpris, lorsque la vieille femme furieuse l’attrapa par la manche.
–Et « Habibi », mon chéri, tu ne vas pas partir comme ça, mon miel, tu as bien une minute pour réparer tes bêtises et aider une vieille mère commemoi !
Ahmed n’eut pas le choix, il se plia à la demande, qui tenait plus de l’ordre incontournable. Il aida la femme à tout ramasser, se faisant même accompagner de l’homme qui s’était moqué de lui, encore tressautant de rire. Une fois tous les légumes en place, en vrac dans le panier, ils se relevèrent et l’homme lui confia, un sourire chaleureux sur les lèvres :
–Moi aussi, « Habibi », je préfère les femmes tu sais, mais il faut avouer que c’est plus dangereux que les légumes ! Et il partit d’un grand rire jovial, qui emporta Ahmed dans son élan dejoie.
Ahmed se présenta et sut en retour le nom du chaleureux plaisantin.
–Je suis Tamer, dit-il en lui faisant une vigoureuse accolade.
Au moment de repartir, ils s’aperçurent qu’ils allaient dans la même direction. En chemin, Tamer lui demanda pourquoi il était si pressé et Ahmed tout joyeux, lui expliqua les raisons qui le poussait d’un pas vif à regagner sa maison. Tamer le félicita et lui dit que sa mère avait de la chance d’avoir un si bon fils, comme lui. Oui, Ahmed était heureux d’annoncer la bonne nouvelle de ce travail à sa mère. « El amdoulillah », ils allaient peut-être pouvoir vivre un peu mieux.
Il ne restait plus qu’une rue à prendre pour se retrouver chez lui quand soudain un sifflement intense pénétra son corps entier et d’instinct ils se jetèrent à terre, les mains sur la tête. Puis ce fut un bruit d’explosion assourdissant, où ses tympans étaient comme pris d’assaut, bouchés à tous les sons, si ce n’est le battement frénétique, de son cœur apeuré au-dedans. Une minute à peine suffit pour que des hurlements déchirants atteignent ses oreilles et que sous l’effet d’un pressentiment néfaste, il se relève d’un bon, pour courir rejoindre sa maison, dans la rue, juste à côté. Juste à côté, il n’y avait plus rien qui ressemble à des maisons, un nuage de poussière s’élevait de la terre qui n’était plus qu’un amas de pierres, de tôles et de vitres, entassées pêle-mêle. Il n’y avait même plus vraiment de rue reconnaissable sous ce mot, tout avait été dévasté. Le voile de poussière qui enveloppait l’ensemble obstruait la vue, comme par pudeur, de la catastrophe entière.
Ahmed saisi d’effroi se mit à hurler les noms de sa mère et de sa petite sœur, son cœur battant en pleine tempête, il ne voulait pas en croire ses yeux. Il plongea dans la chape épaisse du nuage de poussière, qui s’élevait tranquillement de la terre vers le ciel, retombant pesamment du ciel vers la terre. Courant et trébuchant vers ce qui restait de sa maison, il se mit à dégager les pierres, les bois, les cadres des fenêtres brisées, tout en hurlant comme un fou, les noms de sa sœur et de sa mère. Il déplaçait des pierres énormes, grattait à mains nues la terre accumulée abruptement sur les débris, soulevant à nouveau une poussière noire et dense. Il hurlait encore et encore, s’étouffant de douleur, les noms aimés, cherchant, comme un chien affamé, à creuser au centre de ce qui avait été sa maison, ce matin encore. Il savait d’instinct qu’il fallait faire vite, si elles étaient là, ensevelies en dessous, cela n’était plus qu’une question de minutes.
En soulevant une taule, Ahmed reconnut soudain, plantée entre deux briques, une petite main aux ongles brillants d’étoiles que sa sœur lui avait fièrement montré la veille. Criant le nom adoré, il se mit à dégager tout autour à toute vitesse, se déchirant les doigts, insensible à cette douleur-là, il réussit à dégager le bras. Continuant à le désenclaver de sa gangue de gravas, il projetait tout ce qui lui passait sous les doigts au loin avec fureur, pierres, bois, métal tordu, plastique fondu, jusqu’à découvrir enfin sa frêle épaule.
Mais Ahmed ne trouva rien d’autre que le bras de sa sœur, seul, abandonné du corps, reposant si menu dans ses mains, couvertes de sang et de poussière, et une douleur intense lui déchira le ventre. Un « non » assourdissant explosa de sa gorge en même temps que le prénom de « Zohra » s’élevait en défi vers le ciel. Puis des larmes se mirent à couler sur son visage ravagé, sans qu’il ne ressente plus rien, que cette douleur qui lui broyait lecœur.
Ahmed, à demi enseveli sous la poussière et la violence de la souffrance, ne s’était pas aperçu qu’il n’était pas seul à fouiller dans les décombres de cette guerre sans fin, ils étaient nombreux à chercher les restes d’un parent, d’un ami, d’une vie. Quelqu’un d’autre l’accompagnait au plus proche dans cette excavation morbide. Ce n’est que lorsque Tamer lui toucha l’épaule qu’il l’entendit vraiment lui parler.
–Mon fils, viens vite, il va te falloir du courage, j’ai retrouvé ta mère, je crois.
Sans lâcher le bras de Zohra, qu’il tenait inconsciemment bercé contre sa poitrine, Ahmed suivit Tamer, le précédent presque. Sa mère était là, couchée dans les gravats, à moitié ensevelie, elle respirait à peine quand Ahmed inonda son si beau visage, à présent tuméfié de blessures, de ses propres larmes. Il eut le temps de voir ses yeux, s’ouvrir pour le recouvrir d’amour en une faible éclaircie, l’éclat s’évaporer dans un rayon du jour, et ses yeux se refermer en un souffle.
Combien de temps Ahmed resta prostré à déverser ses larmes, recroquevillé, les mains enveloppant le visage tant vénéré de Wahida, il n’en savait rien, mais le jour déclinait déjà qu’il était encore là, immobile, le front posé sur celui de sa mère. Il avait bien senti la présence de Tamer qui tentait de l’arracher à cet état de torpeur. Mais Ahmed n’était que lamentations réitérées, que des pourquoi, pourquoi encore, se succédant en vagues croissantes et décroissantes qui le submergeaient sansfin.
Deux ans auparavant, il y avait eu son père, blessé lors de la première explosion de leur maison, et mort des suites de ses blessures. Ils l’avaient enterré, et réussi au prix d’efforts surhumains, peu à peu, à se reconstruire, une maison, une vie, sa mère, sa sœur et lui, malgré l’absence du père, pourtant essentiel. Mais là, en un instant, tout lui était pris, sa mère, sa sœur et sa maison. Non, non, non ! Mais pourquoi, pourquoi Dieu permettait-il ça encore ? Qu’avait-il fait ? Qu’aurait-il dû faire ? Et pourquoi, lui, n’était pas mort aussi, avec elles ? Pourquoi était-il arrivé une minute trop tard ?
Peu à peu, un froid glacial, malgré la chaleur ambiante, s’insinua en lui et il sentit qu’il devait agir. Avec l’aide de Tamer, ils dégagèrent le corps de sa mère Wahida, comme ils purent, et l’enterrèrent avec les restes de sa sœur, sous l’égide de l’Imam du quartier voisin. Ce fut une courte cérémonie, il y avait tant à faire, lui confia l’Imam. Le quartier avait été détruit par plusieurs missiles israéliens, on ne savait pas pourquoi, peut-être en représailles. C’était un moment de la journée où les maisons étaient remplies de voisins, d’amis, c’était l’heure conviviale du partage, de ce que chacun avait pu ramener pour manger ensemble. Un vrai carnage, il ne restait plus rien qui ressemblât à un quartier vibrant. Les rares voisins qu’Ahmed reconnut, c’était ceux qui comme lui, avaient tardé à rentrer, pour leur chance ou malchance, comment savoir.
Ahmed lui aussi, au-dedans, était à l’image du quartier, en ruine. Assis sur le tas de pierres qui fût sa maison un jour, Ahmed, la tête entre les mains pour ne pas qu’elle tombe sous le poids du désespoir, n’avait plus où aller se réfugier pour lanuit.
Tamer ne l’avait pas quitté des yeux, ange protecteur, rôdant autour pour apporter son aide à ceux qui en avaient le plus besoin. Passant d’une voisine effondrée qui voulait en finir avec tout ça, à une petite fille éperdue ne comprenant pas où était sa maison, où était sa maman. Elle était tellement désolée de ne pas être rentrée tout de suite, comme lui avait demandé sa maman, elle jouait avec Samia, elle n’avait pas vu l’heure, mais là, elle voulait rentrer chez elle, mais où était sa maman ?
Tamer dut saisir Ahmed par le bras, et avec le plus de douceur et de force alliées, le tirer comme une ombre hors de ce quartier, devenu en moins d’une minute un cimetière à cœur ouvert. Il se laissa emporter, puisque désormais, peu importait où il irait, la souffrance de la perte était là, l’accompagnant partout en chien fidèle. D’ailleurs, il n’avait plus nulle part où aller. Même plus d’âmes qui vivent, attendant son retour. Son cœur pleurait à sang, la perte des êtres chers qui constituaient son monde, sa réalité. Le monde s’était soudainement vidé de sa réalité, il lui semblait avancer sur la frange d’un mauvais rêve. L’explosion avait tranché net, dans la part la plus importante qui composait son être, sa part d’amour.
La femme de Tamer lui prépara de l’eau chaude et insista pour qu’il se lave. Ahmed ne comprenait pas pourquoi, quand Fatiha lui tendit un bout de miroir pour qu’il se voie. Il ne se reconnut pas, tant il était couvert de poussière et de sang mêlés, mais c’est surtout ses yeux exorbités, sous des paupières gonflées au regard foudroyé, qui l’impressionnèrent. Et alors que Fatiha le poussait gentiment vers le bain, il sentit sur ses joues sales, les sillons libérateurs des larmes emporter encore un peu du poids de son désespoir.
Dans le bain, Ahmed vit la peau reprendre sa couleur brune naturelle et sentit sur le bras gauche une légère brûlure. Quand il releva la main, il s’aperçut qu’elle était entaillée et que de la blessure, ravivée par la chaleur de l’eau, coulait un sang rouge profond sur sa peau mordorée. Tout ce sang versé, pensa Ahmed, la gorge serrée, que l’on soit de ce côté-ci de la frontière ou de l’autre, tout ce même sang versé, pour quoi ? Qu’est-ce qui pouvait justifier tout ça ? Une même terre, un même sang pour abreuver la folie des hommes ! Et il sentit la fraîcheur de ses larmes couler à nouveau sur ses joues enfeu.
On ne peut pas dire qu’il mangea, malgré la tendre insistance de Fatiha, l’appétit l’avait déserté, le sommeil aussi. Il entendit les multiples réveils en sursaut, et les averses de pleurs, de la petite Leïla qui cherchait sa mère désespérément, et que Tamer avait recueillie en urgence du quartier détruit. Il entendit toute la nuit les chants doux de Fatiha, tentant de la réconforter dans ses bras, pour lui procurer quelques heures de sommeil, volées à la souffrance de la perte. Ahmed aurait aimé lui aussi retrouver des bras maternels pour apaiser sa douleur. Mais sa mère avait disparu à tout jamais, et à dix-huit ans, c’était déjà un homme, il devait trouver en lui la force de se consoler. Mais où ? Et comment ? Une question l’obséda toute la nuit : comment faire pour accepter l’inacceptable ?
À l’aube, il sortit sans réveiller ses hôtes, avec le fol espoir qui l’avait tiré du court sommeil, survenu après des heures à lutter contre la fatigue, que peut-être tout ceci n’avait été qu’un cauchemar abominable. Il allait tourner quelques rues plus loin et retrouver sa maison intacte, sa mère le guettant à la porte, inquiète ; il voulait absolument y croire. Mais lorsqu’il tourna dans sa rue, tout était clair, c’était toujours le même amoncellement de gravas et de parties de murs qui tardaient à s’écrouler. Ahmed s’assit juste en face du tas de pierres qui fut un jour sa maison, pour se pénétrer de cette vision. Comme si la force de sa souffrance pouvait redresser les pierres, faire reculer le temps et redonner vie à sa mère et sa sœur ensevelies. Il regarda intensément le vide. Vide devant lui, vide en lui, son esprit et son envie, vides aussi.
Lorsque Tamer le retrouva quelques heures plus tard, Ahmed semblait s’être changé en pierre, fondu dans le décor, immobile, avec dans les yeux une lueur de désespoir qui faisait mal à voir. Tamer s’assit à ses côtés, lui tendit un café chaud et proposa une cigarette à tout hasard.
–Mon garçon, tu devrais aller voir cet homme qui t’a proposé du travail, ce sera une bonne chose pour toi de travailler. Tu peux toujours venir dormir à la maison, en attendant. Ma maison, c’est comme cheztoi.
Ahmed tourna son visage perdu vers lui et d’une voix rauque, que le silence approfondi avait vidé de sa substance de joie, il répondit :
–En attendant quoi Tamer ? Je n’ai plus rien à attendre, je vais partir de cet endroit maudit, d’où même Dieu s’est enfui. Je ne veux plus attendre ni croire.
Sa décision était prise avant même qu’il ne le sache, quelque chose en lui avait choisi la vie. Comment, il n’en avait pas la moindre idée encore, mais il trouverait le moyen de partir de cet enfer, c’étaitsûr.
Tamer ne chercha pas à le retenir, il comprenait si bien. Il aurait souhaité que son propre fils ait pu avoir le choix et le temps de partir, avant cette fusillade, qui l’avait jeté face au ciel. Tamer inspira profondément, cherchant à relâcher sa gorge resserrée par le souvenir, et pensa que Ahmed avait raison de tenter l’impossible. N’importe quoi valait mieux que de rester à attendre, la peur au ventre, d’être la cible de la mort, coincés dans ce trou àrats.
AYA
Perdue dans ses rêveries, Aya ne perçut pas immédiatement la vibration du téléphone portable, abandonné pour un temps, sous les feuilles éparpillées à même le sol de la chambre en un parterre fleuri et coloré.
Elle vibrait d’un autre mode, plongée dans la douceur du tissu en fils de soie et alpaga, dans la finesse de la trame qui alliait force et fragilité, en sentiments mêlés. Et ce bleu océan éclatant, qui débordait du tissu pour venir éclabousser les alentours, écumes des souvenirs nonchalants.
Par instant, le vrombissement refaisait surface à sa conscience, pour être aussitôt englouti, dans le flux des sensations persistantes.
Elle se revoyait frémissante de plaisir, enfiler cette veste qu’elle avait taillée à ses mesures, sur les bras nus de Dominique. Le col, tout simple, mettait parfaitement en valeur sa nuque massive et ses cheveux coupés très courts. Dans le ciel parsemé de gris, un rayon de soleil avait subrepticement traversé la cape nuageuse pour venir se poser sur sa nuque, éclairant d’une lueur éblouissante la naissance de ses cheveux. Une rougeur lui montait au visage, de cette chaleur qui l’avait submergée à la vision de cette nuque, unique pourelle.
La vibration insistante s’était infiltrée, comme par inadvertance, dans l’espace-temps possible pour sa conscience. Et si c’était Dominique ? Aya bondit sur le téléphone et décrocha, le cœur battant.
–Moshi, moshiAya !
–… chichi ?
Souffle suspendu, en une seconde d’absence, comme un léger pressentiment reconnu par le corps, un « je ne sais quoi » de tendu l’avait saisie, dans la voix de son père reconnu à l’instant.
Aya n’eut pas à poser de questions, son père parla directement sans lui laisser l’espace de répondre. Il lui intimait l’ordre de rentrer le plus tôt possible. Il était temps qu’elle grandisse, elle avait tout de même vingt-quatre ans, il avait décidé qu’elle allait se marier, et suivant la tradition, ils avaient déjà prévu quelqu’un de très bien pour elle. Ainsi, sa jeune sœur n’aurait plus à attendre et pourrait enfin épouser celui qu’elle avait choisi. La voix d’acier, parvenant de plus en plus percutante à ses oreilles dévastées, continuait en rajoutant qu’il était temps qu’elle se mette à travailler, ses études d’architecture étaient interminables et coûtaient cher. Quoi qu’il en soit, il fallait trouver un travail convenable et sûr, il avait déjà parlé d’elle dans son entreprise et il y aurait possiblement une place, de secrétaire pour débuter. Ce serait à elle, ensuite, de faire ses preuves pour s’élever par la qualité de son travail et son dévouement, à un poste supérieur.
Son « mais » jaillit explosif et incontrôlé, soupape d’un étouffement qui l’avait prise à la gorge petit à petit jusqu’à l’enserrer, au fil des mots marteaux, à l’autre bout de l’onde de choc. Strangulation des mots qui tuent à même la voix. Son père était passé maître dans « l’iaidô » l’art de dégainer et de frapper dans un même mouvement : il ne lui laissa pas le temps de se défendre, tranchant que, si elle osait contester sa décision, il couperait les vivres et les liens qui les unissaient d’un seul tenant. Il raccrocha net, couperet sonore sur sa fille, restée sans voix !
Aya était abasourdie. Une gelée abrupte avait saisi le réseau si fluide, qui d’habitude laissait glisser, librement, une pensée vers l’autre, dans la tête d’Aya. Elle était abasourdie, par l’ampleur du coup de tonnerre qui avait percuté ses tympans. Elle était là, figée, quand son corps lui lança un appel. Un frisson lui traversa l’échine, de froid ou de peur, on ne sait jamais trop, cela touchant au même endroit, une question de survie sans doute. Elle se leva lentement, pour attraper son châle bleu nuit, et s’envelopper avec douceur dans les longs poils angora, avant de se recroqueviller, au pied du lit défait, saisie de stupeur. Puis, tout se mit à défiler très vite dans son esprit en état dechoc.
Retourner vivre à Kyoto, impossible. Oui, elle adorait sa ville natale, d’un raffinement sans pareil, et souvent la nostalgie l’enveloppait lorsque lui revenait en mémoire de peau, la douceur des soies des kimonos. Croisées de ci de là, dans les ruelles de Gion, des geishas aux couleurs chatoyantes, semblant glisser entre les passants, allures d’un autre temps, avec leur visage fardé de blanc, incarnaient la perfection artistique nippone. Puis tous ces temples disséminés au cœur de la ville, comme autant de joyaux en bois brut, venus du fond des âges. Ces refuges des âmes lui manquaient ardemment. Ces nombreux endroits de recueillement, pour renouveler ses vœux et rappeler aux Kami ce qu’on espérait d’eux : une santé durable, une bonne réussite aux examens, suffisamment d’argent pour vivre à l’aise et surtout de rencontrer l’amour, d’être heureux.
Aya laissa échapper un soupir de sa poitrine compressée et son esprit repartit faire une virée dans son Kyoto d’enfance.
Oh ! et la nature, comme elle lui faisait défaut ici à Paris. Oui, bien sûr, il y avait des parcs ici et là, mais c’était incomparable avec la présence subtile et minutieuse de la nature chez elle. Le moindre recoin de maison, même minuscule, voyait jaillir un jardin dans les règles de l’art. Tout un art, les jardins à Kyoto, on venait de très loin pour les admirer, se dit-elle fascinée. Ces jardins, si précieusement soignés qu’ils absorbent le promeneur dans un instant d’éternité. Sa saison préférée était l’automne, quand les « momiji », les érables, emblèmes de cette saison, déclinaient le rouge sous tous sestons.
Ces jardins étaient composés d’un entrelacs de formes et de couleurs variées, allant du vert foncé au rouge écarlate. Avec différentes textures de mousses recouvrant les rochers qui, suivant l’angle de la lumière caressante, prenaient des tons du vert sombre au vert anis. Elle se sentait transportée enfant, de ce mélange de formes et de couleurs, qui semblait si naturel, et où cependant la main de l’homme, en rendant visible des détails, des arrangements particuliers, magnifiait tout. Le dentelé des feuilles rouges des érables et la mousse vert fluo derrière, moelleuse et arrondie… envie de s’y coucher délicatement. Bien que très sophistiqué, rien n’était lisse dans ces jardins, tout était en recoins, pas japonais, chemins en courbe, pontons surmontant un filet d’eau. Tout était fait pour ramener constamment et insidieusement à la présence, à l’éveil des sens, à la contemplation.
Depuis combien de temps n’avait-elle pas flâné, sur « le chemin de la philosophie » jusqu’au Ginka kuji temple, côte à côte avec sa tendre cousine Junko ? Oui, c’était juste avant de partir à l’aventure, chacune de son côté vers un autre bout du monde. Pour elle, faire des études d’architecture à Paris, quant à Junko, elle avait choisi les États-Unis d’Amérique, pour la liberté qu’elle espérait y trouver.
Retourner vivre à Kyoto ? Non, impossible vraiment. Se retrouver prise dans le filet des conventions familiales, avec le père en haute autorité qui décide pour sa femme et ses enfants ? Non, elle n’y arriverait plus. Personne n’osant contester la décision, de peur de faire perdre la face à ce père qui remplit sa fonction, en choisissant au mieux, ce qu’il croit bon pour eux. La mère n’a pas son mot à dire, elle s’occupe de tout autre chose, c’est ainsi qu’elle a été éduquée en Corée, c’est ainsi qu’ils se sont construits en tant que couple, au Japon. S’opposer n’est pas une option digne, elle emprunte le chemin du déshonneur pour celui qui ose, rejaillissant également sur sa famille. Cependant, combien de jeunes, se demanda Aya, ne rêvent que de ça, dire non à ce que l’on veut pour eux. Oser faire ses propres choix est une vraie révolution intérieure. Alors beaucoup tentent la voie du milieu, comme elle, en prétextant des études à l’étranger qui leur permettent d’expérimenter d’autres modes de vie. Ils peuvent ainsi renforcer leur volonté de choix ou revenir vers le cocon familial et culturel, qui finalement leur vabien.
Aya n’était pas de ceux-ci. Oui, elle avait choisi un prétexte pour s’évader, mais ne s’imaginait plus revenir dans l’enceinte familiale. La vie qu’elle s’était faite, dans la capitale française, lui avait ouvert des portes insoupçonnées, sur ses désirs les plus profonds. Elle ne pourrait revenir en arrière sans mourir à petit feu, mais comment dire non sans jeter le déshonneur sur sa famille entière. Sa mère bien-aimée en mourrait, c’était sûr, et sa petite sœur en pâtirait dans son avenir à construire. Ce poids de la tradition, qui voulait que chaque fille doive attendre que la sœur aînée soit mariée pour pouvoir accepter une proposition d’union, était injuste à ses yeux. Sa sœur devait la maudire. Elle ne lui avait pas parlé depuis longtemps, prétextant toujours le décalage horaire inapproprié, beaucoup de travail à fournir ou une mauvaise connexion. Aya se sentait coupable. Elle avait été très égoïste, c’est vrai, ne pensant qu’à son propre bien-être, oubliant sans souci celui de ses proches. Mais comment trouver le juste équilibre, entre son bonheur personnel et le respect de celui des autres ? Les lèvres d’Aya tremblèrent en frissons successifs.
Son père s’était-il douté de quelque chose ? La honte lui montait à la gorge quand elle prenait conscience que, depuis plus d’un an, elle lui mentait outrageusement.
Quand elle était arrivée dans l’école d’architecture de La Villette, elle avait été surprise du peu de cadre qui y régnait et de la vétusté des locaux peu soignés. Très vite, elle avait décroché, les cours l’intéressaient bien moins que les vêtements que portaient ses camarades, stylés, customisés. L’une d’elle lui avait parlé de cette école de mode, en termes si élogieux que Aya s’était prise à rêver. Un de ces nombreux jours d’ennui, après les cours, sa camarade l’avait incitée à la suivre, juste par curiosité, juste pour voir cette fameuse école de ses propres yeux. Ce qu’elle y trouva la combla immédiatement, oui c’était vraiment ça qu’elle rêvait de faire. Créer des architectures de tissus, inventer de nouvelles formes, chercher des matières alliées pour revêtir les corps, les mettre en valeur par des détails infimes et les ramener, subrepticement, à la sensualité du contact au tissu même. Le corps comme un jardin dont on révélerait tous les recoins, les magnifiant en les masquant, en épousant les fragilités ou dénudant les endroits de pur beauté.
Sans rien dire, elle s’était inscrite à cette nouvelle école, convaincue, dans son insouciante jeunesse, qu’on ne s’apercevrait de rien, là-bas. Le Japon était si loin de la France.
Si loin d’elle également ce poste à pourvoir, dans l’entreprise du père. Elle se souvenait de ses paroles à lui, si fier d’appartenir à cette entreprise : « c’est comme une famille, le président prend soin de ses employés comme de ses propres fils ». Oui, appartenir à l’entreprise, c’était lui donner tout son temps et son âme. L’honneur du travail bien fait, surpassant toutes qualités dans la culture japonaise, les entreprises fonctionnaient si bien, avec un personnel serviable, conscient des nécessités pour leur boîte, se dévouant entièrement. Jusqu’à ce qu’un jour le cœur lâche, pressé jusqu’à la moelle, pensa Aya. Comme son oncle d’ailleurs, un employé modèle qui passait de moins en moins de temps à la maison, tant sa boîte avait besoin de lui. Après le travail, il y avait les réunions conviviales entre employés dans des boîtes, où il était mal vu de ne pas se rendre. Puis certains soir, trop tard pour rentrer, par sécurité pour être à l’heure à son travail, il dormait dans ces capsules hôtels, des boîtes-lits, avec juste l’espace de se coucher. Son oncle était ainsi passé d’une boîte à l’autre, comme elle l’avait entendu dire à cet homme plein de sagesse et d’ironie, Pierre Rabhi, jusqu’à la petite boîte finale de l’urne funéraire.
Non, c’était clair, Aya ne voulait pas appartenir à une boîte, elle rêvait de créer sa propre marque de vêtements artisanaux, pour que chacun trouve ce qui lui va le mieux et se voit beau dans son individualité. C’était un tout autre projet que lui préparait son père. Souvent elle s’était demandé si c’était vraiment son père, tant cet inconnu la connaissait sipeu.
Sa mère par contre, savait saisir la signification de son moindre froncement de sourcil, ou mordillement de lèvres. C’était à elle qu’il avait été le plus dur de cacher la vérité. Les quelques rares fois où elle était revenue à Kyoto, Aya avait réussi à bifurquer tant bien que mal dans une conversation qui, elle le sentait bien, la mènerait vers un sujet intime, qu’elle ne pouvait dévoiler. Bien sûr elle sentait glisser, presque imperceptiblement dans le regard de sa mère, un voile d’inquiétude. Le visage de sa mère, ce lac limpide qu’elle admirait tant, où commençait à affleurer quelques rides en surface. Mais elle trouvait toujours le chemin, pour faire fleurir sur ce beau visage, un sourire inondé de tendresse.
Aya prit une profonde inspiration et secoua ses longs cheveux ébène, pour dégager son visage de nacre de l’ombre des non-dits.
ANTON
Dans le bleu azur silencieux, il entendit soudain un frottement d’ailes puissant, et levant les yeux vers le ciel, il vit passer un oiseau aux couleurs splendides. Un cou bleu cobalt, des ailes vert turquoise et un ventre rouge sang, qui contrastait avec le monochrome tout bleu du ciel. Mais c’est lorsqu’il aperçut les longues plumes vertes et bleues de la queue flotter au vent, qu’il reconnut sans hésiter l’oiseau symbole de liberté, le Quetzal.
De façon prodigieuse l’oiseau vint se poser tout près de lui, le regardant intensément. Alors qu’il s’approchait pour l’admirer, subjugué par son plumage flamboyant, un filet vint enserrer brusquement l’oiseau, et en une seconde celui-ci se retrouva enfermé dans une étroite cage dorée. Il regardait, effaré, l’animal se débattre jusqu’à épuisement, puis se poser et mourir, tout simplement. Anton se sentit soudain oppressé, comme s’il faisait corps avec l’animal, étouffant d’impuissance. Puis abruptement l’oiseau prit feu, jusqu’à se consumer et tomber en cendres, sous les yeux stupéfaits d’Anton, qui avait envie de hurler de douleur. Du pauvre tas de cendre, s’éleva soudain, une minuscule forme d’oiseau, beaucoup plus petit, si petit qu’il pût passer à travers les barreaux et venir se poster devant lui, en arrêt, les ailes battant à toute allure. Ce colibri vint si proche, qu’il pût sans difficulté aucune lui butiner les yeux. Étrangement, Anton n’éprouvait ni peur ni douleur, plutôt une joie intense de reconnaissance, qui s’élevait de son cœur, pour ce minuscule colibri qui lui nettoyait la vue. Il sentit l’oiseau lui caresser la tête de l’aile, en l’appelant par sonnom.
–Anton, Anton, réveille-toi mon chéri, il est très tard, est-ce que tout va bien ?
Anton ouvrit les yeux, et fut aussitôt matraqué par l’intensité de la lumière, qui faisait rebondir un énorme tambour dans sa tête. Il referma les yeux aussitôt, et tout lui revint d’un bloc, reformant une boule d’angoisse dans sa gorge, qui lui permettait difficilement de déglutir sa salive. Il revint avec désespoir aux événements de la veille au soir, quand finalement, contre toute attente, l’odieux candidat avait été élu président de la République de son pays. Anton était en état de choc. Lorsqu'il avait entendu les résultats, après quelques secondes d'incompréhension interdite devant l'inaudible nouvelle, il avait fondu en larmes, comme enfant lorsqu'il souffrait d’une injustice trop évidente. L’onde de choc avait atteint ses intestins, provoquant des crampes intenses, et faisant jaillir du bas de son épine dorsale un frisson de peur. La honte avait gagné sa gorge, avec un goût amer qui dévastait son palais. Les États-Unis d’Amérique, son grand pays de liberté, allaient plonger désormais dans la plus barbare absurdité. Il n’arrivait pas à comprendre comment autant de ses compatriotes avaient pu se laisser convaincre par ce fou. Dévasté par cet événement, un éminent collègue lui avait avoué : « Aucune crapule ni aucun charlatan ne s’est jamais hissé à la tête de l’un des principaux partis,ni ne s’est frayé un chemin jusqu’à la Maison Blanche. Des idiots, oui — il y en a qui sont parvenus à la Maison Blanche… Trump est sans précédent, et c’est pour cela que personne dans la classe politique n’a prédit qu’il réussirait. » Totalement consternés, avec des collègues de l’université, ils n’avaient pas trouvé mieux, pour calmer la douleur, que d’aller noyer leurs désespoirs dans l’alcool. Lui qui ne buvait jamais ne tarda pas à se retrouver totalement ivre, au point de ne plus avoir aucun souvenir de comment il était rentré chez lui. Lui qui avait toujours été d’un optimisme « frôlant l’ânerie», comme lui reprochaient parfois ses propres enfants, atterrissait abruptement dans un monde nouveau, vidé d’espoir. Comment allait-on faire pour continuer à vivre ici, en paix, s’insurgeait la conscience d’Anton, àvif.
Quand il fit l’effort de rouvrir les paupières, c’est le doux visage de sa femme qui le réceptionna, avec un petit sourire tendre et inquiet.
–Comment te sens-tu mon amour ? Tu m’as fait peur hier, tu es arrivé dans un tel état ! lui avoua-t-elle. Tu ne tenais pas debout, je ne t’ai jamais vu ainsi de toute notre vie. Qu’est-ce qui s’est passé ?
–Qu’est-ce qui s’est passé ? s’emporta-t-il en la regardant éberlué, mais tu n’as pas entendu les informations ? Trump a été élu président, c’est une catastrophe !
–Si, bien sûr, j’ai reçu l’information, mais je l’avais pressenti déjà depuis un petit temps tu sais, lui affirma-t-elle calmement, en hochant la tête tristement.
–Mais comment ? répondit-il estomaqué. Je n’aurais jamais pu imaginer que les gens pourraient se laisser séduire par ce fou dangereux, au point de l’élire à la tête dupays.
–Je crois que vous ne mesuriez pas le niveau de mécontentement de la population, monsieur le professeur d’université dans sa bulle, lança-t-elle dans un petit sourire ironique. La poésie, ça peut couper un peu de la réalité, mais pas vous en protéger.
–Mais comment allons-nous faire maintenant ? se désespéra-t-il
–Je vais continuer à faire comme je l’ai toujours fait, affirma-t-elle d’un ton décidé, me battre chaque jour, pour que la peur et l’injustice ne remplissent pas ma vie, et que la relation avec les autres reste bienveillante et généreuse. Et ce n’est ni ce président ni son gouvernement, qui vont m’empêcher de continuer. Si chacun fait ce qu’il peut dans ce sens, j’ai confiance que cela ne peut pas empirer. Mais bon, le problème majeur est la peur, qui rend les gens complètement ignorants de leur pouvoir personnel. Tiens d’ailleurs, j’ai lu il y a quelques jours une légende amérindienne qui parlait deça.
« Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes d’eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces quelques gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. »
J’ai été touchée par cette histoire. Après tout, c’est vrai, on se demande parfois à quoi ça sert, quelques gouttes d’eau n’éteindront pas un feu de forêt. Une feuille de papier recyclé ne freinera pas la déforestation. Des actions ponctuelles ne sont peut-être pas des révolutions, mais ce sont des changements, qui valent toujours mieux que de ne rien faire. Une personne qui agit seule, ça ne change sûrement pas grand-chose, mais si chaque personne qui prend conscience de son pouvoir d’action agit dans son quotidien, ça peut faire une sacrée différence, finalement.
–Colibri ? Souffla-t-il, j’ai fait un rêve justement…
Anton ouvrait de grands yeux admiratifs, maintenant, sur cette femme qu’il avait choisi d’épouser il y avait déjà vingt ans, et qu’il n’avait jamais cessé d’aimer. Elle le surprenait toujours, par sa vivacité d’esprit et son cœur généreux, complètement tourné vers les autres. Alors que lui, souvent mal à l’aise en trop grande compagnie, se repliait sur lui-même et ce qu’il connaissait le mieux, la littérature et sa muse poésie. Derrière ses lunettes rondes, il observait le monde à distance, pour ne pas être trop perturbé. Lui, le sensible à fleur de peau, les enlevait souvent, pour se laisser imprégner de cette vision pointilliste qui avait fait tout l’art des peintres impressionnistes dont il était féru. Il se laissait baigner alors dans son imaginaire, armure de protection contre une réalité qui bien souvent le désarmait dans l’incompréhension.
Son poste de professeur de littérature à l’université de Berkeley le nourrissait amplement. Financièrement tout d’abord, et par la transmission aux élèves de sa passion de la poésie, mais surtout en réconfortant son image de soi, et en valorisant son besoin de reconnaissance. Michelle, sa femme, soupirait parfois en se plaignant tendrement auprès de lui, qu’elle avait en fait à s’occuper de trois enfants, dont le plus âgé était celui qui avait le plus besoin d’être rassuré. Anton c’est vrai, le reconnaissait humblement, il était toujours inquiet, de ne pas faire ou ne pas être comme il faut. Il ne se sentait d’ailleurs pas très beau, un peu trop grassouillet. Mais il trouvait un tel plaisir réconfortant dans la nourriture qu’il se laissait parfois déborder par sa gourmandise, et comme son pire ennemi était le sport…
Son amour de femme tentait de le rassurer, en trouvant des excuses à son immaturité flagrante. Oui, le divorce de ses parents, quand il avait trois ans, l’avait installé dans un scénario de peur de l’abandon, qui le poursuivait toujours actuellement. Et puis surtout, sa mère, Natacha, très belle femme mannequin russe, était ensuite morte d’un cancer, quand il avait à peine cinq ans. Cette perte avait creusé un sillon d’insécurité dans la personnalité même d’Anton. Après ce drame, il s’était retrouvé à la charge de son père, John, un industriel très occupé, qui n’avait jamais assez de temps pour être avec lui, car il avait toujours des choses plus urgentes à faire. Il avait été élevé par des nounous, dont certaines n’étaient pas restées assez longtemps pour établir une vraie relation d’intimité. Heureusement, il y avait eu Maria. Cette femme mexicaine, qui était restée cinq ans à son service, était un pur soleil, elle illuminait ses jours de brins de joie éparpillés. Il se souvient de cette période, comme un temps de bonheur retrouvé. Elle lui avait donné tant d’affection et de joie, que ce fût un drame pour lui quand son père la mit à la porte, sans qu’il sache vraiment pour quoi. Il n’avait jamais eu le courage d’aller fouiller en lui, pour clarifier tout ce qui n’allait pas bien. Il avait préféré s’évader dans les études et la poésie, dans un parcours assez solitaire.





























