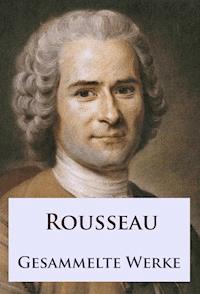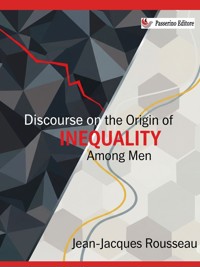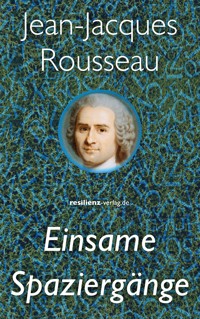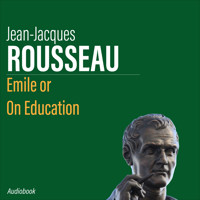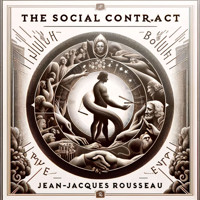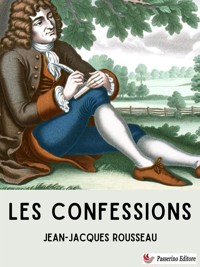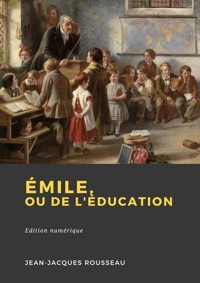0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Éditions Synapses
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Valère est coquet et vaniteux. Sa sœur Lucinde, aidée par Angelique, lui joue un tour en maquillant un de ses portraits en fille. Valère s'éprend alors de sa propre image et rompt avec Angélique. De son côté, Lucinde aime en secret Cléonte alors que son père veut lui faire épouser son filleul Léandre qu'elle n'a jamais vu. En réalité, Léandre se dissimule sous le nom de Cléonte. Après quelques péripéties, les deux couples s'accordent à la fin de la pièce.
Adroitement construite, comique et émouvante, intéressante par la bonne humeur et la sensibilité de ses jeunes héros, Narcisse est une pièce heureuse. Vingt ans plus tard, Rousseau fit précéder sa comédie d'une préface sérieuse qui invite le lecteur à se demander quelle structure sociale se dissimule derrière ces jeux, ces méprises et ces ridicules.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Jacques Rousseau
NARCISSEou L’AMANT DE LUI-MÊME
© 2023 Éditions Synapses
PRÉFACE.
J’ai écrit cette comédie à l’âge de dix-huit ans, et je me suis gardé de la montrer, aussi longtemps que j’ai tenu quelque compte de la réputation d’auteur. Je me suis enfin senti le courage de la publier, mais je n’aurai jamais celui d’en rien dire. Ce n’est donc pas de ma pièce, mais de moi-même qu’il s’agit ici.
Il faut, malgré ma répugnance, que je parle de moi ; il faut que je convienne des torts que l’on m’attribue, ou que je m’en justifie. Les armes ne seront pas égales, je le sens bien ; car on m’attaquera avec des plaisanteries, et je ne me défendrai qu’avec des raisons : mais pourvu que je convainque mes adversaires, je me soucie très peu de les persuader ; en travaillant à mériter ma propre estime, j’ai appris à me passer de celle des autres, qui, pour la plupart, se passent bien de la mienne. Mais s’il ne m’importe guère qu’on pense bien ou mal de moi, il m’importe que personne n’ait droit d’en mal penser ; et il importe à la vérité, que j’ai soutenue, que son défenseur ne soit point accusé justement de ne lui avoir prêté son secours que par caprice ou par vanité, sans l’aimer et sans la connaître.
Le parti que j’ai pris, dans la question que j’examinais il y a quelques années, n’a pas manqué de me susciter une multitude d’adversaires1 plus attentifs peut-être à l’intérêt des gens de lettres qu’à l’honneur de la littérature. Je l’avais prévu, et je m’étais bien douté que leur conduite, en cette occasion, prouverait en ma faveur plus que tous mes discours. En effet, ils n’ont déguisé ni leur surprise ni leur chagrin de ce qu’une académie s’était montrée intègre si mal à propos. Ils n’ont épargné contre elle, ni les invectives indiscrètes, ni même les faussetés2, pour tâcher d’affaiblir le poids de son jugement. Je n’ai pas non plus été oublié dans leurs déclamations. Plusieurs ont entrepris de me réfuter hautement : les sages ont pu voir avec quelle force, et le public avec quel succès ils l’ont fait. D’autres plus adroits, connaissant le danger de combattre directement des vérités démontrées, ont habilement détourné sur ma personne une attention qu’il ne fallait donner qu’à mes raisons ; et l’examen des accusations qu’ils m’ont intentées a fait oublier les accusations plus graves que je leur intentais moi-même. C’est donc à ceux-ci qu’il faut répondre une fois.
Ils prétendent que je ne pense pas un mot des vérités que j’ai soutenues, et qu’en démontrant une proposition je ne laissais pas de croire le contraire ; c’est-à-dire que j’ai prouvé des choses si extravagantes, qu’on peut affirmer que je n’ai pu les soutenir que par jeu. Voilà un bel honneur qu’ils font en cela à la science qui sert de fondement à toutes les autres ; et l’on doit croire que l’art de raisonner sert de beaucoup à la découverte de la vérité, quand on le voit employer avec succès à démontrer des folies.
Ils prétendent que je ne pense pas un mot des vérités que j’ai soutenues ! c’est sans doute de leur part une manière nouvelle et commode de répondre à des arguments sans réponse, de réfuter les démonstrations même d’Euclide, et tout ce qu’il y a de démontré dans l’univers. Il me semble, à moi, que ceux qui m’accusent si témérairement de parler contre ma pensée ne se font pas eux-mêmes un grand scrupule de parler contre la leur : car ils n’ont assurément rien trouvé dans mes écrits ni dans ma conduite qui ait dû leur inspirer cette idée, comme je le prouverai bientôt ; et il ne leur est pas permis d’ignorer que, dès qu’un homme parle sérieusement, on doit penser qu’il croit ce qu’il dit, à moins que ses actions ou ses discours ne le démentent ; encore cela même ne suffit-il pas toujours pour s’assurer qu’il n’en croit rien.
Ils peuvent donc crier autant qu’il leur plaira qu’en me déclarant contre les sciences j’ai parlé contre mon sentiment : à une assertion aussi téméraire, dénuée également de preuve et de vraisemblance, je ne sais qu’une réponse ; elle est courte et énergique, et je les prie de se la tenir pour faite.
Ils prétendent encore que ma conduite est en contradiction avec mes principes, et il ne faut pas douter qu’ils n’emploient cette seconde instance à établir la première ; car il y a beaucoup de gens qui savent trouver des preuves à ce qui n’est pas. Ils diront donc qu’en faisant de la musique et des vers on a mauvaise grâce à déprimer les beaux-arts, et qu’il y a dans les belles-lettres, que j’affecte de mépriser, mille occupations plus louables que d’écrire des comédies. Il faut répondre aussi à cette accusation.
Premièrement, quand même on l’admettrait dans toute sa rigueur, je dis qu’elle prouverait que je me conduis mal, mais non que je ne parle pas de bonne foi. S’il était permis de tirer des actions des hommes la preuve de leurs sentiments, il faudrait dire que l’amour de la justice est banni de tous les cœurs, et qu’il n’y a pas un seul chrétien sur la terre. Qu’on me montre des hommes qui agissent toujours conséquemment à leurs maximes, et je passe condamnation sur les miennes. Tel est le sort de l’humanité ; la raison nous montre le but, et les passions nous en écartent. Quand il serait vrai que je n’agis pas selon mes principes, on n’aurait donc pas raison de m’accuser pour cela seul de parler contre mon sentiment, ni d’accuser mes principes de fausseté.
Mais si je voulais passer condamnation sur ce point, il me suffirait de comparer les temps pour concilier les choses. Je n’ai pas toujours eu le bonheur de penser comme je fais. Longtemps séduit par les préjugés de mon siècle, je prenais l’étude pour la seule occupation digne d’un sage, je ne regardais les sciences qu’avec respect, et les savants qu’avec admiration3. Je ne comprenais pas qu’on pût s’égarer en démontrant toujours, ni mal faire en parlant toujours de sagesse. Ce n’est qu’après avoir vu les choses de près que j’ai appris à les estimer ce qu’elles valent ; et quoique dans mes recherches j’aie toujours trouvé satis eloquentiœ, sapientiœ parum, il m’a fallu bien des réflexions, bien des observations, et bien du temps, pour détruire en moi l’illusion de toute cette vaine pompe scientifique. Il n’est pas étonnant que, durant ces temps de préjugés et d’erreurs où j’estimais tant la qualité d’auteur, j’aie quelquefois aspiré à l’obtenir moi-même. C’est alors que furent composés les vers et la plupart des autres écrits qui sont sortis de ma plume, et entre autres cette petite comédie. Il y aurait peut-être de la dureté à me reprocher aujourd’hui ces amusements de ma jeunesse, et on aurait tort au moins de m’accuser d’avoir contredit en cela des principes qui n’étaient pas encore les miens. Il y a longtemps que je ne mets plus à toutes ces choses aucune espèce de prétention ; et hasarder de les donner au public dans ces circonstances, après avoir eu la prudence de les garder si longtemps, c’est dire assez que je dédaigne également la louange et le blâme qui peuvent leur être dus ; car je ne pense plus comme l’auteur dont ils sont l’ouvrage. Ce sont des enfants illégitimes que l’on caresse encore avec plaisir en rougissant d’en être le père, à qui l’on fait ses derniers adieux, et qu’on envoie chercher fortune sans beaucoup s’embarrasser de ce qu’ils deviendront.
Mais c’est trop raisonner d’après des suppositions chimériques. Si l’on m’accuse sans raison de cultiver les lettres que je méprise, je m’en défends sans nécessité ; car, quand le fait serait vrai, il n’y aurait en cela aucune inconséquence : c’est ce qui me reste à prouver.
Je suivrai pour cela, selon ma coutume, la méthode simple et facile qui convient à la vérité. J’établirai de nouveau l’état de la question, j’exposerai de nouveau mon sentiment ; et j’attendrai que sur cet exposé on veuille me montrer en quoi mes actions démentent mes discours. Mes adversaires, de leur côté, n’auront garde de demeurer sans réponse, eux qui possèdent l’art merveilleux de disputer pour et contre sur toutes sortes de sujets. Ils commenceront, selon leur coutume, par établir une autre question à leur fantaisie ; ils me la feront résoudre comme il leur conviendra ; pour m’attaquer plus commodément, ils me feront raisonner, non à ma manière, mais à la leur ; ils détourneront habilement les yeux du lecteur de l’objet essentiel, pour les fixer à droite et à gauche ; ils combattront un fantôme, et prétendront m’avoir vaincu : mais j’aurai fait ce que je dois faire ; et je commence.
« La science n’est bonne à rien et ne fait jamais que du mal, car elle est mauvaise par sa nature. Elle n’est pas moins inséparable du vice que l’ignorance de la vertu. Tous les peuples lettrés ont toujours été corrompus, tous les peuples ignorants ont été vertueux : en un mot, il n’y a de vices que parmi les savants, ni d’homme vertueux que celui qui ne sait rien. Il y a donc un moyen pour nous de redevenir honnêtes gens ; c’est de nous hâter de proscrire la science et les savants, de brûler nos bibliothèques, fermer nos académies, nos collèges, nos universités, et de nous replonger dans toute la barbarie des premiers siècles. »
Voilà ce que mes adversaires ont très bien réfuté : aussi jamais n’ai-je dit ni pensé un seul mot de tout cela, et l’on ne saurait rien imaginer de plus opposé à mon système que cette absurde doctrine qu’ils ont la bonté de m’attribuer. Mais voici ce que j’ai dit et qu’on n’a point réfuté.
Il s’agissait de savoir si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer nos mœurs.
En montrant, comme je l’ai fait, que nos mœurs ne se sont point épurées4, la question était à peu près résolue.
Mais elle en renfermait implicitement une autre plus générale et plus importante, sur l’influence que la culture des sciences doit avoir en toute occasion sur les mœurs des peuples. C’est celle-ci, dont la première n’est qu’une conséquence, que je me proposai d’examiner avec soin.
Je commençai, par les faits, et je montrai que les mœurs ont dégénéré chez tous les peuples du monde à mesure que le goût de l’étude et des lettres s’est étendu parmi eux.
Ce n’était pas assez ; car, sans pouvoir nier que ces choses eussent toujours marché ensemble, on pouvait nier que l’une eût amené l’autre : je m’appliquai donc à montrer cette liaison nécessaire. Je fis voir que la source de nos erreurs sur ce point vient de ce que nous confondons nos vaines et trompeuses connaissances avec la souveraine intelligence qui voit d’un coup d’œil la vérité de toutes choses. La science prise d’une manière abstraite mérite toute notre admiration. La folle science des hommes n’est digne que de risée et de mépris.