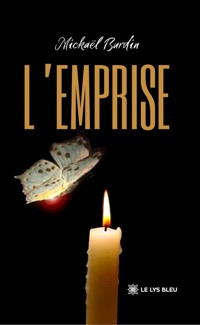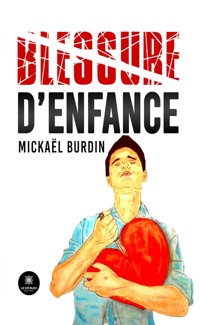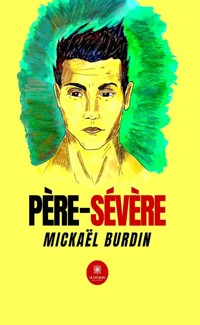
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Mickaël, adolescent studieux et fils unique, semble mener une existence paisible, entouré de ses parents et de ses amis proches. Sa nature introvertie le conduit à se réfugier dans un univers imaginaire, à l’abri des regards extérieurs. Cependant, à l’âge de quinze ans, son quotidien bascule brusquement lorsque son père commence à l’interroger de manière insistante sur sa vie sentimentale et sexuelle. Ces interrogations se transforment rapidement en une véritable persécution, marquée par des accusations infondées d’homosexualité. Confronté à cette violence psychologique et à l’indifférence passive de sa mère, Mickaël se retrouve cruellement isolé. Parviendra-t-il à puiser la force nécessaire pour affronter cette pression destructrice et s’affranchir de l’emprise familiale ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Mickaël Burdin aborde avec finesse et authenticité une situation délicate qui a marqué son adolescence : l’homophobie parentale. Sans complaisance ni détour, l’auteur nous invite à pénétrer l’intimité de sa famille, non pour susciter la pitié, mais pour offrir un puissant témoignage de résilience et un vibrant hommage à la quête de soi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mickaël Burdin
Père-sévère
© Lys Bleu Éditions – Mickaël Burdin
ISBN : 979-10-422-4680-8
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Préface
Dans notre pays, il est aujourd’hui de bon ton de prétendre que chacun a le droit d’être soi-même et de vivre librement sa différence. Mais, dans la réalité, il en va tout autrement, même si les « non-hétérosexuels » sont davantage présents dans le paysage médiatique depuis quelques années, grâce aux personnalités de la culture ou de la politique qui ont fait leur coming out. Les faits prouvent, hélas, que l’idée d’une soi-disant « normalité » est toujours présente dans un grand nombre d’esprits. SOS homophobie ne cesse de dénoncer la recrudescence des agressions anti-LGBTQIA+, agressions provoquées par une plus grande visibilité de la communauté. Une visibilité chèrement acquise, mettant néanmoins en péril tous ceux à qui l’on tend des « gay-apens » (guet-apens), que ce soit sur un site de rencontre ou au sortir d’un bar ou d’une boîte de nuit.
Le combat contre l’intolérance ne peut donc que continuer. L’écrivain homosexuel suédois Jonas Gardell l’a fort bien exprimé : « Tant que des milliers de pédés seront persécutés, harcelés, emprisonnés, assassinés à cause de leur amour, l’homosexualité ne sera pas une question de vie privée ».
Contrairement à ce que d’aucuns peuvent dire, il faut toujours du courage pour s’assumer et se montrer « hors norme » (« un homme, oh, comme ils disent », chantait Charles Aznavour). Ce courage, Mickaël n’en manque pas !
Graham Green déclarait : «L’écriture est une forme de thérapie ; je me demande parfois comment tous ceux qui n’écrivent pas, ne composent ni ne peignent parviennent à échapper à la folie, à la mélancolie et à la peur panique qui sont inhérentes à la condition humaine. »
Poussé par son amour de l’Art, Mickaël a « fait ses armes » dans ces différents domaines : écriture, chanson, dessin et peinture dans lesquels il a su faire preuve de son talent et continue d’ailleurs de se distinguer.
Ma rencontre avec lui s’est faite par l’intermédiaire de Facebook. Lorsque nous sommes entrés en contact téléphonique, j’ai découvert chez lui toutes ses qualités : sincérité, intelligence émotionnelle et capacité d’analyse, que j’appréciais chez ma meilleure amie décédée en novembre 2022. Bien que nous ne nous soyons rencontrés que très récemment, son amitié est venue tout de suite combler le vide laissé par cette disparition.
Nombreux sans doute sont ceux qui connaissent Mickaël pour avoir lu ses « 69 chroniques sexo », livre publié en 2021 aux Éditions de la Trémie, « meilleure maison d’édition gay 2022 ». C’est un ouvrage complet et fort bien documenté sur les pratiques et, d’une manière plus générale, la vie de tous ceux qui ne se laissent pas définir comme « hétérosexuels ». Ce livre, qui est une vraie mine d’informations, pourrait donner à penser que son auteur a connu très jeune une vie riche en expériences de toutes sortes ; or la vérité est tout autre, car Mickaël n’a véritablement assumé sa sexualité qu’à trente-trois ans. En effet, sa vie d’adolescent et de jeune homme a été un chemin semé d’embûches. Ce second livre, « Père-sévère », est le récit de l’homophobie parentale dont il a été victime, mais révèle également une formidable envie d’être soi et de s’affranchir des diktats familiaux. Il l’a écrit afin de pouvoir tourner définitivement la page sur son passé. Toutefois, grâce à sa force de caractère, il avait su devenir bien avant un homme équilibré et à l’écoute des autres.
Jacques Pépin
Ami non point de toujours, mais de tous les jours
Avant-propos
Le but de cet ouvrage n’est pas de « régler des comptes ». Il représente un moyen d’évacuer mes traumatismes d’enfance et d’adolescence liés principalement à mon père. Je me donne le droit de tout dire, ma seule contrainte est la vérité. Pour aller mieux et être en paix avec mon passé, je vais vous raconter mon histoire. Elle pourra, je l’espère, aider certains d’entre vous, qui ont vécu des choses similaires, à mieux comprendre les mécanismes d’un parent toxique. Et surtout, à vous libérer d’une culpabilité infondée : vous n’êtes responsables de rien, ni de votre éducation, ni des défaillances de vos parents.
Chapitre 1
Naissance
Je suis fils unique. J’ai toujours été affecté par les jugements à l’emporte-pièce portés par beaucoup sur les enfants sans frère ni sœur : ces derniers seraient personnels, égoïstes et privilégiés. Ce sont là des clichés injustifiés et de surcroît malveillants. On ne choisit pas d’être le seul enfant d’une famille, seuls les parents en décident.
Je suis issu d’un milieu populaire.
À l’âge de seize ans, ma mère, qui souhaitait gagner de l’argent, a interrompu sa scolarité pour entrer dans le monde du travail. Elle était ouvrière à la chaîne en maroquinerie.
C’était une petite femme d’un mètre soixante, très menue. Les cheveux châtains avec une coiffure typique des années quatre-vingt : un brushing avec beaucoup de volume. Elle ressemblait un peu à l’actrice Michelle Lee à ses débuts. Plutôt discrète et effacée, elle manquait terriblement de confiance en elle. C’est pourquoi, dès l’adolescence, elle était déjà « dépendante affective ». Elle le restera toute sa vie. Elle ne s’imaginait pas exister autrement qu’en couple : sans homme, elle se sentait insignifiante et malheureuse. Comme elle voulait absolument trouver un homme qui viendrait combler ce vide intérieur, elle était extrêmement soucieuse de son apparence. Bien que timide, la demoiselle montrait tous les signes extérieurs d’une personne obnubilée par la rencontre avec un compagnon. Elle n’eut pas longtemps à attendre : elle connut mon père lors d’un bal, la première fois où elle eût la permission de sortir seule. Elle n’avait pas encore dix-sept ans et lui en avait vingt. Ce fut le coup de foudre. Il lui proposa de la raccompagner en scooter. Elle accepta. Une chose en entraînant une autre, un premier baiser fut échangé.
Mon père était son premier partenaire. Comme beaucoup de femmes en ce temps-là, ma mère se voyait « la femme d’un seul homme ». Fille de parents divorcés, elle aspirait à une union « pour la vie ». Pour le reste, elle n’avait pas beaucoup d’ambition : une vie bien rangée et classique suffisait à son bonheur. Ils se marièrent deux ans après leur rencontre. Je naquis deux ans après les noces. Mes parents avaient tous deux souhaité avoir un enfant. Pour ma mère, donner la vie était essentiel ; elle sentit très tôt ce désir grandir en elle et vit mon arrivée comme une bénédiction. Tous deux étaient persuadés d’avoir un garçon. C’est mon père qui choisit mon prénom. Si j’avais été une fille, ma mère aurait souhaité m’appeler Carine.
Contrairement à ma mère assez complexée, mon père, qui n’avait pourtant pas fait davantage d’études, avait une haute estime de lui-même. Responsable d’une petite équipe dans les espaces verts, il bénéficiait d’une certaine autorité. Il aimait attirer l’attention. Pour séduire son auditoire, il imitait des personnalités politiques de l’époque, Jacques Chirac ou François Mitterrand, de façon d’ailleurs pas toujours très reconnaissable. Il se plaisait aussi à raconter des blagues, le plus souvent salaces. Il avait la fâcheuse manie de répéter la chute plusieurs fois de suite. Cela alourdissait l’histoire. L’une de ses blagues préférées évoquait l’histoire d’un homme qui avait dormi avec une femme mexicaine sans qu’il ne se passe quoi que ce soit entre eux : quand l’homme se vanta d’avoir passé la nuit avec une Mexicaine ; cette dernière, frustrée, rétorqua n’avoir jamais dormi avec « un mec si con ».
Ma mère n’avait pas vingt ans quand elle me mit au monde. J’ai vu le jour à la fin des années soixante-dix. L’année de ma naissance, mille neuf cent soixante-dix-sept, Patrick Juvet sortait son célèbre titre « Où sont les femmes ? ». Sur les ondes radio, on pouvait également entendre le fameux « Rockollection » de Laurent Voulzy, « Big Bisou » de l’ami Carlos ou encore « J’aime » de Michèle Torr.
Ma venue au monde aurait dû faire le bonheur de mes parents. Malheureusement, l’accouchement se passa dans des conditions difficiles. Les techniques de l’époque n’étaient pas aussi évoluées que celles d’aujourd’hui. Quant aux soignants, ils n’avaient pas tous la psychologie et la diplomatie nécessaires pour parler à leurs patients. Ma mère dut subir une césarienne sous anesthésie générale et fut victime d’une infection. Généralement, le bébé, une fois sorti, est déposé sur le ventre de sa mère. Or, comme la mienne était potentiellement susceptible de me transmettre son infection, les médecins ont fait le choix de me placer au service des prématurés. J’ai été séparé d’elle pendant le premier mois de ma vie. Les médecins avaient refusé de me montrer. Elle fut très angoissée, elle ressentait le besoin naturel de voir sa progéniture, de s’assurer que je sois « bien formé ». Mon père et ma tante firent fi des prescriptions du corps médical, réussirent à me faire sortir du service des prématurés et me présentèrent à ma mère, derrière la vitre de sa chambre. J’étais bien vivant et sans séquelles : elle pouvait dès lors être rassurée.
Mes parents louaient une petite maison dans une ville moyenne en Savoie. C’était une bâtisse assez traditionnelle, avec une façade de couleur claire et un petit jardin orné de quelques arbres : un cadre plutôt agréable. Le loyer était un peu élevé par rapport aux petits revenus de mes parents. Aussi, très vite, ils ont déménagé pour aller habiter en banlieue, dans les quartiers dits « sensibles ». Nous sommes venus nous installer dans un « trois pièces » situé dans un bloc d’immeubles, sur les hauteurs de Chambéry. Le quartier était cosmopolite, les incivilités fréquentes, sans parler des trafics de drogues et autres substances illicites qui rendaient le quartier dangereux. Il était préférable de ne pas sortir seul le soir si l’on ne voulait pas faire de « mauvaises rencontres ». Les jeunes étaient fréquemment en conflit avec les forces de l’ordre. Les scooters volés étaient légion, les voitures en stationnement régulièrement incendiées. Toutefois, en dépit de ce milieu insécurisé, mes parents ne rencontrèrent pas de problèmes majeurs. Ils se sentirent même assez bien intégrés.
Comme mes parents travaillaient, bébé, je fus confié à des nourrices. Ce fut une expérience compliquée. L’une d’elles me posa sur une table, sans aucune surveillance. Ce qui devait arriver arriva : je tombai au sol en gigotant et me mis à hurler. Plus de peur que de mal. La nourrice raconta cet épisode à ma mère comme un banal accident. La seconde avait un garçon plus âgé et nous laissa seuls à l’arrière de la voiture, pendant qu’elle allait faire des courses. Dans un mouvement de colère soudain, le garçon me griffa tout le visage. En fin de journée, lorsqu’elle vint me récupérer, ma mère fut horrifiée en découvrant mon visage tuméfié. Après ces mésaventures, elle fit le choix d’arrêter de travailler afin de pouvoir me garder. À partir de là, nous devînmes très fusionnels. Ma mère me prenait très souvent dans ses bras pour me bercer. Elle jouait avec moi, me racontait des histoires, me chantait des comptines. Elle voulait toujours m’avoir près d’elle.
Après un premier accouchement difficile, mes parents décidèrent de ne pas avoir d’autres enfants. Ils voulurent éviter de connaître les mêmes déconvenues.
Les années suivantes se passèrent bien. Je n’en ai conservé quasiment aucun souvenir, mis à part peut-être quelques flashs. Je me revois, bébé, dans les bras maternels. Je ne sais pas s’il s’agit de réels souvenirs ou simplement d’images recréées par mon esprit. On m’a raconté que je faisais rapidement mes nuits et ne posais aucun souci particulier.
Je fus scolarisé dès mes quatre ans, seulement à mi-temps et dans une école proche de la maison. C’était un petit établissement de quartier, avec une cour de récréation assez exiguë. Les classes maternelles étaient séparées des classes élémentaires. L’ambiance dans cette école était agréable. Un contraste avec le climat généralement « difficile » du quartier où elle était située. À cinq ans, je suis allé à l’école toute la journée. Cela ne me déplaisait pas, bien au contraire. J’aimais le milieu scolaire : j’avais une grande soif d’apprendre. Ma meilleure amie s’appelait Zora. Pour moi, habitué à être entouré uniquement d’adultes, elle était mon repère, mon pilier, dans cet univers plein d’enfants. Nous jouions régulièrement ensemble dans la cour. Elle était sympathique et dynamique. Mon institutrice était une jeune femme prénommée Julie. Dans mes souvenirs, elle était rousse, belle, douce, gentille et bienveillante. Une dame plus âgée l’assistait la plupart du temps. Toutes deux avaient aidé les enfants à fabriquer des petites marionnettes en laine. L’enseignante nous expliquait que lorsque nous quittions l’école, les petites poupées prenaient vie et vivaient de folles aventures. La mienne avait les cheveux rouges. Je l’avais prénommée Mina. Cette idée de marionnettes s’animant une fois seules me faisait rêver.
Chapitre 2
« Même ton ours ne t’aimerait pas ! »
En primaire, j’ai eu un peu de mal à trouver ma place. Je n’avais pas l’habitude d’être parmi d’autres enfants. J’avais un seul cousin que je ne voyais pratiquement jamais. Je ne savais pas trop « comment me situer ». J’avais pourtant de très bons rapports avec mes enseignants et les filles de ma classe.
Même si je me bagarrais avec certains garçons, j’avais quelques copains. Avec ces derniers, nous aimions nous diviser en deux bandes rivales. Le but du jeu était de s’approprier le trésor de l’autre bande. La plupart du temps, il s’agissait d’une poignée de cailloux. Il pouvait aussi y avoir des « prisonniers » lorsque nous parvenions à capturer un membre de l’équipe adverse. Nous nous adonnions à ce jeu principalement entre garçons. Seule Séverine, qualifiée de « garçon manqué », se joignait à nous.
Nous jouions aussi beaucoup aux billes. La plupart des autres garçons s’intéressaient au football. Un grand terrain était installé au milieu de la zone de jeux. Indirectement, c’était un signe de la prévalence des garçons sur les filles. En retrait, elles étaient cantonnées à s’amuser dans les coins de la cour. Elles jouaient à l’élastique ou à la corde à sauter. J’aimais beaucoup leur compagnie : je les trouvais tellement plus douces que les garçons. J’étais un des rares à qui elles proposaient de jouer avec elles. Peut-être est-ce pour cela que je m’étais mis à dos cinq garçons de la classe ? Ils me suivirent du CP au CM2. Je ne me rappelle plus le motif de notre première querelle. Je me souviens juste de plusieurs manifestations d’hostilité dont je ne comprenais pas alors la raison.
À cette époque, mon père a commencé à manifester dans son comportement envers moi une ambivalence très difficile à supporter. Il pouvait se montrer aimant, protecteur et investi dans son rôle de père, notamment en société. Mais, en privé, et principalement en présence de ma mère, lorsque nous étions tous les trois « en huis clos », il devenait mon persécuteur, mon bourreau.
J’étais un enfant très calme de nature. Il réussissait pourtant à m’asticoter et m’exaspérer de façon à me faire perdre patience. Il aimait ensuite, de manière sadique, me répéter en boucle, sous la forme d’une comptine malsaine, le nom d’un hôpital psychiatrique pour enfants, proche de chez nous. Il prétendait que c’était là où je finirais. Là où, lorsque l’orage grondait, on entendait les enfants hurler. Mon père me poussait délibérément à bout et, dès lors qu’il avait réussi à provoquer ma colère, il se délectait visiblement de mon mal-être. Il prétendait voir dans mes énervements le signe d’une pathologie mentale. On ne m’a bien évidemment jamais diagnostiqué un quelconque trouble psychiatrique. Mon père le savait très bien, mais il aimait s’amuser de cette idée. Ma mère, comme ce sera le cas durant toute ma vie, ne réagissait pas. Elle laissait faire et minimisait systématiquement les intentions de mon père. Jamais elle n’osa s’interposer, elle me laissait ainsi croire, de manière indirecte, à la normalité de la situation.
Ma mère était, pour sa part, animée par la volonté de me voir « parfait ». Puisque j’étais son seul enfant, il me fallait répondre à toutes ses attentes. Aussi, à la moindre insatisfaction, elle me voyait avec « tous les défauts du monde ». J’étais donc tour à tour l’enfant idéal et celui qui décevait. Longtemps après, avec le recul, nous avons fini par nous rendre compte, elle et moi, que j’avais été un enfant facile et docile. Mon objectif était de donner satisfaction à mes parents et d’en être aimé.
À ma naissance, on m’avait offert une grosse peluche : un ours de couleur orange. Je l’avais baptisé « nounours gros ». Je dormais avec lui. Il était un peu ma mascotte, mon doudou préféré. Un soir, mon père m’avait tellement mis hors de moi que, de colère, j’avais violemment jeté mon ours au sol. Pour mes parents, ce geste avait été révélateur : j’étais mauvais. « S’il était vivant, même ton ours en peluche ne t’aimerait pas ». J’ai eu alors l’impression de ne pas être digne de recevoir de l’affection, à moins d’être irréprochable. Cela pouvait paraître anodin, mais l’interprétation faite par mes parents de mon geste de colère a été, j’en suis convaincu, à l’origine du manque de confiance en moi dont j’ai longtemps souffert. Assurément, cet épisode a été un élément majeur dans la construction de ma personnalité à venir.
Chapitre 3
Dénigrement
Mon père aimait me répéter à longueur de journée l’inintérêt de mes dires. Pour lui, ma parole n’avait « pas de valeur ». Cela se manifestait, entre autres, lorsque je relatais un événement. Si mon père le jugeait « irrecevable », il le prétendait faux. Pour lui, j’étais un menteur. On ne pouvait pas prendre mes propos en considération. Il réussit à en convaincre ma mère.
Je ne comprenais pas la raison de cette défiance à mon égard. Si je me plaignais de quelque chose, il avait le réflexe de commencer sa phrase par un lancinant « qu’est-ce qu’il y a encoreeeeee ? ». Il me donnait l’impression d’être toujours dans la contestation. Par de tels agissements, il me freinait dans ma spontanéité et parvenait à me déstabiliser. Un jour, un enseignant nous avait donné un exercice de mathématiques avant de nous l’avoir expliqué afin de nous inciter à chercher, à raisonner par nous-mêmes. Hélas, je ne pus résoudre le problème. J’essayais d’expliquer à mon paternel la raison de mes difficultés, mais il refusa de me croire : « et les autres, ils font comment ? Tu ne vas pas me faire croire que l’on vous donne un exercice avant la leçon ! Tu devais plutôt être bien trop occupé à discuter avec tes camarades plutôt qu’à écouter ! » La sentence était tombée, une fois de plus. Mon père était toujours persuadé d’avoir raison. Avec lui, aucun dialogue n’était possible.
Je l’entendais fréquemment me dire, le sourire aux lèvres : « Papa te dit merde et Maman aussi ». Comme à l’accoutumée, ma mère ne relevait jamais ses propos. Elle faisait toujours « comme si elle n’avait pas entendu ». Par cette phrase répétée, mon paternel me mettait en opposition avec l’image parentale : d’un côté, il y avait moi, et de l’autre mes parents, unis, « contre moi ».
Je me suis heurté toute mon enfance et mon adolescence à cette remise en cause systématique de ma parole. C’est sans doute cela qui a motivé par la suite mon désir d’être « écouté ». À trente ans, j’ai écrit mes premiers textes de chansons. Grâce au partenariat avec différents compositeurs, mes textes ont été mis en musique. Sans être un grand interprète, j’avais peu confiance en ma voix, mais j’ai tout de même tenu à les chanter. Un moyen de me faire entendre. J’ai participé à plusieurs scènes. Quel bonheur de partager avec des centaines de personnes des textes personnels gribouillés sur le coin d’une table, dans l’intimité de ma chambre. J’y avais mis toute ma sensibilité, une partie de mon cœur.
Après mes études universitaires, j’ai postulé pour intégrer la première année à l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) de ma ville. Mon dossier n’avait pas été retenu, j’étais un peu déçu. Un père bienveillant m’aurait soutenu, compris, aurait relativisé ce refus. Le mien fit tout le contraire. Il me provoqua sur tout un tas de sujets « sensibles » jusqu’à me faire sortir de mes gonds. Puis, une fois ma colère exprimée, il se dédouanait, prétendant n’être pour rien dans mon énervement. Selon lui, si j’étais mécontent c’était uniquement en raison de « mon échec ».
J’ai finalement décidé de passer le concours en candidat libre, par le biais du CNED. Afin de ne pas travailler seul, j’avais fait paraître une petite annonce sur le journal local pour trouver d’autres étudiants. Deux filles avaient répondu, Sarah et Nathalie. Toutes deux avaient déjà passé le concours l’année précédente. Sarah se montra tout de suite la plus investie. Elle me fit part de son expérience et m’aida beaucoup. Nous avions coutume de nous rejoindre dans les locaux de l’IUFM (Institut Universitaire de Formation des Maîtres) afin d’être baignés dans l’ambiance du concours. En parallèle, je donnais des cours de soutien scolaire à des collégiens, une quinzaine d’heures par semaine.
Le vendredi soir, j’étais épuisé. Je comptais sur le samedi et le dimanche pour récupérer. Pourtant, certains week-ends, mon père s’ingéniait à me réveiller en faisant du bruit, il estimait ma durée de sommeil suffisante. Un matin, il a poncé un mur mitoyen à celui de ma chambre, avec du papier de verre. Malgré mes suppliques, il ne voulut rien entendre et continua son activité. Un tel réveil ne me mit pas dans de bonnes conditions pour débuter la journée. J’étais agacé. Dans l’après-midi, j’ai pris le volant pour aller faire quelques courses, et j’ai heurté une voiture devant moi : cet accident était dû soit à la fatigue, soit au besoin inconscient d’exprimer ma rage. Dans tous les cas, l’accrochage était incontestablement en rapport avec ce réveil brutal. Les dégâts étaient heureusement minimes, juste un peu de tôle froissée.
Grâce à notre solide préparation, Sarah et moi réussîmes le concours dès la première année. Nathalie avait moins de temps pour préparer l’examen. Elle n’était pas souvent présente. Elle le réussit l’année suivante. Bien placé parmi les candidats, j’intégrai l’IUFM de Chambéry, mon premier choix, me prédestinant à enseigner en Savoie. Mon métier était pour moi une véritable vocation. Je ne comptais pas les heures passées à préparer mes cours. Le dimanche soir, j’avais hâte d’être au lendemain pour retrouver ma classe.
J’avais là encore un public à mon écoute : une classe entière, regards et oreilles tendus dans ma direction. Les parents, quant à eux, me faisaient entièrement confiance. Le summum a été une interview où une intervenante me demandait d’expliquer mes méthodes pédagogiques, jugées novatrices pour l’époque. J’aimais me servir pour mon travail des nouvelles technologies, notamment d’Internet. Professeur en maternelle, j’ai eu l’idée de créer un site qui regroupait les comptines apprises en classe. Les parents avaient le lien et pouvaient consulter régulièrement l’apprentissage de leurs enfants. Quand on est enseignant, la parole est le principal outil de travail. J’étais donc rémunéré pour « parler ». Ma parole était reconnue, elle transmettait du savoir. Ma profession, même si ce n’était pas l’objectif principal, a indirectement démontré à mon père son erreur de jugement.
Le fait d’écrire des livres n’est pas non plus anodin. Cette parole jugée « sans valeur » par mon père est ainsi transmise par écrit et lue par plusieurs personnes, dont toi, ami lecteur. Tu me fais l’honneur de t’intéresser à mon livre et je t’en remercie vivement au passage.
Dans ma vie, j’ai toujours oscillé entre des moments toxiques essentiellement causés par mon père et des moments de bonheur trouvés à l’extérieur du cercle familial. Mes amis, mes loisirs, mon métier m’apportaient la force de continuer. Ils me ressourçaient, me donnaient l’énergie et le courage d’aller de l’avant, de continuer à me battre pour me détacher de l’emprise toxique parentale.
Cette remise en cause de ma parole par mon père a laissé plusieurs traces. Mes amis et mon entourage m’ont souvent fait remarquer ma tendance à trop m’expliquer et à me « justifier », même pour des faits banals. Sans doute était-ce la peur de ne pas être cru ? Je ne me suis pas tout de suite rendu compte de ce travers, de ces perpétuelles tentatives dans lesquelles je me lançais pour démontrer ma sincérité. J’en comprends aujourd’hui les raisons.
Ses attaques ne se résumaient pas à douter de mes actes et de ma parole. Sous couvert d’humour, il trouvait également un malin plaisir à me critiquer sur mon apparence. Il m’avait donné le sobriquet de « long nez ». De plus, selon lui, ma bouche était en « rebords de pot de chambre ». Il comparait mes dents à des grains de maïs : il parlait de « gromaillons de maïs ». Il critiquait aussi beaucoup ma maigreur d’adolescent et octroyait à mon corps la note d’un sur dix.
Mon nez était peut-être un peu long, certes, mais droit et aucunement difforme. Je passais pourtant régulièrement de longues minutes devant la glace à l’observer et à me demander ce qui clochait. Qu’avait-il d’aussi étrange pour être ainsi déprécié ? Mes camarades de classe ne s’étaient jamais moqués de mon profil. Cela aurait dû me rassurer. L’adolescence est une période ingrate et difficile. Le moindre défaut ou la moindre différence sont scrutés et font vite l’objet de railleries.
Comment assumer une disgrâce qui n’en était pas une ? Il m’a fallu des années pour le comprendre. J’ai même songé à la chirurgie esthétique. Heureusement, une amie de faculté, réputée franche et directe, me dit un jour que mon nez était tout à fait « normal ». D’après elle, il « s’accommodait » fort bien avec l’ensemble de mon visage. Ce fut comme un électrochoc. Mes complexes relatifs à mon nez finirent par s’estomper. L’appréciation de cette amie avait réussi à faire contrepoids aux réflexions désobligeantes de mon père.
Quant à mes dents, ces dernières ont toujours été blanches : les dents de lait et les définitives. En regardant des photos de moi, enfant et adolescent, je ne peux que le constater. Malgré tout, j’ai toujours – même encore aujourd’hui – la crainte de les voir jaunir. Je n’ose plus demander à mon entourage si mes dents sont assez blanches, car ils ne comprendraient pas : ils penseraient à « une recherche de compliment ».
Généralement, dans notre miroir, nous ne nous voyons pas tels que nous sommes, mais tels que nous nous ressentons. Les remarques de nos parents peuvent nous donner une mauvaise image de nous-mêmes. Je n’ai jamais vraiment compris quel intérêt trouvait mon père à me critiquer sur mon apparence. Sans doute cela faisait-il partie de sa personnalité toxique. Était-ce un moyen pour lui de nier ses propres « défauts physiques » ? Il a un léger strabisme dont je n’ai pas hérité, un visage plutôt carré, un nez assez long et une oreille un peu froissée. Néanmoins, rien de très disgracieux. Peut-être ne voulait-il pas reconnaître ses imperfections et préférait-il se cibler sur les miennes ?
Toujours ambigu, mon père était parfois capable de me trouver beau. Il me prenait en photos et m’encourageait à devenir mannequin. Comme je lui ressemblais, j’étais une projection narcissique de lui-même.
Un samedi après-midi où il avait voulu m’emmener faire un shooting photos en ville, il n’avait cessé, en présence du photographe, de me répéter « mais décontracte-toi ! » d’un ton moqueur. Cela avait eu le don de me stresser davantage. Je dois reconnaître qu’il ne fallait alors pas grand-chose pour me mettre mal à l’aise. Néanmoins, je réussis à me reconcentrer et les clichés furent satisfaisants. J’avais obtenu l’effet escompté et renvoyais une image virile me permettant de correspondre à « l’idéal masculin » de l’époque.
J’avais dix-neuf ans. Lors d’une soirée, une des collègues de travail de mon paternel, me voyant pour la première fois, crut lui faire plaisir en lui adressant un compliment sur mon apparence. Elle commit une maladresse – ou voulut le taquiner – affirmant : « Il est plus beau que toi ». Mon père fut froissé. Pour garder bonne figure, il répondit « Eh bien, tant mieux pour lui ! ». Son ton contrarié, ajouté à son sourire forcé, témoigna de son agacement. À ce moment précis, une rivalité père/fils s’accentua. J’avais l’avantage de la jeunesse tandis que lui allait commencer à subir le temps qui passe. J’eus l’impression d’être projeté dans le conte de Blanche-Neige : la collègue de travail de mon père était en quelque sorte le miroir qui révélait à la méchante reine qu’elle n’était plus « la plus belle » du royaume. Avant de m’endormir, ce soir-là, je repensai à la marâtre qui avait ordonné au chasseur d’emmener Blanche-Neige dans la forêt, de la tuer et de lui ramener son cœur dans un coffret.