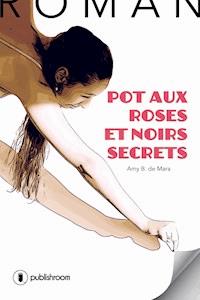
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Béatrix, jeune femme contemporaine, est à la recherche de réponses sur les silences qui entourent son passé...
Avez-vous déjà caché des vérités ? En imaginant préserver vos enfants avez-vous choisi de ne rien leur dire ? Mais le silence a ses limites et Béatrix va l'apprendre à ses dépens.
Mariée, maman, Béatrix vit en parfaite adéquation dans notre folle époque contemporaine. Cependant, elle a toujours ressenti autour d'elle des non-dits et les comportements d'évitement de son entourage rendent son passé confus, telle une évidence qu'elle aurait négligée.
Quels noirs secrets sa famille a-t-elle pu lui dissimuler ? Et si l’enquête dans laquelle elle s’investissait la conduisait à découvrir le pot aux roses ?
A la fois délicieux, et implacable,
Pot aux roses et noirs secrets nous entraîne dans une quête d’identité savoureuse, mêlant anecdotes cocasses et réalisme pittoresque. Un roman qui donne à réfléchir, et apporte de la bonne humeur. Comme une main tendue pour apprendre à tourner la page sur les écueils de la vie.
Découvrez, au travers de ce roman, la vie pleine de non-dits de Béatrix ; une jeune femme à la recherche de son passé.
EXTRAIT
Je ne vivais pas avec mes parents mais chez mon parrain et ma marraine. Pendant son congé maternité, ma mère vint s’installer chez eux ; en aucun cas, elle n’aurait voulu retourner auprès de ses parents pour les raisons évidentes évoquées plus haut.
Après ma naissance, Emily me laissa. Je n’avais pas un sentiment d’abandon, j’étais pensionnaire. Maman ne pouvait pas s’occuper de moi, elle travaillait de nuit. Mon père jonglait avec ses séjours à l’hôpital, s’efforçant de sauver sa jambe. La solution qui avait été trouvée pour mon bien-être était de me confier à une nourrice. Maman et moi passions ensemble les week-ends quand elle ne travaillait pas, et certains mercredis. Elle habitait Paris dans un petit studio près du Marais, moi dans le Val-de-Marne. J’aimais bien aller dans le petit appartement qui me semblait si opposé à ma vie de tous les jours. À cette époque, je me demandais comment des gens pouvaient vivre dans un aussi petit endroit :
« Comme c’est petit chez toi, avais-je dit à maman.
–Oui, c’est bien, non ?
–Riquiqui tout de même, tu peux à peine tourner dans la cuisine, regarde : impossible d’y être toutes les deux.
–Oui, c’est vrai.
–Si tu me prends un jour, ce sera difficile.
–Nous déménagerons.
–Nous prendrons une maison ! » m’étais-je exclamée, enthousiaste.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Amy B. de Mara est née à Paris, et séjourne entre le Var et la capitale. Passionnée et explosive, on retrouve dans ses écrits cette vivacité de style. Il y a quelques années, elle bascule dans l’écriture et publie à présent son premier roman : Pot aux roses et noirs secrets.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amy B. de Mara
POT AUX ROSES ET NOIRS SECRETS
Balivernes
« On » m’a dit de ne rien dire
« On » a fait une promesse
« On » n’a pas voulu s’en mêler
« On » a attendu tes questions
« On » n’a pas voulu te faire de la peine
« On » n’a pas voulu désobéir
« On » a pensé que ce serait mieux pour toi
« On » a fait de notre mieux
« On », etc.
Quel pauvre « On » … !
« On » et « Tu devrais » sont sur un bateau. « On » tombe à l’eau, qui reste-t-il ?
« Tu devrais » !
« Tu devrais » tourner la page
« Tu devrais » te faire aider
« Tu devrais » laisser tomber
« Tu devrais » aller vers le futur
« Tu devrais » ne plus y penser
Prologue
La « tête de nègre » a toujours été le mets sucré que je préfère ; pourtant je n’ai pas d’appétence particulière pour les saveurs douces. Après un plat roboratif, je n’ai aucun besoin de cette petite touche pour terminer un repas. Je ne mange que peu de gâteaux, rien de sirupeux ne me séduit quand je passe devant une pâtisserie.
Cependant, dès qu’il s’agit de la « tête de nègre », il devient très facile de me dévoyer. Cette douceur me fait fondre. Appétit ou pas, régime ou pas, si vous m’apportez ce gâteau, l’envie l’emporte sur la raison. Je me délecte de cette union : chocolat et meringue. Summum du péché de gourmandise.
Du reste, je me retrouve dans cette sucrerie, son aspect est proche du mien. Elle trouve elle aussi son origine dans le nord de la France, elle est recouverte de chocolat et, à l’intérieur, nous découvrons une délicieuse et croquante meringue blanche.
Cette confiserie n’est plus nommée ainsi à présent. Des arguments politiquement corrects ont eu raison de son patronyme : elle a été rebaptisée « boule meringuée au chocolat » et même parfois, pour faire plus smart, « le merveilleux », et c’est vrai que ce dessert est une merveille.
Pour ma part, ce sera toujours la « tête de nègre », souvenir de mon enfance. Mais pourquoi devons-nous absolument employer un consensus mièvre afin de dénaturer la réalité de certains mots qui seraient désormais dépassés ?
Assise devant ma charmante préparation, je me laisse aller à la rêverie en philosophant sur le monde dans lequel nous vivons. Non, en définitive, je ne pense pas que polir des mots offensants bouleverse les mentalités.
Rien n’a changé pour moi du fait que ma « tête de nègre » est maintenant appelée un merveilleux.
Certaines personnes que je croise sont avides de savoir d’où je viens et dans quelle catégorie elles vont pouvoir me mettre. S’assurent-elles que mon contact soit acceptable ou profitable ?
De fil en aiguille, d’argument en hypothèse, naissent dans mon esprit les prémices d’une interrogation.
Alors, un jour, non différent d’un autre, je me suis éveillée. Une toquade m’a galvanisée, une fantaisie m’a prise : fouiller dans mon arbre généalogique, juste une envie d’en savoir un peu plus sur mes origines et imaginer d’où je viens. Et qui cherche trouve.
J’ai gratté, enlevé du vernis, fouillé, erré de place en place. Comme un lierre qui se cramponne à son support, je me suis accrochée. Mon arbre pique. Plus je monte, plus je me blesse. Le vertige me prend mais je veux capter la lumière, grandir et fleurir à mon tour.
Panique !
Ne pleure pas, je t’en prie, ne pleure pas. Marraine –je l’ai toujours nommée ainsi, tu m’as choyée, élevée. Pardonne à l’ingrate de t’arracher ce jour-là des larmes.
Acculée, je n’en pouvais plus. Je n’avais pas d’autre option.
Tu n’as pas confirmé, ni contesté, tu n’as rien dit. Mais je sais, je savais, je crois que j’ai toujours su.
Le sol vient de s’ouvrir sous mes pieds. Je dois m’appuyer au mur pour ne pas tomber.
Il faut que j’arrive à reprendre mon souffle. Respire, respire, respire.
Tu aurais pu me poser la question : pourquoi maintenant ?
Oui, pourquoi maintenant, dans une période de ma vie stable, confortable et heureuse ?
Pourquoi pas à quinze, vingt, trente, quarante ans ou à un moment charnière de ma vie, adolescence, mariage, naissance de mes enfants ?
Je n’ai aucun élément de réponse, je serais bien incapable de donner un avis justifié.
Tu aurais dû aussi t’en enquérir : comment en es-tu arrivée là ? Mais tu n’as rien dit.
Une fois encore je ne sais rien, les faits sont survenus, c’est tout.
L’état nébuleux duquel je suis sortie n’est pas dû à de super pouvoirs. Est-ce de l’inconscience, du subconscient, de la mémoire enfouie, que sais-je ?
J’ai cheminé vers une quête, utilisé mes souvenirs pour comprendre mes péripéties. Ma mémoire avait tout organisé, j’ai dû fouiller au plus profond pour affiner des soupçons. Des maux d’enfance passés sous silence se sont imprégnés en moi, qui demeure inquiète, écartée, apeurée. Année après année, j’ai dû façonner les matériaux bruts de mes souvenances pour provoquer une rencontre avec mon moi subliminal. Un rendez-vous brutal et violent. Une porte qui était fermée, qui s’est ouverte sur un puits profond où j’ai basculé dans les abîmes, là où tout est triste, sans intérêt et sans plaisir. Jusqu’au moment où j’ai pu ouvrir les yeux et entrevoir la lumière. Une révolte intérieure contre mon infortune a été mise en marche. Soutien, bon sens, acceptation des signes se sont organisés comme dans une formule de sciences physiques. J’ai résisté au choc, repris ma forme et mes propriétés initiales.
J’ai mis en place un procédé pour réparer la déchirure et pour combattre les démons qui s’étaient immiscés en moi. Je peux maintenant tendre la main vers la résilience pour que le début soit la fin.
Je me dois de vous initier. Vous devez passer par toutes les étapes et suivre le parcours qui m’a été soigneusement tracé. Plongeons ensemble dans cette rétrospective.
En scène, les protagonistes !
Ô ! Feus mes aïeuls
« As-tu vu comme elle est laide ?
–Arrête de dire cela.
–Non, mais tout de même, tu ne peux pas dire, elle est vraiment laide, je ne sais pas ce qui lui a pris à Emily de fricoter avec un noir.
–Chut ! C’est fait … C’est fait !
–Oui, mais quand même. »
J’étais chez ma grand-tante, une sœur de ma grand-mère maternelle.
J’entends encore le son de leurs voix résonner dans mes souvenirs. Présent à l’intérieur de moi, comme une mauvaise influence qui aurait contribué à mal me construire.
Tout était impeccable chez la tante Sophie, une vraie maniaque. Minutieusement, les franges du tapis étaient peignées. À longueur de journée, tante Sophie passait le balai-brosse sur les bandes effilées de ses carpettes pour que tout soit parfaitement rectiligne. Attention à celui qui dérangeait cette symétrie !
Je jouais sur ce fameux tapis. Je devais avoir cinq ans.
J’étais presque sûre ... Non, j’étais sûre qu’elles parlaient de moi, je sentais leurs yeux dans mon dos, je n’osais pas bouger.
Continue de jouer, me disait la petite voix dans ma tête. Mais le cœur n’y était plus. Je pris ma poupée, je lui parlai tout haut pour montrer que je n’avais rien entendu et que j’étais concentrée sur mes distractions.
« Allez, Fanny ! Nous allons mettre une nouvelle robe », lui dis-je
Je l’aimais, ma poupée Fanny, je ne savais pas trop pourquoi. Elle n’était pas vraiment belle. Comme quoi, qui se ressemble s’assemble. Petite et toute en tissus, c’était une poupée de chiffon légère et malléable, je pouvais l’emporter partout. Ce qui me contrariait, c’était qu’elle n’avait pas de cheveux.
Maman était où, d’ailleurs, et mon oncle, et mon père ? C’était étrange que je fusse seule avec les deux harpies pour une visite de dimanche après-midi. Pour mon grand-père, Émile, je savais pourquoi il n’était pas là : il ne venait plus chez la tante Sophie, ils étaient fâchés.
Émile, le pépé pénible, s’immisçait partout et voulait tout diriger, surtout la vie des autres. Autant ma grand-mère était plutôt discrète et conciliante, autant sa sœur était explosive. Les deux personnalités ne pouvaient pas se comprendre, et un jour ma grand-tante lui avait déclaré : « Je ne veux plus de toi chez moi. » Il n’avait jamais remis les pieds chez sa belle-sœur.
Quand maman revint, le temps de la visite était enfin terminé. « Viens, Béatrix, nous partons ». En me levant, je marchai exprès sur les franges si bien entretenues du tapis, petite vengeance personnelle. En revêtant le manteau en peau que maman m’avait offert dernièrement, je me regardai dans le miroir de l’entrée : je ne m’imaginais pas si moche. Nous partîmes.
Je suis mulâtresse ou griffonne, je ne sais pas trop quelle est la juste dénomination. Papa métis et maman blanche. Pareil pour les ongulés, impossible de me souvenir du bon terme entre le mulet, le bardot et le baudet, même espèce mais race différente. Si chez les équidés cela ne semble pas trop poser de problèmes, chez l’homme tout se complique. Sommes-nous plus stupides que les ânes ? Je pense que si j’avais été de type caucasien, j’aurais traversé ma vie sans encombre, mais la couleur de ma peau entraînait sans cesse des interrogations. Cela a fait germer dans mon esprit des questions toutes plus farfelues les unes que les autres.
Pour mon grand-père, cette différence était une réelle difficulté. Il avait eu bien du mal à ouvrir sa porte à mon père.
Au début, Papa n’avait pas eu le droit de venir chez mes grands-parents mais, au fil du temps, avec toute la patience et la gentillesse dont il savait faire preuve, il avait fini par conquérir mon terrible pépé.
Ils étaient devenus les meilleurs amis du monde.
« Tu sais, Pierre, toi, ce n’est pas pareil, tu es né en France, tu as toujours travaillé, tu es adapté. Ce n’est pas comme tous les autres, là, ils ne s’adaptent pas, eux, ça ne peut pas aller », disait mon grand-père.
Mon père ne répondait pas, avec douceur il changeait de sujet.
« Tu n’as pas fini d’arracher les betteraves dans le jardin ? Viens, je vais t’aider. »
La maison de mes grands-parents était pitoyable, petite, deux malheureuses pièces sans confort, toilettes, eau chaude ou salle de bain. Jusqu’à sa mort, mon grand-père refusa catégoriquement tout changement ou progrès. Les week-ends chez mes grands-parents étaient un calvaire.
Pépé Émile avait la stature haute et un caractère tyrannique. Des disputes violentes éclataient constamment entre mes grands-parents qui ne se supportaient plus mais étaient obligés de survivre ensemble. Je détestais ces éclats de voix, je me cachais sous la table dès que le ton montait.
La région dans laquelle cette famille vivait paraissait cependant merveilleuse à l’enfant que j’étais. Se promener sur les plages ventées du Touquet et courir dans les dunes me donnait un sentiment de liberté. Cet amour pour ces paysages m’a fait passer outre tous les désagréments d’un week-end chez pépé et mémé.
Quand je suis sur ces plages, j’oublie tout. Aujourd’hui encore, la mer a un effet apaisant sans pareil. De l’eau salée coule dans mes veines. Du côté de ma grand-mère, nos ancêtres étaient tous émérites dans l’art de la navigation. Marins, chasse-marée, cordiers de génération en génération.
Grotesque paradoxe, je garde une affection particulière pour mes aïeuls. La vie difficile qu’ils ont eue, la guerre, Émile emprisonné cinq ans en Allemagne, son épouse accouchant seule de ma mère chez sa sœur, leur vie de travail harassante, tout cela suscite chez moi une tendre bienveillance.
Prisonnier, évadé, prisonnier à nouveau, mon grand-père était devenu carreleur en rentrant d’Allemagne. C’était un homme intelligent, même si les propos qu’il tenait étaient stupides. C’était toute l’absurdité du personnage. Il était plein d’humour, cultivé et passionné d’art. C’était une personne agitée, hyperactive, tout devait aller très vite : il parlait vite et marchait vite, on le surnommait « la flèche ». Il tutoyait tout le monde, du maire au curé, mais vouvoyait son chien, une espèce de bâtard hargneux qu’il emmenait partout avec lui et qu’il appelait « Monsieur » : « Si Monsieur veut bien monter dans la voiture. » « Monsieur, venez ici tout de suite ! »
La vie était dure, le travail, puis la construction de sa pauvre maison, puis le travail, l’alcool pour se réconforter, puis le travail encore. Jamais de loisirs et peu de plaisirs ont sûrement contribué à faire de pépé la flèche quelqu’un de dur.
La vie est inattendue.
Pépé la flèche venait pourtant d’une famille aisée : son grand-père Louis était médecin. Il avait une grande demeure vers Amiens, des notables, comme on disait à l’époque. Mais Louis buvait et but tout, maison, terres et domaine. La légende racontait qu’il n’était pas rare de voir passer le fiacre seul, Louis allongé sur la banquette en état d’ivresse avancé, pour ne pas dire soûl comme un cochon, le cheval rentrant de lui-même à la propriété, connaissant la route par cœur.
Quand tout fut bu et vendu, Louis et sa femme Germaine furent hébergés par charité près du golf du Touquet.
Son fils Charles, le père de mon grand-père, était un artiste. Il faisait de la photographie et s’était établi près du camp militaire de Sissone. Il devint le photographe attitré des soldats, ce qui fit sa bonne fortune, tous les conscrits voulant se faire tirer le portrait. Charles avait son propre magasin de photo et acheta l’une des premières voitures de la région. Bien mal lui en prit puisqu’il eut un accident. Bras arraché, septicémie. Bref, il décéda.
Pas de chance ! Vanité, quand tu nous tiens …
Charles mort, Joséphine, son épouse, se retrouvait seule avec cinq enfants.
Une fois la « fortune » dilapidée, elle était retournée au Touquet pour être femme de chambre dans un palace. Elle rencontra un gentleman, tomba enceinte et partit vivre avec lui à Londres.
Au revoir, Joséphine, bon voyage en Angleterre !
En partant, la Miss allégea ses bagages, déposa deux de ses enfants à la DDASS, partit avec les deux plus jeunes et, dans cet imbroglio, laissa mon grand-père chez Louis et Germaine, les alcoolos installés au golf.
Pépé la flèche dut faire sa vie avec ce passé : voilà comment de nanti il était devenu prolétaire.
Grand-mère est d’un milieu plus modeste. D’origine anglaise et espagnole, son père Victor avait cassé la tradition familiale pour devenir jardinier. Sa mère Eugénie, nourrice, prenait en charge des enfants de la DDASS.
Mes grands-parents se rencontrèrent. Ma mère naquit. Le train-train reprit son cours : le travail, les disputes. Ainsi va-t-elle.
Je regarde en arrière. Comme un film muet que l’on visionne avec mélancolie, je revois mes grands-parents. Si je suis là, c’est grâce à eux, à leur histoire.
Ces souvenirs gravés renaissent dans mon esprit. Comme une malédiction inconsciente. Des similitudes se sont révélées dans ma famille. D’incroyables ressemblances de parcours, des points communs découverts les uns après les autres, parfois frappants ou capricieux, se profilent. Un cycle infernal que rien ne semble pouvoir arrêter : la DDASS, les nourrices, la photographie, la médecine, l’art. J’ai l’impression qu’il ne sera plus possible de sortir du schéma de départ.
Si, comme nous l’enseigne la mythologie, de vieilles fileuses tissent l’écheveau de notre existence, alors mesdames, cessez de jouer avec les ficelles de notre destin ! Tout est-il écrit par avance ? Est-ce noté dans nos gènes pour un éternel recommencement ?
À mère
Dans ce contexte, il est bien compréhensible que ma mère ait eu envie de partir le plus vite possible de chez ses parents et vivre sa vie. Maman aurait pu être l’héroïne d’une œuvre romanesque un tantinet dramatique. Comment décrire le visage sacré de la source de vie ? D’allure frêle presque chétive, petite, des cheveux fins blonds lumineux et des yeux noisette malicieux. Voilà sans détails le portrait d’Emily. Tout en contraste, timide et effrontée, forte et fragile.
Si je lui demande si elle était heureuse chez ses parents, elle me répond qu’elle n’a manqué de rien et a toujours mangé à sa faim. Cela suffit-il au bonheur ?
Elle était née pendant la guerre, fille unique. La vie fut dure, pas d’argent, pas de contentement ni de joie.
Mais maman aime lire, la lecture lui permettait de s’évader. Se plonger dans les livres était un réel outil thérapeutique afin d’enrichir ses pensées et ouvrir son esprit. Elle dévorait tous les ouvrages que les voisins voulaient bien lui donner. Pour tenter de vivre un peu mieux et de moins dépendre de son despote de mari, ma grand-mère faisait des ménages. Maman devait l’accompagner pour ses nettoyages dans les belles demeures du Touquet. De temps en temps, elle pouvait en profiter pour lire ce que les propriétaires lui prêtaient, mais souvent elle n’avait pas le droit de bouger pendant que ma grand-mère frottait et récurait. Elle devait rester des heures assises sur une chaise de cuisine ; parfois, les riches employeurs ne l’autorisaient pas à entrer dans la maison et elle restait à attendre dehors, assise par terre.
Si un jour je suis riche, pourrai-je être aussi méchante ?
Ce fut dans ces moments-là que l’amour de la lecture fut le plus salvateur.
À la maison, ce n’était pas l’euphorie : les disputes des parents, le confort spartiate. Il fallait aller se laver dans les douches publiques du village. Toute cette survie était la sienne et elle l’acceptait, car que faire d’autre ? Cette existence restait triviale à l’époque.
Les origines aidant, maman voulut être professeur d’anglais. Mais la France avait besoin d’infirmières, les études étaient gratuites et assuraient de partir vite de la maison familiale.
Va pour infirmière !
L’arrivée de la provinciale à Paris fut difficile, de toute façon c’était accepter et pleurer quelques fois ou repartir chez les parents.
Les étudiantes étaient logées dans des dortoirs de vingt personnes ; chacune avait un lit, une armoire, une caisse à oranges en guise de table de nuit, un drap marquant la séparation avec la voisine de chambrée ; le lavabo pour se laver et faire sa lessive et les toilettes au fond du couloir. Pour maman, cela ne la changeait pas de la maison. Un coin avec un réchaud pour faire chauffer de quoi se nourrir.
Un travail éreintant entre études et soins.
L’histoire d’une infirmière à une époque où les moyens techniques étaient encore peu développés. Pas tout à fait le Moyen-Âge, mais pas très loin non plus.
Enfin maman fut diplômée d’État. Elle commença sa carrière à raison de douze heures par jour auprès des patients. Toujours de grandes salles communes, pas encore les moyens d’avoir un petit appartement à soi, elle passa donc du dortoir « des bleues » au dortoir des diplômées en attendant de pouvoir payer le loyer d’un petit studio.
Et puis plus rien n’alla : Emily était fatiguée, elle maigrissait.
« Madame, vous avez la tuberculose », lui dit le médecin.
Comme Marguerite mais sans le soutien d’Armand, maman avait un camélia dans les poumons. Elle partit dix-huit mois au sanatorium de Saint-Paul-de-Vence pour se soigner.
Quand elle revint, tout avait changé. De sa vie d’avant, il ne restait rien. Il fallut recommencer seule, sans soutien, sans personne, trouver un poste et repartir pour douze heures de travail journalier.
Quand elle reprit sa vie, Emily pesait trente-six kilos, mais elle n’était plus la même.
Le phénix
Ce fut comme un mauvais film qui commençait.
Il faisait beau ce jour de fin août et à Paris, l’arrière-saison est souvent très agréable. C’était une période difficile, la Seconde Guerre mondiale menaçait, le monde était déjà près du chaos. L’ultimatum avait échoué, les troupes allemandes ne se retireraient pas.
Une femme marchait sur les trottoirs parisiens, le dos courbé, elle semblait souffrir. Elle avait dans ses bras un paquet, on aurait dit un vieux châle roulé en boule.
Elle passa devant une poubelle, souleva le couvercle, jeta le ballot et repartit à petits pas.
Sur ce même trottoir, quelques minutes plus tard, un couple flânait, profitant encore de cette douce chaleur. Ils passèrent à leur tour devant la poubelle, dont des bruits émanaient. L’homme ouvrit le couvercle et le laissa tomber sur le sol, sortit le châle et présenta à sa femme horrifiée un bébé. Sa peau était foncée, son visage était déformé, sa bouche n’était pas fermée. La dame recula d’effroi, c’était un monstre. Un bébé difforme qui ne pleurait pas et qui ne se plaindrait jamais.
Papa commença ainsi son existence, abandonné et jeté dans une poubelle. Une femme avait accouché d’un enfant de couleur, atteint d’une malformation. Une fente palatine communément appelée « bec-de-lièvre ».





























