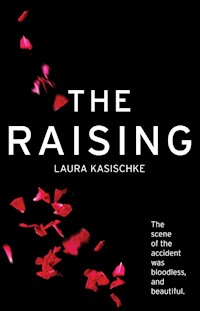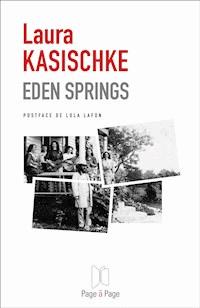Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Page à Page
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Plongée dans l'univers décalé de Laura Kasischke...
Paru en 2013 aux États-Unis, ce recueil comprend 15 nouvelles dans lesquelles on retrouve le climat caractéristique de Laura Kasischke : l’étrangeté, à la frontière du surnaturel, un malaise palpable, souvent innommable, un éventail raffiné de violences et une tension sous-jacente. Le plus : ces formats courts révèlent l’humour subtil que l’on devine dans ses romans.
Cet ouvrage a été traduit par Céline Leroy et est introduit par une préface de Véronique Ovaldé.
Un recueil de nouvelles qui mêle l'étrange, le surnaturel, le malaise, la violence, la tension ainsi que l'humour !
EXTRAIT DE
MONA
Ils lui avaient bien dit, tous, de ne pas fouiner. À quoi bon lire le journal intime de ta fille adolescente ou fouiller dans les tiroirs de sa commode si tu ne sais pas quoi faire de ce que tu risques de découvrir ? Ne serais-tu pas plus sereine en ne sachant rien au cas où il y aurait quelque chose que tu ne voudrais pas savoir ?
Et à vrai dire, il n’y avait eu aucune raison de fouiner. Pas de comportement étrange. Pas de baisse dans les notes. Pas d’amis qui auraient eu mauvaise influence.
Mais Mona était de ces mères qui ont besoin d’être rassurées, et du reste, Abigail avait seize ans.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
La romancière du Michigan saupoudre son recueil de nouvelles d'un zeste de fantastique. Ensorcelant. -
L'Express
Étrange, vous avez dit étrange. Chaque nouvelle se termine sur une pirouette ou un mystère, et l'on n'a qu'une envie, entamer la suivante pour se replonger dans l'atmosphère paradoxale, tour à tour lumineuse et sombre, empathique et cinglante, de cette auteure. -
L'Express
Fascinées par son univers à la fois prosaïque et surnaturel, et par ses personnages faussement ordinaires, Tatiana de Rosnay, Marie Desplechin, Dephine de Vigan applaudissent à l'envi cette magicienne de l'écriture aux métaphores singulières. -
L'Express
Ces 15 nouvelles inquiétantes, puissantes, à la prose vertigineuse, envoûtent longtemps encore après avoir refermé le livre. Le maléfice Kasischke a encore fonctionné. -
Marianne
À PROPOS DE L'AUTEUR
Laura Kasischke vit dans le Michigan où elle enseigne l'écriture à l'université. Ses romans sont publiés chez Christian Bourgois et au Livre de Poche. Parmi eux, deux best-sellers :
À moi pour toujours et
Esprit d'hiver (Grand Prix des lectrices de
Elle). Trois de ses romans ont été adaptés au cinéma. Poète américaine majeure, sa poésie est traduite en français chez Page à Page.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COMME UNE DÉLICATE EXPLOSION
Ce qui est frappant quand on rencontre Laura Kasischke c’est sa douce beauté, son sourire timide, son regard surpris, comme celui d’une antilope prise dans les phares sur une route en plein désert, quelque chose de candide et d’un tout petit peu inquiet, quelque chose qui semble absolument inoffensif, alors qu’à l’intérieur, soigneusement caché, il ne reste plus rien de domestiqué, tout est sauvage et féroce, ne persiste qu’un territoire post-apocalyptique où errent çà et là quelques fantômes. C’est ce contraste qui est fascinant. C’est cela que j’aime et que nous sommes si nombreux à aimer chez Kasischke. L’impression de toucher à quelque chose de secret, de profondément existentiel, qui s’apparenterait à une révélation, mais une révélation terrifiante et jubilatoire à la fois – la vie n’est que cela, l’adolescence n’est que cela et la mort n’en parlons pas.
C’est ce charme si singulier et si hypnotique que l’on retrouve dans chacune de ses nouvelles. Sa délicatesse de ballerine et sa précision de médecin légiste.
Je pourrais, je crois, établir une liste de tout ce qui me plaît infiniment chez Kasischke – j’aime la poétique des listes –, il y aurait avant toutes choses son sens des images, son acuité et son inventivité pour exprimer le plus précisément possible une sensation, cette manière si particulière d’en appeler à notre expérience commune et de la tisser dans un maillage d’images inédites : l’autoroute est « un ruban de velours noir », il y a ces femmes qui ont l’air minuscule au milieu de tout le chrome de leur voiture, il y a l’odeur de « la tourte à la viande de ses cheveux », et puis ce « ciel aussi limpide que du gin ». Je me souviens dans l’un de ses romans de « mon cœur qui s’emballe comme un requin circulant dans mon sang ». Ou d’un panier de fruits « comme une petite explosion, comme une bombe abandonnée par l’IRA dans une poubelle de la gare ». Ces phrases, je les connais par cœur, elles sont mes trésors.
J’aime son acuité, sa manière de parler des faubourgs de la vie, du mariage, de la jalousie, du divorce, des conseilleurs conjugaux et des centres commerciaux infinis, de la férocité des mères et du dépit des pères, et j’aime son humour bien sûr, un humour plutôt bienveillant, comme si elle regardait de jeunes enfants s’ébattre dans un grand jardin et qu’elle secouait la tête, incrédule. La différence essentielle entre les hommes et les femmes, nous dit-elle par exemple, ne serait-elle pas résumée dans leur manière de jouer à la balle aux prisonniers : les garçons, formés à être compétitifs, veulent être les derniers dans la course, les filles, quant à elles, dupent le système en se laissant toucher dès que possible par la balle afin d’aller tranquillement s’asseoir pendant toute la partie.
Et puis il y a son rapport aux accidents grotesques, aux farces dans ce qu’elles ont de plus grimaçant, aux deuils qui entachent à jamais notre fréquentation des autres, le manque, le terrible manque que l’absence a créé et qui est comme une ombre qui vivrait sur notre visage. L’ombre d’une plante grimpante qui croît à notre insu et qui baigne nos traits de gravité et de perplexité. Comme un démon discret qui habite notre figure et se cacherait dès que quelqu’un nous regarde.
Et de là bien sûr découle l’incroyable relation qu’entretient Kasischke avec l’adolescence, ses échecs, ses humiliations, son attente, c’est le moment où tout est possible, où le champ des possibles est si vaste qu’il pourrait vous donner le vertige ou même plutôt la nausée, c’est vous qui dorénavant inventez le monde, personne avant vous n’avait fait l’expérience d’un amour aussi absolu (et certainement pas vos parents), personne n’avait essayé cette drogue, cette position, personne ne savait combien il est si bon et si déstabilisant d’être jeune, vous voilà à l’orée d’un grand événement, à quelques centimètres du bord de la falaise. Et Kasischke est la magicienne absolue pour faire revivre ce moment si dangereux et si exaltant.
On retrouvera ici son amour de la science-fiction avec Notre père – une anticipation inquiétante qui évoque L’Alphabet de flammes(1) de Ben Marcus mais aussi nous replonge dans l’étrangeté de son roman En un monde parfait(2), dans lequel une femme protégeait sa famille d’une épidémie qui ravageait l’humanité.
Ses nouvelles se rapprochent de son travail de poétesse, me semble-t-il, Kasischke y travaille (comme on travaillerait à un objet admirable sur le tour du potier) le côté résolument organique de nos vies, leur violence (dans l’un de ses poèmes elle écrit : « arrache-moi de cette maison comme tu arracherais un enfant de l’épave d’une voiture »)(3) et là, me paraît évident que la nouvelle est sans doute le territoire idéal pour une perfectionniste comme Kasischke, inutile de s’embarquer dans une narration trop complexe, l’important est ailleurs. Même si certaines de ses longues nouvelles touchent au sublime comme Melody où le père divorcé, narrateur, vient déposer des cadeaux – des offrandes – pour l’anniversaire de sa petite fille, et ne voit autour de lui que des mères menaçantes qui font compétition de maigreur.
Kasischke aime les fantômes, les vivants qui ne sont plus tout à fait vivants et les morts qu’on croit vivants. C’est ce qui donne parfois cette indétermination qui se répète ici à des dizaines de reprises, cette indécision particulière et très drôle (complice, oserais-je dire), dont ses lecteurs peuvent débattre longtemps (qui est la jeune fille qui meurt sous les balles du tueur de La vie devant ses yeux(4), qu’est-il vraiment arrivé à Nicole lors du bizutage de sa sororité dans Les Revenants ?)(5), les identités deviennent floues, ambiguës, Kasischke propose une chute à son roman, elle propose une chute à sa nouvelle, la saisit qui voudra.
Et reviendra, comme une ritournelle, cette question fondamentale : comment réussir à prendre la mort comme une nouvelle du cosmos, quelque chose qui ne vous arriverait pas personnellement mais serait un simple élément du cycle de la vie ?
Véronique Ovaldé
(1) Traduit par Thierry Decottignies, Éditions du sous-sol, 2014.
(2) Traduit par Éric Chédaille, Christian Bourgois éditeur, 2010 ; Le Livre de Poche, 2011.
(3) Extrait d’À qui de droit, in Mariées rebelles, traduit par Céline Leroy, Page à Page, 2016 ; Points, 2017.
(4) Traduit par Anne Wicke, Christian Bourgois éditeur, 2002 ; Points Seuil, 2003 ; Le Livre de Poche, 2014.
(5) Traduit par Éric Chédaille, Christian Bourgois éditeur, 2011 ; Le Livre de Poche, 2012.
Pour Antonya Nelson –la meilleure amie et conteuse au monde
Comment expliquer notre réaction.
Nous avons tous reconnu Toby.
Mais ça ne pouvait pas être lui. Et pourtant, si !
Extrait du « Garçon qui ne savait pas qu’il était mort »Fate Magazine, juin 1996
À mon réveil je ne suis pas resté ;
mais là où j’ai demeuré, je ne puis te le dire.
Le Tristan de Wagner
MONA
Ils lui avaient bien dit, tous, de ne pas fouiner. À quoi bon lire le journal intime de ta fille adolescente ou fouiller dans les tiroirs de sa commode si tu ne sais pas quoi faire de ce que tu risques de découvrir ? Ne serais-tu pas plus sereine en ne sachant rien au cas où il y aurait quelque chose que tu ne voudrais pas savoir ?
Et à vrai dire, il n’y avait eu aucune raison de fouiner. Pas de comportement étrange. Pas de baisse dans les notes. Pas d’amis qui auraient eu mauvaise influence.
Mais Mona était de ces mères qui ont besoin d’être rassurées, et du reste, Abigail avait seize ans. Son papa chéri avait pris la poudre d’escampette, était sorti du champ – parti vivre une toute nouvelle existence avec une toute nouvelle famille dans un nouvel état – et le monde actuel n’avait plus rien à voir avec celui qu’avait connu Mona dans sa jeunesse. Elle avait lu que certains gamins sniffaient, se scarifiaient, prenaient de la méthamphétamine. Sans parler du sexe, bucco-génital et autre. Mona était la mère d’Abigail et s’il y avait quelque chose à savoir, autant le savoir.
Et s’il n’y avait rien, alors tant mieux.
Ça c’est dans le meilleur des cas, songea Mona en ouvrant le tiroir du bas après avoir inspecté les trois autres où elle n’avait rien trouvé de plus que les habituels sous-vêtements, leggings, bijoux de pacotille, vernis à ongles et chaussettes rayées. Elle avait été agacée en tombant sur une barre chocolatée Hershey’s à moitié entamée – et ce après tout le foin l’été précédent au sujet des fourmis et du fait qu’il ne fallait rien, surtout rien manger à l’étage. Mais elle se contenta de la remettre à sa place pour ne pas avoir à avouer qu’elle l’avait vue.
Dans le tiroir du bas apparemment, toujours plus de chaussettes, de soutiens-gorge et de culottes. (Comment cette petite avait-elle réussi à en accumuler autant ?). Des articles simples. Convenables. Pas de soutien-gorge noir. Pas de string. Mona n’avait qu’une idée floue de ce que portait sa fille depuis qu’Abigail faisait sa propre lessive, la pliait et la rangeait elle-même. Elle avait eu la gentillesse de se prendre en charge quand on avait allongé le temps de travail de Mona qui, certains soirs, rentrait à vingt heures passées.
Abigail était une fille obéissante, une excellente élève, n’avait jamais eu le moindre problème…
Mais Mona savait aussi à quelles extrémités on peut être rendu quand les choses tournent mal. Elle aussi avait été adolescente. Au même âge, elle avait failli avoir de gros ennuis. Avec un garçon plus âgé. Scott. Cette voiture qu’il avait. L’alcool. L’herbe. Cela remontait à 1977, et à l’époque, tous les gamins fumaient et buvaient jusqu’à l’abrutissement. Même les plus sages. Surtout les plus sages. « Dites non à la drogue », le slogan de Nancy Reagan, ne serait lancé que cinq ans plus tard et en attendant, tous disaient Oui, oui, oui.
De toute façon, ses parents ne se rendaient compte de rien. Scott et elle rentraient pile à l’heure le samedi soir, leur air d’Américains moyens peint sur le visage. Scott serrait la main de son père, faisait la conversation quelques minutes à sa mère, puis Mona et lui descendaient au sous-sol, déjà complètement défoncés, vidaient la bouteille de Jack Daniel’s que Mona avait dans son sac jusqu’à la dernière goutte et faisaient l’amour sur le canapé en skaï à la lumière d’un innocent programme télé, le volume à fond.
Mona elle aussi était une excellente élève. À la tête de la chorale. Membre actif de son groupe de jeunes à l’église. Visiblement, ses parents ne s’étaient jamais donné la peine de fouiller dans ses tiroirs où ils auraient trouvé des cadavres de bouteilles, la petite pipe en forme de colibri pour fumer de l’herbe et peut-être même un sachet avec quelques têtes de cannabis et la boîte de préservatifs.
C’est pour ça que Mona était à présent agenouillée devant le tiroir du bas en train de retourner les soutiens-gorge et les culottes de sa fille. À cet instant, elle palpait les différents articles sans penser y trouver quoi que ce soit, mais pour autant, ne fut pas si surprise quand elle mit la main sur la chose.
Plus tard, Mona se demandera pourquoi cette chose entre ses doigts lui avait paru étrange. Sur le coup, ça n’était qu’un amas soyeux au milieu d’autres amas soyeux.
Mais celui-ci renfermait quelque chose.
Une chose qui n’était pourtant pas solide.
Pas plus grosse qu’un gland. Plus légère qu’un gland. Mona aurait pu si facilement passer à côté, la confondre avec un chouchou ou une rose séchée, souvenir d’un repas après une compétition d’athlétisme, un œillet du club des pom-pom girls, ou l’un des millions de souvenirs floraux que reçoit une fille de son âge.
Même sensation. Au toucher, un ruban, un végétal ou un petit tas de dentelles.
Mais par ailleurs, la chose avait été emballée à la hâte dans un carré de soie et – l’imagination de Mona lui jouait-elle des tours ? – il semblait qu’on l’avait cachée avec soin. Le tiroir du bas, dans un coin au fond, sous un caraco plié au cordeau.
Mona sortit l’objet et observa d’abord le carré de soie qui était tacheté de petits points marron à la forme irrégulière. Vaporisés, comme quand on se mouche avec un nez qui saigne.
Du vieux sang. Quelque chose de menstruel ? Abigail avait-elle, pour une raison ou une autre, laissé là un tampon usagé ?
Mais pourquoi ?
Non, ça n’était pas assez gros. Le petit paquet reposait sur la paume de Mona – et il y avait cette autre sensation. Un picotement, une apesanteur. Lentement, alors qu’elle regrettait déjà son indiscrétion (ils l’avaient prévenue), elle défit l’enveloppe.
La chose au centre du carré de soie était rouge, d’un rouge qui avait viré au brun. De la taille d’un bouton de rose, supposa-t-elle, même si ça n’était pas une fleur. La chose avait séché, mais n’avait jamais été une fleur. Il n’y avait pas de pétales. On aurait plutôt dit…
Un caillot de sang ?
Une grosseur ?
Une petite tumeur ?
L’extrémité bulbeuse d’une langue, le gros orteil d’un bébé, ou quelque chose d’interne, une masse recrachée par les poumons ? Une petite protubérance qui s’était racornie, presque réduite en poussière, maintenue par… ?
Par des épingles.
Cette chose sur la paume de Mona ne devait pas peser plus de trente grammes, mais elle compta entre vingt et trente épingles profondément enfoncées dedans.
Sa main s’était mise à trembler.
Elle s’approcha de la fenêtre pour mieux voir.
Nom d’un chien, songea-t-elle. Mais qu’est-ce que ça peut bien être ?
Une lueur d’espoir saisit Mona quand il lui vint à l’esprit qu’il pouvait s’agir d’un morceau de fruit séché. Un abricot. Une fraise. Une prune.
Non. Quand elle la brandit près de son visage, à la lumière vive déversée par la fenêtre (remarquant que les épingles n’étaient pas plantées au hasard, mais qu’elles traversaient la matière en suivant une sorte de schéma compliqué – une en haut, deux en bas, croisées, une en bas, une en haut jusqu’à en faire le tour, à côté d’une deuxième rangée identique, suivie d’une troisième et d’une quatrième) elle sut à quoi lui faisait penser cette chose : le fœtus de cochon étudié en cours de SVT de seconde. Disséqué. La cage thoracique maintenue ouverte par des épingles pour révéler les organes minuscules et parfaitement formés qui étaient nichés à l’intérieur. Des bijoux faits de chair. Les pitoyables petits poumons. L’estomac. Et le cœur.
Le cœur.
Les artères sectionnées. Une, deux, trois, quatre, cinq, et la plus grosse (elle retourna la chose dans sa paume pour voir le côté droit) – l’aorte.
Mona la fit tomber par terre et s’en écarta, une main portée à la gorge. Mon Dieu. À nouveau à quatre pattes, elle vida complètement le tiroir, fit voler les vêtements autour d’elle. La soie rose, la soie blanche, le coton blanc. Elle s’empara de chaque culotte, chaque soutien-gorge, les débardeurs et les collants qui remplissaient tous les tiroirs. Les jolies petites marguerites sur les culottes, les roses cousues entre les bonnets des soutiens-gorge, éparpilla le tout jusqu’à vider la commode. Après quoi elle passa les mains sur le fond des tiroirs, sur les bords, et là non plus, ne trouva rien – pas même un grain de poussière, pas même une miette. Rien que cette pitoyable moitié de barre chocolatée. Une gamine si gentille. Une gamine si ordonnée, obéissante.
Lentement, soigneusement, Mona remit tout dans la commode – plia les vêtements avec attention, les disposa comme sa fille les avait disposés – avant de mettre le reste de la chambre sens dessus dessous : draps, étagères, boîtes à chaussures au fond du placard, poches de manteaux, vestes et jeans, table de nuit, sans oublier le coup d’œil sous le lit – et quand elle eut fini de ne toujours rien trouver, elle remit une fois de plus tout en place, saisit la chose par une épingle, écœurée, saisit la chose momifiée, le minuscule cœur momifié et le déposa sur le carré de soie dans lequel Abigail l’avait enveloppé, puis sortit de la maison avec, le mit délicatement sur le siège passager de sa voiture, claqua la portière, s’installa derrière le volant, démarra et descendit l’allée qui menait à la rue.
Alors que Mona s’éloignait de chez elle, les rues lui semblèrent avoir été vidées, de tout et de tout un chacun. Seule la lumière. Aucune voiture ne circulait cet après-midi-là. Seules les ombres vertes. C’était sublime. L’automne. Une nouvelle année scolaire démarrait. Une nouvelle journée dans un enchaînement de journées semblables qui la précédaient et la suivraient. Dans une heure ou deux, Abigail rentrerait à la maison, les devoirs encore à faire, avide de beurre de cacahuète étalé sur une demi-pomme, et Mona l’attendrait.
Mais il lui fallait d’abord se délester de cette chose, et elle connaissait la poubelle idoine.
Elle était située derrière le supermarché.
Un jour, elle y avait jeté le téléphone portable de son ex-mari, glissé dans une chaussette de sport.
Une autre fois, elle y avait jeté le portefeuille de la maîtresse (devenue l’épouse) de son ex-mari après l’avoir extirpé de son sac à main déposé dans une chambre faisant office de vestiaire lors d’une soirée – à l’époque où l’existence de cette maîtresse n’était encore qu’un soupçon.
Avant de le jeter, Mona fit le ménage dans les cartes de visite, les permis, les cartes de crédit et d’adhérent plastifiées – là, dans l’intimité que lui offrait la puanteur charnelle à l’arrière du supermarché – et les balança une par une au milieu des melons pourris et des bagels moisis.
Mais cette fois elle ne descendit même pas de voiture. Elle tendit la main par la vitre baissée et jeta le petit cœur enveloppé de soie dans la benne comme on met une lettre à la boîte, ralentissant à peine, et rentra chez elle.
Plus tard, Abigail appela à la maison depuis son portable pour savoir si elle pouvait rester faire ses devoirs chez Kate jusqu’à l’heure du dîner.
« Non », rétorqua Mona.
Sur le coup, Abigail gloussa. Elle dut croire que Mona plaisantait. Mais quand Mona réitéra son refus, Abigail demanda, sans avoir l’air particulièrement en colère ou surprise : « Mais pourquoi, maman ? »
Que pouvait répondre Mona ? Elle s’efforça d’adopter le ton de ce qu’elle imaginait être celui d’une figure d’autorité – ferme, sans émotion, paternelle – « Parce que je veux que tu rentres à la maison. »
Quand Abigail passa la porte, Mona la trouva pâle. D’habitude, elle jetait son sac à dos dans l’entrée avant d’enlever ses chaussures, mais cet après-midi-là, elle le garda sur le dos, s’immobilisa sur la moquette du vestibule et puis, regardant autour d’elle, elle lança : « Maman ? »
Mona garda les bras croisés sur la poitrine pour dissimuler ses tremblements et dit : « J’ai découvert quelque chose. Quelque chose…
– Maman ? dit Abigail les yeux écarquillés par l’affolement. Maman. Qu’est-ce que tu as fait. Qu’est-ce que tu en as fait ?
– Je m’en suis débarrassé, Abigail. Abigail, qu’est-ce que c’était ? »
Mais sa fille ne répondit pas. Elle ouvrait la bouche à intervalles réguliers, haletait par le nez, tout son corps comme secoué par une force inconnue, puis elle poussa une sorte de hurlement prénatal, à la fois hystérique et étouffé, quelque chose semblait s’agiter à l’intérieur de son torse, puis elle laissa tomber son sac à dos derrière elle d’un mouvement d’épaules, et sans enlever ses chaussures, elle se précipita vers les escaliers en lâchant de petits braillements désespérés et gravit les marches deux à deux, faillit tomber à plusieurs reprises mais s’obstina à avancer, et Mona en fut clouée sur place, plongée dans sa propre horreur, incapable de bouger, écoutant sa fille qui tombait à genoux dans sa chambre à l’étage, retirait violemment le tiroir de sa commode et frappait le parquet, écoutant le vagissement animal et terrible de sa fille et ses cris sans fin.
MELODY
Les lampadaires étaient allumés en pleine journée et les lignes téléphoniques bourdonnaient. Qu’est-ce que c’était que ça, bon sang – une surtension, un orage magnétique, un genre de surcharge cosmique ? Il était deux heures de l’après-midi, un ciel aussi limpide que du gin, aussi blême que la mort, entre trente-cinq et quarante degrés facile, pas un poil d’humidité dans l’air, et ces satanés lampadaires qui brillaient et les lignes téléphoniques qui bourdonnaient.
Tony Harmon s’était garé à deux rues de la maison dans l’espoir que le petit trajet à pied jusqu’à sa porte d’entrée lui permettrait de se débarrasser de sa nervosité – mais la marche était sans effet. Il grinçait des dents, réalisa-t-il, ce que son dentiste lui avait déconseillé de faire. Il porta une main à sa mâchoire pour s’obliger à arrêter.
En dehors du bourdonnement des câbles téléphoniques, un silence mortel régnait sur le voisinage. Même le chien jappeur attaché au tronc blanc d’un bouleau dans l’un des jardins se tenait totalement immobile – collet monté, muet comme une carpe, seuls ses petits yeux humides bougeant au-dessus de sa gueule à moustaches blanches. Une sorte d’accessoire en forme de chien. Un leurre en forme de chien. Alors qu’il avait déjà remonté la moitié de la rue, Tony crut l’entendre lancer un petit aboiement aigu dans son dos, mais quand il se retourna, il vit que le chien était toujours au même endroit, affichant exactement le même air, le fixant toujours du regard, mais sans avoir l’air capable d’émettre le moindre son. Il transféra le poids des cadeaux d’anniversaire sur son autre bras.
C’était l’un des avantages de vivre à Pétaouchnoc, USA – un lieu où personne ne connaissait personne ni ne voulait connaître personne. Il n’y avait donc personne pour le stopper, l’interpeller : « Tony ! Comment ça va la vie, mon vieux ? ». Il vivait au milieu de ces gens depuis des années, mais ces derniers ne le connaissaient toujours ni d’Ève ni d’Adam. Pas de véranda à l’avant des maisons, ce qui facilitait les choses. Personne ne serait assis sur sa véranda à se demander qui était l’homme qui marchait dans la rue chargé de paquets emballés dans du papier cadeau Barbie. Tiens, tiens, est-ce que ça ne serait pas Tony Harmon qui se rend chez lui à pied ; alors ça ! qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Mais personne ne se poserait la question.
Ici, pas besoin de rappeler aux gens de s’occuper de leurs affaires. On pouvait bien agoniser sur sa pelouse, ils étaient du genre à tirer poliment les rideaux pour ne pas nous offusquer en remarquant quoi que ce soit. C’était le genre de banlieue où, tous les dix ans environ, se produisait quelque chose d’abominable. Découverte d’un réseau pédophile. D’un cadavre dans une bâche, abandonné au bout de l’allée en attendant le passage des éboueurs. Et quand la presse, la télévision ou la police interrogeait les voisins, ceux-ci disaient : « Je n’ai jamais rien remarqué d’inhabituel. Ils avaient l’air de gens très bien. »
Mais est-ce que vous leur avez déjà parlé ?
Non.
Un état de fait qui rassura Tony au moment de traverser le croisement de Periwinkle et Martin, là où se trouvait le petit parc du quartier – presque toujours désert à moins qu’un père, comme lui-même, pousse sa gamine, comme lui avec la sienne, sur la balançoire pour le quart d’heure obligatoire du dimanche après-midi. Ou à moins que des adolescents viennent s’avachir bêtement sur les bascules.
Mais il n’était jamais pris d’assaut. Les badauds s’en allaient s’ils voyaient quelqu’un arriver.
À vrai dire, ça n’avait de parc que le nom. À peine cinq cents kilos de sable jetés entre deux bancs – des bancs sur lesquels étaient vissées de petites plaques en cuivre portant le nom de morts, payées par des familles pour qu’on se souvienne d’eux. Sur l’une de ces plaques, quelqu’un avait gravé le mot PUTAIN avec une clé ou un canif. Et CONNARD sur une autre, si sa mémoire ne le trahissait pas.
Mais cet après-midi-là les balançoires ne bougeaient pas d’un millimètre dans la chaleur étouffante, si simples et figées que Tony en eut le souffle coupé rien qu’à les voir, comme un coup de poing au ventre – il se plia en deux, les cadeaux tombèrent sur le trottoir à ses pieds dans un bruit creux et ridicule.
Il n’arrivait pas à respirer. Bon sang. Il n’arrivait pas à respirer.
Il n’arrivait pas à respirer.
Pourtant, il avait la bouche ouverte, il en était sûr parce qu’un filet de bave avait dégouliné sur le ciment entre ses chaussures (ses chaussures de ville rutilantes, nom de Dieu, pourquoi est-ce qu’il n’avait pas mis des baskets, plutôt ? Il allait à l’anniversaire de sa gamine, nom d’un chien, il lui faudrait peut-être cavaler après un ballon dans le jardin), et il essaya de se calmer.
Tout va bien. Tout va bien. C’est juste ce foutu parc.
La balançoire, il n’avait pas vu la balançoire depuis sept semaines. Bien sûr. C’était la balançoire. Tout allait bien.
Il respirait de nouveau, avalait le fluide inconnu qui lui avait noyé les poumons et le visage. Il passa le creux de son coude sur ses yeux et secoua la tête dans l’odeur de Javel de sa manche blanche.
Inspiration profonde. Expiration lente. On se calme. Il n’était qu’un homme ayant fait tomber quelques paquets au coin d’une rue. À peine quelques petites boîtes. L’une d’elles, peut-être celle de Barbie Reine du Bal, était cabossée sur le côté, mais ces boîtes ne contenaient rien de fragile, rien qui ne puisse supporter un petit choc. Rien de catastrophique là-dedans. Rien qui ne ressemble, aux yeux d’un éventuel témoin, à un simple faux pas. Les trottoirs étaient fissurés de partout. Peut-être s’était-il pris le bout de la chaussure dans une lézarde et avait fait tomber les cadeaux d’anniversaire. Peut-être était-il un oncle de passage en provenance d’une autre ville. Peut-être s’était-il garé loin pour faire une surprise à la petite qui fêtait son anniversaire (C’est moi, je suis rentré de mon déplacement professionnel !). Ou peut-être avait-il un problème de voiture ou voulait-il laisser des places pour les autres invités à la fête. Quoi qu’il en soit, il n’était qu’un homme ayant fait tomber des paquets et qui se penchait à présent pour les ramasser.
Tout allait bien. Rien que du très banal.
Et de toute façon, c’était quoi, le banal ?
Tout était banal.
La séparation était banale, aucun doute là-dessus, tout comme le divorce. Il y avait des situations domestiques beaucoup plus étranges que celle-ci et qu’on qualifiait aussi de banales. En toquant à n’importe quelle porte de n’importe quelle banlieue dans le genre de celle où il se trouvait, il tomberait sûrement sur des histoires comme celle-ci, ou bien pire encore. On lui avait raconté une blague il n’y avait pas si longtemps :
Un couple âgé entre dans le bureau d’un avocat. Ils lui expliquent qu’ils sont mariés depuis soixante-dix ans et qu’ils veulent divorcer. L’avocat prend des notes pour lancer la procédure, puis lève la tête et dit : « Je peux vous poser une question ? Pourquoi vouloir divorcer après soixante-dix ans de mariage, pourquoi maintenant ? » À quoi ils répondent : « On voulait attendre que les enfants soient morts. »
Elle était bonne, pas de doute. Les gens se mariaient, divorçaient. Ils faisaient tout une histoire de leur mariage. Des kilomètres de satin blanc, de la mauvaise musique, toute la pompe religieuse, le riz sur les marches du temple. Les conserves accrochées au pare-chocs de la voiture. Des milliers de dollars à boire et à manger. Tout une clique de vieux amis en smoking et de demoiselles d’honneur affublées de meringues en dentelle. Des montagnes de cadeaux. De grandes et belles promesses scellées par un galimatias et des mains qui s’agitent, l’invocation de Dieu, des quatre vents et de l’esprit des ancêtres – et puis un jour, l’un d’eux vous dit : « Bon, il serait peut-être temps de passer à autre chose. »
Passer à autre chose !
Est-ce que le pasteur ayant marié le couple en question est censé enfourcher son balai de sorcière et revenir pour gérer ça aussi – la cérémonie où on passe à autre chose ? Ne devrait-il pas y avoir une espèce de rituel avec marche interminable sur charbons ardents sous le regard des anciens invités au mariage, invités qui pleureraient et lanceraient des pierres sur le dos dénudé des divorcés. Rituel suivi du traditionnel Bûcher des Cadeaux. Tout le monde réuni pour voir le grille-pain et le mixeur exploser. Après quoi, il y aurait la noyade sacrificielle d’une demoiselle d’honneur, celle qui a attrapé le satané bouquet, pourquoi pas ?
Le conseiller conjugal qu’ils avaient vu durant les premières semaines de la séparation, celui que Tony Harmon avait lui-même choisi dans la liste que Melody avait compilée, mais qu’il reniait à présent (à l’époque, il s’était imaginé qu’un homme serait de son côté), ce conseiller avait dit de cette voix implorante du thérapeute : « J’ai l’impression qu’avec les années, vous avez beaucoup changé, que peut-être vous avez emprunté des chemins différents, et…
– Alors quoi, putain, on divorce et c’est tout ? » s’était emporté Tony.
Il avait aussitôt regretté. Sa femme se plaignait notamment qu’il jure beaucoup. Le thérapeute avait inspiré et expiré si lentement et longuement que son souffle avait soulevé les feuilles du bloc-notes sur ses genoux.
« Une séparation, avait-il dit. En général, eh bien, je ne donne pas de conseil aussi spécifique, mais cela fait trois semaines que je vous écoute, et je pense que… »