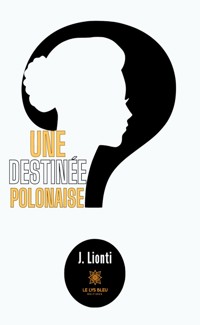
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Durant un conflit européen, une jeune Polonaise de confession juive immigre en France. Aidée par le consul français en Pologne, elle change son nom afin de mieux s’intégrer. Elle est employée par un couple de Français et tombe enceinte. Malheureusement, son bébé sera déclaré mort-né à la naissance. Plus tard, elle découvre une effroyable vérité qui changera le cours de son existence.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Pour
J. Lionti, l'écriture va bien au-delà d'un simple moyen d'expression ou de divertissement ; c'est un acte de libération. Plongez dans son univers littéraire avec "Une destinée polonaise".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 229
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
J. Lionti
Une destinée polonaise
Roman
© Lys Bleu Éditions – J. Lionti
ISBN : 979-10-422-2604-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Chapitre I
Jan Caroncowski travaillait comme jardinier dans une immense propriété appartenant au consulat de France, située à Dantzig, l’actuelle Gdansk, en Pologne. Les arbres de toutes espèces ombrageaient des allées finement ratissées. Une roseraie parfumait le jardin aux pelouses tondues avec soin. Des fleurs coloraient les espaces verts. On y respirait la mousse, les feuilles. Les oiseaux s’en donnaient à cœur joie tant ils se trouvaient à l’abri des chasseurs et des braconniers. Ce consulat avait un air d’ambassade au point que certains pouvaient s’y méprendre.
Jan était né en 1878, l’année même où Dantzig était intronisée capitale de la province de Prusse-Occidentale.
Ô combien complexe est l’histoire de cette cité, quelquefois ville libre, mais bien des fois, ballotée au gré des Empires. Du temps où elle fut polonaise – ce qui lui arriva parfois –, la ville entretint les meilleures relations avec la France. Les Polonais n’oubliaient pas que ce fut un officier de Napoléon, le général Lefebvre, futur duc de Dantzig, qui reçut la capitulation des Prussiens. En roué stratège, l’empereur français saisit l’occasion pour créer le duché de Varsovie, marquant ainsi une renaissance de l’État polonais. Mais plus souvent qu’à son tour, le pays connut le triste sort des nations écartelées entre plusieurs Empires : prussien, russe, austro-hongrois… Et dans cette histoire conflictuelle, Dantzig restera un point de litige profond entre Allemands et Polonais. Quant aux Français, il leur fut donner de vibrer avec ferveur pour la Pologne. En retour, cette dernière rechercha la reconnaissance de la patrie des Droits de l’Homme. Il y eut – et il y aura encore –, des moments moins heureux, d’incompréhension, de désillusions, voire un sentiment de trahison…
Mais revenons à notre modeste jardinier.
En 1900, Jan épousa Irina, cuisinière auprès de Madame et Monsieur le Consul. Les jeunes mariés étaient de confession juive ashkénaze. Mais ils ne pratiquaient pas et étaient assimilés au point de n’être plus que des Polonais d’origine juive.
Les époux Caroncowski occupaient un logement au sein même de la représentation diplomatique française. C’était un hôtel particulier coquet et confortable. Les meubles avaient été minutieusement choisis par Mathilde Ambroise, la femme du Consul.
Le couple Caroncowski se sentait heureux. Une ombre toutefois entachait leur bonheur : il ne parvenait toujours pas à avoir d’enfant. Les médecins, qui avaient examiné la jeune femme, se montraient unanimes et catégoriques. Sans une once de compassion, tous avaient prononcé le même diagnostic, aussi tranchant que le couperet d’une guillotine :
— Madame, jamais vous n’aurez d’enfant.
À en croire les docteurs, il n’y avait donc aucun espoir de maternité pour Irina. Et il va sans dire qu’à cette époque, il n’existait aucun recours médical tel que la fécondation in vitro ou le don d’ovocytes.
Pourtant, et malgré les années qui défilaient, Irina ressentait toujours ce désir ardent d’enfanter. Elle ne se sentirait pleinement femme que le jour où elle aurait mis un enfant au monde.
Un jour, devant ses fourneaux, elle fut prise de malaises. Le visage en sueur, les mains tremblantes, elle se retenait au dossier d’une chaise pour ne pas tomber. De ses lèvres exsangues s’échappaient des gémissements sourds. Soudain, son corps la lâcha. Elle s’écroula sur les dalles de la cuisine sans connaissance. Madame Ambroise, alertée par les domestiques, fit aussitôt prévenir le médecin attaché au consulat. Celui-ci accourut, sa sacoche à la main.
Après avoir palpé le pouls de la jeune femme, il demanda qu’on lui apporte des linges mouillés dont il se servit pour lui recouvrir le front. Irina sortit enfin de son évanouissement. Bien qu’il ne fût nullement inquiet, l’homme de santé jugea préférable de l’envoyer à l’hôpital. Il l’accompagna dans une ambulance tirée par un maigre cheval.
Après une journée d’observations et d’examens, le médecin put livrer son diagnostic à Irina et à Jan, qui entre temps avait rejoint son épouse :
Jan prit sa femme dans les bras. Il la serra très fort. Ils fondirent en larmes, serrés l’un contre l’autre. L’espoir ressuscitait. Dans le creux de son oreille, il lui glissa :
De retour au consulat, Jan était si heureux qu’il s’enhardit à demander à Monsieur le Consul la permission d’organiser une petite fête pour le retour de sa femme, fête à laquelle il comptait bien inviter tout le personnel, ainsi que Monsieur et Madame naturellement. Alors que le diplomate s’apprêtait à décliner l’invitation, du moins pour lui-même, il sentit une forte pression à hauteur de son avant-bras. C’était sa femme qui, pressentant la réponse de son mari, lui signifiait de ses doigts de n’en rien faire. C’était là, certes, une manière fort peu diplomatique et néanmoins efficace, puisque monsieur le Consul se ravisa et déclara :
Le futur père courut annoncer la bonne nouvelle à tout le personnel. Il se rendit auprès de Marta, une des cuisinières qui secondait sa femme, pour lui demander de bien vouloir organiser un grand apéritif en précisant que Monsieur et Madame seraient présents. Marta, en femme simple et joviale, lui donna l’accolade. Elle se réjouissait pour eux, sachant qu’Irina retrouverait sa bonne humeur d’antan, elle qui désirait tant être mère !
Huit jours plus tard, Jan allait chercher Irina à l’hôpital, cette fois avec une voiture de service conduite par le chauffeur du consulat, car Jan ne se déplaçait qu’à vélo. De plus, Irina devait se reposer. Le médecin avait conseillé de fréquents et longs repos, si elle ne voulait pas perdre son bébé.
Au chevet d’Irina, Mathilde Ambroise fut la première à féliciter la future maman. Au fil de la conversation, les barrières sociales qui séparaient les deux femmes d’origines et de conditions si différentes s’estompèrent, au point que l’épouse du Consul s’abandonna à la confidence :
Devant le regard interrogateur de la jeune mère, elle poursuivit :
Ces mots attristèrent sincèrement Irina, qui ressentait depuis longtemps une grande affection pour Madame. Elle voulut la réconforter :
En temps ordinaires, Madame Ambroise, qui désirait la paix autour d’elle, prêtait déjà une grande attention à tous ses domestiques. Donc elle veillerait tout particulièrement à ce que la grossesse d’Irina se déroulât au mieux. Elle avait trouvé une solution de remplacement pour la cuisine.
De son côté, Jan, malgré la somme de travail que réclamait l’entretien du domaine, essayait de soulager le plus possible sa femme en accomplissant les travaux ménagers indispensables.
Il avait été décidé que le bébé naîtrait dans le lit familial. Les hôpitaux d’alors n’inspiraient pas confiance à ces femmes qui, de génération en génération, enfantaient dans la chambre conjugale.
Enfin, l’accouchement arriva. Ce fut un matin de 1912.
La voiture étant indisponible – monsieur le Consul était en déplacement –, c’est en charrette que Jan partit chercher la sage-femme. Au milieu de la sarabande de bassines d’eau chaude, de serviettes humides, une petite fille très chevelue et menue, vint au monde. Madame Ambroise, qui avait tenu à assister à l’accouchement, aida à envelopper le nouveau-né dans des langes bien serrés pour le protéger du froid. Emmaillotées dès la naissance, ses jambes seront très droites ainsi que l’esprit de la fillette, croyait-on, à cette époque. Elle fut présentée au père qui attendait derrière la porte de la chambre. Les parents depuis longtemps avaient choisi le prénom : ce serait Maria.
Jan, reconnaissant envers sa femme, les mains jointes, pria Yahvé pour le remercier de l’immense joie que leur procurait cette naissance, lui qui, jusqu’alors, n’avait pas cru en quoi que ce soit.
Après qu’Irina fut relevée de ses couches, il y eut une nouvelle fête mémorable. On sortit des armoires du consulat, la vaisselle blanche, les verres en cristal de Bohème et même de l’argenterie. Des nappes brodées et repassées recouvrirent les tables installées sous l’immense tonnelle. Jan et Irina montrèrent le bébé en robe et bonnet de dentelles mousseuses. Ils étaient comblés. Tout le personnel trinqua à la santé de la petite Maria. Monsieur et Madame lui souhaitèrent longue vie.
Le jeune couple était aux petits soins avec le bébé. Elle était leur orgueil. Irina adorait sa poupée. Elle installait le berceau en bois dans un coin de la cuisine. Elle pouvait ainsi veiller sur elle pendant qu’elle faisait rôtir à point les volailles et cuire des pâtés délicieux. Jan était aussi fier de Maria que de ses fleurs, de ses parterres colorés, de ses allées bien alignées. Chacun appréciait son travail de jardinier.
Le jardin du consulat était admiré de tous. On photographiait les charmilles couvertes de roses, le kiosque à musique orné de lierre exubérant. On y organisait des séances de portraits. Ces dames en robes et ombrelles posaient aux côtés de leurs époux, de leurs enfants et de leurs chiens de race. Monsieur le Consul et Madame, en robe de soie blanche à la mode de l’époque, n’avait pas manqué de se faire tirer le portrait. Un observateur attentif aurait décelé un peu de tristesse sur leur visage, car seul le chien était assis à leurs pieds.
Chapitre II
La petite Maria avait maintenant trois ans.
L’Europe, désormais embourbée dans la Première Guerre mondiale, était à feu et à sang. Les trois puissances d’Europe centrale – le royaume de Prusse, la Russie tsariste et l’empire austro-hongrois – s’étant accaparé leur part de territoire polonais, les populations civiles en furent les premières victimes. C’est ainsi que des Polonais furent contraints d’incorporer l’armée allemande ou autrichienne quand d’autres furent enrôlés dans celle de Russie. Si bien que des batailles allaient opposer des Polonais dans des combats fratricides. Des citoyens des pays belligérants, qui jusque-là avaient vécu paisiblement, devinrent, du jour au lendemain, des ennemis, ce qui provoqua des déplacements forcés et massifs de population. En raison de sa mauvaise vue, Jan Caroncowski échappa à la mobilisation.
La France étant alliée à la Russie et de ce fait en guerre avec l’Allemagne, les citoyens français présents à Dantzig durent quitter la ville. Le consulat de France fut précipitamment évacué. Monsieur Ambroise n’eut pas d’autre solution que de confier les clés de la représentation française au couple Caroncowski. Le simple jardinier et la modeste cuisinière avaient pleinement conscience de l’immense honneur que la France, à travers la personne de son Consul, leur faisait. Ils n’ignoraient pas que ce vénérable consulat avait été fondé trois siècles plus tôt, par le roi de France Henri IV. Ils promirent de s’occuper de la demeure comme ils le feraient pour leur propre maison.
Durant toute la guerre, l’ancien consulat serait un cocon à l’abri de la fureur du monde et de la folie des hommes. Petit bout de chou, aux adorables fossettes, Maria serait l’étoile lumineuse au sein du foyer.
Chapitre III
Il ne fallut pas moins de quatre interminables années pour mettre un terme à ce carnage aux allures de suicide collectif.
Si la Pologne en tant que telle n’avait pas été partie prenante du conflit, pour la simple raison qu’elle n’existait pas comme État au moment de la déclaration de la guerre, cela n’avait pas empêché son territoire d’être le théâtre de dévastatrices batailles militaires, ni sa population, incorporée dans les armées de ses différents occupants, de subir de lourdes pertes.
En 1917, après l’effondrement de l’empire tsariste, les Polonais pro-russes rejoignirent le camp allié. En France même, une brigade de soldats polonais fut constituée qui combattit au sein de l’armée française sous le nom d’Armée bleue.
Le jour de l’Armistice, le 11 novembre 1918, la Pologne retrouva son indépendance. Quelques mois plus tard, la création de la deuxième République de Pologne fut entérinée par le traité de Versailles. Au cours des négociations, le président américain Woodrow Wilson, fervent avocat de la Pologne, exigea que le pays eût un accès à la mer. Pour cela, on créa spécialement « le corridor de Dantzig », débouchant sur la mer Baltique. Celui-ci séparait l’Allemagne en deux. Quant à la ville de Dantzig elle-même, dont la population était pourtant majoritairement allemande, elle fut retirée à l’Allemagne sans pour autant devenir totalement polonaise. Déclarée ville libre, elle fut placée sous la protection de la jeune Société des Nations (SDN).
Dès 1919, le Consul Ambroise put reprendre ses fonctions à Dantzig. Il fut le premier étonné de pénétrer dans un consulat qui n’avait pour ainsi dire pas changé. C’était comme si le temps s’était figé. Il remercia chaleureusement le couple Caroncowski d’avoir ainsi veillé sur la demeure.
Le Consul fut rapidement rejoint par son épouse. Madame Ambroise fut émue de revoir le jeune couple et plus encore la petite Maria. En serrant l’enfant dans ses bras, elle ne put retenir une larme. Elle avait quitté un bébé, elle retrouvait une petite fille. Si Maria ne gardait aucun souvenir de ces inconnus, elle avait néanmoins été élevée par ses parents et au travers de quelques photos, dans le souvenir du couple Ambroise.
En remerciement des services rendus à la France, le Consul proposa au couple Caroncowski d’assumer les frais de scolarité de leur enfant, en l’envoyant à l’école française. Rattaché au consulat, l’établissement était indépendant du système éducatif de la ville. Les parents accueillirent la proposition avec joie et fierté. Même si cela se faisait au détriment de l’allemand, leur fille apprendrait la langue de Molière. La culture française jouissait alors d’une grande réputation parmi la population polonaise.
Le premier jour d’école, ce fut Irina qui accompagna sa fille jusqu’au portail de l’école. Ensuite, Maria emprunterait le véhicule qui assurait le transport de tous les enfants du personnel et que conduisait le chauffeur Aleksander.
Le père de Maria n’entendait pas confier à la seule école française l’instruction de sa fille. Il se voulait partie prenante de son éducation. À la moindre occasion, il l’emmenait avec lui dans ses travaux de jardinier. Ainsi il lui apprenait le monde des fleurs, la germination, la pollinisation, les mariages possibles à l’aide de greffes et de marcottage pour obtenir des espèces hybrides, éclatantes de couleurs inédites. Il l’invitait à apprécier les arômes, à comparer des senteurs différentes. La beauté des parterres l’incitait à philosopher :
— Tu vois, Maria, ces parfums, ces formes élégantes, la vie simple, mais aussi complexe des plantes, te donnent à voir une autre facette des choses. Lorsque des pensées te tortureront l’esprit, observe-les. Tu prendras des décisions claires, naturelles et sensées.
Maria n’était pas en âge de comprendre toutes ces explications, mais elle était toujours sous le charme quand son père lui expliquait la nature. Certes, elle savait qu’il lisait toujours les notices avant de faire la leçon de choses. La philosophie de ce modeste jardinier qui avait très peu fréquenté l’école l’enchantait. Elle portait une grande admiration à ce père aimant.
Maria adorait l’école. Un monde inconnu s’ouvrait à elle. Elle avait soif d’apprendre. Pour cela, elle avait la chance de pouvoir se procurer des ouvrages auprès de madame Ambroise qui, discrètement, suivait l’éducation de l’enfant. La bibliothèque du consulat était riche de volumes d’histoire, de géographie, mais aussi de romans. Maria restait rêveuse lorsque, le récit terminé, elle refermait le volume.
Au bout de la quatrième année de scolarité de leur fille, les parents reçurent une convocation du directeur de l’école. Inquiets, ils sollicitèrent les services d’Aleksander pour se rendre au plus vite dans l’établissement scolaire.
Le directeur les invita à s’asseoir en face de lui. Timidement, Jan et Maria obéirent. Lui ajusta le col de sa veste en toile grossière, elle tira sur sa jupe pour dissimuler ses chaussures usées. Le directeur fut le premier à parler. D’emblée, il tint à rassurer des parents dont il avait perçu l’anxiété :
Et pourtant, comme vous le savez, notre établissement détient le niveau le plus élevé du pays.
Jan et Irina restèrent sans voix. Ils ne s’attendaient pas à tant de compliments. Stupéfaits, ils ne comprenaient pas la raison de cette convocation ni les intentions de l’homme qui se tenait de l’autre côté du bureau. Le directeur en vint à l’avenir éducatif de l’enfant :
Et dans un éclat de rire, il ajouta :
Jan et Irina se tournèrent l’un vers l’autre. Ils s’interrogeaient du regard. Jan hésitait. Ce n’était pas clair dans son esprit. Il craignait surtout de ne pas avoir bien compris les paroles du directeur. Et il avait trop de respect envers cet homme de culture pour oser lui faire répéter ses explications. N’allait-il pas nuire à sa fille en acceptant la proposition ? Il n’était pas très convaincu, il se sentait dépassé par la situation, et pourtant, après un dernier regard interrogatif en direction de sa femme, il s’entendit répondre :
Toujours dans la crainte, monsieur et madame Caroncowski prirent congé sur une poignée de main hésitante.
Chapitre IV
Monsieur et Madame Ambroise, mis dans la confidence, rassurèrent les parents. Ils étaient ravis que Maria puisse bénéficier d’études appropriées à ses qualités intellectuelles. Emporté dans son élan, le Consul se laissa aller à quelques considérations sur l’avenir :
— Nous mettons beaucoup d’espoir dans cette jeunesse intelligente, qui gravira les échelons et sera apte à diriger plus tard le pays, même si elle n’est pas issue de la classe des élites.
À seize ans, Maria était devenue une belle adolescente, au caractère certain. Bientôt, ses résultats, toujours aussi brillants, lui permettraient d’intégrer l’une des hautes écoles, qui était appelée gymnases supérieurs.
Maria restait toujours aussi proche de son père. Dès qu’elle le pouvait, elle le rejoignait au milieu de ses fleurs, de ses plantations. Elle-même n’hésitait pas à sarcler, à bêcher… Elle prenait plaisir à plonger ses doigts dans la terre. Les semis, les repiquages, les boutures n’avaient plus de secrets pour elle.
Bien que son caractère la portât à l’étude et la solitude, elle maintenait quelques liens avec les enfants du personnel consulaire qui avaient grandi avec elle. Mais une différence s’était malgré tout installée en raison de la précoce maturité de l’adolescente.
Cependant, elle entretenait une amitié particulière pour un garçon, Igor, de deux ans son aîné. Elle aimait ses yeux comme des lacs tranquilles dans lesquels il ferait bon plonger. Elle le trouvait à part. Silencieux, ceint d’une auréole de mystère, il l’intriguait. Elle le sentait attentif aux détails de son environnement. C’est qu’Igor était un observateur pénétrant de la nature, et il lui en montrait les originalités. Parfois, elle surprenait son regard qui la détaillait des pieds à la tête. Sans bien comprendre, elle ressentait un trouble, elle qui, par ailleurs, se moquait intérieurement des autres filles qui se pinçaient les joues pour avoir des pommettes roses, ou encore qui fixaient une mèche rebelle en se regardant dans une vitre… Tout cela pour aguicher les garçons. Ces frivolités l’agaçaient, et Igor, au-delà de ses yeux, ne l’intéressait pas plus que cela.
Diplômée de fin d’études secondaires avec mention spéciale, Maria était à l’aise avec toutes les matières, en littérature comme en sciences. Elle ne pratiquait pas moins de trois langues différentes, le polonais, le français et l’allemand. Ses parents étaient admiratifs. Ils voyaient leur fille devenir « savante », alors que, pour leur part, ils n’avaient mené aucune étude. À peine déchiffraient-ils les journaux de Dantzig. Très jeunes, ils avaient dû aider leurs parents aux champs, nourrir les animaux de la ferme, assurer les corvées d’eau et de nettoyages… Ils n’avaient pas eu de temps à perdre à fréquenter l’école.
Monsieur et madame Caroncowski s’inquiétaient de plus en plus de savoir quel serait l’avenir professionnel de Maria. Serait-elle employée au secrétariat du consulat ? Puisque sa fille adorait les plantes, son père espérait secrètement qu’elle lui succéderait à la tête des jardins. Mais ne pouvait-elle prétendre à des métiers plus ambitieux comme enseignante ? Le pays en avait besoin. Pour mettre un terme à ce qui devenait un sujet grandissant d’anxiété, le père interrogea sa fille :
Jan ne laissa pas sa fille terminer sa phrase :
Maria baissa la tête, et retint ses larmes. Elle acquiesça d’un mouvement de tête avant de s’enfuir hors de la pièce. En fille raisonnable, elle se consola en mesurant ce qui restait tout de même sa chance : elle allait poursuivre des études quand ses camarades s’échinaient déjà dans les champs depuis longtemps. Cela pour un maigre salaire.
Grâce aux relations du Consul, Maria put s’inscrire à l’université de médecine de Dantzig, le futur Collegium Medicum.
Chapitre V
Ce matin-là, Jan se réveilla avec une forte fièvre. Des maux de tête intenses lui donnaient l’envie d’aller se fracasser le front contre les murs. Mais il se sentait tellement épuisé qu’il en était bien incapable. Il se tenait prostré dans le lit. Il n’avait ni l’envie ni la force de se rendre à ses travaux du jardin. Sa femme, qui avait pour habitude de se lever bien avant lui, ne s’était rendu compte de rien. Pourtant, à l’endroit où il dormait, le matelas de crin était trempé de sueur. Ce n’est qu’en fin de matinée qu’Irina comprit l’état de santé de son mari. Jan refusa obstinément de voir un médecin, affirmant que cela lui passerait.
Mais il n’en fut rien. Au contraire, son état empira. Au bout de plusieurs jours, d’inquiétantes petites macules de couleur rose pâle apparurent sur le torse. Cette fois, il n’y avait plus à tergiverser, il fallait consulter.
Après une auscultation pourtant scrupuleuse, le médecin avoua sa perplexité. Il reconnaissait ne pas identifier les symptômes. Il décida de diriger immédiatement le patient vers l’hôpital. Une fois de plus, Aleksander, le chauffeur de monsieur le Consul, fut mis à contribution. Il conduisit Jan à bord de la voiture de service.
Dans le hall de l’hôpital, Aleksander patientait, stoïque, sur une chaise, personne ne lui ayant donné de consigne quant à la conduite à tenir une fois le jardinier déposé. Devait-il repartir sur le champ ou attendre ? Ce soir-là, Jan ne put rentrer chez lui.
Monsieur Caroncowski resta plusieurs jours à l’hôpital, dans une chambre blafarde, allongé sur un lit de fer. La fenêtre était grillagée, le soleil entrait timidement à travers le maillage métallique. Sur la table de chevet trônaient une carafe d’eau et un verre vide. Peu nourri ces derniers jours, ses joues s’étaient creusées et ses côtes commençaient à saillir.
Le médecin, qui l’avait pris en charge dès son admission, avait jugé préférable d’éviter un passage par la salle commune, de crainte qu’une épidémie ne se répandît parmi les autres malades. Plusieurs membres du corps médical – des médecins, des spécialistes, des internes – vinrent à son chevet, pour l’examiner, pour le palper, le questionner… On procéda à des prélèvements de toutes sortes, que l’on analysa. On alla jusqu’à pratiquer des saignées… Mais rien n’y fit. Monsieur Caroncowski demeurait un cas, et le mal dont il souffrait, une énigme. Tant et si bien qu’il fut renvoyé à son domicile sans être davantage fixé sur sa maladie qu’il ne l’était à son admission.
Les macules ne cessèrent de progresser, au point de devenir envahissantes. Le jardinier se sentait de plus en plus abattu. Il fit de nombreux allers et retours entre l’établissement hospitalier et son domicile.
Durant le trajet en voiture, par la vitre, Jan regardait défiler des arbres secoués par le vent. Le ciel monotone, à l’unisson de la situation, n’était en rien un réconfort, il ne donnait pas envie de se réjouir.
Au volant, Aleksander s’inquiétait pour le jardinier, et, sans oser se l’avouer, pour lui-même. Son collègue n’était-il pas contagieux ? Et cependant, ses craintes se dissipaient quand il prenait de multiples précautions pour aider le malade à monter ou à descendre du véhicule. Il oubliait ses peurs quand il le soutenait pour gravir les marches qui menaient dans le hall de l’hôpital. Ces trajets renforcèrent leurs liens jusque-là distendus, au point qu’ils en vinrent à s’apprécier l’un l’autre. Jan était reconnaissant à Aleksander pour son aide et celui-ci était admiratif devant le courage dont il faisait preuve face à l’adversité. Le chauffeur était à l’écoute du jardinier plein de savoir, qui était passé d’une vie active à une vie de « légume ». Il n’était plus question de s’arrêter dans un estaminet pour boire un verre de vodka.
Maria était très accaparée par ses études à l’université. Elle avait toujours un livre et un crayon dans la main. Elle s’enfermait dans ce qu’elle appelait son bureau, mais qui n’était qu’un sombre cagibi. Elle ne se rendait plus, comme elle en avait l’habitude, il y avait peu encore, dans les allées sableuses du jardin pour y retrouver son père. Elle prenait ses repas du soir à n’importe quelle heure, restait debout pour grignoter, ignorait la table familiale… Si bien qu’elle ne se rendait pas vraiment compte de la dégradation de l’état de santé de son père. Mais peut-être préférait-elle se voiler la face, car la vérité était trop dure à entendre et à voir…
Sa mère ne l’aidait pas beaucoup à affronter le réel, elle qui faisait diversion chaque fois que, par hasard, la conversation dérivait sur son père. Pour madame





























