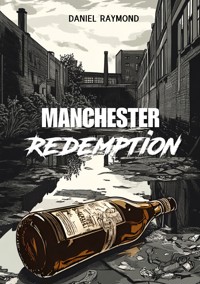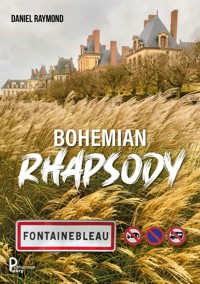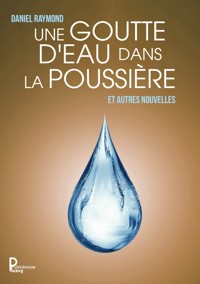
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Né américain, j’ai été séduit par la France. J’aime avec excès, sans retenue, avec passion. Je tente de faire honneur à l’adolescent que j’étais si aujourd’hui il portait son regard sur moi. J’aime le grand air, la course à pied, la randonnée, les belles courbes, celles de la nature, celles des corps. Les réparties cinglantes, drôles, percutantes, mais par-dessus tout un gazon impeccable !
Le temps libre, l’énergie disponible, me permettent aujourd’hui de transformer mes rêves en réalité. La vie est un jeu, je commence tout juste à connaître les règles.
J’ai toujours voulu écrire. Débarrassé de l’obligation de m’en tenir à la réalité dans mon métier de journaliste, j’écris pour mon plaisir, et j’espère celui de mes lecteurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel RAYMOND
UNE GOUTTE D’EAU DANS LA POUSSIÈRE
Et autres nouvelles…
PTT MONAMOUR
Dans sa famille, on était facteur de père en fils, les PTT, ils avaient ça dans le sang ! Les filles n’étaient pas en reste y travaillant comme guichetières, receveuses, chargées de clientèle pour les plus malines. C’était une sorte de dynastie, comme d’autres sont ébénistes ou garagistes ! Dans le village, comme dans les environs, si vous vouliez travailler aux PTT sans être de la famille, il fallait épouser un frère, une sœur, éventuellement un cousin, mais c’était moins sûr.
Jean représentait la cinquième génération de « PTTistes ». Quand, au début du 21e siècle, le vent du libéralisme avait soufflé sur le pays, reléguant l’appellation « PTT » aux oubliettes, il avait craint d’être le dernier de la lignée, de trahir l’ADN familial, d’être le chaînon défaillant, la génération maudite. Heureusement, il fallait plus que des lubies de politiciens pour casser un moule comme celui des Postes, Télégraphes et Téléphones forgé dans la fonte du XIXe siècle. Face au danger, Jean avait pris sa carte au syndicat comme l’avaient fait ses aïeux avant lui dès qu’une menace pesait sur leur bien commun, cette grande Maison Postale. Côté syndicats il y avait le choix, l’entreprise avait toujours su faire fleurir en son sein les différentes essences de la revendication sociale.
Au fil des générations, les conditions de travail avaient évolué, avec toujours la même finalité : DIS-TRI-BUER le courrier dans les boîtes ! Jean et ses aînés avant lui en avaient connu des variantes dans la diffusion des sacro-saintes missives. L’antique gibecière postale capable de coller des scolioses aux plus solides des gaillards, les tournées à vélo puis à mobylette, les voitures jaunes et bleues enfin, fumant sur tous les chemins des campagnes jusqu’à être supplantées par une armada électrique. Il y avait les moments de convivialité avec la vente un brin forcée des calendriers à Noël et ces enfants qui choisissaient les agendas avec de gros chiens ou de petits chats. Mais ces derniers avaient déserté les almanachs des PTT pour faire les beaux jours d’Internet…
L’électronique, le numérique, ces concurrents diaboliques auraient raison un jour des PTT plus sûrement que le capitalisme triomphant dénoncé par les syndicats, voilà ce que pensait Jean ! Il s’était fait un point d’honneur à ne pas avoir d’adresse « mail » au grand dam de ses amis qui avaient déjà rejoint le côté obscur avec le courriel. Un nom barbare pour une pratique qui ne l’était pas moins.
Du haut de ses 40 ans, Jean en avait vu des boîtes aux lettres, celles traditionnelles des pavillons, celles collectives des immeubles, les massives des administrations et des commerces. Ces dernières étaient régulièrement submergées de factures et de formulaires déclaratifs qu’il avait parfois honte de déposer. Si certaines de ces boîtes le séduisaient, d’autres malgré les années de pratique l’intimidaient.
Jean aimait distribuer le courrier à l’aube, à l’heure où le loup rentre dans sa tanière, celle où le coq trouve le courage de chanter, celle où la nuit finit son voyage et où l’aube tient encore ses promesses. Celle enfin où personne ne pouvait le voir où il passait comme un gardien secret des maisons. S’il n’avait pas eu sa tenue bleue logotée à l’enseigne de la glorieuse Poste, personne ne remarquerait Jean, il passerait incognito au travers de la vie, un peu comme Clark Kent avant qu’il n’endosse la tenue de Superman !
Ses boîtes aux lettres préférées restaient les rafistolées qui ne se fermaient que parce que c’était la mode. Il aimait les bichonner, leur offrir un fil de fer pour qu’elles tiennent mieux, un clou pour qu’elles soient droites, un morceau de papier collant pour boucher un trou et conserver le courrier au sec. Il y avait aussi celles qui, percées dans la porte d’entrée, permettaient d’entendre les bruits de la maison, d’attraper des bouts de conversations donnant l’impression de faire partie de la famille. Jean était causant, il avait toujours un mot gentil quand on lui ouvrait la porte, il connaissait bien sûr les noms de famille, mais aussi ceux des chiens, des petits-enfants, parfois les dates d’anniversaire.
Certaines maisons en revanche restaient totalement hermétiques, comme ces bocaux que l’on n’arrive pas à débloquer. Il devait y avoir du vide à l’intérieur qui empêchait les habitants d’ouvrir la porte, de laisser entrer l’air, la vie et le courrier par une fente, aussi petite soit-elle. Ces maisons sans boîte aux lettres l’avaient toujours intrigué, mis mal à l’aise. C’était comme une insulte, une mise en cause de sa fonction, s’il n’y avait pas de boîte c’est qu’il n’avait pas de place pour lui dans ce monde.
Et puis il y avait la charmante boîte du 59 rue des Petits Champs, le nom lui avait toujours plu, surtout parce que la rue se trouvait en cœur de ville. Il en avait déposé du courrier dans cette boîte aux lettres solidement accrochée à la grille du jardin par des boulons inoxydables, mais il n’avait jamais vu personne relever le courrier. Personne, même pas un rideau qui bouge derrière une fenêtre, pas plus de lumières allumées à l’étage les petits matins d’hiver. Pourtant la boîte pimpante et astiquée, était vidée chaque jour. Un joli modèle, classique avec un simple nom de famille écrit à la machine et l’incontournable autocollant Stop Pub qui ne stoppait rien du tout.
Un jour que rien de spécial ne distinguait de ses prédécesseurs, la boîte n’était plus là ! Disparue, envolée ! Jean avait déjà été confronté à des situations bien plus complexes et le manuel du parfait facteur prévoyait tous ces cas insolites. Aucune lettre recommandée ne figurant dans la liasse, le courrier du jour serait celui du lendemain. Il n’en doutait pas, un beau coffret, le modèle officiel adapté aux livraisons de colis, viendrait remplacer l’ancien.
Trois jours passèrent et toujours pas de nouvel écrin où déposer le paquet ficelé de lettres qui commençait à peser. C’était écrit noir sur blanc dans le manuel : en l’absence de boîte réglementaire, le courrier pouvait être déposé à l’abri sur un rebord de fenêtre ou devant la porte d’entrée ! Les trois semaines suivantes, Jean avait pris ses nouvelles habitudes, poussant la grille, traversant le jardinet, jetant un œil aux parterres de fleurs bien entretenus et déposant le courrier du jour, toujours copieux, sous une pierre devant la porte d’entrée.
Un rituel tranquille, comme il en avait d’autres un peu partout sur sa tournée, s’était mis en place. Mais un jour tout aussi banal que celui de la disparition de la boîte aux lettres du 59 rue des Petits Champs, la porte de la maison apparut entrouverte, comme une invitation à entrer. Pour le coup, ça c’était expliqué en gras dans le manuel : « Ne pas pénétrer dans les habitations sans y être expressément invité par l’occupant ». Le Manuel est une chose, la vie en est une autre, se dit Jean en poussant la porte qui s’ouvrit sans un bruit sur un intérieur sobre et coquet.
Trois pas, il n’osa en faire plus. Comme un poulain à peine sorti du ventre de sa mère, Jean se lança dans ce monde inconnu, maîtrisant mal ses jambes. Trébuchant, il finit par prendre confiance et déposa les missives sur une table qui s’offrait à lui, large et accueillante. Sans un bruit, le regard enregistrant les détails de cet intérieur élégant, l’aventurier facteur sortit à reculons et ferma derrière lui la porte dont la serrure bien huilée claqua sans accroc.
Jamais les syndicats, pas plus que les autorités administratives, n’avaient évoqué un tel cas de figure dans l’analyse des conditions de travail. Pas plus qu’ils n’avaient envisagé qu’elle dure, encore moins qu’elle évolue. C’est pourtant ce qui arriva à Jean qui ne vécut plus que pour ce moment où il poussait la grille du 59 !
Quelques jours plus tard, alors qu’une nouvelle routine s’installait, une feuille de papier apparut sur la table toujours impeccablement cirée. Un seul mot y était inscrit d’une écriture déliée à l’encre bleu ciel : Merci !
Les jours passèrent, le printemps s’installa durablement en faisant fleurir le jardin toujours aussi bien entretenu. Chaque jour une nouvelle note déposée sur la table occasionnait un sourire sur le visage de Jean. Un matin de juin où le soleil brillait plus encore qu’à l’accoutumée, il s’enhardit et laissa à son tour une phrase sobre sur la feuille de papier. Un café, puis des croissants accompagnèrent rapidement ces échanges épistolaires qui s’étalaient maintenant sur le recto et le verso de la feuille quotidienne. Jean déposait le courrier, sa propre lettre, et rangeait précieusement dans sa poche de veste son message du jour qu’il lirait désormais tranquillement chez lui le soir.
Le jour que Jean redoutait arriva ! Pas un mot sur la table, pas plus de croissant, encore moins de café. Mais au fond du salon silencieux, une porte était ouverte et laissait filtrer de la lumière. Une légère musique parvenait à ses oreilles, un concerto de Dvorak qu’il avait récemment évoqué dans l’une de ses lettres.
Ce jour-là, les habitants du village ne reçurent pas leur courrier ! Une première depuis… la guerre ! La tournée quotidienne de Jean avait pris fin rue des Petits Champs. Il ne sortit de la douillette maison que tard le soir, avec un dernier regard pour ce numéro 59, comme s’il le voyait pour la dernière fois. Le lendemain, la porte du jardin était fermée à clé, un panneau « À vendre » y était accroché.
Le 59 resterait à jamais son chiffre fétiche, celui qu’il jouerait au loto si seulement il était dans la grille, celui de l’âge de sa retraite à venir, merci les syndicats. Retraite qu’il prendrait dans le Nord (59) bien sûr.
En attendant cette retraite que certains attendaient avec impatience quand d’autres la craignaient comme une petite mort, les tournées avaient repris, banales, avec leurs petits plaisirs autrefois si charmants, mais désormais si lointains de la magie sans égal du 59.
Chaque jour, Jean guette les boîtes aux lettres… Tiennent-elles bien ? Tiens celle-là est toujours en place, celle-ci en revanche ne va pas tarder à tomber.
On verra ça demain…
DIX ANS D’PLACARD, BELLE AFFAIRE
Elle a dix ans. Dix ans de bon devant elle. Et après basta ! Elle ne pourra plus faire illusion. Voilà ce qu’elle se dit.
À croire que la vie marche par paquets de dix pour elle.
Dix ans d’enfance, au maximum. Et dix ans d’études, pas un de plus. De toute façon elle ne se souvient ni de l’un ni de l’autre !
Dix ans de galère, série en cours, et dix ans de taule, série également en cours. Ça, elle s’en souvient bien. Trop bien même.
Comme les emmerdements qu’elle récolte par poignées dedix.
Comme les baffes qu’elle vient de se prendre de ce vieux salaud si elle ne l’avait pas arrêté, nul doute qu’elle en aurait prisdix !
Quelle idée aussi d’accepter de boire un verre avec un tordu pareil sous prétexte qu’il le lui avait payé !
Qu’est-ce qu’elle imaginait ?
Que c’était juste comme ça. Désintéressé ?
Il suffisait de voir l’allure de ce bouge pour savoir ce que les gars comme lui attendent quand ils payent un verre.
Un bar comme celui-là ne figurait sur aucun guide touristique, artistique, gastronomique ou autre. Peut-être à la rigueur sur celui de ce bon vieux Satan, car une chose était sûre, Dieu ne connaît même pas l’existence de cet endroit. La climatisation était aux abonnés absents, un simple ventilateur se contentait de brasser un air chaud et fétide, chargé de sueur et d’autres odeurs dont on ne voulait surtout pas connaître l’origine.
En son absence - celle des dix années de taule - le prix de l’essence avait gagné 30%. La température avait dû prendre environ 40%, le taux de criminalité 50% et les prix des boissons au moins 60%. Ici, c’est une ville de statistiques. Et vous ne voulez pas toutes les connaître au risque de partir en courant en espérant avoir 100% de chances de ne pas revenir !
Donc elle en était là, à se frotter la joue, là où les doigts de l’autre cinglé s’étaient fracassés. Les marques, rouges pour l’instant, vireraient sûrement au bleu, puis au noir, dans les jours à venir. Elle verrait ça plus tard, il y avait plus urgent pour l’instant.
Lui, il se frottait les yeux, avec l’énergie du désespoir. Ce qu’il restait du verre qu’il avait payé lui était revenu dans la figure. Contenant et contenu !
Et, croyez-moi d’expérience, le mauvais whisky, ça brûle les yeux. À hurler.
Elle, elle était en probation c’était écrit dans l’épaisseur de ses traits fatigués. Si elle se faisait choper par les flics pour une agression comme celle-là, son compte était bon. Retour à la case départ : la zonzon, sans toucher les vingt mille ! Jamais on ne voudrait la croire, la légitime défense on n’y croyait jamais pour des filles commeelle.
La meilleure défense étant l’attaque – elle avait appris ça très vite dans la cour de la prison – avant qu’il ne pousse son premier cri de douleur elle fit taire son prétendant d’un violent coup de pied là où se trouve l’interrupteur des hommes. Plus de son plus d’image. Elle pouvait se lever tranquillement et quitter ce bastringue sans être inquiétée. Ses chaussures en cuir lui avaient offert dix - évidemment – minutes d’avance sur les emmerdes.
***
Il faisait sombre dans ce coin du rade et à part moi, personne n’avait prêté attention à son échange musclé avec son acolyte. Les gens ici en ont vu bien d’autres et croyez-moi il faut des affaires sacrément plus sérieuses pour que les clients commencent à imaginer s’occuper de celles de leurs prochains.
Elle fut éblouie par le soleil et frappée par la chaleur quand elle franchit la porte d’entrée. Une porte lourde, sûrement blindée, gonds grinçants, mal peinte et marquée de traces qui pouvaient provenir de couteaux comme de poings américains. Finalement, les traces de peintures étaient peut-être du sang, se dit-elle en y jetant un dernier regard. Elle ne prit pas le temps de vérifier. Soulagée de respirer un air un peu plus pur, elle se glissa le long du mur extérieur. Elle y trouva un peu d’ombre et l’une de ces foules ordinaires dans lesquelles pour disparaître, il suffit de glisser sespas.
À aucun moment, elle ne remarqua ma présence, anonyme parmi les anonymes. Si la vie avait été bien faite, j’aurais pu devenir chasseur de grands gibiers, là-bas dans les savanes d’Afrique. J’aurais approché les lions et les rhinocéros sans qu’ils me repèrent. J’aurais abattu les plus beaux spécimens. J’aurais fait la Une des magazines de Safari et d’amateurs d’armes. Bon bref, ça c’est si la vie avait été bien faite. Dans la vraie vie, celle que vous connaissez comme moi et qui est sacrément mal faite, j’avais un autre boulot. Un qui demandait les mêmes qualités, mais qui n’avait pas le même gibier ni les mêmes clients. En y réfléchissant, j’aurais aussi pu être fonctionnaire. Aux impôts, service des impayés. Retraite dorée à soixante ans et quelques – ça change tout le temps –, voiture de fonction, bureau climatisé et fauteuil en cuir ! Je m’égare…
Pour finir, j’étais percepteur. D’un genre un peu particulier. Pas le genre où il faut une formation dans les facultés ou dans des écoles privées. Ma formation à moi c’est plutôt dans la rue, une arme à la main avec les gestes persuasifs qui vont bien. Vous saisissez. S’il vous faut un nom plus précis, celui que l’on emploie dans ma branche, je dirais recouvreur de dettes.
Et cette donzelle qui venait de prendre la poudre d’escampette avait une sacrée dette. Elle avait payé – dix ans – celle qu’elle avait envers la société. En revanche celle vis-à-vis de mon patron courait toujours. Et là, pas sûr que le chiffre de dix suffise pour se faire une idée de ce qu’elle devait. Quoiqu’en comptant les intérêts, ça pouvait monter à dix millions ! Mais l’argent n’était pas le plus important. Il y avait Max. Ou plutôt, il y avait eu Max. Max, le fils de mon patron. Max qui était resté sur le carreau quand elle avait pris la fuite avec le butin.
Vous ne connaissez pas mon patron et c’est tant mieux pour vous. Vous n’auriez rien de bon à y gagner. Max en bon fils devait prendre sa suite, mais avant ça il fallait qu’il fasse ses preuves, qu’il montre qu’il était à la hauteur. Ça marche comme ça chez nous. Être le fils de papa ne suffit plus de nos jours. Un bon casse, ça vaut tous les diplômes, ça vous ouvre les portes. Ou ça vous ferme celles de la prison comme pour l’autre poufiasse. Ne croyez pas que je sois misogyne. Je dis « l’autre poufiasse » parce que, depuis la mort de Max, le patron ne veut plus que l’on prononce son nom. Elle avait pourtant été à deux doigts d’être sa belle-fille. Des doigts qu’il lui aurait bien tranchés aujourd’hui d’un coup de sécateur !
Bref, Max et l’autre poufiasse - pardon sa copine – avaient monté leur affaire comme il faut. Un casse à l’ancienne, classique, dans une bijouterie des beaux quartiers. On entre un flingue à la main, la cagoule sur la tête, on rafle tout dans des sacs et on file à moto. En tirant une ou deux fois en l’air pour faire bonne mesure. Rien d’extraordinaire. La routine, quoi !
L’affaire avait tourné vinaigre. Les coups de feu, c’est un client qui les avait tirés. Touchant Max par deux fois. L’autre - vous voyez qui je veux dire - au lieu de régler son compte au tireur et de porter secours à Max, elle avait filé avec le butin. Max n’avait pas survécu à son transport tardif à l’hôpital. Dans cette ville, on n’emporte pas grand-chose au paradis, Miss Lâcheuse s’était fait prendre quelques semaines après avoir planqué son magot !
Et nous voilà dix ans plus tard ! Elle, avec un vrai problème. Moi, avec une mission simple. Substituer dans la panoplie de la Dégonflée les bijoux par un ou deux morceaux de plomb bien placés. À ma convenance !
Avant de faire l’échange standard, plomb contre or, il fallait que je mette la main sur le magot. Je suis comme ça, moi, il me faut du solide. Du palpable. Et pour ça, une seule solution, la suivre jusqu’à ce qu’elle ait besoin de revendre quelques cailloux ou breloques.
***
Vous ne me connaissez pas, mais laissez-moi vous dire que je suis plus fin que le lourdaud du troquet sordide qui s’était fait éteindre à coup de pompe. Pas question de forcer la gazelle, j’avais opté pour l’approche en douceur. Comme pour les animaux sauvages dont je vous parlais il y a cinq minutes, il fallait avancer sans se dévoiler, n’offrir que son meilleur profil.
Au fil des semaines, la poulette s’était refait une santé, sa peau dopée à la vitamine D - si rare derrière les barreaux - avait retrouvé souplesse et douceur, la cantine putride de la prison avait laissé la place à des salades aussi « bio » qu’allégées qui lui avaient affiné la taille. Il ne restait que la violence et la dureté de son regard qui trahissaient son stage dans les pensions longue durée de l’administration pénitentiaire.
S’il y en un qui sait ce dont on a besoin et envie en sortant de prison, croyez-le, c’est bien moi. Homme ou femme, on aspire à la même chose. Un cocktail savant de respect, tranquillité et attention. Quelques semaines plus tard, alors que je l’avais convaincue de jouer au docteur dans ma chambre, elle n’avait pas perdu ce reflet d’acier au fond du regard, cicatrice indélébile que portent tous ceux qui ont survécu au statut de taulard. Nul doute qu’elle avait entrevu le même éclat dans mes yeux. Ça avait aidé au rapprochement.
Le moment crucial où les masques tombent approchait. Chaque jour un peu plus. Si elle m’avait parlé de son magot – tout petit à l’écouter - et de son envie de mettre les voiles (les grandes si possible), je m’étais bien gardé d’en dire plus sur ma mission. D’une part, je n’avais pas encore mis la main sur les bijoux, de l’autre je commençais à imaginer un scénario un tant soit peu différent de celui que l’on avait écrit pour moi.
Dix millions, ça fait réfléchir. Surtout quand on s’en rapproche de plus en plus. Je commençais à comprendre pourquoi elle avait pris la tangente au lieu de porter secours à ce bon vieux Max. L’amour donne des ailes, mais l’argent fait voler. Dans tous les sens du terme ! Ma fidélité à mon patron vacillait comme un immeuble de Los Angeles pendant The Big One.
Une nuit où nos corps avaient trouvé des points d’accord bien au-delà de ce que nous en attendions, nous sommes restés là, allongés, incapables de trouver le sommeil ou de bouger. Elle m’a tout balancé : Max, le casse foireux, la fuite, la taule, la planque du magot et son envie d’ailleurs. Avec moi.
Au point où nous en étions, j’ai fait la même chose. J’ai tout posé sur l’oreiller, ma mission, le père de Max, les petits cadeaux en plomb…
Vous dire qu’elle l’a bien pris serait loin de la vérité. Ou alors d’une vérité livrée, la main sur le cœur par un avocat bien payé. On n’était pas dans un conte de fées ! J’ai eu droit à ce qu’il faut de cris et d’insultes. Assez pour faire rougir le pire des mafieux. À des coups aussi, à envoyer un catcheur à l’hôpital, mais pour finir nos corps se sont de nouveau lancés dans l’un de leurs exercices favoris. Après, ni elle, ni moi n’envisagions d’en rester là.
N’allez pas croire qu’en quelques semaines, pour le regard ou la caresse d’une belle, je me sois transformé en premier communiant prêt à croire à la vie éternelle. Mais merde, dix millions et quelques gâteries bien faites, ça fait réfléchir.
Nous avons bu, nous avons parlé. Les rêves ont disputé la vedette aux insultes. Les coups se sont atténués pour laisser la place à ces corps à corps qui me retrouvaient chancelant comme un poulain à ses premières heures. Autant de montagnes russes émotionnelles qui nous ont montré la seule voie à suivre. Disparaître.
La vie est un pari. Je venais de décider de jouer la mienne à la roulette. Tapis sur le rouge ! Rouge piment, rouge passion, rouge sang. Tout ce que vous voulez tant que la boule ne tombait pas sur le noir ! Il y a bien des gars qui parient sur l’existence de Dieu et sur la vie éternelle… Après tout, j’avais autant de chance qu’eux de gagner. Ou de perdre ! J’ai réussi à arrêter de fumer, de boire (trop), mais pas de m’embarquer dans des paris à la con ! Chacun ses addictions…
Les lames acérées de son regard sont toujours là, pointées sur moi dès qu’elle me dévisage. Elles ferraillent joyeusement avec celles qui animent le mien. Moi aussi j’ai eu dix ans ! De taule. Je le lui ai dit, elle sait à quoi s’en tenir. Seule différence entre nous, elle ne sait pas pourquoi on m’a coffré. Et mieux vaut que le sujet reste comme moi pendant dix ans… à l’ombre.
***
Jusqu’à ces derniers jours, je tenais mon boss informé des progressions de la mission. Pour calmer son impatience, je l’assurais que je touchais au but. Côté collecte de dettes, je me montrais performant comme jamais avec mes autres clients, histoire qu’il n’ait pas de doute sur mes compétences. Un vrai presse-citron. Le jus jusqu’à la dernière goutte sans un pépin. Devant son air sceptique, je lui avais même refilé l’une des montres qui avaient été volées pour lui montrer que sa vengeance était proche. Une Rolex à 30 000 balles dont on pouvait se passer. J’avais dressé pour mon propre usage un rapide inventaire du magot, on frôlait les vingt millions ! Vingt bâtons ! Le pauvre Max n’avait aucune chance. N’importe qui l’aurait laissé tomber pour une telle somme. Ma trahison valait bien une saloperie de Rolex.
Il ne fallait pas traîner, je n’aimais pas les questions non formulées que je voyais dans le regard de mon boss. « Si tu mens, sois très concis », j’avais lu ça dans les mémoires d’un mafieux dont j’ai oublié le nom et j’avais de plus en plus de mal à me tenir à cette maxime.
Elle et moi on formait une drôle d’équipe. N’allez pas imaginer Bonnie and Clyde ou d’autres duettistes de pacotille. Simplement deux escrocs qui se tenaient par le bout du nez. Elle tenait le pognon - notre pognon ? - et moi sa vie. On avait chacun des raisons de tenir à l’autre. Au-delà de nos séances de jambes en l’air.
Quand nos sens nous laissaient en paix, comme tous les couples, on pensait à l’avenir. Mais pour nous, soyons sérieux, elle est où la ligne d’horizon ? Des enfants ? Pourquoi pas des petits-enfants aussi à garder et pouponner ? Nous avions juste quelques années devant nous pendant que nos organes fonctionnaient à plein. Après ? À la vérité, nous n’y pensions mêmepas.
Dans le fond, je suis un bon gars et je peux croire à beaucoup de choses. Qu’Elvis soit toujours en vie ou que le Pape ait une famille nombreuse, OK. À son amour à elle, j’avais des doutes. Il y a eu quelques tensions entre nous.
–J’amène vingt millions, toi tu amènes quoi ?
–Ta survie ma belle. Tu sais cette petite histoire entre le plomb etl’or.
Elle voulait s’évaporer dans les îles ! Une connerie, c’était le premier endroit où le père de Max allait nous chercher. Comme si moi j’avais choisi les parcs avec les lions et les rhinos dans la pampa africaine. En gros, on était toujours en prison. Si on voulait voir le verre à moitié vide, on avait juste changé de gardien !
Mais on a quand même levé les voiles. Les grandes.
En partant, j’ai foutu le feu à la baraque. On n’est jamais trop prudent. Et vous savez quoi ? Dans notre chambre, deux corps sont en train de rôtir. Thermostat à fond ! Des SDF que j’ai trouvés dans une ville voisine. Même corpulence, même âge ! Un homme, une femme… Ils n’auraient pas vécu bien longtemps de toute façon. Ils auront gagné au moins une fois dans leur vie. Le gros lot, celui d’une sépulture digne de ce nom.
Moi et l’autre… Non j’ai dit que j’arrêtais de l’appeler comme ça. Je reprends ! Lucille et moi - pas la peine que je vous donne mon nom, vous l’avez déjà lu dans les journaux – vivons désormais heureux là-bas. Si un jour je repasse dans le coin, j’irai mettre des fleurs sur nos tombes. On le mérite ! Ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus. Du genre où nous sommes partis ! Après tout peut-être que vous le connaissez, mon patron. Ou peut-être que lui vous connaît ! On n’est jamais trop prudent. J’ai mis dix ans à l’apprendre…
LA DERNIÈRELEVÉE
Jaune d’or comme ces champs de colza qui encerclaient la ville, légers comme de vaporeux jupons agricoles, elle trônait seule, massive et cubique, sur son solide pied de métal dans un coin de cette grande place récemment restaurée. Resplendissante sous le soleil de ce frileux matin d’avril, elle n’allait pas tarder à basculer dans l’ombre et se fondre dans le paysage, délaissée, négligée, presque oubliée. Ces derniers mois pourtant elle avait été la star des gazettes, l’objet de toutes les attentions, un trophée, un emblème pour lequel certains étaient prêts à se battre. Elle, la boîte aux lettres de la place qui avait survécu tant bien que mal à toute la modernité qui avait déferlé sur la ville.
Ses plus ardents défenseurs étaient les retraités. Vent debout contre les faiblesses et la modernité de l’administration qui voulait la supprimer. De valeureux combattants aux casques déplumés et grisonnants qui ne voulaient pas la voir disparaître ni ne voulaient faire cent mètres de plus jusqu’à la Poste centrale, arpentèrent les rues de la ville avec force panneaux revendicatifs : « La lettre n’est pas morte » « Monsieur le Président, je vous fais une lettre »…
On le sait, débarrassé des contraintes du travail, le monde de retraités a tout le temps devant lui pour se mobiliser pour une cause. Surtout quand celle-ci concerne les marqueurs de son passé en perdition, de sa jeunesse évanouie, de ses habitudes que les jeunes générations piétinent souvent avant de les honorer plus tard quand, devenues espèces en voie d’extinction, soudainement alors, elles les passionnent.
Il y avait bien quelques touristes venus du bout du monde qui, attirés par un rayon de soleil posé sur l’antiquité, venaient faire des photos au caractère « so frenchy », accoudés à ce totem d’aluminium trônant là comme un improbable témoin d’un temps révolu.
Le préposé de La Poste à quelques encablures de la retraite, pris dans sa routine qui l’amenait plus souvent qu’à son tour au comptoir des bars qui se trouvaient sur son chemin, oubliait d’en relever le contenu un jour sur deux ! Il faut dire à sa décharge qu’il se passait parfois une semaine sans qu’il y trouve la moindre lettre à mettre dans le glorieux circuit de distribution de la Poste française. N’est pas Saint-Exupéry qui veut !
Quand il partit en retraite après des centaines de kilomètres de tournées, de collectes de tonnes de papiers, le petit nouveau qui lui succéda n’avait pas été informé de l’existence de cette vieillerie, de cette pièce d’aluminium témoin d’un autre temps. Pour ce qui est de la liste des cafés en revanche, il ne perdit pas de temps à la connaître sur le bout des lèvres régulièrement humectées par les petits blancs offerts au comptoir.
Dans le coin délaissé de la place, jour après jour, la végétation prit doucement le dessus sur ce que la main de l’homme avait forgé. L’arrivée du lichen, la ronde des araignées, la prolifération des champignons, le tapissage par les fientes de pigeons - ces rats ailés - attaquèrent doucement la peinture laquée censée résister à toutes intempéries. On n’était pas là dans le monde de l’exceptionnel, à peine de l’ordinaire, la boîte aux lettres de la place était un modèle très classique en aluminium de la fonderie Dejoie, établie à Nantes, fournisseur officiel et exclusif depuis 1949 des quelque 140 000 boîtes installées sur le territoire national ! Une petite valeur sur une foire à la brocante, mais guère plus !
Au fil des ans, les retraités avaient vieilli et oublié leurs âmes de combattants revendicatifs. Eux aussi avaient découvert Internet pendant que les gonds de la boîte, faute d’être manipulés, se grippèrent chaque saison un peu plus faisant de l’auguste sculpture un perchoir pour oiseaux d’excellente facture.
La boîte autrefois jaune se patinait lentement au fil des semaines, des mois, des années, ignorée de quasiment tout le monde. Même les caméras de surveillance installées à grands frais par une municipalité cédant aux chants des sirènes de la modernité ne la prenaient pas dans leurs champs optiques, balayant le paysage au-dessus ou à côté, mais l’ignorant dans leur vision numérique de la ville. Même la jeunesse friande d’espaces libres pour exprimer révoltes, passions et autres envies n’y apposait pas d’autocollant, pas plus de tags. C’est dire !
Et pourtant…