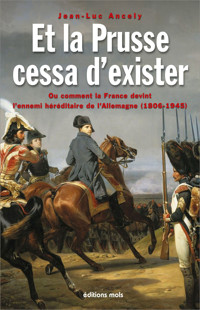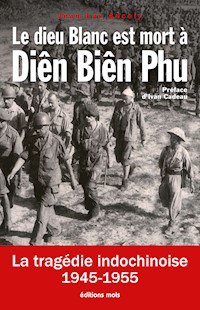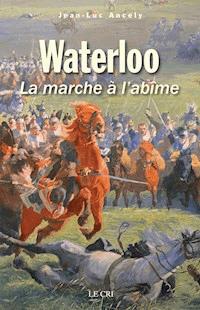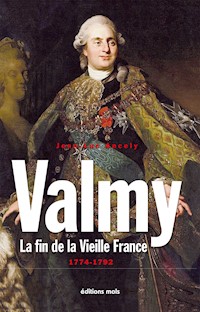
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mols
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
L’homme, Louis XVI, qui accède au pouvoir en mai 1774, jeune, inexpérimenté, plein de bonne volonté, bon époux et bientôt bon père, est conscient de ses limites. Il sait qu'il lui faut réformer ce vieux pays glorieux dont il est le nouveau roi, la France. En suivant son parcours, de 1774 jusqu'à la proclamation de la République, en passant par sa déchéance en août 1792, l'auteur tente, sans dogmatisme, d'y voir plus clair, de débroussailler notre vision parfois trop schématique de ce que furent ces évènements souvent dramatiques, toujours instructifs, mais définitivement enseignée depuis Michelet. À propos des conséquences de cette époque qui a vu naître la Révolution, et de la bataille de Valmy en particulier, la France va réussir ce tour de force qu’elle va dégoûter l’Europe de l’idée républicaine pour cent ans. En 1900, seule la France sera républicaine. L’Europe de la Belle Époque sera toute monarchique. Que dire de plus ? Eh bien, que, somme toute, la royauté n’était pas un obstacle aux libertés fondamentales, que le roi n’était pas incompatible avec les droits des citoyens. Cela porte un nom : monarchie constitutionnelle qui est le contraire de l’absolutisme. À propos de la Belgique, on leur apprendra la Liberté en la leur refusant – et en leur faisant les poches. On se battra bec et ongles pendant vingt-trois ans pour la conserver, jusqu’à Waterloo. Et tout cela grâce à Valmy ! On leur colla des commissaires de la République ; on leur fit découvrir l’assignat et la guillotine, ces merveilleuses inventions de la modernité française. Plus tard, on leur donna des préfets et un empereur bien plus exigeant que leur ancien souverain d’Autriche. Et tout cela à cause de Valmy ! Valmy, par ses conséquences lointaines, met fin au XVIIIe siècle et ouvre les terribles deux siècles suivants. La République va déstabiliser tout le continent en pratiquant une politique de destruction des anciennes structures.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Luc Ancely est Français et réside dans la région d’Autun ; ancien élève de Saumur, il a fait carrière dans l’Arme blindée Cavalerie. Il est l’auteur d'ouvrages littéraires, essais et tragédies.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
VALMY
LA FIN DE LA VIEILLE FRANCE
1774-1792
Du même auteur
Waterloo. La marche à l’abîme, Le Cri.
Ainsi sont-ils (contes et nouvelles), Mols.
Le dieu Blanc est mort à Diên Biên Phu. La tragédie indochinoise.1945-1955, préfacé par Ivan Cadeau, Mols.
Napoléon aura-t-il lieu ?, Mols.
Jean-Luc Ancely
VALMY
LA FIN DE LA VIEILLE FRANCE
1774-1792
Essai
© Éditions Mols, 2020
Collection Histoire
www.editions-mols.eu
« Rien n’est absurde comme de juger, d’expliquer le passé d’après le présent. Rien n’est plus faux ni plus dangereux. »
Louis Aragon
« Comme un fleuve en crue sorti de son lit et qui dévaste les champs qu’il avait d’abord irrigués, la Révolution a recouvert de sang ce qu’elle avait créé. »
Max Gallo
Prologue
« Je définis la Révolution, l’avènement de la Loi, la résurrection du Droit, la réaction de la Justice. » Michelet, 1847. C’est par cette phrase que Michelet, l’immense et incontournable Michelet, entame la rédaction de son Histoire de la Révolution française. Michelet, l’éducateur, le prophète, celui qui a fixé une fois pour toutes dans notre mémoire collective l’image de cet évènement énorme : la Révolution. Michelet, repris avec vénération par des générations d’instituteurs républicains. Michelet ? C’est Moïse descendant du Sinaï en portant les Tables de la Loi. Michelet est la Révolution.
Oserai-je, moi, ignare, inculte mais pensant, attaquer ce Valmy, la fin de la Vieille France en portant – ô légèrement – une estafilade, un timide effleurement de ma lame malhabile ? La Révolution de Saint Michelet. J’ose. Pour moi, je ne vois pas une révolution mais des révolutions. Quoi de commun entre la révolution « bourgeoise » de 1789 et la révolution « prolétarienne » de la Commune de Paris le dix août 1792 ? Et Thermidor, cette révolution contre-révolutionnaire des corrompus et des trouillards ? Et la révolution avortée de Babeuf, ce proto-communiste, en 1795 ? Et les autres ? Celle de 1830 : une révolution républicaine subtilisée par ce filou de Louis-Philippe d’Orléans pour le bénéfice des bourgeois enrichis ? Et la révolution ouvrière de 1848 ? Et la Commune de 1871 ? Quoi de commun entre Mirabeau et Robespierre, entre Barras et Bonaparte ? Non, décidément, pas une mais des révolutions. Certes, je ne prétends pas toutes vous les conter. En outre, la difficulté rencontrée est considérable. La Révolution est de ces sujets qui impliquent nécessairement un parti pris. Comment demeurer neutre face à ces évènements ? La Révolution, on est forcément pour ou contre, partisan ou détracteur. La Révolution, c’est l’histoire de notre famille, la France. On n’est jamais neutre dans une querelle familiale. Comment faire ? Je m’arrêterai à Valmy, date fondatrice puisque dernière bataille de l’armée royale et première de la nouvelle armée républicaine. Il y eut un avant et un après Valmy.1 Goethe l’a vu. Présent sur les lieux, il écrit : « De ce jour et de ce lieu date une ère nouvelle dans l’histoire du monde. Plus tard, vous pourrez dire : J’y étais. »
J’allais oublier. Parmi ces révolutions, il y en eut une qui avorta : ce fut la révolution royale de Turgot, celle de 1774-1776 que nous classons sommairement comme une ère de réformes alors qu’elle fut bien davantage. Ce fut bel et bien une tentative, une esquisse révolutionnaire mais d’en haut, c’est-à-dire décidée par le Roi et soutenue par lui. Une tentative de despotisme éclairé à la française. Nous l’effaçâmes de notre mémoire collective comme trop gênante. J’y viendrai.
Deux siècles pleins après la prise de la Bastille – quel symbole ! – et la mort du Roi – tuer le père ! – il reste que, parler de, écrire sur, tenter de comprendre la Révolution française est parfois difficile. Elle demeure, encore de nos jours, un tabou collectif. Si d’aucuns admettent du bout des lèvres qu’il y eut des crimes, ce furent des « bavures » ; si Robespierre a conduit la Terreur, cette dictature sanglante, il y était contraint par les évènements et il n’était pas un psychopathe, etc. La difficulté tient en ce que l’objectivité, la neutralité sont difficiles à conserver dans cette narration. On tombe vite dans la polémique en affirmant ceci, en contestant cela. La plaie est encore sensible et le sujet nous concerne tous. J’en veux pour preuve l’existence, de nos jours, d’une Société d’études robespierristes ! Pourquoi pas ? J’en veux pour preuve la commémoration du martyre de Louis, chaque 21 janvier, par les nostalgiques de la monarchie. Derrière le lourd rideau de l’histoire officielle et enseignée comme un dogme se cache une autre réalité. C’est toujours l’histoire mais l’œil de celui qui la contemple n’est plus le même. Il y a même un « folklore » révolutionnaire : le poétique et amusant calendrier de Fabre d’Églantine : messidor, ventôse, floréal ; les arbres de la Liberté (Liberté avec une majuscule ; importante la majuscule) ; le système métrique et l’unification des poids et mesures (une bonne chose mais qui s’en servit ? Personne.) ; la Marseillaise (écoutez bien ce que vous chantez : il n’y est question que de tyrans, d’égorgements, de morts et de massacres ; et l’on fait apprendre cet hymne aux enfants !) ; la peinture de David (Marat dans sa baignoire), celle de Georges Moreau de Tours (Carnot à Wattignies) ; le beau Saint-Just (« pas de liberté pour les ennemis de la Liberté ») ; Danton rugissant à la tribune de la Convention ; les soldats de l’an II ; enfin, la démocratie. Le droit de vote, quoi. Oui, bon, peut-être (dommage qu’en accordant le droit de vote on n’ait pas accordé la liberté d’expression, cela eût évité à André Chénier d’être guillotiné). Et les Droits de l’homme et du citoyen (majuscule, majuscule, toujours) ? Tout le monde s’en réclame ; dès qu’une difficulté apparaît, on nous ressort les Droits de l’homme, ce nouvel évangile. Et les Devoirs, alors ? Oubliés. Je pourrais continuer, vous pourriez en être lassés. Tout ce fatras, s’il touche parfois au grotesque, demeure souvent sublime, le ridicule côtoyant l’admirable. Un folklore héroïque qui passe sous silence bien des atrocités. Atrocités, vraiment ? Atrocités ? Mais de quoi parlez-vous ? Ah oui ! Les massacres de septembre, les Gardes suisses coupés en morceaux et dévorés parfois devant les Tuileries ? Le génocide vendéen ? Les insurgés lyonnais exécutés au canon par Fouché ? Bavures, broutilles, dommages collatéraux. Passons. C’est ainsi.
Selon Max Gallo, la Révolution est « un séisme majeur de notre histoire ». Un séisme ou un renouveau ? Un accident ou un accomplissement inéluctable. Un « bilan globalement positif » (pour paraphraser l’inénarrable Georges Marchais) ? Une catastrophe ? Une libération ? À chacun sa vision, à chacun sa révolution, à chacun son idée. Oui, la Révolution est tout cela, sûrement et sans doute une tragédie (au sens dramatique théâtral).
Il y a plusieurs lectures possibles de la Révolution : une lecture républicaine et laïque comme celle de Michelet ; une lecture sociale voire socialiste comme celle de Jaurès ; une lecture libérale-droitière : celle de Tocqueville ; une lecture marxiste opposant le prolétariat aux capitalistes du dix-huitième siècle. Autant de lectures que de lecteurs, mais un seul et même ensemble d’évènements. François Furet dans son Penser la Révolution française (éd. Gallimard) nous invite à y voir non pas une rupture historique mais une accélération d’un processus déjà bien engagé. Ce n’est pas faux. Au fond, les Jacobins ne firent que poursuivre et accélérer la marche en avant des rois : recherche des frontières naturelles, destruction progressive de la noblesse féodale, création d’un État-nation, etc. Croit-on que j’affabule ? Mais les rois qui se succèdent depuis Philippe IV le Bel jusqu’à Louis XIV en passant par Louis XIII (et Richelieu) luttèrent sans cesse contre les féodaux qui refusaient la centralisation du pouvoir. En permettant et facilitant l’accès du tiers état à la noblesse (lettres patentes) récompensant des services, possibilité d’acheter une charge anoblissante, création de la « noblesse de robe » en opposition à la « noblesse d’épée », les rois s’appuyèrent toujours sur le tiers état pour museler les grands fauves féodaux. Le fin du fin, ce fut Versailles et la mise à la mangeoire d’une certaine aristocratie dépouillée de son prestige. Cet avilissement voulu de la noblesse eut comme conséquence que ses privilèges, cessant d’être justifiés par des services rendus (militaires et protection des populations), apparurent à tous comme exorbitants. La destruction par les Jacobins de la vieille noblesse s’inscrivit très logiquement dans le prolongement d’une action royale déjà ancienne. Le dépouillement du clergé en fut une autre conséquence. Le haut clergé était tout autant noble que religieux. En privant les évêques de leurs biens territoriaux, en supprimant les Congrégations (autres gros propriétaires), en imposant la Constitution civile du clergé, en leur faisant prêter serment, on fit des prêtres des fonctionnaires qui ne pouvaient plus se réclamer du Pape. On nationalisa l’Église de France (elle l’était déjà par la doctrine gallicane voulue par la monarchie). Après tout, c’est Louis XV qui prononça le bannissement des Jésuites en 1763 (ils seront interdits par le pape Clément XIV en 1773). Le renvoi des Jésuites priva l’Église de ses meilleurs combattants et de ses meilleurs enseignants.2-3 Le roi lui-même mettait à mal un des piliers de la foi ! Et on est encore à vingt-cinq années de la prise de la Bastille… Tout ceci pour dire que, si l’on y réfléchit bien, les révolutionnaires Montagnards se firent tout naturellement les héritiers et les continuateurs des rois. Le royaume de France, en devenant la Nation française, se comporta comme une grande entreprise nationalisée : elle remplaça l’ancien patron par un autre, désigné par elle. Mais il y aurait tant à dire…
Je vous avertis, cher lecteur, si vous acceptez d’embarquer à mon bord, préparez-vous à une traversée mouvementée, à des coups de tabac, à tirer d’improbables bordées avant que d’aborder aux rivages de la République et de jeter l’ancre à Port-Valmy, cette destination qui sera tout à la fois la fin d’un monde connu et l’entrée dans un nouveau encore à créer. Mais que Dieu fasse que mon esquif craquant ne devienne pas une galère !
Premier tableauLa France avant 1788
Vous lisez bien : 1788 et non 1789. Ce n’est pas une coquille. Je ferai volontairement débuter la révolution en 1788, aux États provinciaux du Dauphiné, à Vizille. C’est là, un an avant tout le monde, que fut lancée la rébellion à l’autorité du roi. Le royaume de France est, à ce moment de l’histoire, une société vieillie, bloquée et déséquilibrée. Mais, pour bien comprendre l’enchaînement des évènements, il nous faut établir les causes lointaines de la Révolution et remonter quinze ans en arrière.
Dix mai 1774, trois heures et quart de relevée – pour nous, quinze heures quinze –, une foule se bouscule dans les couloirs de Versailles : dames parées, beaux messieurs l’épée au côté, le chapeau à la main, le cordon de Saint-Louis en sautoir, ils courent à qui sera le premier à crier : « Le roi est mort ; vive le roi ! » Non, ils n’oseront pas mais tous y pensent. Ils se précipitent dans l’aile éloignée où l’on a calfeutré le Dauphin et la Dauphine afin de les préserver de la mortelle contagion. Louis XV, jadis « le Bien-Aimé » devenu le « très-détesté », vient de mourir. Enfin ! La petite vérole – autrement dit la variole –, à soixante-quatre ans, ne pardonne pas. C’est la peste et le cancer du siècle ; elle tue un malade sur sept et quasiment personne n’y échappe un jour ou l’autre.
La cohue s’agglutine autour d’un couple jeune, en larmes, le mari dans les bras de son épouse. Ils ont vingt ans. Ils sont trop jeunes, ne savent rien et vont devoir, dès cet instant, régner sur le plus beau royaume du monde: la France. L’homme sera Louis XVI; son épouse sera Marie-Antoinette (de son vrai nom Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine) et deviendra, un jour prochain « l’Autrichienne », « Madame Veto », « Madame Déficit ». Ils sont roi et reine, tremblent de l’être et ignorent, les pauvres, que, un jour, les Français les feront mourir, ces Français à qui ils veulent sincèrement tant de bien. Mais pourquoi ?
Marie-Antoinette écrit souvent à sa mère, l’impératrice Marie-Thérèse, à Vienne. Elle se confie et ses lettres en disent long sur ce qu’elle ressent : « Mon Dieu, qu’allons-nous devenir ? Nous sommes épouvantés de régner si jeunes. »4 Autre lettre : « La mort du roi nous lègue une tâche d’autant plus effrayante que M. le dauphin est resté tout à fait étranger aux affaires, le roi [elle parle ici de Louis XV] ne lui en parlant jamais. » Épouvantés ? Tâche effrayante ? Les mots sont forts ; elle ne dissimule pas – elle écrit à son seul soutien, sa maman –, sa peur est sincère et dramatiquement vraie. Quoi qu’il en coûte, il faut régner désormais et si « la tâche est effrayante », il faut s’y mettre.5
Mais revenons dans les couloirs de Versailles, ce dix du mois de mai de 1774.
Un nouveau roi pour un temps nouveau
Avant de devenir le roi Louis XVI, il fut le duc de Berry, petit-fils de celui qui vient de trépasser et que nul ne regrette. Notre République avec ses mœurs démocratiques nous a fait oublier ce qu’était le Roi de France – même si certains de nos présidents élus tentent de singer la pompe royale. Le Roi était bien plus qu’un homme. Certes, il en était un mais il était l’Unique, l’oint du Seigneur, celui dont tout dépendait, à qui tout remontait et qui pouvait – théoriquement – tout. « Si veut le Roi, si veut la Loi » était la devise communément admise. La France n’avait pas de constitution écrite – actuellement, la Grande-Bretagne n’en a pas et s’en passe fort bien. Il y avait les us et coutumes, disons les habitudes ancrées dans l’histoire et confirmées au fil du temps : un maquis touffu de règles, d’avantages acquis, différents d’une ville à l’autre, d’une province à l’autre, d’une corporation à l’autre ; un entassement dont la France est spécialiste, un « mille feuille » administratif, judiciaire et fiscal auquel personne n’eût osé s’attaquer. Le simple mot de « réforme » sentait le soufre et les philosophes auteurs de l’Encyclopédie prêchaient encore dans le désert français. Alors ? Une France immobile, en 1774, après Montesquieu, Diderot, d’Alembert, Voltaire et Rousseau? Mais qui pourrait la faire se bouger un peu cette vieille douairière arthritique ? Qui nettoiera les « écuries d’Augias » ? Et si le dauphin – pardon, le roi –, lui, jeune, moderne, osait ?6
Mais qui est-il ? On le salue bien bas, on le vénère, on attend tout de ce jeune homme – jeune, il est forcément bon. Mais qui le connaît ? Qui peut dire avec certitude ce qui se cache derrière ces yeux bleus délavés – et vides, mais il est myope et comme les Enfants de France sont interdits de lunettes… C’est idiot, mais c’est ainsi, derrière cette silhouette massive à la démarche oscillante – certains diront qu’il marche « comme une oie » –, déjà lourd à vingt ans, peu loquace, visiblement placide – mais de la placidité du bœuf. Oui, qui le connaît ? Quels sont ses désirs, ses ambitions ? À quoi pense-t-il ?
Bien malin qui pourrait le dire. Un grand gaillard déjà empâté – il mange trop, c’est de famille. Un timide, comme Louis XV, intelligent sans doute, cultivé, sûrement, sous des abords un peu rebutants. A-t-il seulement un projet de gouvernement ? Qui va-til mettre aux affaires ? Quel projet secret tapi dans le cœur de cet homme dont dépendent vingt-sept millions de sujets ? En a-t-il seulement un, de projet ?7 Timide, il semble indifférent quand il n’est qu’indécis, brusque voire brutal quand il n’est que maladroit. Mais que ressent-il, si jamais il est capable d’émotion ?
De l’angoisse. Et l’inquiétude de celui qui doute de ses capacités. N’oublions jamais que lui, Louis, duc de Berry, ne devait pas régner. C’est son père, d’abord, puis son frère aîné, Bourgogne, qui devaient assumer ce fardeau. Mais il est roi. C’est la volonté de Dieu – Louis est un croyant, très, trop peut-être ? Lui a-t-on appris le métier de roi ? Jamais. Enfant malade et souffreteux, on espérait sa mort, jugeant que ses puînés, Artois et Provence (les futurs Charles X et Louis XVIII) seraient d’un autre calibre. Cela ne peut inspirer confiance dans son avenir. Son éducation ? On lui a donné le duc de la Vauguyon, un borné méchant et incompétent. Son mariage ? On connaît : pas d’enfant en vue. Il a grandi seul, sans un ami, sans un confident. Mais est-il liant ? Non, trop timide, trop maladroit, trop mal embouché. Né bourgeois, il eût fait un bon notable, aimant sa femme, ses enfants, fidèle, économe, sachant tenir son rang et sa maison, sans passions excessives – et même sans passion du tout –, aimant la table, la chasse, le bricolage (il eût fait un excellent serrurier), la lecture, la géographie. Un bon bourgeois, un prudhomme sans doute, incolore, invisible, ordinaire. Mais, pour son malheur et celui de ses peuples, il est roi, roi de France, l’Élu de Dieu. Et puis, cette femme qu’on lui a fait épouser, sa femme, est trop belle, trop brillante. À ses côtés, il a l’air encore plus balourd qu’il n’est. Elle va en venir bientôt à le mépriser et l’appeler « le pauvre homme ». Charmant. Ses frères le détestent et ne cessent de savonner la planche sur laquelle il doit péniblement exercer le pouvoir. Et son cousin d’Orléans, Philippe? Oh c’est simple : il votera sa mort lors de son procès. Quelle famille !
De cet homme dont on peut dire que le costume endossé est trop grand pour lui, on eût pu faire un bon gros bourgeois allemand aimant sa femme, la bière et la choucroute, l’horlogerie, la serrurerie et la géographie, respecté de ses concitoyens et appelé à quelque fonction corporative au sein de sa cité. Je dis « allemand » car, si l’on y regarde d’un peu près, il est plus allemand que biologiquement français. Sa mère, l’épouse du Grand Dauphin décédé, était saxonne; sa grand-mère, l’épouse de Louis XV, était polonaise : Marie Leczinska. Si l’on remonte dans le temps, on trouve des Autrichiennes parmi ses ascendants royaux, quand on allait chercher des archiduchesses ou des infantes espagnoles (c’est tout comme dans la lignée de Charles Quint) – toujours Habsbourg. Et ses frères ? Ils épousent des princesses de Savoie et la Savoie n’est pas la France – pas encore. Et son aïeul Henri IV? Marié à une Médicis. Ceci dit, les rois d’Angleterre sont des Allemands du Hanovre8, le roi d’Espagne est descendant direct de Louis XIV, les tsars de Russie épousent des princesses Allemandes sans faiblir.
Louis XVI, vu au débotté, c’est une énigme enfouie dans le secret, le tout enveloppé de mystère. Louis-le-taciturne, Louis-le-secret. Secret le roi, ou vide ? Que dissimule-t-il si jamais il a quelque chose à cacher ? Cet homme sans nerfs ne paraît s’émouvoir de rien, semble glisser à la surface des choses et des êtres qui l’approchent. Un roi pour temps calmes, mais, en cas de crise, que fera-t-il ? Pour ses ministres, ce sera un permanent supplice de ne pas savoir quelle est sa volonté. Leur maintien en place dépendant de sa faveur, il leur faudra savoir s’ils plaisent ou non. Mais comment décortiquer cette noix dont nul ne voit jamais le fruit ? Pas de confident, autant dire pas d’ami car, pour en avoir, il faut oser se confier. Même la reine ne parvient pas à dégager le vif de l’ombre qui l’entoure. Attendons ses premiers actes de souverain ; sans doute y verra-t-on plus clair.
Qui va-t-il mettre aux affaires ? Pas les hommes du défunt roi, pas Choiseul. Choiseul lui rappelle trop son mariage autrichien qui fut son œuvre. Choiseul, c’est la Du Barry. Louis détesta l’amoralité de son grand-père, ses maîtresses et leurs créatures. Son père à lui, ce père vénéré, lui a transmis sa bigoterie et l’horreur des maîtresses. Pas de danger qu’il en ait, lui ! Hélas, outre la pudibonderie, son père a ancré en lui une idée du croyant qui peut être néfaste ; sa foi est celle de la résignation devant les évènements qui ne peuvent être que l’expression de la volonté divine. Son apparente apathie voire son asthénie peuvent s’expliquer ainsi. Sa foi, profonde, sa dévotion sont celles du candidat au martyre. On le verra trop bien lors des crises de 91-92. Il ne se révoltera vraiment que lorsque les politiques voudront attenter à la religion. Ce sera alors le sursaut du croyant blessé. Pour simplifier, l’Évangile de Louis est celui de la résignation face aux actions d’hommes qu’il ne comprendra pas. Avoir nourri son éducation de Fénelon et Bossuet ne prépare pas à lutter.
Sans doute commencez-vous à trouver le portrait outré et peu flatteur. C’est vrai ; il l’est, mais il est le Roi et, en dépit de ses défauts, il lui faut régner. C’est Dieu qui lui a confié cette tâche – ce fardeau – et ce vrai croyant confinant à la bigoterie (selon les malveillants) ne saurait aller contre la volonté divine. On ne comprendrait rien, mais rien, à Louis, à ses actes, ses décisions, si l’on oubliait cela. Cet homme semblera tout accepter, tout subir sans broncher, en chrétien acceptant l’épreuve, mais se braquera toujours quand on voudra l’amener à renier sa foi ou sa majesté royale. Ce n’est certes pas un mauvais homme celui qui écrit : « Un roi ne doit avoir d’autre sujet que de rendre son peuple heureux. » Notez qu’il parle du bonheur de son peuple, pas de son bonheur à lui, qu’il n’aura jamais à la bouche des propos relatifs à la grandeur de son règne, à sa gloire, tout ce fatras des hommes parvenus au sommet. Il ne sera jamais Napoléon. Allons, avec cette pâte-là, on peut espérer ! Ses peuples peuvent croire que ce roi-là sera un bon roi. Mais ce dont ils doivent être convaincus, ces braves gens, c’est que ce lourdaud apathique ne transigera jamais sur son droit à régner : « Le roi tient de Dieu l’autorité souveraine, dont il ne doit rendre compte qu’à Lui, mais s’il asservit son peuple, il est coupable devant Dieu. » J’ai souligné le membre de phrase qui porte en lui tout le drame de son règne, d’où viendra le fatal malentendu : il est convaincu n’avoir de comptes à rendre qu’à Dieu quand les Français voudront qu’il rendît des comptes à la Nation et à ses représentants élus. Le droit divin va se fracasser contre la démocratie parlementaire. Pour résoudre ce dilemme, il faudra la mort de l’un ou l’autre. Louis voudra de toutes ses forces le bonheur des Français quand les Français ne voudront recevoir le bonheur que d’eux seuls. Saint-Just prononcera un jour ces mots lourds de sens et de sang : « Il faut qu’un roi règne ou meure. » Et ailleurs : « Le bonheur est une idée nouvelle en Europe. » Mais le bonheur selon le gros garçon monté sur le trône n’a pas le même sens pour lui que pour Rousseau, Mirabeau, Danton ou Robespierre. Cet homme très « pointu » sur la théologie, eût pu faire un bon gros prélat attentif au troupeau de ses ouailles, un de ces évêques faisant le bien dans son diocèse, si le sort en avait décidé ainsi. Ce roi-prêtre a une vision paternaliste de sa charge. Il est comme ces patrons qui souhaitent de tout cœur améliorer le sort de leurs salariés quand la classe ouvrière n’entend rien recevoir qu’elle n’ait conquis de haute lutte. Pour elle, la classe ouvrière, ce qui vient d’en haut, même le bien, est forcément suspect. Seul vaut ce qui a été arraché par force. Dramatique.
D’autant plus dramatique que le terrain sur lequel va s’avancer le roi est un terrain miné. Rien n’est simple en France. C’est un pays merveilleux que tous envient mais un pays pourri de contradictions. Les Français, et c’est une constante dans l’histoire, aspirent au changement à condition de ne pas bouleverser leurs habitudes ; ils veulent des réformes sous réserve qu’elles ne touchent pas à leurs acquis ; ils iraient même jusqu’à souhaiter une vraie mise à plat de la fiscalité dans la mesure où cette révision fiscale touche le voisin mais pas eux. Si la France de 1775 est fort différente de celle de 2020, les Français, eux, se ressemblent étrangement. Mais la France à la mort de Louis XV, que dit-elle, que pense-t-elle, que veut-elle ?9
Un roi réformiste pour une France en mutation ?
Notre vingt et unième siècle nous fait vivre dans une France nivelée, unifiée, rabotée, centralisée à force par les Jacobins de la Révolution et leurs successeurs. Ce que décide Paris pour Lyon, Nice ou Mont-de-Marsan, nous l’acceptons parce que, depuis deux siècles, on nous a appris à l’accepter et le trouver comme allant de soi : la même langue, les mêmes lois et règlements, les mêmes impôts, les mêmes droits et les mêmes devoirs. En annihilant les différences régionales et les particularismes provinciaux, la République née en 1792 a rayé d’un trait les Libertés de nos aïeux. Cette uniformité, ils ne la comprenaient pas. Que ce qui était bon pour l’Artois le fût aussi pour l’Auvergne, ils ne pouvaient le concevoir. La France de 1775 était diverse et c’est pourquoi le roi parlait de ses peuples quand la Révolution ne verra que le peuple. Le terroir des uns n’était pas celui des autres ; les modes de vie variaient d’une province à l’autre en fonction des coutumes et cela tenait au fait que la France unifiée par les rois n’était pas encore « Une et indivisible ». Il y avait des Frances et leurs habitants étaient fiers d’être bretons ou auvergnats sans d’ailleurs chercher à en savoir davantage. Mais pourquoi ?
C’est la rançon de l’histoire et de la construction millénaire du pays, construction commencée par les premiers Capétiens à partir d’un domaine royal qui n’allait guère plus loin qu’Orléans au sud et le Valois au nord. Nous n’allons bien évidemment pas refaire l’histoire de cette construction mais, en quelques lignes, tenter d’en faire un résumé, une synthèse absolument nécessaire si l’on veut bien comprendre la suite.
La France n’est pas tombée de Saturne toute bâtie. Elle s’est faite, les rois l’ont faite peu à peu, patiemment, avec obstination, longtemps avant tous les autres. Quand Louis XVI reçoit sa charge, l’Allemagne n’est qu’un fatras de plus de trois cents États ; l’Italie n’est pas encore Italienne : elle est napolitaine, papale, autrichienne et même l’Angleterre éprouve encore des difficultés à « angliciser » l’Écosse ou l’Irlande. Et l’Espagne ? Certes, depuis la Reconquista conclue en 1492 par les Rois Catholiques (Isabelle et Ferdinand), elle est une mais déjà en dégénérescence sous des rois Bourbon nés de Louis XIV.
La France n’a pas encore le visage actuel : elle vient d’acquérir la Lorraine et la Corse mais le Rhône est une frontière. Le comtat Venaissin n’est pas encore français, Nice non plus. La politique de nos rois – politique que poursuivra la République – sera toujours d’arrondir le pécule, comme le paysan soucieux d’acquérir un champ, puis un autre : le but ultime ayant toujours été « les frontières naturelles » : les Pyrénées, les Alpes, le Rhin.
Au début, la France était bien petite : Provins n’était pas en France, la Somme fut longtemps une frontière. Les Capétiens furent enserrés par l’empire Plantagenêt qui allait jusqu’aux rives de la Seine (c’est Richard Cœur de Lion qui fit bâtir Château-Gaillard). Le duc de Bourgogne sera le grand-duc d’Occident, plus riche que le roi ; ses domaines iront de Mâcon à la mer du Nord. La Comté bourguignonne – notre Franche-Comté – sera terre d’Empire jusqu’à Louis XIV et l’Alsace idem. Lille était espagnole. Sedan ? Elle était principauté souveraine de Turenne ; mais oui ! le grand Turenne, le maréchal de Louis XIV, dans sa principauté de Sedan n’était pas français. Nancy ? Louis XV l’achètera en viager à Stanislas Leczinski, ex-roi de Pologne et épousera une de ses filles fort désargentées.
Les mariages, bien plus que les conquêtes militaires, firent la France moderne. Comme un hobereau, le roi épousait une princesse étrangère qui lui apportait en dot un territoire. Le roi apportait le titre ; la fiancée, les biens. Ainsi, le fils aîné du roi devint le Dauphin de Viennois quand le royaume acheta ce territoire à des princes fort démunis. Le plus bel exemple est celui de la Bretagne et l’union de la duchesse Anne qui posa le duché dans la corbeille de mariage avec Charles VIII.
Qui dit mariage dit « contrat de mariage ». C’est ainsi que, chaque fois qu’une ville ou un territoire entraient dans la mouvance française, le roi acquéreur avait pour habitude de consentir – en les garantissant – des privilèges, exemptions, franchises et droits divers attachés au terroir concerné. Le but était de rassurer les habitants et de consolider la nouvelle union. C’est fondamental. Entre le roi et la ville devenue française s’établissait un véritable acte notarié qui définissait sous quelles conditions on vivrait désormais ensemble. Chaque fois que le roi promulguait un édit royal, le parlement provincial ne se gênait pas pour lui faire remarquer que telle ou telle clause lui interdisait, à lui, le roi, de faire ceci ou cela ; ce qui revient à dire que les rois avaient le plus grand mal à uniformiser et que ce qui était bon pour Pierre ne pouvait s’appliquer à Paul. Nous abordons là un des vrais et graves problèmes qui s’offraient à résoudre. Tout poussait à l’unité voire à l’unification. Les marxistes appelleront ce phénomène « le sens de l’histoire ». La France, pour avancer dans le sens du progrès devait raboter ces franchises, privilèges, exemptions divers et variés.10
Ce qui nous amène à constater l’extrême diversité, voire la complexité du royaume de France, cet empilement séculaire difficile à gérer. Sous les baillis et sénéchaux, officiers du roi, ou sous les intendants provinciaux, les lois et règlements royaux se modéraient ou variaient selon les us et coutumes locaux que les peuples n’omettaient pas de mettre en avant auprès des divers représentants de l’autorité royale.11 Les taxes et impôts, que l’on tendait à uniformiser, variaient d’une province à l’autre ; c’était grave car cela entravait la libre circulation des marchandises. Un exemple : le problème crucial des blés.
Le pain était et sera longtemps encore la base alimentaire des Français les plus pauvres. Le pain se fait avec la farine du blé, encore qu’on y adjoignait d’autres céréales ; on parlait ainsi des blés. Mais les blés de Beauce ou de Brie acquittaient des taxes en voyageant d’une province à une autre. Conséquence : les régions productrices n’avaient pas toujours intérêt à vendre leurs blés là où on en manquait. La coutume était de consommer sur place les grains produits. Les disettes successives étaient souvent le fait du problème de la libre circulation des marchandises. Le climat aggravait les choses : en hiver, canaux et rivières gelaient et bloquaient les péniches. Ne disposant pas encore de camions et de trains, on pouvait manquer de grains à quelques lieues de silos remplis.
Louis XVI l’avait bien compris et ce sera la première bataille de son règne : la guerre des farines. Nous verrons cela. Plus globalement, le pays, immobile sous Louis XV, avait un besoin crucial de réformes. Mais, à vouloir réformer, on se heurte toujours à ceux qui se complaisent dans le statu quo : ceux que nous avons coutume de désigner sous le vocable de privilégiés. Ah, les privilégiés ! Que n’en a-t-on pas dit ! Pour nous, en 2020, les privilégiés, les nantis, sont les nobles et les évêques. Prétendre cela, c’est simplifier à l’excès.
La France des privilèges
Claude Manceron dans son monumental Les Hommes de la liberté brosse le tableau d’une phrase : « Les nobles désœuvrés et les magistrats corrompus de cette fin de siècle. » Tableau cruel, mais hélas vérifiable. La France est en gésine d’un grand chambardement. Pourquoi ?
Ce sera le sujet du grand débat de la première Révolution : les privilégiés opposés à l’égalité. Le privilégié, c’est toujours l’autre, le voisin qui deviendra bientôt l’ennemi. Mais qui sont-ils ? Combien sont-ils ? La noblesse et le clergé, certes, mais pas seulement. La noblesse ? Quelle noblesse ? Celle de Versailles, ces quelques milliers de parasites nourris de pensions royales ou celle des campagnes ? Le clergé ? Quel clergé ? Le pauvre curé de paroisse en charge de ses ouailles ou le grand seigneur riche à millions ? Quoi de commun entre un recteur breton et le cardinal de Rohan, évêque de Strasbourg, libertin qui se perdra dans l’affaire du Collier de la Reine ? Ou Loménie de Brienne, archevêque de Toulouse et qui sera contrôleur général des finances (ministre de l’économie et du budget pour nous) ? Trions afin d’y voir plus clair.
Le premier des trois Ordres du royaume, c’est le clergé. Le roi est le Roi Très-Chrétien, c’est tout dire. La France est couverte d’églises, d’abbayes et de couvents. Les séminaires pullulent. L’Église de France est le premier propriétaire foncier. Ses biens représentent plus de la moitié du patrimoine foncier du royaume! Mais cette fortune colossale est sacrée. Nul n’oserait y mettre la main. Et le clergé (en fait une centaine d’évêques et archevêques tous nobles) en dispose librement et sans contrôle. Ceci est le résultat de mille ans : dans les temps anciens de la dissolution de l’empire carolingien, le seul recours, le refuge habituel des pauvres manants fut souvent, avant l’apparition de la féodalité, l’abbaye. Les moines du Xe siècle furent les grands défricheurs, les grands cultivateurs. Chez eux se réfugièrent les derniers savoirs, les vestiges de la culture. Eux seuls lisaient et écrivaient. La Francie qui n’était pas encore la France survécut chez eux et grâce à eux. Il n’y avait pas d’État, pas d’ordre, nulle sécurité, peu ou pas d’avenir. L’Église a maintenu, dans l’espérance et la foi, les bases du royaume à venir. Infatigable propagandiste de la paix intérieure, toujours opposée aux brutalités des fauves féodaux, protectrice des arts par le mécénat, fondatrice des premières universités, l’Église, en dépit des défauts et vices de certains de ses prélats, à bien mérité du royaume. En 1775, l’Église (catholique, cela va de soi ; les protestants et les juifs ne comptent pas légalement), exempte d’impôts, riche à milliards, n’est cependant pas inutile. Elle assure des services publics importants : l’état civil (puisque tout passe par le curé : naissances, mariages, décès), la santé (puisque nombre d’hôpitaux dépendent de congrégations), l’éducation (puisque les petits-maîtres d’école sont contrôlés par le curé). Si l’on repère un sujet dégourdi et digne d’intérêt, le curé le recommande à son évêque et propose aux parents de mettre le gamin au petit séminaire (au collège) afin de lui fournir gratuitement les moyens d’avancer. S’il se révèle avoir, en plus, la foi, on poussera le drôle vers la prêtrise. Sinon, il fera du droit, peut-être médecine ou autre chose. Ordonné prêtre, peut-être aura-t-il le destin des grands ecclésiastiques qui ont fait la France : Suger, Mazarin, Richelieu, Dubois (sous le Régent), Fleury (sous Louis XV). De tout ceci, il appert que l’Église n’est pas sans jouer un rôle important. N’oublions pas qu’elle est aussi le refuge des cadets de famille nobles sans fortune (le destin de Talleyrand-Périgord en est un pur exemple). Oui, mais les impôts ? Certes, elle n’est pas imposable mais en paie tout de même. Tous les cinq ans, l’Assemblée générale du clergé se réunit et décide de voter le don gratuit, c’est-à-dire une somme qu’elle consent à donner au roi « pour ses pauvres », si l’on veut. Cette somme n’est pas sortie tout droit de leur aumônière : c’est le roi, ou son ministre qui en ont fait la demande. Pas d’impôt mais la fiction d’un don. C’est tout comme. Remarquons au passage que, ce faisant, l’Église fonctionne presque – je dis : presque – comme une institution démocratique puisqu’une assemblée représentative vote un don consenti et non imposé, à l’anglaise, en somme. Enfin, toutes proportions gardées. Il est vrai que si elle donne, elle reçoit aussi : elle perçoit les droits seigneuriaux attachés à ses biens fonciers et la dîme, cet impôt sur la production agricole qui lui permet de se financer. Ne pleurons pas sur le sort de l’Église de France : à côté de curés crottés aussi démunis que leur troupeau, on trouve de grands seigneurs richissimes tel le cardinal Louis de Rohan (le futur gogo de l’escroquerie du Collier dit « de la Reine »). Il mène, dans son palais-château de Saverne, une existence de rajah des Indes : il possède quasiment la moitié de l’Alsace, est évêque de Strasbourg, Grand Aumônier de France (il dispose de la feuille des bénéfices ecclésiastiques, ce qui fait de lui une sorte de ministre du budget de l’Église.) Ainsi il nomme, ici ou là, qui il veut comme titulaire de revenus des abbayes, cures diverses ou fonctions honorifiques grassement rétribuées. Il dispose d’un budget énorme et ne rend compte qu’à Dieu (le pape est loin et l’Église est gallicane), ne l’oublions pas ! Il est aussi landgrave d’Alsace, libertin à peine déiste, couvert de maîtresses, un grand aristocrate sous la pourpre cardinalice, très bel exemple de la noblesse mitrée de ce siècle. Remarquons que s’il est prince, c’est d’Empire (d’Allemagne donc) et non de France ; l’Alsace, acquise par Louis XIV, est tellement compliquée et embrouillée territorialement que les Alsaciens eux-mêmes ne savent plus trop s’ils sont de France ou d’Empire.
Mais les temps ont changé. L’Église n’est plus aussi sacrée qu’auparavant. Trop impliquée dans les luttes politiques (elle a souvent fourni les grands ministres), ridiculisée par les nouveaux intellectuels tels Voltaire ou Diderot, elle n’est plus inattaquable. L’arme de la tolérance et de l’anticléricalisme va saper les fondements de son pouvoir millénaire.
Le deuxième des trois Ordres est la noblesse – sujet sensible et délicat en France –, c’est un à deux pour cent de la population : dans les trois cent mille personnes en y incluant la progéniture. Elle est issue des temps anciens où une brute guerrière plantait sa demeure au sommet d’une motte, la ceignait d’une palissade et devenait le seigneur de fait. Le noble rançonnait plus ou moins les vilains vivant dans son ombre ; il avait droit de justice, parfois de battre monnaie, était une sorte de petit roi. En contrepartie, il protégeait ses manants qui se réfugiaient dans son enclos en cas de danger ; et le roi l’appelait à son service de guerre en cas de nécessité. Un exemple : les La Rochefoucauld, une des familles les plus puissantes de France, ne descendent-ils pas d’un ancêtre Foucauld qui s’incrusta sur son rocher (sa « roche ») des Charentes ? La noblesse vit, en très grande majorité, sur ses terres ; elle a fermiers et métayers, coupe son bois, amende les sols (surtout la bande des physiocrates dont fait partie le marquis de Mirabeau, surnommé « l’Ami des Hommes »). Il existe donc une noblesse « progressiste » différente de la noblesse conservatrice, indifférente au sort des gueux à qui elle ne daigne pas accorder un regard. Comprenez-moi : pour une certaine aristocratie, l’ordre des choses est immuable : il y a Dieu, le Roi (son lieutenant sur terre), le clergé et la noblesse (et souvent on est de l’un et de l’autre) et les manants. Les manants, les vilains, les jacques sont là pour travailler, produire, nourrir le royaume et mettre chapeau bas quand le seigneur vient à passer. Chacun à sa place et pourvu que rien ne change ! Je simplifie, bien sûr, mais à peine.
La noblesse de province, elle, se pique parfois de progrès, voire de progrès « social ». Ainsi le duc de La Rochefoucauld-Liancourt (une branche picarde de la tribu, à côté de Clermont-de-l’Oise) fait vacciner la population, crée des ateliers afin de donner du travail à tous. Exploiteur ? Démagogue ? À nos yeux, oui, mais, en son temps, un homme qui veut le bien et bien faire. Un noble, riche, dans l’air du temps.
Vous me direz : Oui, mais le noble ne travaille pas, se goberge, danse, chasse et vit de la sueur des pauvres manants. Oui. Mais non. Le statut de l’aristocrate lui interdit un certain nombre d’activités. Pour vivre noblement, il convient de ne pas déroger, c’est-àdire ne pas exercer la plupart des métiers ni aucun commerce. Un noble peut faire valoir ses terres, travailler les métaux (Buffon maître de forges), être verrier, et c’est tout. Nul commerce, ni banque, ni aucune autre activité industrielle. Évidemment, il peut servir, être militaire. Il peut et doit au roi ce qu’il est convenu d’appeler l’impôt du sang – et souvent à ses frais. Si sa famille a de quoi, elle achète un brevet d’officier au fils qui veut servir ; on achète un grade comme une charge, un office. C’est ainsi que le jeune marquis de La Fayette, descendu de son Auvergne et marié à une Noailles, deviendra officier et partira aux Amériques, comme on sait. Les cadets ? On en fera donc des lieutenants ou des abbés, voire des évêques si l’on sait y faire (voir Talleyrand-Périgord qui, infirme, ne peut être soldat et devient donc ecclésiastique).
Michel de Saint-Pierre a écrit, dans les années cinquante, un roman, Les aristocrates, situé en Bourgogne, qui nous en apprend beaucoup sur la noblesse rurale. Elle tire souvent le diable par la queue, peine à entretenir le château familial, à faire valoir le domaine, doit parfois vendre une terre pour acquitter les impôts… bref, vit comme ses paysans, se lève et se couche tôt, travaille, fait comme elle peut, s’inquiète de comment marier ses filles et que feront ses fils. Il est vrai que la noblesse a subi de plein fouet les réformes de la République et l’abolition du droit d’aînesse qui, seul, protégeait l’entièreté du patrimoine familial.
Autre cas, autre exemple. Relisez Les mémoires d’outre-tombe, le début, l’enfance du jeune François-René, vicomte de Chateaubriand, garnement de Saint-Malo qui revient grelotter à Combourg, cette vieille bâtisse lugubre où l’on se nourrit assez chichement, guère mieux que les paysans bretons des environs. Un privilégié, François-René ? Quel avenir possible ? S’il est l’aîné, il reprendra le domaine ; sinon, le séminaire ou le régiment. Les filles ? Le couvent, parfois, le mariage, souvent et puis, quoi ?12
À côté de la noblesse des campagnes et des villes, il y a celle de Versailles, la plus critiquable car la plus vaine et la moins utile. Six mille personnes sur les trois cent mille que compte la noblesse de France. Une bande de rapaces toujours à quémander des faveurs royales. Quand Louis XIV a créé Versailles et sa cour, c’était après la guerre civile de la Fronde ; là, il les tiendrait à l’œil, loin de Paris, loin des complots possibles qui l’avaient traumatisé, lui, enfant ballotté entre les menées subversives des bourgeois de Paris et de quelques grands noms rebelles : la Grande Mademoiselle, le cardinal de Retz, Condé, tant d’autres… Le jeune roi découvrait que la véritable ennemie du roi c’était la noblesse. Je vous surprends ? Contre les restes de la féodalité, le roi s’appuie alors, comme avant, sur le tiers état. Depuis Philippe le Bel, c’est ainsi ; les ministres seront souvent des roturiers, juristes ou autres, plutôt que des ducs ou princes. Le plus célèbre fut Colbert, fils de gros drapiers rémois.
La noblesse est héréditaire. Oui et non. L’ascenseur social passe souvent par l’achat d’une charge ennoblissante. Le bourgeois peut parfaitement devenir noble de robe et propriétaire de son office : c’est la vénalité des charges. Si, de plus, il devient propriétaire de terres, il met bientôt un « de » avant son nom ou celui de son domaine. Il a changé d’Ordre. C’est ainsi que la noblesse se reproduit et se multiplie.
Mais la haute noblesse, qu’elle soit d’épée, de robe (magistrats) ou ecclésiastique, a un point faible. Ces géants sont pétris d’une argile qui s’effrite : la vanité les tue. Afin de « paraître », on affecte de ne pas compter. « Morbleu ! C’est bon pour un épicier de compter ses écus ! » On entretient des armées de jardiniers, valets, femmes de chambre, cuisiniers, garde-chasses, médecins personnels, voire musiciens et goujats divers dont on ignore parfaitement le nom et le nombre. Or donc, on dépense, on dilapide, on s’endette, on a recours à des usuriers atroces ; notaires et intendants s’arrachent les cheveux mais qu’y faire ? On a un nom à préserver et les charges vont avec. Les années 1780 vont voir exploser des faillites retentissantes que nul n’ignorera : les Rohan-Guéménée (une branche de la grande famille de Rohan où l’on trouve le cardinal, les Rohan-Chabot, Rohan-Soubise, la branche du fameux maréchal de Louis XV vaincu à Rossbach), etc. Une faillite à trente millions de livres ! Mais aussi celle du duc de Choiseul – mais oui ! le fameux ministre de Louis XV, auteur du renversement des alliances et organisateur du mariage du dauphin Louis et de l’archiduchesse Marie-Antoinette : encore une catastrophe financière ! Des créanciers hurlant partout, des domaines bradés pour boucher les trous, mais rien n’y fait. On se tourne alors vers le suprême recours : le Roi. Le roi n’abandonnera pas ces grands personnages ; il prête des millions (avec l’argent de l’État, mais qui distingue l’argent privé de l’argent public quand il s’agit du roi ?) L’État donc volera au secours de ces glorieuses cigales. Même les Orléans, cousins du roi, trafiquent en lotissant des morceaux du Palais-Royal ! On en est là ! Qui mettra de l’ordre dans ce micmac ? Comment est-ce possible ?
C’est possible parce que la noblesse a rendu, en des temps plus ou moins reculés, de grands services à la France ; elle en a été payée par sa position privilégiée. Des hommes tels que Turenne, Vauban, Buffon, tant d’autres, ont « fait » la France, ont contribué ou contribuent encore à son prestige, font qu’elle est, en dépit de ses difficultés, la première nation du monde civilisé – donc du monde tout court. Mais si l’on creuse un peu, on devine une société parvenue à son sommet dans le goût, l’art de vivre, le raffinement quelque peu précieux. Après le sommet s’amorce l’inévitable déclin. La France de Louis XVI nous apparaît en dégénérescence. À l’image de sa reine, elle devient légère, frivole et dépensière – je parle bien sûr de « la France qui compte », pas celle des manants ou des bourgeois. La noblesse et le haut clergé en sont les symboles vivants. Cette impuissance, cette perte de virilité, cet appauvrissement du sang auront des conséquences tragiques dans quelques années quand la révolution menacera physiquement le roi et qu’il ne trouvera plus personne à ses côtés. Où seront passés les hommes de cœur ? Émigrés pour sauver leur peau ou aplatis devant le nouveau pouvoir.13 Nul ne les plaindra, ces ci-devant qui avaient vécu au-dessus de leurs moyens et chez qui les privilèges devenaient des injustices éhontées. Posons ce principe encore valable de nos jours : tout privilège non justifié par un service rendu à la collectivité devient une injustice qu’il convient d’abolir. On y vient.
Mais, à côté de ces faisans de haut vol, ducs, princes et archevêques, il est une foule de privilégiés réels moins fortunés mais tout autant acharnés à défendre bec et ongles leurs rentes de situation : tous ceux qui ont mis le pied dans la petite noblesse, ont escaladé la première marche et entendent bien n’en pas rester là, les robins qui fourmillent (magistrats, notaires, procureurs), les gros entrepreneurs protégés par le système des corporations qui interdit le libre travail à qui ne fait pas partie du système, les gros négociants enrichis par la traite négrière (même Voltaire en fut !), et même les rapaces de la ferme générale.14
Le troisième des trois Ordres est tout naturellement le tiers état. Selon le pamphlet célèbre de l’abbé Syès ou Sieyès, paru en 1788, « le tiers état n’est rien et aspire à être quelque chose. » Le Tiers, c’est quatre-vingt-quinze pour cent des Français et le seul producteur de richesses. On y trouve de tout : depuis le manouvrier (le lumpenprolétariat) jusqu’au gros bourgeois, entrepreneur, industriel, magistrat qui gratte à la porte de la noblesse afin d’y entrer. Le Tiers regroupe tout ce qui n’est ni prêtre, ni baron. Il paie l’essentiel des impôts qui ne sont pas consentis ni votés. Il n’a pas de représentation nationale : pas de chambre des Communes à l’anglaise ou de Congrès à l’américaine. Nous allons bientôt nous frotter à lui. Il est l’avenir et ne le sait pas encore.
Le grand embarras : la fiscalité
Je ne prétends aucunement faire œuvre d’historien de la fiscalité de l’Ancien Régime. Rien n’est plus touffu, plus abscons, plus rébarbatif et plus incompréhensible pour un homme de 2020 que l’étude de la fiscalité des années 1780. Mais il faut bien en dire quelques mots puisque ce sera la cause directe et immédiate de la Révolution. On a dit, à tort, que les nantis ne payaient pas d’impôts quand l’immense majorité des Français étaient écrasés, tondus, saignés à blanc. C’est faux. Nous vivons depuis la Révolution dans l’habitude d’une fiscalité s’appliquant à tous et uniformément. Ce n’était pas le cas alors. Le problème n’est pas que les membres des deux premiers Ordres ne payaient pas d’impôts que seuls ceux du tiers état devaient couvrir. Non, le problème est qu’ils ne payaient pas les mêmes impôts. Nul n’échappait à l’impôt (hormis le roi) mais d’aucuns étaient exempts de certains impôts.
Distinguons d’abord impôts directs et indirects. L’impôt direct, le plus visible, ponctionné dans la poche du citoyen, était et demeure toujours le plus impopulaire. Le plus connu, c’est la taille. Il perdure dans l’expression courante, dont on a oublié l’origine, « être taillable et corvéable à merci ». La corvée, cet impôt « physique », cette réquisition destinée à l’entretien des routes et ponts, était une plaie pour le monde rural. Elle sera réformée et remplacée par une taxe locale bien mieux ressentie. Mais le grand sujet, le grand mal, c’est la taille. C’est l’impôt roturier par excellence, un peu notre IRPP moderne. Autre impôt : le fouage est une taxation « par feu » (rien à voir avec foyer). Le « feu » est une entité fiscale difficile à établir et variable selon les provinces.
Les nobles ne paient pas la taille ni le fouage mais la capitation, un impôt « par tête ». Il y a aussi les impôts du dixième et du vingtième dont sont exempts nobles et clercs. Privilège ? Oui, mais rappelons que les nobles ne pouvaient exercer la plupart des métiers faute de déroger. Ils n’avaient comme revenu que celui de leurs terres (ainsi que les droits seigneuriaux), ne pouvaient être commerçants, juristes ou banquiers. Ils pouvaient recevoir une pension royale liée à un service rendu ou un office public (la charge écrasante de la Maison du Roi tenait, notamment, dans les multiples pensions versées à certains nobles, pensions souvent justifiées par un service militaire ou injustes comme des faveurs accordées). De plus, ils devaient « l’impôt du sang » c’est-à-dire la guerre et eux seuls. Précisons que bon nombre de nobles ne pouvaient vivre décemment des revenus de leurs terres et que les pensions royales leur évitaient la gueuserie. On trouvait donc à la campagne des nobles authentiques guère plus fortunés que nombre de tenanciers de leurs fiefs.
Le clergé ? Exempt, certes, mais on tournait la difficulté par le « don gratuit » consenti périodiquement par l’Assemblée du clergé ; c’était une sorte d’hypocrisie fiscale mais dont le rendement était bien réel.
Par contre, ainsi que nous avec la TVA, tout le monde payait des impôts indirects, assis sur la consommation. On les nommait les aides. Les traites étaient les droits de douane. Mais les communes percevaient l’octroi, cette taxe perçue à l’entrée en ville de toute marchandise (une manière d’impôts locaux). Les bureaux de l’octroi ont perduré longtemps à la périphérie de nos villes. À Cherbourg, ma ville natale, il y avait une « rue de l’octroi » en 1960. Vieille survivance.
J’ai gardé la gabelle pour la bonne bouche. Impôt sur le sel dont l’État avait le monopole (comme nos taxes sur l’essence, l’alcool ou le tabac). La gabelle était un pâté d’alouette puisque chaque Français devait acheter tant de livres de sel par an – même s’il ne les consommait pas. Impôt indirect mais assimilé à un impôt direct. D’où l’existence de contrebandiers (les faux-sauniers) fournissant un sel détaxé. Les douaniers leur faisaient la chasse et gare à eux s’ils étaient capturés : les galères ou la corde ! C’est ainsi que les douaniers, dans le jargon populaire, sont devenus des gabelous mais qui se souvient de l’origine du mot ?
Et le clergé ? Il perçoit la dîme faute de quoi il serait bien incapable d’entretenir écoles et hôpitaux dont il a la charge. Le curé est un élément essentiel de la vie paroissiale, nous l’avons vu.
Et les droits seigneuriaux, ces survivances des temps obscurs ? Pour certains, ils ressortent plus du folklore que de la fiscalité. Sauf le droit de chasse. Ah ! le droit de chasse réservé au noble ! Grande future conquête de la Révolution. Deux cents ans passés, le droit de chasse est viscéralement acquis à nos ruraux. Le droit de tuer des bêtes, ils ne l’avaient pas et même il leur était interdit de clôturer pour protéger leurs cultures souvent dévastées par le gibier. Le braconnage était puni de mort ! Mais n’oublions pas que ce privilège nobiliaire était de fait le seul sport que pouvaient pratiquer les hobereaux. À nos yeux, droit injuste et abusif. Je n’en dirai rien de plus. La protection des cultures par l’enclosure donnait lieu à d’incessantes querelles entre le paysan et son seigneur. C’était pain bénit pour les avocats.
Ce tableau rapide – trop – et forcément incomplet nous montre une France mal imposée parce qu’inégalement imposée. Une des grandes revendications du tiers état sera celle-ci : des impôts, oui, mais consentis par les représentants élus de la Nation et non imposés arbitrairement (voir l’exemple anglais). Les Français ne contesteront pas le bien-fondé de l’impôt mais son mode de calcul et son assiette. Bref, tout le monde égal devant la taxe. Ce sera cela la Révolution, avant toute autre revendication.
Bien, mais les Français étaient-ils aussi imposés que notre école républicaine veut nous le faire accroire ? Pas tant que cela, finalement, puisque la pression fiscale représentait, en gros, un mois de travail quand, de nos jours, nous œuvrons quasiment six mois de l’année pour l’État. Je vous laisse mesurer le progrès réalisé.
Turgot ou l’espérance déçue
Anne-Jacques-Robert Turgot, baron de l’Aulne, entre dans l’histoire. Il est l’homme essentiel des débuts du règne. L’homme clé, l’espoir de tous ceux qui pensent et savent que le moment est venu de faire enfin bouger cette vieille machine rhumatisante qu’est devenu le royaume. Sera-t-il le Sully de Louis XVI ? Turgot, plus qu’un théoricien, est un homme de terrain qui a fait ses preuves. Longtemps intendant du Limousin (rappelons que l’intendant est une sorte de préfet qui commande au nom du roi), il a agi en supprimant les corvées et libérant les grains.
Deux écoles s’opposaient : les économistes – les physiocrates – comme le marquis de Mirabeau, et les encyclopédistes – les philosophes. Il nous faut bien en dire quelques mots. Voici : les physiocrates professent que l’agriculture est la seule vraie productrice de richesses quand la France en est encore aux balbutiements de l’industrie lourde. Elle prendra avec retard le chemin de la révolution industrielle à l’anglaise, celle du machinisme. Les physiocrates seraient assez dirigistes.
Les encyclopédistes, les philosophes donc, sont plutôt libéraux. Turgot, en fait, en est assez proche. Ainsi, dans son intendance de Limoges, pragmatique, il établit un cadastre rigoureux, ce qui permet d’établir une assiette de l’impôt foncier direct (la taille) plus saine. Libéral au sens économique, ses travaux influenceront grandement le pape du libéralisme économique moderne, Adam Smith. Smith dans son ouvrage majeur, La richesse des nations, reprendra moult idées de Turgot.
En 1774, dès son accession au trône, Louis est sollicité par Maurepas, son « mentor », qui le convainc d’appeler Turgot au contrôle général des finances, c’est-à-dire au ministère de l’économie et des finances.15
Quand il accède au ministère, Turgot trouve une situation financière mauvaise (mais quand fut-elle bonne dans notre histoire ?), avec un État largement déficitaire (et pas de budget !). Que faire ? Trop de dépenses, pas assez de recettes, classique. S’endetter en empruntant ? (Cela ne vous rappelle-t-il rien, cet endettement public que nul ne sait effacer ?) Turgot, lui, prône les restrictions budgétaires, une économie de dépenses, bref, la rigueur (là encore, non, cela ne vous évoque rien ?) Donnant l’exemple, Turgot décide de réduire son propre traitement de cent quarante mille livres (francs) à quatre-vingt mille (le franc de Louis XVI équivaut à six francs des années 1970, à peu près ; simplifions : une livre égale un euro mais le pouvoir d’achat était évidemment différent). Turgot est assuré du soutien royal sans lequel rien n’est possible. Jusqu’à quand ?
Il décide alors de s’attaquer à son grand sujet, au nœud gordien : la libre circulation des grains.
Le problème des grains en France
Vaste sujet. Pour l’immense majorité des Français, pour ceux qui n’ont que leurs bras et leur courage, qui n’ont pas « de quoi », pas de réserves fiduciaires ni de rente, le pain est tout. C’est la nourriture incontournable, une denrée sacrée. Et cela durera longtemps encore. En 1947, le gouvernement proclamera un pacte de subsistance afin d’assurer les Français d’un pain régulier. En 1947 !
Les nombreuses disettes qui ponctuent l’histoire de France prirent souvent leur origine dans la pénurie de farine. Des farines, devraiton dire, car le pain est fait non seulement de froment – c’est le pain blanc, celui des riches – mais aussi d’autre chose : seigle et autres céréales – c’est le pain noir, le pain du prolétariat, le pain du peuple.
Comprenons bien : un pain de quatre livres vaut, quand tout va bien, huit sous (vingt sous font un franc). L’ouvrier d’en bas, le manouvrier, gagne environ vingt sous par jour. Il a femme et enfants, évidemment qu’il lui faut bien nourrir. Le repas du prolétaire, c’est, au mieux, une soupe de légumes, un morceau de fromage (et encore !) et du pain. Du pain !16
Parfois, les grains se raréfient (mauvaises récoltes, problèmes climatiques, guerres), les prix montent. Entre douze et quinze sous, le pain devient inabordable aux trois quarts des gueux. C’est la faim et donc, souvent, l’émeute dite frumentaire. Que faire ? Stocker. Les autorités ont créé de vastes silos. Ainsi, Paris dépend, en amont, de Corbeil (de là datent les Grands Moulins de Corbeil) ; en aval, de Pontoise. Quand manquent les grains à moudre et donc la farine à pétrir, on déstocke. Bien. Mais le véritable problème, c’est la libre circulation des grains d’une province à une autre. Si la rivière gèle, plus de péniches. Turgot fera bâtir des estacades en bois, sorte de brise-glace qui permettent de garder le fleuve navigable. Bien encore.
Mais il y a la spéculation. En période d’abondance, de bas prix, les producteurs n’ont aucun intérêt à vendre ; ils préfèrent attendre la rareté – relative – des grains et la montée des prix. Ainsi, quand l’intendant provincial impose un prix accessible à tous, les grains disparaissent – phénomène qu’on reverra sous la Terreur : la loi dite du maximum, la taxation des denrées, générera une pénurie totale.
Edgar Faure, dans La disgrâce de Turgot, a parfaitement analysé le phénomène. Ce qu’on appellera « la guerre des farines », en avril 1775, sera surtout l’expression d’une angoisse populaire. Les Français attendent toujours de l’État qu’il résolve leurs problèmes. Ils veulent un état protecteur – donc dirigiste – mais respectueux de leurs libertés. Dans le cas du pain, la taxation leur convient alors qu’elle entraîne la pénurie. C’est une constante économique : tout abandon du dirigisme pour le libéralisme économique amène, dans un premier temps, une hausse des prix. Ensuite, le marché se régule de lui-même comme le sang circule librement dans l’organisme. Le contrôle étatique n’incitant pas à vendre à vil prix entraîne la rareté quand ce n’est pas la pénurie. Sinon, il faut la dictature d’un État policier. Ce sera le cas en 1793-1794.
Turgot est intimement convaincu qu’il faut libérer les grains. Mais l’été pourri de 1774 amène une mauvaise récolte en 1775. Les prix montent tout naturellement au moment du déstockage. Les émeutes se multiplient de l’Île-de-France à la Bourgogne et la Normandie. Le drame est que, si l’économie se gère sur le moyen et le long terme, la faim, elle, est quotidienne. De plus, chaque province, nous l’avons dit, avait coutume de consommer sur place sa propre production. Un paysan poitevin se sentait dépossédé si l’on portait ses grains en Auvergne où l’on en manquait. La libre circulation sans entrave apparaissait comme une spoliation et une mesure antipopulaire. Paris, énorme lieu de consommation (il y avait environ mille deux cents boulangers à Paris), Paris dépendait de la Picardie, de la Beauce, de la Brie, donc bien évidemment des transports. La paroisse porte ses grains au meunier local et ne voit pas pourquoi elle devrait les expédier à la ville de cinq ou six lieues. Le voisin, c’est déjà l’étranger. « Gardons nos grains au cas où. Les autres ? Qu’ils se débrouillent. » Égoïsme ? Non, mais le sentiment de l’intérêt national n’est pas encore né. La patrie ? Oui, mais la petite patrie, celle dont on ne perd pas le clocher de vue. La crise frumentaire de 1775, dite guerre des farines, va démontrer que la conscience nationale et la notion de bien public élargi font encore partie du domaine des vues lointaines.
Turgot a raison quand il se place sur le plan national. Mais au niveau du terroir, il a tort. Libérer les grains ? Oui. Mais donneznous du pain pas cher et tout de suite. Cette affaire, gênante, où l’on devra faire marcher la troupe et pendre quelques « meneurs » pris au hasard, va être le premier accroc, le premier point de désaccord entre Louis et son ministre. Des réformes ? Oui, sans doute, mais elles dérangent. Et si elles dérangent le roi dans sa quiétude…17