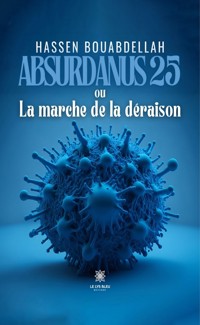
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le 22 mai 2025, un luxueux yacht s’écrase à Marseille, tuant treize personnes et déclenchant une mystérieuse pandémie virale. Témoin de l’accident, Aria, une philosophe quinquagénaire, erre dans la ville meurtrie. À l’hôpital où elle est admise pour suspicion de contamination par « Absurdanus 25 », elle rencontre Marguerite, une jeune banquière aux multiples talents. Son mari, Splendide, conducteur de TGV, brave la quarantaine pour la ramener à Paris. À son arrivée, il découvre une Marseille plongée dans le chaos et sous la coupe du parrain de la drogue, Lambdabradoro. Un écran géant dans le ciel affiche une phrase troublante : « La déliquescence se fait, lorsque la raison s’en va », laissant présager une perte de la raison collective. Dans ce tourbillon de confusion, la quête de survie d’Aria et Splendide se transforme en une lutte poignante pour redonner un sens à leur monde.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Cinéaste et auteur d’une cinquantaine de documentaires dont le célèbre Barberousse, mes sœurs, Hassen Bouabdellah prend la plume pour s’adresser aux peuples des deux côtés de la méditerranée auxquels il est lié par l’âme. Par ailleurs, il est l’auteur de trois romans, "L’insurrection des sauterelles", "Pauvre Martin, pauvre misère", ainsi que "Mâ Fatoûm et l’assassinat de l’Imam de la mosquée « Yves Rocher »".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 673
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hassen Bouabdellah
Absurdanus 25
ou
La marche de la déraison
Roman
© Lys Bleu Éditions – Hassen Bouabdellah
ISBN :979-10-422-3636-6
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Les événements de ce roman se déroulent en mai 2025
On ne peut mieux dire que c’est une fiction ?
Absurdanus 25 n’est qu’une fantaisie d’affabulateur
À ma formidable petite-fille
Indira Anquetil
Fille d’une mère aimante et d’un père prévenant.
Avant-propos
Un mot à mes futurs lecteurs
Peut-être, n’est-il pas donné à un auteur de s’adresser à ses futurs lecteurs, mais je vais le faire quand même. Un fort ressenti m’y oblige. Ce même ressenti qui a déclenché l’inspiration de ce livre et qui a guidé son écriture du premier jusqu’au dernier mot.
J’ai peur. Une peur insidieuse, une obsédante angoisse de l’acabit du tortionnaire qui sait s’y prendre à petit feu. À faire pâlir mes globules rouges. Et d’autant de la pire sournoiserie qu’elle épargne la chair pour oppresser l’esprit. À entortiller de toutes les façons mes neurones.
Non ! malheureusement, dirais-je, ce n’est pas moi qu’elle vise, cette peur.
Elle vise ce qu’il y a en l’homme de plus cher : la raison. L’ennemi de l’animalité. La potion magique qui donne sens à toute chose. La faculté de se pénétrer du secret du monde et de le reconstruire. La boussole qui aide à trouver les bons chemins, celui de la vérité, celui de la justice, celui de la fraternité, celui de la lucidité et du discernement. De la modestie aussi. L’outil qui permet d’imaginer et de concevoir. Les deux ailes de l’amour, de l’abnégation et du savoir-vivre avec les autres. Le grand filtre des sentiments.
La raison est le rachis qui tient haut la tête d’une nation. Qu’elle recule et voici place faite aux démons destructeurs… Il fut trop tard pour des civilisations qui ne l’ont pas compris à temps.
Je marche et je frissonne. Est-ce que la France est en train de perdre la raison ? Descartes serait-il en train de mourir une seconde fois ? Ai-je raison d’avoir peur ?
Ce livre est écrit par un homme qui a peur pour la France pour des gens qui ont peur pour la France.
1
L’action de ce récit commence le jeudi 22 mai 2025.
Sifflant de la force d’un hourra libérateur, le TGV 6176 s’extirpa du tunnel de la Nerthe.À cet instant précis, dans un parfait synchronisme, Aria ouvrit les yeux. Pour les fermer instantanément. Un puissant éclat solaire lui brûla les paupières. Soleil du sud d’un jeudi 22 mai. Dans un mouvement de recul, sa nuque heurta la paroi arrière de la cabine du conducteur à laquelle avait été fixé le siège sur lequel elle avait pris place, un siège aussi provisoire qu’austère et que la SNCF n’installait que rarement, uniquement pour répondre aux nécessités du service. Elle ressentit des sortes de picotements au niveau des yeux, ce qu’elle prit pour des brûlures, eut peur d’être en train de perdre un œil, voulut soulever ses paupières, n’y arriva pas, lourdes et douloureuses qu’elles étaient. Plongée dans le noir, elle eut la sensation que son corps s’était délestée de son poids et que, maintenant, elle n’était plus qu’une plume ondoyant dans un espace sidéral, sans étoiles et sans profondeur. Un long moment, il lui sembla qu’elle se vidait de ses pensées comme on se vide de son sang et qu’elle avait perdu sa capacité de voir, d’entendre et même de respirer, elle qui aimait tant écouter l’air taquiner ses narines. Dans un étrange réflexe, elle plaqua très fort sa main gauche contre ses yeux comme pour leur interdire de se déplier tandis qu’avec sa main droite, elle tira frénétiquement le lobe de son oreille dans l’espoir d’en favoriser une meilleure écoute. Oh ! miracle, elle perçut un écho lointain, un chuintement émergeant d’un gouffre profond, mais qui, très vite, devint ce qu’il était, rien d’autre que le roulement sourd et régulier du TGV, glissant sur les rails. Et le hasard aidant, un double cornement lui confirma qu’il s’agissait bien du bruit d’un bolide sur rail, filant à une vive, très vive allure. La goutte de sueur cessa son irritante avancée dans le sillon du haut du corps. Aria dégrafa deux boutons de la rangée de son chemisier d’un blanc immaculé, glissa sa main sous le corsage, essuya le suintement. Libéra un souffle éthéré. Languissant…
— Aria chérie, t’es fatiguée ? Tu t’ennuies ? Je comprends…
Après un silence, ajouta :
— Mais je suis tellement content que tu sois là. Ici… Avec moi…
Ne sut que dire de plus. Se tassant, il s’enfonça de tout son poids dans son fauteuil de conducteur. Les épaules infléchies.
Le train corna. Pareil à un raclement de gorge qui déchire le silence ! Tuut, uu ! Tuuu, uu !
— Marseille, dans 10 minutes ! annonça, Julien. La voix légèrement éraillée…
Mais son annonce resta sans réponse. Il tourna légèrement à gauche le volant-accélérateur pour décélérer. L’indicateur de vitesse marqua 170 km/h.
Il se retourna, transgressant la recommandation qui exigeait du conducteur de doubler d’attention à l’approche d’une agglomération et surtout de ne pas quitter des yeux le pare-brise dans le souci de pouvoir promptement faire face à tout accroc.
— Mais… Mais… t’es toute rouge… Qu’as-tu donc ? T’es malade… S’il te plaît, pas aujourd’hui… Par tous les dieux, pas en ce jour… En ce jour de renaissance.
Aria ouvrit les yeux, mais resta figée, bouche ouverte comme si elle ne pouvait plus parler… Toute rouge en effet, le front encore moite, les cheveux ébouriffés, le regard vitreux, elle avait l’apparence d’une femme incapable de se remettre d’un bouleversant cauchemar. Que m’arrive-t-il ? s’interrogea-t-elle, je ne suis plus dans mon assiette, que donc se passe-t-il ?
Le visage de Splendide Julien, le conducteur et mari, se creusa encore plus, le front se ridant, les sourcils se hérissant, les lèvres se crispant.
— Tu me fais peur comme ça mon cœur. C’est sûrement de la faute de ce vilain strapontin, de cet instrument de torture, devrais-je dire. Tu as mal dormi et tu as tous les os qui chahutent, c’est donc ça ?
— Ne dis pas de bêtise ! répondit-elle en hochant négativement la tête.
Sa main se porta sur son sac accroché au strapontin. L’idée de prendre un doliprane lui traversa la tête, mais fut vite oubliée, écrasée par un sentiment de mal-être. Elle ne comprenait pas. Elle n’aimait pas ne pas comprendre. Était-ce un début de grippe ? Le dos de la main sur le front lui révéla qu’elle n’avait pas de fièvre.
Elle se leva. Debout, elle défroissa ses cheveux coupés à la garçonne, écarquilla ses yeux d’un vert clair et aussi translucides qu’une gemme fraîchement rincée. Elle se masqua de sérénité avant de s’approcher de son homme :
— Ne t’en fais pas va, ça va aller… Un petit passage à vide, rien de plus. Bientôt Marseille, m’as-tu dit… ?
— Oui. Marseille. Ma ville fétiche. La ville que je vais retrouver après trois ans de galère et de merdouille de toute sorte. Je crois que c’est fini tout ça… Fermée, la parenthèse. Me voilà pilotant de nouveau cette magnifique machine. Une merveille. Comme je suis content de m’en être sorti à bon compte. D’avoir vaincu la malchance, la maladie et le malheur. Une belle triple victoire. Hip, hip, hip hourra ! Beaucoup grâce à toi. Grâce à tout ce que tu dégages en force et en inspiration. T’es mon énergie, ma raison et aussi mon ange gardien, mon amour pour toujours, pour toujours celle qui me fermera les yeux.
— Il se peut que je m’en aille avant toi, mon cher, le bon sens que tu m’apprêtes te le dit. La mort est un enfant gâté qui prend ce qu’il veut quand il veut. Ses caprices sont infinis…
— N’y pense pas. C’est vrai que tu as de l’avance sur moi, mais tu es d’une meilleure santé. Après tout ce que la vie m’a fait subir, faut-il encore que la mort s’y mêle. Mais bon. Il y a juste que je veux te dire tout mon contentement, toute ma joie, tout mon plaisir que tu sois là avec moi en ce jour du renouveau. Viens ! Approche un peu que je sente ton parfum, que je bisoute ton joli nez d’oiseau du paradis. Que serais-je sans toi, ô, reine de ma destinée…
Pauvre enfant qui ne veut pas grandir, pensa-t-elle. Voulut l’embrasser sur la tête. Ne le fit pas.
Julien chercha la main d’Aria, ne la trouva pas. Dans un réflexe aussi incompréhensible que vif, la femme replia les doigts et croisa ses deux mains derrière le dos. Un geste instinctif, nullement pensé, nullement dans ses habitudes. Dans le même mouvement, elle esquissa un léger recul. Sur son visage, une imperceptible grimace. Une soudaine révulsion. Pourquoi donc ce refus de communier avec son homme ? Pourquoi ce refus soudain de répondre à sa tendresse ? L’âme humaine a des raisons que la raison ignore… Aria ne se posa pas la question, néanmoins elle ressentit une sorte de crispation secouer sa poitrine, perturbant sa respiration. Pourquoi n’avoir pas pris sa main ? Pourquoi avoir reculé comme prise de dégoût ? Un geste totalement irréfléchi. Dicté par le dégoût ? Non ! Impossible ! Pourquoi impossible ? Jamais rien n’est impossible pour l’inconscient lorsque s’offre à lui l’opportunité de se manifester à notre insu, c’est un drôle de diable, un manœuvrier, un maître de nos souterrains qui décide des choses en toute indépendance, à son gré, selon son humeur. Son inspiration.
— Excuse-moi, j’ai un peu mal à la tête, tu permets, je retourne m’asseoir. Un petit mensonge qui en disait long sur le marasme dans lequel flottaient à la fois son corps et son esprit.
Confusément, il devina que quelque chose n’allait pas chez Aria, mais Splendide Julien ne montra aucun signe de déception, d’agacement ou de dépit. Il aspira une bouffée d’air sans grand bruit et se tassa sagement dans son fauteuil de conducteur, regardant droit devant lui, entièrement concentré sur la voie métallique qui fuyait devant lui. Machinalement, il actionna le bouton de l’avertisseur : un sifflement aussi tonitruant que jubilatoire. Il voulait rire lui aussi. Mais ne put. Ce jour de reprise, de résurrection, béni entre tous… murmura-t-il entre les lèvres, pas suffisamment fort pour être entendu.
Ce jour jeudi 22 mai 2025 n’était pas n’importe quel jour en effet. Pour Splendide Julien ce voyage était un nouveau départ, un espoir vers une nouvelle vie où rien ne serait comme avant. Une reprise… Non pas une reprise. Une nouvelle vie. Une vie sans cigarette, sans alcool et surtout sans ce maudit loto et tout autre jeu de hasard, une vie dans une succession de jours, dont le travail et le culte d’Aria, en seront les deux piliers.
Presque au même moment, cette date du 22 mai 2025 traversa l’esprit de la philosophe cinquantenaire. Un demi-siècle déjà, se dit-elle profondément contrariée. Y a-t-il plus téméraire que le Temps qui avance toujours et ne recule jamais ? « Le temps est une forme pure de l’intuition sensible… » Est-ce bien le moment MOO, sieur Kant ? Remballe donc tes réflexions… Ce faisant, comme mue par un obscur mécanisme, sa main droite passa sous sa chemisette et s’attela à masser son bas-ventre qui la grattait. Un diffus pressentiment s’infusait en elle, angoissant parce que mystérieux. Il lui sembla que son sang se lestait de quelque chose qui faisait ralentir son écoulement, une pernicieuse anxiété traçait son chemin en elle comme celle qui vous prend lorsque de gros nuages noirs s’accumulent au-dessus de votre tête et que, devant le ciel en furie vous vous demandez, la gorge nouée, quel sens donner au déluge ?
Le TGV 6176 entra en gare de Marseille Saint-Charles à 12 h 32 sonnantes. Il s’immobilisa sur le quai n° 1 sous la grande halle de verres et d’acier. Arrosée d’une lumière filtrée, mais flamboyante qui pénétrait aussi bien par les panneaux vitrés du toit que par les larges fenêtres de la façade, on s’y croirait sous serre.
En deux temps, trois mouvements, Julien Splendide, sécurisa le bolide puis tendit la main à Aria pour l’aider à quitter la cabine :
— Vas-y tout au bout, au hall qui donne sur les quais, deux collègues et amis nous y attendent. J’en ai pour quelques minutes à mettre la machine au dépôt pour qu’on me la prépare pour le retour et je vous rejoins. La gare Saint-Charles a beaucoup changé, paraît-il, de nouveaux aménagements l’ont grandement transformée. La grande chaîne « Le train bleu » s’y est installée juste après la fin de l’épisode Covid-19. C’est là que les collègues Pierre et André ont réservé. Il n’y a pas mieux pour fêter un grand événement, m’ont-ils assuré, on y mange comme à une table de rois, on ne va pas s’en priver…
Dans un geste furtif, il posa un bisou sur la joue droite d’Aria, avant de remonter dans sa cabine. La regardant s’éloigner, il ajouta à tout de suite !
Elle fit deux pas, puis revint en arrière :
— J’ai oublié mon sac ! Donne-le-moi. Ajouta, vite, vite !
2
Marseille. Me voici à Marseille. Deuxième ville de France. Que je ne connais pas. La ville de ce pauvre Julien. Mon Splendide de mari. Je suis seule, je déambule sans but précis, je tourne comme ça depuis je ne sais combien de temps, refusant obstinément de m’arrêter à un café pour en prendre un et m’abreuver du verre d’eau qui va avec au grand dam de la grande et pressante envie qui me taraude, ma salive se tarit et ma bouche est toute pâteuse. Je n’ai rien décidé de tout cela, je n’ai nullement prémédité ce qui est bel et bien une fuite, la chose s’étant faite aussi naturellement que l’air rentre dans le nez : Splendide m’a fait descendre de la cabine de conducteur de son TGV, j’ai lâché sa main, elle était chaude, après deux ou trois pas, j’ai réalisé que j’ai oublié mon sac. Je suis revenue en arrière et j’ai demandé à Julien d’aller le chercher, glapissant « vite, vite ». Oh ! Rien, un petit pétage de câble passager. Il pouvait parfaitement me le rapporter en venant tout à l’heure me rejoindre au restaurant « Le train bleu ». Mais voilà, une cloche s’est mise à carillonner dans ma tête, je veux mon sac, je veux mon sac. Une hargneuse saute d’humeur de fillette gâtée criant ma poupée, ma poupée. L’enfant qui reste en moi. Une hargne que rien ne justifiait : mon sac ne contenait que des bagatelles féminines, genre rouge à lèvres, humidificateur, car les miennes de lèvres ont tendance à gercer, tictac à la menthe, mouchoir, lunettes de soleil, poudre et autres babioles dont je ne me sers que très rarement. Donc à part mon iPhone, rien de spécialement important et ce n’est pas le scrupuleux et loyal compagnon de mes jours qui allait me le piquer. Absurde tout cela. Monter sur mes grands chevaux de cette façon n’avait pas de sens, cette rogne enveloppée du désir de froisser mon homme, n’était, je crois, que l’expression paroxysmique du mal-être qui squatte mon corps et mon esprit depuis un bon moment. Cela ne veut pas dire que je ne tiens pas à mon sac, à vrai dire pas un sac, mais plutôt une musette inspirée des musettes des soldates anglaises de la Deuxième Guerre mondiale, un conflit de quatre-vingts millions de morts au minimum. Mon engouement pour la british chose me vient de plusieurs mois de visionnage à la BnF1 des archives du monstrueux conflit, cela pour le compte de mon doctorat au titre : « Essentialisme et libre arbitre dans les sociétés modernes » ce qui avec le recul de plusieurs années, me paraît philosophiquement d’une pertinence limitée. J’avais alors 28 ans et je vivais la période la plus chaude de mon idylle avec Mahfouz. Gorgée d’amour, le corps frémissant, je m’asseyais devant une visionneuse, et laissais défiler le noir et blanc des images pétillantes de grains et de hachures : Londres, des essaims d’avions déversant leurs bombes sur la ville, des flammes, des jets d’eau, des gens qui courent, les scènes passaient devant mes yeux dans une sorte de flou, comme les paysages défilent lorsqu’on marche repu et épuisé. Quand soudain, ma main, de son propre chef, se jeta sur le bouton arrêt sur image de l’appareil : des soldates défilant cagoulées de masque à gaz, c’est intéressant, mais il n’y a pas de quoi prendre son pied, me dis-je alors et j’allais relancer le film lorsque mon œil pointa la bretelle blanche entourant le corps de la Britannique de gauche en tête de cortège, et encore une fois ma main, sans me consulter, appuya sur « Play » et oups ! voici le sac, je veux dire la musette. En gros plan s’il vous plaît, détaillée comme il se doit. J’ai stoppé de moi-même cette fois-ci et j’ai reluqué l’objet avec un émerveillement surprenant et c’est peu dire. Les vestiges de ma nuit d’amour s’évanouirent, faisant place nette à une intense concentration qui entérina définitivement ma flamme pour la musette militaire de la soldate anglaise. Un coup de foudre ! Alors même que j’en vivais un avec un homme. Je me promis d’en avoir une. Le samedi suivant, au bras de mon amant égyptien, j’ai fouillé de fond en comble les « puces » de Clignancourt, j’ai fini par en dénicher une. En bon état en plus. Le soir même, je l’ai nettoyée à coups de brosse à linge et de savon. Le plus difficile fut de retourner les quatre pochettes intérieures pour les débarrasser de divers résidus, il y avait aussi une bonne dose de sable. Je me rappelle comme si c’était hier, le sable éveilla l’intérêt de Mahfouz, il en pinça quelques grains entre le pouce et l’index concluant que c’était là du sable du désert égyptien et que certainement, la Britannique à qui appartenait le sac, soldate ou infirmière, avait dû se frotter aux Allemands à Tobrouk. Brave héroïne ! J’ai adopté définitivement ce type de sac – de musette, je veux dire, pour avoir sur moi une marque de l’héroïsme féminin incarnée en l’occurrence par ces braves soldates britanniques. Le sac oublié dans la cabine du conducteur n’est pas celui acheté aux puces, celui-ci avait fait son temps. Celui dont il s’agit est une copie exacte, confectionnée avec l’aide de ma voisine couturière qui occupe toujours l’appartement au-dessus de celui que j’occupe actuellement avec Julien, 3 rue Erard. Ce dernier exemplaire, fait à base de toile de Canvas, est tout récent, mais est-ce une raison pour s’énerver comme ça ?
J’ai récupéré mon sac-musette puis j’ai rejoint le hall qui donne sur les quais, j’ai cherché des yeux la brasserie « Le train bleu », ladite brasserie où l’on mange comme des rois, dixit la pancarte publicitaire, comme si l’on avait besoin de manger comme des rois, c’est-à-dire manger peu, jeter beaucoup – ah ! la royale absurdité. Soudain, mon regard fut happé par des luminaires scintillant de mille feux, des murs lambrissés à la Versailles. Tout au fond une grande horloge, fixée au mur, indiquait 12 h 45, je me suis exclamée : déjà ! Des tables nappées de blanc, des chaises capitonnées sûrement de satin. « Fy fan de fy fan » 2! Exclamation qui donne une idée de mon trouble. Les irascibles exclamations de mon arrière-arrière-grand-mère suédoise ont jailli du tréfonds de ma mémoire. C’est vrai que je n’aime pas trop dire les gros mots en français, mais ça passe avec le patois de mes aïeuls, descendants des valeureux Vikings.
Trop de lumière aveugle. Trop d’or appauvrit !Ce n’est pas pour moi ces choses, ai-je fini par conclure à haute voix, chantonnant ces mots comme on chantonne les vers d’un poème. La salle est presque vide. Ni Pierre ni André. La vérité : j’ai oublié de zieuter les environs du royal palais à bouffe et pour cause, irritée comme je suis, j’ai oublié ce que Splendide avait suggéré en ce qui concerne le repas de midi. La Révolution françaisecoule dans mon sang si bien quetout ce qui se rapporte aux têtes couronnées et à leurs glamoureuses histoires me sortent par les trous du nez : je suis restée plantée sur place, le crâne embrouillé de questions aussi vaines qu’inutiles.
Je quitte la gare. Je chemine lentement. J’essaye de ne penser à rien. Enfin, si… Après un menu silence mental, si je puis le dire comme ça, perce dans mon esprit la question de savoir si par cette fugue je n’étais pas en train de gâcher un peu ou même beaucoup la fête de reprise de Splendide. Je ne crois pas, il s’est assagi et sait maintenant faire avec tout ce qui arrive sans crier gare. C’est un grand acquis que la guérison de son insupportable TOC. Bon, ça va, je n’entends ma conscience me dire que j’ai mal fait et qu’il faut que je retourne le rejoindre. Non ! aucun regret, aucun remords, aucun trouble ! Ça m’étonne, mais c’est comme ça. Nul sentiment de résipiscence.
J’aime ce garçon. Je l’aime comment dire ? Gentiment. C’est un homme humble, à la parole modeste, bon et retenu comme le sont souvent les gens des savoirs pratiques. Il ne puise pas dans ce qu’on appelle le savoir des ignorants. C’est reposant. C’est une bonne chose qui fait qu’on n’est pas deux philosophes dans le même lit. Pas plus que deux fous dans le même village, deux philosophes sous le même toit, c’est l’enfer. Mais à toute chose un revers, c’est un guignard, un guignard à servir d’icône à la confrérie des malchanceux… Sainte-Marie, pleine de grâce…
Mes jambes se débrouillent toutes seules. Ce sont elles qui mènent la barque. Au petit hasard. C’est bien sauf que mon esprit ne veut pas rester vacant. Il trotte, trotte, laissant s’enflammer plein de petites pensées qui, maintenant, se chamaillent, grouillant dans ma tête comme les frelons un jour d’été, comme j’en ai vu dans la ferme de mon grand-père. J’entends, mais n’écoute pas. Mais ça me détache de ces mauvaises ondes qui perturbent mon état. Criii…
C’est une voiture. Grosse, noire et sacrément acrimonieuse. J’ai les yeux qui sortent de leur orbite. Son œil à trois pointes qui frappent d’effroi3. J’en tressaille encore. Je ne sais pas comment j’ai fait pour éviter le choc. Dire qu’elle a failli me faire passer de vie à trépas. Une main me tient encore par le col de la chemise. Je prends conscience que c’est à cette main que je dois la vie. C’est un bras qui m’a retenu à temps me permettant ainsi de faire casser en deux. Un bras de gaillard. Merci à lui. Le parechoc de la limousine continue de me narguer en me renvoyant dans les yeux d’aveuglants rayons du soleil. Les échardes solaires dans les yeux, j’en suis déjà passé par là tout à l’heure dans le train, autant dire j’en ai ma claque. Il n’y a pas que ça, j’entends vociférer : espèce degrosse dinde, pétasse va ! C’est le chauffeur de la luxueuse bagnole. Moi une dinde ? Sale con ! je vais te ravaler tes mufleries. En plus, il n’est pas beau le mec. Un guignol, un vrai de vrai. Épaisse et horripilante moustache passée à l’encre noire, casquette à visière posée de travers, la gorge coincée par la vitre mal relevée – tout à fait, un taré de guignol. J’en pleure à grosses larmes salées ! ça ne peut se passer comme ça ! que je me dis. Je sens le sang me monter aux tempes Veines grésillant, je crie : Moi, une dinde !comment oses-tuespèce delarbin de grippe-sou. Je fonce sur la voiture et pan-pan ! je frappe de toutes mes forces de femme offusquée. Trop fort et à la va comme ça vient. Une chaussure quitte mon pied. Un pied nu c’est pas suffisant pour m’arrêter de taper dans la gueule à cette salope de voiture. Je suis folle de rage !
— Mais arrêtez, à quoi ça sert sinon à vous casser une jambe…
Je sens une main cherchant à m’agripper par le dos. De quoi je mêle...
Je me retourne. Un homme avenant. De forte taille. Les yeux de Gamel, noirs et lumineux. Certainement celui dont le bras m’a évité de mourir. Comment il est ce bras que je le bénisse ? Musclé et velu comme les pinces d’une tarentule :
— Une femme comme vous…
— Qu’est-ce ça veut dire une femme comme moi ?
— Rien de méchant, dame. Cessez de vous démener comme ça. Ce n’est raisonnable. Respirer bien fort plutôt…
— Et quoi encore ?! Être raisonnable dans ce monde de fous…
— Pourquoi vous fâcher ? La colère…
— En voilà une question ! Je ne suis pas fâchée. Une mini colère, c’est tout. Dans une grande colère, vous auriez vu des étincelles me sortir par le nez. J’ai coupé court mes cheveux exprès pour qu’ils n’aient pas à se hérisser. Seulement, il y a que ce malotru de chauffeur a failli me tuer, s’il n’y a pas là de quoi s’offusquer un tout petit peu alors le monde tourne à l’envers. Non !
— Ça, qu’il tourne à l’envers, ça fait un bail, me rétorque le brave homme, les yeux pétillant d’ironie.
Ce poilu de Goliath mérite un sourire. Je lui en fais un en guise d’un au revoir et merci, un salut bien gentil de la part d’une vilaine comme moi, un adieu dépollué de toute inimitié.
Boulevard d’Athènes. L’angle droit est occupé par un grand hôtel, quoi ?! Qu’est-ce que c’est que cette plaisanterie ? « Splendid », sainte Marie, je ne crois pas mes yeux. Le patronyme de mon mari. Moins un « e ». De l’anglais, toujours de l’anglais. Celui de Julien mon mari s’écrit avec un « e » à la fin, conformément à l’État civil de la mairie du 10e arrondissement de Paris. Pauvre Julien que je viens de laisser en plan ! Parler d’un hasard ! J’ai toujours pensé que hasard, coïncidences, bons ou mauvais aléas ne sont ni plus ni moins que des sortes d’outils dont dispose l’ingénierie existentielle de chacun, une magie occulte dont les ingrédients comme les manigances échappent à notre entendement. Il n’y a pas à dire, on n’échappe pas à son destin. Bon ! Mais est-ce le moment de philosopher sur le destin et la perception que nous en avons, pauvres humains que nous sommes ?
Le Splendid hôtel a le soleil dans le dos. Merci pour l’ombre. J’entends mon corps réclamer une pause et, tant qu’à faire, aussi un remontant pour pouvoir continuer sans souffrance. Mon corps aime les étirements, il s’en délecte, il faut dire que ça m’aide à prévenir le mal de dos qui me prend lorsque je marche beaucoup. Combien ? Cinq étirements, j’expulse dehors tout ce que j’ai dans les poumons.
La bâtisse sent le neuf autant qu’un œuf qu’on ramasse dans le poulailler comme on dit. L’édifice a dû être détruit à la sortie de la pandémie du Covid et reconstruit en hôtel. Et de quelle façon ! Ce n’est pas un gratte-ciel, tout juste un modeste bâtiment de huit étages, mais dans une belle combinaison de béton, d’acier et de verre ! Baie vitrée en arc de chaque côté des murs. Pour sûr du Design-Art déco, comme quoi, Marseille, en cela imitant Paris, et comme beaucoup de capitales européennes, veut profiter de l’élan de la reprise post pandémie pour se relooker et se mettre au goût du jour. L’Art déco s’habille de neuf partout dans le monde. Au couple béton acier, s’est ajouté le verre. Prompt dans la construction, sonne moderne et plaît à l’œil, et, et… Et rapporte gros, c’est là l’opinion d’un des conservateurs de la Cité de l’architecture et du patrimoine, visitée il y à peine quinze jours. Et dans cette civilisation des banques et du commerce qui nous infeste, tout ce qui rapporte gros est beau ! L’esthétique du beau artistique est morte, vive l’esthétique du rentable ! Vive l’Art déco ! C’est un formidable tremplin pour le bâtiment ! Et quand le bâtiment va, tout va, n’est-ce pas la formule choc, le slogan incantatoire des gros du BTP ? Art déco, quand tu nous prends. Le BTP grandement haillonné par un virus qui s’en était donné, il faut bien le dire, à cœur joie, aujourd’hui se marie à l’Art déco, mettant les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu !
Tout le rez-de-chaussée du Splendid Hôtel est cerné de vitrines. Que vois-je ? Une sœur jumelle ? Non, moi ! Ça fait un bail que je ne me suis regardé dans une glace. Me voici nez à nez avec une psyché qui en impose. J’avance d’un pas. Impossible de résister à l’attraction du miroir, femme je suis, femme je reste. Je m’entends, riant et persiflant, oh ! miroir, mon beau miroir… je ne sais pourquoi, sans doute pour me moquer de ma petite personne dans une fulgurance inexpliquée d’autodérision. La vitre étant à l’abri du soleil, mon auguste moi s’y reflète presque aussi bien que dans la glace de l’armoire de ma chambre à coucher. Comme mon fond de teint a souffert du voyage, ma rousseur ne se voit presque plus, ce dont je m’en balance comme d’une pomme pourrie. Mon visage paraît calme, tranquille, reposé, nonobstant le désordre de mon esprit. Je trouve amusante cette contradiction entre mon agitation intérieure et l’aspect tout à fait paisible de ma figure. Ce n’est pas pour me déplaire : très tôt dans ma vie de philosophe, j’ai compris et soutenu mordicus que nos contradictions sont souvent génératrices de beauté, canalisatrices de nos meilleures émotions et de nos plus divines extases ! « La beauté est une contradiction voilée ». Merci Sartre. Se voir dans le miroir parfois exaspère, parfois amuse, cela dépend comment on est luné dans le moment où la glace captive notre œil. Un peu gênée aux entournures, mais nullement exaspérée, la preuve hi hi je pouffe carrément. Je me dis, hé Aria, prolonge cette pause etprofite s’en pour scruter de près les ravages du temps sur la femme de cinquante ans que tu es. Cinquante ans déjà ! Un demi-siècle ! À cet âge, la mort s’invite dans vos pensées et, perverse, s’amuse à semer dans les plis et replis de nos idées toute sorte de grains de sel, susurrant l’inanité de notre vie ou détaillant le cérémonial de notre certain ultime voyage. Ah ça, la mort sait s’y prendre pour nous présenter le néant comme le paradis de nos désirs les plus fous.
Check-up. État général : pas très poil de carotte, mais globalement positif. Tout net, tout beau, tout énigmatique : le sphinx tatoué sur mon front ! Une idée de Gamel Mahfouz, décidée à l’apogée de notre histoire d’amour. Les deux mèches, s’ouvrant en V renversé, sont bien en place, encadrent parfaitement le mythique Abou al-Hôl4. Oh ! ces rides – hantise des femmes. Heureusement si peu perceptibles. Dans la réalité, elles sont hélas bien plus prononcées. Pauvre de mes yeux, ils ont perdu leur vert métallique ! pour prendre la forme de deux ronds sombres évanescents sous des sourcils à peine arrondis, nettoyés et passés au khôl comme chaque matin. J’aurais voulu me voir plus gaie, plus souriante, mais ce n’est pas le cas. Mi-ouverte, ma bouche étire mes lèvres, les affinant plus qu’il n’en faut, atténuant la saillie du menton, un menton peut-être un peu trop aigu, mais, après tout, plus ou moins en harmonie avec un visage émacié aux pommettes creusées, en un mot comme en deux, une tronche à la Julia Roberts. À part le nez, penchant un tout petit peu à gauche. Julia Roberts ! Quel talent celle-là, une merveille de dynamisme, d’intelligence et de charisme. Je ne dis pas ça pour m’attribuer ces qualités-là. À part cette petite ressemblance physique, je n’ai pas ni son sex-appeal ni cette notoriété qui fait les choux gras de la presse people. Dans le domaine du charme et de la grâce, elle ferait bander un mort, autrement dit la sensualité qu’elle dégage, toute spectrographique, possède le pouvoir de percer toute boîte à viande, quelles que soit sa forme et la matière dont elle est faite, pour atteindre et revitaliser ce qui chez l’homme fait l’homme. Ce qui est loin d’être mon cas.
J’ai du mal à mettre fin à cet égarement aux relents narcissiques. J’ai les pieds comme rivés au sol, difficile de faire demi-tour. J’ai fermé les yeux puis j’ai cherché par quoi et par où m’éloigner du vitreux objet de béatitude, de m’exfiltrer de son magnétisme. Contre toute attente, ce fut l’image de Gamel Mahfouz qui se refléta dans ma tête. Claire. Nette. Cheveux sel et poivre brossés en arrière, les yeux amusés, moustache parsemée de poils blancs et collant au millimètre près à la courbure de la lèvre supérieure, drue, mais affichant la légèreté de la soie, ah ça oui ! Soyeuse autant que le coton d’Égypte.
Je ne suis pas contente de le voir m’halluciner. Venir en intrus se projeter dans mon imaginaire ! Et pourquoi en ce jour et en cet instant ? Je pensais l’avoir oublié à jamais. Mort. Mort, il y a plus d’un quart de siècle et enterré dans un cimetière du Caire comme dans le côté sombre de ma mémoire. Il faut dire que sa mort, brusque et brutale, m’a fait grandement souffrir. Comment a-t-il fait pour se décadenasser du sarcophage enfoui au plus profond du puits creusé dans la partie mémorielle qui, de plus, est la plus obscure de mon cerveau ? L’impoli, le malappris, je hurle de tout mon souffle poitrinaire. J’ai levé ma tête vers le ciel à la recherche de Râ, le Dieu soleil des Pharaons dans l’espoir de pouvoir l’interroger sur cette irruption en cet instant précis, où je suis mal dans ma peau comme dans ma tête, de l’homme qui m’a faite femme et m’a nourrie au mot « sens ». « Le sens », le roi des mots du dictionnaire et de la vie, disait-il. Sens des choses, sens du savoir, sens de la mort, sens de la pensée, la recherche du sens c’est ce qui mûrit.... C’est une clé qui permet d’extraire le jour de l’obscurité de la nuit. La connaissance a pour matrice le jaillissement du sens, eurêka j’ai trouvé… Ô soleil, Dieu Râ, je te regarde droit dans les yeux et te demande que me veut-il donc, celui-là qui s’agite dans ma tête en spectre ensorceleur ? Est-il porteur de funestes monitions ou souhaite-t-il me prévenir d’un prochain cataclysme, d’une nouvelle plaie dont l’Égypte regorge ? Ou seulement, croyant mon âme en peine, veut-il me faire un petit coucou d’amitié et de réconfort ? À moins que ce soit pour me reprocher si singulièrement de l’avoir si vite chassé de mon esprit, extirpé de mon âme, effacé de mon histoire de vie ? Allez savoir…
J’avance. Un pas devant l’autre, ce qui n’est rien d’autre que l’action de marcher. Ha, ha ! Comme quoi une banalité peut détendre. Un « putain » tout ce qu’il y a de plus rabelaisien s’échappe de ma bouche, putain de moi, putain de toi, Gamel. Ce « putain », comme d’autres grossièretés de cet acabit, appartiennent à mon langage privé, à ce qui se dit seulement en mon for intérieur ; for intérieur que je définis comme l’équivalent d’une salle de délibération où se pèse le pour et le contre.
Dieu merci, cette divagation égyptienne n’a pas ajouté à mon désordre. D’une provenance inconnue, se répand en moi une certaine folichonnerie. À qui dois-je dire merci : au soleil de mai, au spectre de Gamel Mahfouz ou au Sphinx gravé sur mon front ?
Pas très animé le boulevard ! À peine quelques passants. C’est l’heure qui le veut. 13 h 50, l’heure de la sieste ! Dont les Marseillais, dit-on, sont très friands. Je marche à l’ombre des arbres, sur le côté impair, les côtés pairs, pour une raison obscure, m’agacent. Les arbres sont apparemment des platanes. Gorgés de soleil. Leurs rayons inondent de lumière le feuillage, le transformant en buisson ardent. Pauvres arbres aux pieds nus, ai-je déploré un peu comme ça en constatant que les grilles de protection ont été enlevées. Coupées en deux, elles avaient été amoncelées dans l’allée. Beaucoup de nouvelles constructions à droite comme à gauche, il y en a même qui devraient finir en gratte-ciel si j’en crois la hauteur d’une des trois grues. Au moins une vingtaine d’étages déjà.
J’ai soif, moi, ma glotte me le signifie, glup,glup dansouille ma pomme d’Adam. Je m’approche et prends place sur le bord du bassin. Pas une goutte d’eau, sec comme le sable du Sahara. Mais ce n’est pas ce qui va troubler ma sérénité retrouvée. C’est bien de ne penser à rien. Je veux dire de ne pas se mettre martel en tête, de filtrer les idées qui vous assaillent, ne laisser passer que les agréables, les vagabondes, les bienfaisantes. Surtout m’interdire de penser à Splendide. Impossible d’arrêter à temps, l’idée qui s’accroche à mes neurones affirmant que ma fugue n’a pas de sens et ce qui n’a pas de sens n’est rien d’autre qu’une aberration, une absurdité, du n’importe quoi ! dixit Mahfouz. Et comment définir l’absurdité autrement qu’en la comparant à une sangsue dont les ventouses vous garrottent tous les nerfs cérébraux ? Mais c’est fini, la petite bête a débarrassé le plancher. Fini la récré. Rien ne justifie que je reste à Marseille, je n’ai rien à y faire sauf à m’y ennuyer. Pour le dire irrévocablement, je le dis tout haut : pour aujourd’hui c’est trop tard, je vais prendre une chambre dans un hôtel, dormir tout mon soûl, et demain, très tôt, je prendrai le premier train pour Paris, voilà le programme. Décision irrévocable.
Je dis à la soif de patienter. La place des Capucines s’ouvre sur plusieurs rues. Que de panneaux indicateurs ! Six accrochés à cette barre ronde, plantée à ma droite. J’ai en face l’allée Léon Gambetta. L’homme du retour de la République souveraine. Un homme de raison donc ! À droite, le boulevard Dugommier. Ça ne perle plus sous mes aisselles. Et même l’envie d’uriner n’a pas encore frappé à la porte. Mon surmoi me susurre comme le ferait une vieille amie, ne t’en fais pas, Splendide s’est fait une raison, il te connaît bien lui, il te connaît maintenant assez bien, il sait que tu as besoin de temps en temps de prendre le large, de plonger dans l’inconnu, et que le phénomène t’arrive toujours comme une soudaine poussée de fièvre. C’est la preuve qu’il est guéri et que maintenant il accepte les choses comme elles sont, comme elles viennent. Il est niveau max en sagesse. Un fleuve tranquille. Il ne joue plus au loto, ne fume plus, a mis fin à toute forme de précipitation qui était un de ses grands défauts et qui lui a coûté une fois plusieurs millions d’euros. La précipitation va de pair avec la négligence, se précipiter c’est oublier de faire travailler ses méninges, c’est oublier cette étape majeure qu’est la vérification. Vérifier le gâteau qu’on mange, vérifier la sincérité d’un ami, vérifier l’information qu’on reçoit…
Je refuse obstinément de regarder l’heure. Pour quoi faire ?
Mon cœur balance au rythme de cette exquise nonchalance qui me porte. Je sursaute. Éclaboussée par un jet d’eau ! Je tourne la tête. Je vois le coupable s’éloigner de la façon d’une araignée dans un fou sauve-qui-peut. C’est un mini engin, certainement une arroseuse municipale. Je ne l’ai pas entendue arriver, elle doit être électrique. L’électrique est pernicieux et comme tout est en train de devenir électrique, tout est en train de devenir pernicieux. Syllogisme – oui et alors ? – ne suis-je pas en quartier libre… Pauvre de ma jupe ! Complètement mouillée, elle me moule les cuisses. Quelques gouttes ont trouvé le chemin jusqu’à sous ma chemisette, mes seins sont perlés d’eau, j’en sens les mamelons se dresser. Tout cela n’est pas du tout désagréable. Dans dix minutes, il n’en restera rien. La fraîcheur de l’eau, par un aussi bel après-midi quasi d’été méditerranéen, est toujours la bienvenue. Mais le charme est rompu, l’impact soudain du jet a mis fin à mes enfantines errances, je dirais ma cogitation sentimentalo-intellectuelle. Pourquoi, me suis-je mise à marcher vite ?
Je ferme solidement la porte aux idées noires. Toutes mes forces sont aux aguets : aucun accès possible aux ondes intruses l’avenue Canebière. Elle n’est pas très large, mais joliment arborée. Canebière est un nom qui m’est connu. Il m’en souvient que ce n’est pas loin du vieux port, le premier de la cité phocéenne, poumon de la ville, centre culturel et royaume du poisson. Le journal télévisé de chaque chaîne télé en donne des images dès qu’il s’agit de Marseille. Ben ! C’est l’occasion ou jamais de regarder ça de près. Et comme j’ai faim, je ne dirais pas non à une bouillabaisse, cliché oblige. Mais suis-je dans le bon sens ? J’espère ne pas avoir à faire demi-tour. Là, je suis au pied de la Bourse… Et… De la Chambre du commerce. Les deux, dans le même palais à colonnades à la Birmingham Palace. 9, rue de la canebière. À ma gauche, un chantier clôturé de palissades, vertes et bleues. Sans doute un futur édifice Art déco. Bon, je suis dans le bon sens. Le vieux port n’est pas loin. La mer est toute proche. Son souffle taquine mes narines, ses senteurs aiguisent mon appétit, tant et si bien que cela se répercute sur mon estomac qui ne cesse de pousser de grincheux SOS je meurs de faim. Je suis si proche. Je distingue nettement la herse de mâts surplombant une rangée de kiosques et petits commerces. Les drapeaux accrochés aux vergues sont comme collés, ils ne flottent pas dans l’air, mais donnent l’impression d’être collés au ciel. Je traverse le quai des Belges. Je veux me rapprocher de la mer… Me voilà sur l’esplanade qui borde la mer. L’arrivée mérite que je regarde l’heure, pile-poil 14 h 50. La voici la mer, ondulant sa chevelure bleue, insondable, apaisante, consolatrice. Malheureusement trop jonchée de bateaux. Ah ! Un attroupement. Une foule entoure un homme en jean et portant casquette rouge. Il est debout, légèrement courbé sur un chevalet d’une hauteur respectable. Sa main droite se meut lentement, traçant sans doute des courbes ou je ne sais quoi. Certainement un peintre installé là pour une marine. Si c’est le cas, il ne doit pas manquer d’imagination, car les boutiques lui ferment l’horizon de la mer. Une crèmerie. Une pizzéria. Des curieux continuent d’affluer en grand nombre ici Quai des Belges d’après ce que je lis sur le poteau indicateur planté pas loin du métro. Des hommes traînants des chiens, des femmes portant sac en bandoulière, des enfants accrochés aux robes de leur mère, des poussettes de bébé, capuche baissée. C’est maintenant un rassemblement de jour de foire. Combien ? Quarante, cinquante, soixante personnes et même plus. Je veux bien voir ce qu’il y a sur la toile de ce peintre dont le béret fait image d’Épinal : un peu de la croûte tropézienne, un peu ce que j’ai vu chez un certain Jalibert5, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de juger. Deux pas encore et je saurai de quoi il retourne. J’ai du temps à perdre, merci à ce jour de vacances, tombé du ciel, une gratification d’un mal-être que j’espère passager. Un jour de libre cours. Ohhh ! Mais, mais… Min Gud6 ! houuu ! Qu’est-ce que c’est que ça ? Une vague… Le déluge… Une gigantesque cascade. Ça tombe dru. Drôlement jaunâtre… Merde que ça pisse. Le jet de vingt titans urinant ensemble. Combine ? Dix, vingt, trente, cent… Il y a… Un énorme poisson, quelque chose comme ça. Un espadon peut-être. Pris dans le flot… Je le vois mieux… Non, un bateau ! Oui, c’est bien un bateau… Plooouf ! là, il tombe. Comme un fruit pourri. Et se fracasse dans une formidable éclaboussure. Dieu du ciel et du malheur ! Mais qu’arrive-t-il ? J’ai la trouille. Je fais deux pas en arrière et me fige. C’est comme du plomb qui rive mes jambes. Mes deux mains tiennent mon visage, serrent désespérément. Ne pas voir. Ne pas exister. Je ne comprends pas… Aucun cri ne sort de ma bouche. Je ferme les yeux. Je les ouvre. Pour voir la trombe écimer les kiosques. Un tsunami… Des images pareilles au tsunami indonésien7. Hallucinante catastrophe. Sauve qui peut, affolé, affolant. D’explosives giclures partent dans tous les côtés. Aspirent, tournoient, projettent. Chlock, chlock… le bruit mat des corps qui éclatent au sol comme des sacs de farines tombant de hautes épaules. L’embarcation s’est brisée en deux… Un Cauchemar ! Jamais vu un pareil. J’entends crier. J’entends gémir. J’entends mourir…
Je ne peux pas m’en empêcher : merde du ciel et de la mer ! Putain de Dieu… De Dieu fouteur de merde. J’ai l’âme qui tambourine dans la poitrine.
3
Parti de Marseille à 16 h 10, le TGV conduit par Splendide entra en Gare de Lyon à 19 h 32, quai N° 10. Collègues et amis l’attendaient pour fêter sa victoire sur sa grave maladie psychique – un TOC8 selon les médecins, et son retour au travail qui marquait son définitif rétablissement. Après des hourras, bravos, t’as gagné Splendidement (jeu de mots souvent entendu), sommes contents pour toi, bon retour parmi nous camarade, TGV tu es, TGV tu restes, et autres mots gentils, la joyeuse assemblée s’empressa de rejoindre le foyer des cheminots de la gare de Lyon, sise 102, rue de Bercyoù les attendait une collation. Jean Coguelin, élu il y a cinq ans secrétaire du syndicat, était le collègue avec qui Splendide avait le plus d’atomes crochus, n’avait pas regardé à la dépense. C’était ce brave homme, un ami aussi, qui avait harcelé nuit et jour le chef du « Technicentre » SNCF, afin qu’il permît l’installation du fameux strapontin dans la cabine du conducteur du train que Julien devait piloter pour sa reprise du travail, cela après un arrêt maladie deux ans. Avec son sens de l’argumentation, Jean Coguelin sut convaincre le directeur du centre technique, arguant vivement qu’il serait approprié que l’épouse pût accompagner cet agent à peine sorti de son TOC, car n’est-ce pas, après une si longue rupture, reprendre les commandes d’un bolide comme le TGV pouvait présenter quelques embêtements inattendus, la présence à ses côtés d’un être passionnément aimé et aimant aiderait assurément Splendide à mieux gérer sa reprise.
Ne voyant pas Aria revenir avec Julien, Jan Coguelin demanda pourquoi, cela à la fois par curiosité et par peur d’un malencontreux incident.
La réponse de l’intéressé se limita à un sourire qui ne laissait rien voir de ses sentiments.
Splendide, aurait bien voulu rentrer chez lui se reposer du voyage de retour, qui, sans être particulièrement fatigant, était néanmoins long et quelque peu ennuyeux parce que passé dans la solitude, Aria étant restée à Marseille. Mais très touché par cette réception de sympathie et de franche camaraderie, il ne chicana pas sur le temps à consacrer à cette collation de bonne amitié. Avec une réelle gaieté de cœur, il partagea avec chacun des convives un moment d’échange et d’évocation des bons souvenirs partagés. S’il ne toucha pas au vin ni à l’alcool, conformément à ses résolutions prises sur le conseil de son médecin traitant qui, yeux pétillants, décréta sa sortie du morbide tunnel, il fit honneur à tout ce que la table offrait en petits fours et autres gâteries du palais. Trois demi-heures passèrent sans qu’il s’en aperçût.
Pour rentrer, il décida de marcher comme il le fait souvent. À pied, il en avait, pour dix minutes, prendre un bol d’oxygène à l’air libre, rafraîchit l’esprit, surtout le soir lorsqu’il y a beaucoup moins de voitures qui circulent. Rentrer à pied lui donnait aussi l’occasion de passer par l’ex Place du Colonel Bourgoin, aujourd’hui « Place des Blouses blanches » – « son havre intime », comme il l’avait baptisé un jour de vague à l’âme. Il avait une histoire en commun avec cet endroit. Cette amitié s’était construite tout doucement, jour après jour, à la manière dont se pétrissent les choses qui durent. C’est très simple, cette amitié s’initia le jour même de son installation dans le quartier. Pas difficile de se rappeler de la date exacte. Et pour cause… Le jeudi 2 janvier 2014, il y a onze ans donc. Et l’heure : midi passé de quelques minutes. Ce jour était le jour où il avait déménagé pour venir habiter chez Aria, au 3 rue Erard, quittant ainsi définitivement son deux-pièces, situé avenue de Flandre, tout proche du Métro Crimée. L’événement ne pouvait s’oublier. Il bruinait légèrement, un crachin détestable. Il était assis à côté du chauffeur de la Berlingot rouge qui transportait ses affaires – livres vêtements, quelques bricoles, dans une grande mesure des cadeaux de sa mère qui ne ratait jamais une occasion de lui offrir quelque chose, mère dont il n’avait plus de nouvelles depuis 2 ans, depuis qu’elle avait pris la poudre d’escampette avec un amoureux. La radio du véhicule hurlait littéralement. Mais les mots lui passaient par-dessus la tête, ne lui parlaient pas, ses pensées étaient occupées à autre chose, un déménagement, un changement de décor est toujours un moment qui suscite trouble et suspicion, on a du mal à imaginer l’avenir qui nous y attend désormais, difficile d’arrêter l’avalanche de questions enquiquinantes qui s’en suivent. Le journal de 11 h. « … Le cyclone tropical Bejisa qui a frappé l’île de la Réunion a fait un mort et 17 blessés… Vents violents, pluie torrentielle… » Non, c’était sans intérêt pour lui.Il avait tourné la tête à droite. Pourquoi ? Son regard accrocha le haut de la vasque émergeant du bassin de la Place du Colonel Bourgoin : la vue du jet d’eau frissonnant suscita en lui un vague sentiment d’agacement, de mauvais présage, de froidure, pas quelque chose de très fort, mais tout de même quelque chose de déplaisant, un peu ce qu’on éprouve lorsqu’on rencontre, pour la première fois, une personne dont la tête ne vous revient pas. Dans un mouvement de recul, il heurta du coude le chauffeur qui le repoussa d’un coup d’épaule avant de dire nous y voilà ! – 3 rue Erard.
Une fois ses affaires déposées, il sortit, harcelé par la soif. Il prit à droite. À peine trois pas plus loin, il se retrouva nez à nez avec la fontaine. Ses yeux cherchèrent le jet du sommet qu’une bise faisait danser. La sensation de froid se renouvela. Il haussa les épaules puis d’un pas assuré se dirigea vers la brasserie qui se trouvait à sa gauche, la « Boutique à boire et à manger ». Commanda une Heidelberg et un sandwich, beurre fromage. Avait-il fait exprès de se mettre dos à la vitre qui donne sur la place ? Un bon moment, il se tint dos courbé en personne qui ne soucie de rien d’autre que de boire et de croquer avec appétit sa demi-baguette. Puis, brusquement, paya et quitta le lieu, le reste du sandwich en main. Traversa la chaussée, zigzagant pour éviter les voitures, indifférent aux sirènes des voitures. Il prit place sur un banc sans faire attention aux grosses gouttes qui en constellaient l’assise. Ne sentit pas le frisson qui parcourut son échine. Il ne pleuvait presque plus. Mais, ci et là, une goutte continuait de tomber dans l’eau du bassin, crayonnant des ondes évanescentes. Il avala le croûton du sandwich puis étala ses bras le long du dossier de la banquette et ferma les yeux. Il crut entendre le ronronnement du petit jet d’eau au sommet de la vasque. Il sombra dans un sommeil tranquille. Reposé, il rentra chez lui sur le coup de deux heures de l’après-midi.
À cette séquence gravée pour toujours dans sa mémoire, s’ajoutait un volet qui lui était absolument consubstantiel. La nuit, la Place du colonel Bourgoin s’invita dans son sommeil, une scène digne d’un film de la troisième dimension où rien ne ressemble à rien. Un début de rêve, délicieux et poétique : des arbres qui dansent en se tenant la main en anges de la fraternité. Il ne comprend pas, il ne s’était jamais intéressé à un arbre. Des voix de sirènes lui susurrent, sur un ton réprobateur, un écho étrange « chênes de la place Bourgoin ! hou ! hou ! Il ne comprend toujours pas. Ne veut pas comprendre. Impossible de fermer les yeux. Il serre les poings dans un grand effort pour essayer de faire baisser ses paupières. Puis, incompréhensiblement, changement de décor : le nuage blanc, enveloppant les arbres-anges-danseurs, se transforme en maussade lumière crépusculaire. Les chênes se mettent à se multiplier, pullulant comme des vers dans le ventre d’une charogne. Ils grouillent, menacent de leurs mandibules tranchantes, se dévorent. L’horreur. Bouche fermée, il crie : Béjisa, le cyclone Béjisa ! Tout bascule dans un tumulte sans nom. Bruit et fureur. Veut se réveiller. N’y arrive pas ! Halète. Tape des pieds. Piétine les draps. Cherche la lampe de chevet. Ne trouve pas le bouton. Dans un papillonnement de cils, la place Bourgoin lui apparaît dans sa configuration réelle. Il veut parler aux chênes. Veut leur demander pardon. De quoi donc ! Il ne sait pas et, parce qu’il ne sait pas, l’angoisse se double pour lui racler méchamment la gorge. Il s’étrangle. La mort brandit sa faucille. Sa tête va se briser… Bang ! Bang ! Non, ce n’est pas sa tête qui se brise, mais les deux vasques de la fontaine. Les deux simultanément. Comme frappés par d’invisibles et foudroyants rayons destructeurs. Amputée de ses coupes, la fontaine n’est plus qu’une hampe. Un pieu stupide. Une misérable colonne de pierre. Au bout arrondi. Un phallus ! Spasme. Haut-le-cœur. Vomissure. Il se redresse. Grincement de porte qui s’ouvre…
C’était Aria qui rentrait tard de sa conférence.
L’après-midi du lendemain, glacial, mais ensoleillé, il prit place sur la même banquette qu’hier et compta les arbres :
— Six, se dit-il, il y en six. Les doigts de la main, plus un.
Il traversa la place, marchant nonchalamment. Il n’oublia pas de regarder l’horloge placée en biais face à la rue Chaligny et la rue Erard, le verso tourné du côté de la rue Crozatier. L’appareil figure une éolienne à trois pales de moyenne envergure dont le moyeu élargi et peint en noir, sert de cadran à un affichage LED, l’heure, les secondes, la date et la température clignotent en blanc. Elle avait été installée en février 2023 et marquait, avec quelques autres travaux, le bouclage définitif du réaménagement de l’arrondissement. Le maire de la circonscription, Monsieur Constantin Groloquet, s’était lancé corps et âme dans une émulation interarrondissements, émulation qui avait pour but de donner à Paris un nouveau visage à même de faire oublier celui qui pouvait rappeler en quoi que ce soit la lugubre et crapuleuse épidémie du coronavirus19. Il fit détruire des immeubles au motif que, vétustes, ils couraient le risque de s’effondrer, pour en construire à la place des édifices futuristes, iridescents, de forme surprenante pour ne pas dire tarabiscotée : tours cylindriques ou carrées, courbes de voiliers ou imitations pyramidales, formes rectilignes ou torsadées. Pour résumer, une « architecture sensualiste », ainsi désignait-il la chose, architecture pensée pour accrocher les sens et donner envie de jouir de tout ce qui s’offre aux yeux. Rues, mobiliers urbains, plaques, panneaux, enseignes, tout avait subi un bain de jouvence. La circulation routière n’échappa pas à la vague rénovatrice, repensée par un jeune ingénieur des mines, tout frais émoulu et dont l’acharnement au travail accoucha d’un circuit automobile d’une extrême fluidité qu’on dirait un carrousel baignant dans l’huile. « Donnez-moi du beau, du mélodieux, du sensuel, par tous les Dieux de la beauté, qu’en toute chose transperce l’amour de la vie et le bonheur de vivre », Constantin Groloquet aimait-il dire aux architectes, urbanistes, jardiniers urbains, à tous les professionnels de l’aménagement territorial, réunis en séance de coordination, « … et surtout ne regardez pas à la dépense, enterrer le coronavirus rapporte plus qu’il n’en coûte ». Puis, cessant de regarder droit dans les yeux l’aréopage de créateurs de talent et ne parlant plus de la haute et péremptoire voix propre à un maître d’ouvrage, il conclut « … mes amis, je ne l’exige pas, mais si pouvez mettre une touche verte à votre travail de création, vous m’en verrez comblé et merci d’avance… ». La politique reprenait la main. Constantin Groloquet, passionné d’échecs, cherchait depuis un temps, un bon moyen de faire du pied aux écolos, la force montante et dont le soutien ne serait pas de trop dans sa stratégie de se faire réélire pour la troisième fois. L’horloge-éolienne donne parfaitement le ton de la connivence recherchée avec les Verts. Un vieux de la vieille comme lui ne pouvait laisser passer l’opportunité que lui offrait le covid-19. Rester en place encore cinq ans, péché mignon, propre pratiquement à tous les élus pris dans l’engrenage du pouvoir.
La date officielle de la fin définitive de l’épidémie fut fixée au 20 avril 2020. Le 12e arrondissement était le premier à lancer son plan de réaménagement, cela dès le 1er mai 2020. Au jour du 1er septembre 2023, soit deux ans après, à part la grande tour de 130 étages, torsadée, un peu voilà mon oreille droite montrée avec la main gauche, une inspiration Shanghai
Tower, avenue Daumesnil, face à la Gare de Lyon qui a encore quelques années de travaux devant elle, les trois quarts de l’aménagement ont été achevés à temps et pile-poil, conformément aux desiderata du maire.
Pour juger de la performance, il faut relever que pendant que la 12e circonscription parisienne inaugurait à tour de bras, deux arrondissements de la capitale française étaient au point zéro de l’élaboration d’un plan de réhabilitation de leur territoire. Leurs murs laissent encore voir de nos jours des stigmates de la cata sanitaire – tags, affiches jaunies sur les gestes barrières, représentations obscènes du virus, suscitant des réactions semblables à ce que suscite en nous la vue d’un drap maculé de souillures.
Indice probant de la célérité des travaux, au 15 octobre 2022, tous les réverbères ont été remplacés par des éléments à diode électroluminescente (LED) de forme stylisée qui rappelle vaguement une tulipe à longue tige recourbée. En plus de servir de relais au réseau Wi-Fi, leurs pétales cumulent plusieurs fonctions : certaines, étamées de matière voltaïque, alimentent tout l’arrondissement en énergie solaire, les autres servent de capteurs et de radars. Le promeneur du soir peut ainsi jouir d’une lumière douce et enveloppante qui, par-dessus le marché, ne coûte rien à la ville.
On s’en doute bien, il serait fastidieux d’examiner l’ensemble des superbes réalisations accomplies. La transformation de la Place du Colonel Bourgoin, comme les modifications, apportées à la rue Erard, suffiront à donner une juste idée de la profondeur et de la qualité du rhabillage du 12e arrondissement parisien.
Le jardinier urbaniste Michel Marceau qui fut chargé de réexaminer l’implantation des espèces végétales, considéra que les six chênes de la placette – des Ilex aquifolium – houx communs en langage courant, seraient mal assortis à la configuration retenue. Monsieur le Maire abonda dans son sens. Lui avait en effet une prédilection particulière pour le merisier de son enfance passée à Joinville. «





























