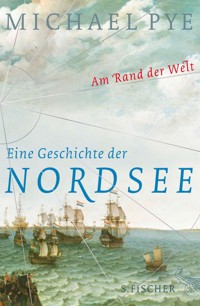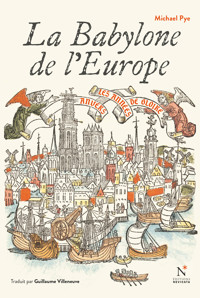
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nevicata
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Au seizième siècle, le cœur battant du monde connu était un port sur la mer du Nord : Anvers. Éblouissante et bouillonnante, telles Paris au dix-neuvième ou New York au vingtième siècle, son opulence semblait sans précédent. S’y croisaient marins et aventuriers venus de tous horizons, négociants richissimes, banquiers avides, artistes géniaux et criminels de toute espèce. Un monde de secrets et d’intrigues, de tolérance et de violence, et le berceau de multiples hérésies. Véritable Babylone de l’Europe, la ville des Pays-Bas espagnols était le centre de toutes les transgressions – religieuses, sexuelles, intellectuelles, artistiques. Tout pouvait y arriver ou être imaginé. Le monde s’y réinventait. Mais cette flamboyance avait aussi un côté sombre : puissance impériale et Inquisition planaient comme un nuage noir sur ses habitants. Quand Anvers se rebella, une impitoyable terreur s’abattit sur elle. L’historien Michael Pye entreprend de faire revivre les jours les plus éclatants d’une cité qui fut pendant quelques décennies l’incontournable et voluptueuse puissance d’un monde nouveau.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1946, Michael Pye est un romancier, journaliste et historien anglais. Résident au Portugal, il a vécu en Italie, en Écosse et aux États-Unis. Il est l’auteur d’une dizaine de livres, dont "L’Antiquaire de Zurich" (Gallimard, 2007).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Exergue
En mémoire de John Holm
in gentil cuore
CARTES
Avant-propos L’exception
Giovanni Zonca vendait du drap à Venise, entre Saint-Marc et le Rialto, au plus près du cœur des échanges marchands de la Méditerranée. En 1563, âgé de vingt ans, il était impatient. Il voulait voyager, gagner le Nord et le cœur de l’autre monde du négoce s’ouvrant à travers les océans, l’Anvers des Pays-Bas espagnols.
Il y séjourna quatre ans, envoya des lettres au pays sur ce qu’il avait trouvé. Il appréciait les règles moins strictes : nul besoin de renoncer au beurre, aux œufs et au fromage durant le carême ; il pouvait arpenter les rues à toute heure, muni de n’importe quelle arme, « au point que si vous portiez un canon, nul n’y trouverait à redire ». Il écoutait les propos des protestants mais s’inquiétait de l’arrivée imminente de l’Inquisition. Surtout, il goûtait les filles, fût-ce les filles des grands, les primi della terra, et leurs mœurs merveilleusement libres. On dînait entre deux filles qui parfois vous embrassaient et après manger on allait s’asseoir sur l’herbe en tenant la fille dans les bras. On pouvait parler de tout sans partager de langue et l’on allait se promener sans que personne vous surveille. Les filles allaient jusqu’à balancer les chapeaux des hommes dans la rivière, tout comme des égales des hommes.1
Zonca estimait avoir trouvé un monde de liberté, très différent de Venise et de sa vie de cour réglée, mais dans une ville qui lui était au moins égale. Anvers semblait inventer une nouvelle manière d’être riche, cultivé et décontracté au centre du monde toujours plus vaste que l’Europe découvrait alors.
Cette simple idée n’avait cessé d’inquiéter les Vénitiens tout au long du siècle. Ils avaient de bonnes raisons de s’en préoccuper car leurs vies et leurs affaires tournaient encore autour de la Méditerranée et des routes commerciales venant de la mer Rouge. Anvers, elle, traitait déjà avec l’Inde via l’itinéraire océanique contournant le cap de Bonne Espérance ; avec le Brésil et l’Amérique, via Séville et Lisbonne. Elle faisait partie d’un nouveau monde et d’un nouveau système.
L’un après l’autre, les ambassadeurs de Venise envoyaient leurs dépêches. Dès 1506, Anvers faisait plus d’affaires que ses voisines : elle le devait à ses deux foires annuelles qui attiraient une foule de négociants.2 En 1525, l’ambassadeur Gasparo Contarini constata que Bruges, sa grande rivale, était dépassée par Anvers. Certes, la plupart des affaires conclues dans cette dernière l’étaient par des étrangers, mais les autochtones, note Contarini, gagnaient malgré tout de l’argent en louant leurs maisons.
Il remarqua que la marée remontait puis refoulait massivement les eaux de l’Escaut si bien que les plus gros navires – caravelles et galères – pouvaient facilement accoster sous les murailles de la ville.3 Certains d’entre eux avaient bravé les eaux depuis Venise. La ville était située en amont d’une profonde embouchure et offrait un mouillage abrité sur le fleuve aux caravelles en provenance des Indes, de l’Afrique ou de l’Amérique ; après quoi leur cargaison pouvait emprunter les bras du Rhin vers les Alpes, l’Italie du Nord voire au-delà, ou bien repartir par la mer du Nord et la Baltique. Les marchandises se monnayaient avec l’argent et les métaux extraits des mines du Sud de l’Allemagne et acheminés par voie fluviale. Celle-ci était plus commode qu’un système routier rudimentaire parcouru par de lourds charrois hessiens, notamment en hiver, a fortiori s’il était pluvieux, lorsque les « routes étaient si mauvaises que le redoublement des bêtes pouvait à peine suffire à mouvoir une demi-cargaison », quand les cordages pourrissaient « d’avoir trop longtemps séjourné dans les champs » et que les chevaux étaient affaiblis par un régime d’éteule. Certes, il arrivait que l’Escaut soit pris dans les glaces, mais au moins la mer était-elle aussi ouverte que le permettaient les tempêtes et les pirates endémiques.4
Au milieu du siècle, l’ambassadeur de Venise Navagero écrivait aux siens : « le commerce du monde entier se trouve à Anvers ».5
Son successeur Marino Cavalli dépeint toutes les villes des Flandres et du Brabant au sénat de sa ville en usant d’analogies : Louvain était aussi savante que Padoue, Gand grande comme Vérone et Bruxelles aussi bien située que Brescia. Dans tout cet immense système d’équivalence, c’était Anvers qui correspondait « très bien à Venise en termes commerciaux ». Cavalli était renversé par le nombre de commerces d’argent et de toutes sortes d’autres marchandises, stupéfait par ce puits d’affaires apparemment sans fond. Personne, « quelles que soient la bassesse de sa position et sa paresse, qui ne puisse s’enrichir ici et faire des affaires sur les marchés d’Anvers ». Les jeunes dandys ayant tout dépensé et au-delà pouvaient s’adresser aux prêteurs qui « s’occupaient de tous contre 12 % annuels ».6
L’argent était un commerce à soi seul, rapporte Federico Badoero en 1557.7 Il note que le duc d’Albe est entré aux Pays-Bas pour écraser l’hérésie et pacifier la rébellion hollandaise muni d’une réserve de 14 000 écus. Il en est reparti lesté de 40 000, « grâce à des investissements réalisés à Anvers ». Badoero avait « peine à évaluer le chiffre d’affaires général – peut-être plus de 40 millions-or chaque année, chiffre en fluctuation constante ». Le coût de l’argent était élevé, même pour le roi d’Espagne Philippe II, sans être au plus haut ; s’il devait payer 24 % à Anvers, ce qui semblait excessif comparé aux 14 % espagnols, ce taux était presque indolore rapporté aux 40 % qu’il fallait payer à Naples rien que pour s’assurer des impôts avant leur perception.
Au surplus, cette machine à produire des richesses était aussi l’inévitable centre de toutes sortes de commerces. Paolo Tiepolo, bien qu’il ne fût ambassadeur dans les Flandres qu’en 1563 parce que Philippe II s’y trouvait pour mener une guerre, vit bien que « toutes les marchandises, de l’étranger ou de l’intérieur du pays, traversent Anvers dont la foule de marchands rend cette ville plus célébrée, plus réputée que toute autre, le marché commun à presque toute l’Europe. » Tiepolo estimait que la ville suffisait à expliquer que l’empereur arrivât – en général – à financer ses guerres.8
C’est ici qu’on touchait au paradoxe pour un Vénitien : Anvers était riche mais sans en faire tout un plat. Badoero voyait toutes les affaires, tous les stratagèmes destinés à mettre les biens sur le marché. Il observait la « variété et l’abondance des marchandises essentielles, utiles, convenables et confortables arrivant et repartant par terre et mer » et qualifiait Anvers de « plus grand marché du monde ». Et pourtant, la ville elle-même ne semblait pas extraordinaire. « Tous ont une maison équipée de tout le nécessaire, mais ils se soucient davantage d’économiser que de dépenser leur argent pour l’étalage. » Le trait le plus remarquable des maisons, selon lui, est leur propreté scrupuleuse. D’autres visiteurs, qui n’étaient pas originaires d’une ville de palazzi, étaient plus impressionnés. En 1520, on emmena le grand Albrecht Dürer voir le nouvel hôtel du bourgmestre, « excessivement vaste (…) de grandes salles extraordinairement belles (…) un très grand jardin ; en bref, une plus belle demeure que je n’en ai vue dans tous les pays allemands. »9
La vraie différence était qu’Anvers faisait peu de cas des manières de cour, des règles de piété, voire de ce qu’on servait à table. Badoero note que les habits féminins sont « très modestes », même si cette pudeur avait ses limites à d’autres égards ; il s’étonne que les hommes parlent aux épouses d’autrui et aillent jusqu’à « faire des plaisanteries grivoises en présence de jeunes filles ». Giovanni Zonca aurait pu lui dire que cela allait même plus loin si l’on avait vingt ans.
Quant à la nourriture, « ils cuisinent une fois par semaine, une nourriture si bon marché qu’il serait difficile de vivre plus pauvrement (…) » Badoera déclare : « Ils ne s’attachent guère à la nourriture, mais pour ce qui est de boire ils s’enivrent tous les jours et souvent les femmes à peine moins que les hommes. » Ce n’était pas systématique. « Les hommes sont si ivres, rapporte plus loin notre Vénitien, que la conduite des affaires revient aux femmes. »10
Jusqu’à la fin du XIVe siècle, Anvers n’avait été qu’un port fluvial parmi d’autres. Elle abritait une foire deux fois par an, mais pas de cour royale justifiant son éminence, pas de gouvernement national, pas d’armée ni de marine pour protéger le commerce ou faire la guerre, pas même d’évêque. Ce n’était pas une ville-État dotée d’une célèbre dynastie comme Milan ou Florence : elle appartenait à l’Espagne.
Et pourtant la République sérénissime de Venise, puissance autonome, voyait en Anvers une égale. Elle était devenue une cité-monde, le centre d’histoires publiées dans toute l’Europe, un phénomène comme le Paris du XIXe siècle ou la New York du XXe, l’une des premières villes où tout pouvait arriver ou du moins être plausible. Si d’autres villes, le long du rivage de la mer du Nord, révélaient la puissance des rois, des ducs ou des empereurs, Anvers n’était qu’elle-même : un centre commercial où les gens voulaient ou devaient être, sans pouvoir ne pas y être. Elle ne devait sa célébrité qu’à elle-même.
Elle s’intégrait peu dans le vaste plan habsbourgeois d’un destin particulier, celui de constituer le cinquième empire annoncé par le livre de Daniel, l’ultime ordre mondial de l’histoire, allant des Amériques jusqu’aux frontières de l’empire ottoman. Elle commerçait avec les Portugais, animés d’ambitions très similaires, mais qui allaient vers le sud – l’Afrique – et l’est – Indes, Chine et Japon. Le roi d’Espagne aimait être représenté sur le char du soleil, en train d’amener la vraie foi à tout l’univers. Les Portugais entendaient agir de même, mais en recourant à d’autres métaphores.11 Le projet de ces empires était aussi sacré que commercial, aussi dynastique que pratique. Anvers était tout à fait différente. Si elle n’était pas du tout laïque, elle pratiquait une tolérance pragmatique. Ses affaires reposaient sur le commerce avec l’étranger : elle n’avait donc aucun intérêt à abolir les hérésies auxquelles sacrifiaient tant de ces étrangers. C’était une ville qui s’efforçait de travailler à ses intérêts.
Anvers, en ce sens, était pionnière. Henri Lefebvre a écrit que quelque chose d’une importance décisive s’est produit en Europe occidentale au XVIe siècle. Pas un événement qu’on puisse dater, pas un changement des institutions, pas même un processus mesurable en termes économiques comme la croissance de telle ou telle production, l’ouverture de tel ou tel marché. L’Occident s’est renversé : la ville a dépassé la campagne en termes économiques et pratiques comme par l’importance sociale.
Ce fut une immense mutation abstraite, mais c’était l’occupation quotidienne d’Anvers, des conversations du soir et de la politique concrète. Sa population s’efforçait de concilier son appartenance à une ville très insolite et l’évitement d’armées inamicales toutes proches. La musique, les tableaux, la langue et l’éducation devinrent des services qui ne dépendaient plus de mécènes mais de débouchés commerciaux : des services transférables ou échangeables, en d’autres termes. Un seul courtier tenait plus ou moins à flot le régime impérial, alors même qu’il avait été chassé de la Bourse pour avoir détourné les fonds municipaux et menacé de mettre un terme au commerce. Un seul agent immobilier modelait et remodelait la ville à sa guise sans que le pouvoir politique pût le contrôler. Lefebvre a bien décrit la situation : « l’argent mène le monde (…) »12
Il existe aujourd’hui un Anvers au même endroit, un grand port essentiel, une ville aux beaux monuments baroques, pleine du souvenir du grand Rubens. Le présent livre ne traite guère d’elle. Certes, les villes ne se déplacent pas et ne sont pas construites pour se dissimuler ; même lorsqu’elles s’écroulent, on peut repérer le réseau de routes les visant comme des cibles. Mais les villes ne sont pas que des réalités physiques. Elles sont faites de ce qui s’y est produit, pensé, utilisé, du regard et de la compréhension qu’en avaient citoyens et voyageurs, toutes choses aussi étroitement liées à un temps qu’à une référence cartographique précise.
Ce livre traite d’Anvers dans un temps très exceptionnel, ce qu’on appelait jadis « l’âge d’or ». Un petit groupe de gens dispute – et le fera artificiellement jusqu’à la fin des temps – pour situer cette période à l’année près : l’époque glorieuse a pu commencer par une révolte du XIVe siècle ou par l’amarrage du premier bateau portugais d’épices vers 1501, et peut-être se terminer par le scandaleux iconoclasme de 1566 où l’on abattit les autels, ou bien par la prise de pouvoir des calvinistes en 1577, quand Anvers s’associa à la guerre violente contre l’Espagne, voire par la défaite de 1585 et le blocus de l’Escaut.13 Tout dépend de ce qu’on appelle la gloire.
Mon livre commence par l’arrivée des navires d’épices portugais et s’achève par l’iconoclasme et ses longues séquelles. La gloire, à mon estime, est l’époque où la ville put être particulière et individuelle, pas seulement un repère de plus sur l’une des cartes qu’aimait faire l’empereur Charles Quint pour montrer où il régnait.
Les historiens tentent parfois de définir une époque par les conditions économiques, parfois par l’évolution institutionnelle, mais c’est en fait une affaire de fable convenue : ce que savent les gens, ce dont ils parlent et ce dont ils se souviennent. Impossible d’interroger les témoins car les âges d’or, par définition, sont irrémédiablement derrière nous ; ils nous servent à illustrer la chute vertigineuse subie depuis lors par l’humanité. L’initiateur de l’allégorie, Hésiode, il y a près de trois mille ans, nous dit vivre un âge de fer, apparu longtemps après ceux d’or, d’argent, de bronze et des vrais héros. Au Ve siècle de l’ère chrétienne, le philosophe Boèce n’ignorait pas que son Arcadie s’était refermée depuis longtemps et que les seuls lieux où se pratiquaient les mêmes usages, où hommes et animaux vivaient dans la paix, se trouvaient aux confins de l’Écosse et de l’Irlande. Boèce fut souvent publié à Anvers dans ses années glorieuses.
On avait aussi la nostalgie des antiques tribus germaniques dans leurs forêts, de simples ancêtres sanguinaires et forestiers. En 1596, le géographe anversois Ortelius publia son Aurei saeculi imago, soit un « tableau de l’âge d’or, » lequel n’a rien à voir avec l’image que nous en donnent les expositions de musées et les beaux livres. Il nous montre des cadavres pendus dans les bois, des hommes pris au piège tête la première dans la boue où ils se noient, la justice barbare des tribus primitives ; il montre des familles sous la tente en plein vent à côté de chariots bâchés, des femmes qui regardent les hommes s’exercer à la guerre, des bûchers funéraires où les chevaux brûlent à côté des cadavres, et un type d’union élastique où la monogamie est générale, sauf si l’homme a besoin de plus d’une épouse. L’âge d’or, pour les citoyens d’Anvers, était presque l’exact opposé de l’âge d’or civilisé que nous prêtons aux ancêtres. Si nous accolons l’épithète « d’or » à toute période dont nous continuons de chérir les œuvres – tableaux, bâtiments, livres, musique, richesses – Ortelius tenait que la civilisation est le point où nous aboutissons quand les âges d’or sont loin.14
Le nom d’Anvers était répandu sur toutes les routes commerciales qui se rejoignaient dans la file des navires amarrés à ses embarcadères : c’était une ville et une légende. Ses histoires escortaient la laine anglaise en route vers la Hongrie et le Levant, les négociants emportant le cuivre et l’argent allemands vers l’Afrique, qu’on troquerait contre de l’or et des esclaves, elles empruntaient les bateaux retournant en Asie après avoir déchargé poivre, diamants et épices. Elles charriaient l’idée de la ville et de tout ce qui évoluait dans ses rues : prix, taux, ententes, savoirs, médecine, théologie, tout cela était vu et rapporté dans l’univers du commerce. Tout pouvait s’interpréter. On scrutait les contrats pour ce qu’ils révélaient de la politique et de la guerre, sur ceux qui achetaient des armes et des armures, sur qui empruntait quel argent pour payer des troupes et où. Il y avait des espions, bien sûr.
À Pavie, en Italie, le mathématicien Girolamo Cardano a dit combien Anvers dépassait toutes les villes environnantes par la taille, les richesses, la population ; que c’était le plus célèbre marché d’Europe et un « point d’attraction inouï d’hommes et de marchands venus d’Angleterre, d’Espagne, de France, d’Allemagne et d’Italie ».15 À Agen, l’évêque Matteo Bandello y voyait « le marché de tous les chrétiens d’Europe et au-delà ».16 À Colmar, en Alsace, le clerc Georges Wickram écrivit un roman où le jeune Lazarus fait valoir ses titres pour se marier : on lui enjoint de voyager et d’apprendre le français, c’est-à-dire d’aller à Anvers « où l’on trouve des écoles pour acquérir n’importe quelle langue ». Il doit se rendre dans le Brabant pour devenir « un homme noble et adroit ». On le met en garde contre les femmes impudiques et les bagarres, contre les jeunes gens pervers dans les tavernes. Quand accoste son bateau, Lazarus découvre une ville splendide et des édifices sans équivalents dans son expérience.17
Anvers importait aux protestants anglais à la recherche de bibles en anglais, tout comme ses bateaux et contrebandiers feraient plus tard passer des livres jésuites aux catholiques anglais. Elle constituait une plaque tournante essentielle pour les Juifs portugais ayant accompli le voyage épuisant depuis le Portugal jusqu’à Ferrare, Salonique ou Istamboul en quête d’une certaine liberté ; en route, ils rebâtirent presque Israël sur une île de Méditerranée. Le nom d’Anvers figurait sur les gravures envoyées aux Amériques qui assistaient les peintres du cru décorant les murs des nouvelles églises chrétiennes.18 C’est vers elle que se tournait celui qui avait la malchance d’attraper la syphilis, car si beaucoup avaient entendu parler de la célèbre racine chinoise, les médecins d’Anvers seuls en connaissaient le mode d’emploi.19
La ville était un récit qui tenait sa substance de ce que les gens en entendaient et en savaient ; elle était célèbre pour négocier toutes sortes d’informations, pas seulement les livres qu’elle publiait en quantités prodigieuses. L’alchimiste Paracelse, venu à Anvers en 1519, estimait avoir « davantage appris au marché que dans toute école allemande ou étrangère ». Quant au mage John Dee, il a noté en marge d’un livre de sa bibliothèque qu’Anvers était l’« emporium totius Europae « 20, une grande boutique où tout le continent venait trafiquer en secrets, comme en épices, laine ou argent. Il s’y trouvait en 1562 et dit « avoir acheté un livre pour lequel d’autres ont offert, sans succès, mille couronnes ».21
Le nouveau monde du savoir dépendait des routes commerciales de la ville – pour les spécimens exotiques et les histoires extraordinaires, mais aussi pour trouver l’argent nécessaire à l’achat du papier pour l’impression, comme à la diffusion des livres. Ce nouveau monde commercial d’itinéraires océaniques était impensable sans Anvers, qu’il s’agisse de fournir les espèces pour la Traite des Noirs ou d’importer en Europe les clous de girofle, le gingembre, la cannelle et le poivre dont on était friand. Quand son éclat s’atténua, que la ville perdit son caractère exceptionnel, quand elle ne fut plus qu’un port utile de plus sur les territoires des Habsbourg, ses idées restèrent vivantes tout en se déplaçant vers le nord : des négociants vendant de l’art, de la musique imprimée pour les masses, un nouveau type de ville construite de toutes pièces autour de canaux, l’idée de l’actionnariat, la conception du monde et de ses relations en termes abstraits et financiers.
Anvers s’efforçait de s’inventer en même temps qu’elle inventait l’avenir.
Quittez la place du Vrijdagmarkt, tournez dans la Heilige Geeststraat* : un bar propose de bonnes frites à un bout, une boutique de lingerie féminine en occupe l’autre. Voici des portes métalliques noires toutes simples dont la fente de la boîte aux lettres vous permet presque de voir ce qui se cache derrière. Si l’on vous laisse passer le portail, vous quitterez le monde des automobiles et des réverbères. Vous voici sous une large arcade qui court sur le côté de la cour. Il y a une porte cochère sur la grand-rue par où transitait jadis le négoce de la maison. Les arches regardent l’allée carrossable, ponctuée de rosiers et de mûriers, qui longe la chapelle sur la gauche. Plus loin se trouve le comptoir doté, comme toujours chez un armateur, d’une haute tour d’où surveiller ses bateaux sur le fleuve.
Dans les années glorieuses, c’était la maison et le quartier général d’un banquier allemand. La coquille est préservée, un peu ajustée, usée et restaurée, mais inchangée à la base. Cela paraît d’abord normal : c’est une maison orgueilleuse, érigée dans une ville qui fut un grand port durant cinq siècles, au célèbre passé monumental. Impossible de manquer la cathédrale inachevée dont l’actuelle magnificence date de 1521. Le lacis des vieilles rues s’évase encore sur le site des marchés d’autrefois puis se rétrécit en venelles, la grand-rue se trouve toujours au même endroit, entre le grand marché et les vieux embarcadères. Survivent de belles façades en briques et pierres, les maisons des guildes sur le Grote Markt**, de loin en loin une tour dans cette ville jadis célèbre pour ses tours, des places utilisées depuis des siècles même si celle où l’on louait des déguisements sert surtout de parking aujourd’hui.
Les traces des plus grandes années de la ville sont réduites à des îlots, des indices, des rémanences accidentelles. L’époque où Anvers défiait ses maîtres, ou s’efforçait de les ignorer autant que possible, a été recouverte par une autre histoire : la puissance de la machine des Habsbourg, finalement imposée avec succès depuis Madrid. De belles églises baroques, très catholiques, remplacent un amas d’hérésies. La ville qui faisait cas des hérétiques a disparu à l’arrivée de l’Inquisition, puis d’un régime calviniste, enfin avec l’impitoyable chasse espagnole des dissidents. Ce qu’on visite et admire aujourd’hui est venu plus tard, une bureaucratie adaptée à son emploi, une culture religieuse visant à l’homogénéité, une ville qui se tenait convenablement au sein d’un empire. C’est une ville magnifique, mais plus une ville-monde.
Elle ne ressemble pas à Amsterdam où les lumières nocturnes sont si savamment mesurées le long des canaux qu’on pourrait presque croire que les péniches débarqueront demain leurs marchandises devant les comptoirs des marchands. Elle évoque davantage Rome dont Mussolini a retenu les parties les plus fameuses du passé, les temples et le forum, et pulvérisé les parties les plus compliquées au profit d’un récit utilisable. Elle ressemble beaucoup à Paris, sans que ce soit d’abord évident. Les boulevards tracés par le baron Haussmann au XIXe siècle ont délibérément aboli les vestiges marécageux, flous, misérables de la cité médiévale, des rues étroites que pouvaient à peine emprunter les charrettes, les citoyens enclins à arracher les pavés en période d’émeute. Chaque boulevard le proclame : Paris est sous contrôle.
Anvers, elle aussi, fut matée.
La mère d’Adriaan Hertsen avait fait de son mieux pour lui : elle fit de beaux et fréquents mariages. Née dans les milieux du pouvoir anversois au XVIe siècle, elle était la sœur d’Aart Schoyte, échevin et un temps bourgmestre intra muros, soit l’ambassadeur de la ville à l’extérieur et le responsable du calendrier légal à l’intérieur. Elle épousa Jacob Hertsen, qui fut à son tour bourgmestre, union dont naquit Adriaan. Quand Jacob eut disparu, elle s’allia au clan des Van der Dilft, et quand elle eut enterré ce mari-là, elle s’allia au clan des Van de Werve, qui régissaient une douzaine de cités. Son fils Adriaan avait tous les amis voulus pour devenir un grand homme.
Il y travailla, évidemment. Il apprit le droit à Orléans, célèbre pour avoir formé des papes avant lui. Il était pieux, appartenait à la Table du Saint-Esprit qui se souciait des pauvres. C’était un citoyen responsable, prêt à défendre les murs de la ville en tant que chef de la Milice du Vieux Grand Arc. Durant trois ans, il fut bourgmestre intra muros tout comme son oncle, et tout comme lui, il fut aussi échevin, presque tous les ans de 1512 jusqu’en 1530.
Adriaan avait une demeure correspondant à son statut. À sa mort, en janvier 1532, il fallut recenser et cataloguer le contenu de chaque pièce, y compris les arrière-salles, outre celui de ses deux maisons campagnardes. Qui feuillette les pages de l’inventaire dans les archives juridiques d’Anvers peut arpenter à nouveau ces pièces, voir les armoires, lits, fauteuils et tables pliantes, les jouets et les poupées de ses enfants, les diamants, la verrerie alors encore exceptionnelle, et les tapisseries sur la porte de sa chambre à coucher à une époque où la tapisserie était un art souvent plus raffiné et onéreux que la peinture.
Adriaan possédait de l’or et de l’argent, plus de soixante-huit kilos d’argenterie. Il y avait des tableaux sur les manteaux de cheminées mais aussi dans des malles. Il y avait des portraits, ce qui est compréhensible quand les relations d’un homme sont aussi importantes. Il y avait un soufflet décoré d’une Vénus nue dans sa chambre. Il y avait bon nombre de tableaux sacrés pour illustrer sa piété et des tableaux de pouvoir, dont un de l’empereur Charles Quint lors de son couronnement, conservé dans la chapelle à côté d’une tête de saint Jean montée sur une couronne ; un tableau de sa paix avec les Français dans une pièce adjacente à la chapelle, un autre de son entrée triomphale à Bologne dans un coffre, avec divers objets liturgiques. L’inventaire nous dévoile, page après page, un homme sérieux, à l’aise dans sa famille, vis-à-vis du pouvoir et de son Dieu particulier.
Il dévoile son fonds, évidemment. Sa maison de ville avait des thermes, une boulangerie, plusieurs cuisines, une garenne de caves et même une pissotière, une pis kamerken ; et il possédait deux maisons à la campagne, assez proches de la ville, une fermette en pierres et une autre de huit pièces, pas aussi somptueuse et tapageuse que la maison de ville mais malgré tout très confortable. Il avait des fonctions officielles et une belle fortune.22
Et pourtant, c’est à peine s’il a une histoire, à cause de ce qui manque. Il fut puissant dans une ville célèbre dans tout le monde connu des Européens, mais il n’a laissé qu’un inventaire exact, dont toute sa vie est absente. Il y a des mentions éparses dans les registres de l’échevinage, aussi sommes-nous informés de certains des biens qu’il acheta après 1514. Nous avons une idée du genre d’objets qui l’enchantaient parce qu’il les possédait. Nous n’avons ni dernières volontés ni testament, et donc aucune idée des biens qu’il chérissait le plus, de ce qu’ils signifiaient pour lui, des sortes de gens qu’il jugeait dignes de les recevoir. Il avait des livres, mais le seul que nous puissions identifier est la Bible, si bien que nous ignorons ce qu’il lisait ou ce qu’il pensait, ni pourquoi il possédait des armoiries de la Bavière et du duché de Clèves.
Nous n’avons aucune certitude sur la maison elle-même. Il est probable – mais c’est une hypothèse – qu’elle avait trois niveaux, de longues ailes, des communs, un jardin ou une cour. Nous ignorons son nom, dans une ville où les grandes maisons en portaient un. Nous n’avons ni le nom de sa rue ni même celui du quartier, bien qu’on l’imagine dans le premier, qui était le plus riche. Nous n’avons qu’une certitude : elle a disparu. La plupart des vestiges architecturaux d’Anvers appartiennent à une période ultérieure et plus ordinaire. Ils ont du charme mais nous racontent, littéralement, une autre histoire.
Assurément, les documents s’égarent au bout de cinq siècles. Ce qu’Anvers a de remarquable, c’est que ses glorieuses années ressemblent beaucoup à la maison d’Adriaan Hertsen : parfois inventoriée, évidemment éblouissante, mais présentant de tels manques qu’il est délicat d’en faire un récit exhaustif. Les notaires n’étaient pas tenus de confier leurs archives à la ville, si bien que celles-ci sont fragmentaires, quand elles survivent. Et Anvers a connu de violents soubresauts dans son histoire, très défavorables aux documents. Lorsque les soldats espagnols rebelles alignèrent en 1576 les citoyens contre les murailles, ils remplirent les rues de cadavres et incendièrent le nouvel hôtel de ville. Des piles entières d’archives communales* partirent en fumée, ce qui suffit à compliquer considérablement la tâche de l’historien de la cité.
Ce qui subsiste est rarement suffisant pour émettre des déclarations catégoriques sur les noms, la délinquance, les impôts, les événements, les querelles, la manière de trouver une compagnie nocturne, qui vendait quoi au juste. Il serait précieux de disposer des données sur les membres des guildes, sur ce qui transitait par les débarcadères, le fonctionnement des élections, le budget et les dépenses de la ville. De remarquables travaux se sont penchés – et continuent de le faire – sur ces questions, sans pouvoir pallier toutes les lacunes. Il nous faut composer une mosaïque à partir des chansons, des tableaux, des griffonnages sur les documents municipaux, des manuels de langue et manuels de bonnes manières, des prohibitions qui nous informent de ce qui arrivait si souvent qu’il fallut l’interdire ; une mosaïque à partir du regard porté sur la ville et ses usages par les diplomates et les étrangers. Nous avons besoin de romans écrits à la même époque en Alsace et au bord de la Garonne à l’autre bout de la France, besoin des archives de Séville, Lisbonne, Florence, Venise, Londres, Zurich aussi bien que d’Anvers.
Alors nous pourrons commencer à saisir la vie tumultueuse d’une ville où le duc d’Albe vit un jour « un tohu-bohu et le réceptacle de toutes les sectes indifféremment » : Babylone elle-même.23
* Rue du Saint-Esprit. Straat signifie rue en néerlandais.
** Le Grote Markt (Grand Marché en néerlandais) est la Grand-Place d’Anvers.
* Municipales.
1 1507
Des ombres sur les murs. Les foules jouent des coudes pour approcher de la lumière. Elles ont ordre de se tenir à l’écart du feu et de s’abstenir absolument de jeter des pierres sur le métal incandescent, mais le rouge des braises fascine, dans le fourneau grossier près de la muraille, comme l’or et le blanc du métal en fusion qui se déverse dans le sol et se fige dans les cratères. La lumière semble être aux mauvais endroits.
C’est le crépuscule d’un soir d’avril 1507, juste après vêpres, dans la cour de la grande église de Notre-Dame qui sera la cathédrale d’Anvers.
Il ne s’agit pas vraiment d’une fête de feux d’artifice, bien qu’il s’agisse d’une fête : on ne promulgue pas autant de règles pour les badauds si on ne les attend pas. Il ne s’agit pas exactement d’un rituel, car les bénédictions proprement dites viendront après, et cela ne s’inscrit pas dans un calendrier car cela fait plus de soixante-dix ans qu’un événement de ce type s’est produit. Au sens strict, il s’agit d’une étape d’un processus de construction. En tout cas, les gens sont venus observer et célébrer. Vingt-huit hommes rivalisent pour actionner le soufflet, histoire de voir qui alimentera le mieux la fournaise.
Ce soir, la ville fond une nouvelle grand cloche : Carolus, du nom du futur Charles Quint, qui va régner sur les Pays-Bas, le duché de Brabant et donc la ville d’Anvers.
La cloche sonnera l’histoire communale officielle, au rythme des événements. Elle sonnera la naissance des princes, l’élection des papes et l’arrivée des cardinaux, un départ de feu dans les rues étroites, le bon retour des bateaux partis en pèlerinage en Terre sainte, les exécutions qui éradiquent les banquiers assassins ou les sodomites impudiques. En 1542, quand Maarten van Rossum viendra assiéger la ville avec ses alliés français, Carolus sonnera pour inviter les habitants à prendre les armes et se précipiter sur les murailles pour résister, sous peine de finir sur un gibet place du Grote Markt. Elle sonnera quand des troupes espagnoles, mutinées pour n’avoir pas été payées, se tourneront contre la ville en 1576, brûleront les archives de l’hôtel de ville, pilleront et vandaliseront avant de pousser la population dans l’eau ; et en 1583, quand les Français lui infligeront encore un malheur. Mais quand les bateaux-pompes remonteront le fleuve en 1585, quand les Espagnols la reprendront et mettront un terme à sa révolte contre Madrid, les cloches ne sonneront pas, on ne célébrera pas la fin de la République calviniste d’Anvers, on n’allumera pas – sauf quelques Italiens – de feux de joie. L’histoire sera repassée sous le contrôle impérial.
Pour l’heure, la cloche appartient à la ville. Dans les jours précédents, des charrettes ont parcouru les rues pour recevoir les dons – feuilles d’étain, bassines métalliques, vieux bougeoirs, voire morceaux de cloches cassées. Quelques-uns insistent pour donner de l’argent, lequel est revendu à part car la cloche sera en bronze, qui ne demande que du cuivre et de l’étain. Le fondeur Guillaume de Moer est venu avec son frère et deux ouvriers pour inspecter très soigneusement le métal, ce qui signifie que la ville devra lui fournir beaucoup plus à manger et à boire qu’elle ne le prévoyait.
Il faut neuf jours pour creuser le grand cratère. De Moer et ses aides font une armature de fer pour renforcer le moule qu’on y installera. Ils utilisent des centaines d’œufs pour graisser le moule avec une préparation de chanvre épaissi de saindoux. Puis on construit le fourneau à l’abri des murs de l’église. On étale quantité de cendres pour le plancher du four, on apporte des charretées de bonne argile pour le former. On allume et entretient le feu puis on commence la fonte.
On fournit du fromage, du pain et de la bière aux ouvriers pendant tout le travail ; les deux principaux adjoints obtiennent deux repas par jour ; naturellement, les magistrats de la ville jouissent d’un banquet arrosé. Le forgeron ayant travaillé à la cloche déclare avoir perdu de l’argent et il exige une gratification.
On laisse deux hommes dans la pénombre du cimetière. Ils surveillent le cratère pendant que le métal refroidit.24
Anvers avait connu d’autres cloches avant Carolus. À partir de 1316, il y eut Orrida, dont le nom signifie « brute, affreuse, susceptible de faire trembler ». C’était la voix de l’autorité locale dans l’un des ports intérieurs du Brabant, pas aussi fameux que Bruges, ni royal ni saint. La ville grandissait et les nouvelles devaient être portées de plus en plus loin, aussi Orrida fut-elle remplacée en 1439 par une plus grosse cloche, Gabriel, du nom de l’archange messager. Elle pesait près de 5 000 kilos de bronze. Il fallait trois hommes solides pour commencer à la mouvoir.
En 1507, Gabriel ne suffisait plus. D’année en année, la ville se peuplait et se densifiait : de plus en plus de gens affluaient d’autres villes, depuis la campagne ou depuis l’étranger. Bientôt elle aurait une population supérieure à celle de Londres, quoique inférieure à Paris, et tous les atouts d’une capitale sauf le siège du pouvoir. Les Anglais y vendaient de la laine et du drap, y achetaient des armures et des joyaux et y contractaient des emprunts pour assurer la bonne marche de l’État. Les Portugais de Bruges s’y installèrent quand celle-ci perdit la faveur de l’empereur. Leurs bateaux étaient d’abord arrivés depuis Lisbonne en 1501, chargés d’épices et de poivre. Ils apportaient aussi des diamants de Golconde, des perles des Indes, de l’or d’Afrique pour acheter de l’argent et du cuivre du Sud de l’Allemagne qui serviraient à la Traite africaine et à l’achat d’esclaves. Anvers devenait une plaque tournante, un marché, un carrefour. Les Italiens venaient de Gênes, Florence et Lucques, les Espagnols étaient chez eux, les Allemands venaient sous deux variétés : depuis les villes commerciales du Nord, la ligue hanséatique, mais aussi d’Augsbourg et des autres villes minières. Depuis longtemps, deux foires annuelles animaient la ville, mais à présent le commerce perdurait toute l’année.
Une telle ville méritait une cloche encore plus grosse, six tonnes et demie de métal qui exigeraient seize sonneurs pour bouger. Carolus était une présence, un objet d’intense fierté. Quand l’empereur Charles arriva aux portes de la ville en 1549, pour lui présenter son fils Philippe, le secrétaire communal Cornelius Grapheus affirma qu’on aurait peine à lui comparer une autre cloche pour la taille, la densité ou la douce résonance, qu’elle « a rendu toutte la ville plaine de grandt et doulce mélodie ».25
Si elle portait le nom du roi, c’est assurément parce qu’il possédait assez de soldats pour contrôler Anvers, du moins lorsqu’il pouvait les distraire de ses nombreuses guerres et lorsqu’il pouvait les payer, chose qui n’était possible que grâce aux prêts des marchands anversois. Il haïssait l’hérésie, mais il avait besoin du revenu des impôts levés sur un bel éventail de négociants hérétiques tout autour de l’Europe : en particulier les luthériens, ainsi que les « nouveaux chrétiens » du Portugal encore soupçonnés d’être juifs, et plus tard des calvinistes qui se rendaient dans les champs pour entendre les sermons et qui finirent par contrôler la ville. Quand Philippe proposa un évêque aux magistrats anversois en 1563, ils lui adressèrent maintes pétitions pour lui signifier qu’ils n’en avaient pas besoin : un évêque amènerait l’Inquisition, dérangerait les marchands étrangers et ruinerait tout.26
« Anvers a pour seigneur et prince le duc de Brabant, margrave du Saint Empire romain, écrit le marchand florentin Lodovico Guicciardini, mais elle est dotée de tant de grands privilèges, obtenus depuis l’Antiquité, qu’elle se gouverne et s’administre presque en ville libre et en république. »27 Au cours du temps, ces privilèges avaient été exigés, retirés, rendus conditionnels ; ils étaient un moyen de pression. La ville insistait pour les détenir, mais il arrivait que l’empereur retirât la permission d’imprimer une simple histoire des Flandres si l’on mentionnait seulement les privilèges.28
Quel que fût l’ordre de la ville, c’était les cloches qui l’égrenaient. Les cloches non-officielles étaient interdites. Chaque jour, la cloche du matin annonçait l’ouverture des portes. C’était elles qui disaient quand les ouvriers devaient être à leur poste et quand les ateliers devaient fermer le soir. Les commerces d’agrément, les imprimeurs, les orfèvres, les teinturiers et les apprêteurs de beaux draps devaient tous tendre l’oreille. Quand fut ouverte la nouvelle Beurs*, en 1531, c’était les cloches de ses deux tours qui ouvraient les affaires le matin et les refermaient le soir. Il vous fallait être là quand sonnait la cloche sous peine qu’on doute de votre crédit et qu’on vous croie même ruiné. Les cloches étaient plus qu’un ordre, elles diffusaient aussi de la musique dans les rues au milieu de toutes les autres mélodies et du raffut. Il était habituel depuis 1480 de leur faire jouer des airs aux heures de joie : le sonneur de cloches se servait des mains et des pieds pour tirer des cordes qui permettaient d’éviter l’imprécision du battant dansant au milieu de la cloche. C’était une nouveauté, quelque chose « d’appris grâce à un sot ». Andreas Franciscanus, très probablement secrétaire d’une mission diplomatique venue de Venise, a écrit en 1497 qu’à Anvers « tout le monde est féru de musique, qu’on y est si expert qu’on joue même des clochettes harmonieusement et d’un son si plein que celles-ci paraissent chanter (…) tous les airs souhaités. »29 Quand les Pays-Bas connurent le schisme religieux et que les calvinistes prirent le pouvoir, on ordonna au sonneur des cloches de la ville, Jacques Rieulin, de ne jouer que des hymnes et des psaumes.30
La nuit, la diefclocke, la cloche des voleurs, fermait les portes et imposait le couvre-feu, renforcée par des clairons. La ville était obscure et l’obscurité était dangereuse.
*
La réalité de la ville ne fut jamais vraiment au diapason de son nom illustre ni de ses ambitions. Les cochons retournaient la terre autour des plus nobles demeures, au milieu des oies, des canards et des chiens errants ; nous le savons parce que la ville s’efforçait sans cesse de les bannir. De nouvelles règles, en 1582, permettaient encore aux chevaux, bœufs et autres bêtes d’emprunter des allées entre les maisons, mais si l’on déplaçait des animaux, on devait se rendre droit au pré le plus proche en causant le moins de dégâts possible. En 1557, on émit des ordres spéciaux pour que nul n’empêche les preneurs de chiens de travailler lorsqu’ils étaient en chasse pour les tuer.31
La ville payait trois sortes de travailleurs nocturnes : les éboueurs, qui ramassaient ce que maisons et ateliers rejetaient, les chiffonniers qui collectaient les débris secs des édifices ruinés afin qu’on les réutilise, et les responsables de la fosse qui géraient les mares et fosses d’égouts de la ville pour les vider quand les niveaux étaient trop hauts.32 Les édifices penchés sur la rue étaient susceptibles de tomber et la puanteur fécale était omniprésente. En périodes de peste, lesquelles étaient fréquentes, la ville s’efforçait de nettoyer les rues qui étaient « très sales ». On devait interdire aux gens de se débarrasser sur la voie publique des peaux et entrailles des animaux domestiques, aux chirurgiens de vider le sang dans les rues, on laissait poliment entendre qu’on pouvait nettoyer le caniveau longeant les maisons, qu’on pouvait balayer le crottin résultant du passage incessant de chevaux et voitures. On manifestait l’espoir de voir bannir tout animal « à l’odeur nauséabonde ».33
La vieille ville recelait des rues presque trop étroites et sinueuses pour accueillir toutes les affaires de sa descendante en expansion. Elles étaient ponctuées de portes jusqu’aux caves, lesquelles sapaient les chaussées ; une bonne femme pouvait apparaître soudain à vos pieds. Les ruelles étaient recouvertes de voûtes, logettes et oriels qui se chevauchaient les uns les autres de telle sorte que des « chariots bâchés et des chevaux » avaient peine à passer, comme le déplore la ville en 1532. Certains dressaient des bancs sur la voie publique ainsi que de petites cabanes et abris. Les canaux qui serpentaient en ville étaient eux aussi surmontés de logettes et de lieux d’aisance qui souillaient l’eau. Les bateaux qui y étaient amarrés étaient régulièrement inondés par des cataractes issues des gouttières des édifices les surplombant.
Les boutiques se répandaient sur les mêmes rues, leurs marchandises étaient entreposées à l’ombre à l’intérieur, mais elles se vendaient dehors à la lumière, présentées dans des étagères sur les murs, sur des volets et des tréteaux ; on devait pouvoir voir les marchandises, après tout, ce qui était difficile à l’intérieur parce que le verre était trop épais et inégal pour laisser passer suffisamment de lumière ; quant aux « carreaux » ordinaires, c’était de la toile huilée. En outre, un marché semblait plus officiel en présence du public et les badauds étaient réputés garantir l’honnêteté du marchand.34
C’était les marchandises les plus chères qui se vendaient en boutique, les gants ou les souliers, l’or ou l’étain ; les acheteurs devaient savoir où se procurer ce qu’il leur fallait. S’agissant des articles quotidiens – nourriture, boissons, combustibles comme la paille ou le bois – des marchés leur étaient attribués, parfois le long des rues ou des canaux, parfois sur des étals sur une place. Les articles y étaient présentés sur un tréteau ou un drap à même le sol. Une fois la semaine se tenait un marché « libre » où pouvaient vendre directement des producteurs et artisans extérieurs à la ville ; bien évidemment, ils vendaient près des portes de la ville ou bien porte-à-porte dans les rues adjacentes les plus pauvres.35 Les commerces nobles suscitaient parallèlement force activités.
Le passage des lourds charrois hessiens apportant les marchandises des docks usait les pavés et les fonds manquaient toujours pour les remplacer tous. La population de l’Arenbergstraat, très fréquentée, déplorait que la rue ne fût pas pavée, qu’en cas de pluie et notamment en hiver, les gens puissent à peine sortir de chez eux. Par temps sec, ils disaient que les passants remuaient beaucoup de poussière.36
Aux plus fastueuses années de la ville, l’hôtel de ville était une bâtisse gothique en pierres parmi les maisons du Grote Markt, nantie de barreaux à piques aux fenêtres, d’une volée d’oiseaux en pierre sur le faîtage, de niches destinées à des statues saintes, sans que toutes fussent occupées ; elle possédait une galerie en bois au milieu d’autres maisons en bois. Le bâtiment était si ordinaire qu’il fallut en bâtir un neuf, en bois, en 1549, pour accueillir dignement le futur Philippe II, dans un décor à la fois théâtral et politique. Les seuls espaces publics susceptibles de paraître somptueux étaient des marchés comme le Meir, aux dais de bois au-dessus des échoppes, aux décorations raffinées de fleurs, de personnages, d’autres fioritures encore sur certaines façades environnantes.
Pour devenir exceptionnelle, la ville allait demander des usages exceptionnels et donc des créateurs capables de les imaginer.
*
Dierick Paesschen rêvait de posséder un bateau et se rendit à Anvers dans ce but. Il quitta une petite ville allemande pour gagner un lieu où tout était possible, et même l’impossible – telle était la réputation d’Anvers. À son arrivée, dans les premières années du XVIe siècle, la ville n’avait pas de marine à elle, ni galères comme Venise ni caravelles comme le Portugal ; ses bateaux, elle les affrétait dans des ports du Nord, Middelburg ou Amsterdam. Dierick Paesschen n’en voyait pas moins les usages de la ville. Il savait qu’elle n’avait peut-être pas de bateaux, mais elle avait tout le nécessaire pour en avoir : de l’argent, des passagers, des assurances et de l’optimisme.
Il lui fallait faire fabriquer un bateau spécial pour le transport de passagers, pas pour des ballots ou des caisses. Son bateau devait être assez somptueux, suffisamment armé pour transporter des pèlerins vers la destination appréciée de Jérusalem, pour éviter les pirates barbaresques de l’extrémité occidentale de la Méditer-ranée et les flottes ottomanes à l’est, de manière à persuader les passagers qu’ils avaient les meilleures chances de survie.37
Paesschen fit son chemin. Il commença par épouser une femme dont les biens méritèrent la signature d’un contrat de mariage formel pour protéger sa dot. Lorsqu’il appareilla pour la première fois, sa femme l’accompagna, ainsi que son beau-père ; il s’agissait après tout de la fortune familiale. Pour acquérir son bateau, il vendit d’abord une demeure anversoise du nom de Wyngaert, puis celle qui lui était attachée derrière, Egypten. L’immobilier anversois ne cessait d’augmenter.
Il fit placarder des affiches en allemand, latin et français pour annoncer une croisière qui s’arrêterait pieusement à St-Jacques-de-Compostelle en chemin vers la Méditerranée, puis à Rome, et toucherait enfin Jaffa. Il s’engageait par contrat à ce qu’aucune halte ne fût plus longue que promis ; il n’aurait pas à attendre de marchandises car il s’occupait de passagers. Il garantissait à chacun du vin, de la nourriture et un espace de sept pieds carrés à bord, sans encombrement de marchandises. Le passage serait payable une fois le bateau de retour à bon port à Anvers. Il informa le barbier Antoine Robyns que tout passager qui prendrait un aller simple n’aurait à payer que la moitié du prix.
Il était tout prêt au début de 1511, mais le fleuve ne l’était pas. L’Escaut était pris dans les glaces et retint tout son avenir, le bateau Salvator, jusqu’au 11 février. Il ne pouvait qu’attendre et voir ses fonds s’amenuiser. Il fallut encore quatre jours pour que la débâcle fût assez prononcée et qu’il puisse donner un grand banquet somptueux sur le bateau, en guise de célébration civique. Des dignitaires impliqués vinrent fêter une nouvelle entreprise, y compris le margrave, seigneur du lieu et représentant du Saint Empire romain sur la frontière. Le bateau était entièrement pavoisé. Onze jours plus tard, Paesschen fournit un reçu pour l’impressionnant catalogue d’armes empruntées à la ville, dont les plus légères étaient deux douzaines d’arquebuses chargées par la gueule. Une fois cette pièce enregistrée, le bateau put enfin appareiller pour Jérusalem.
La traversée se passa bien. Certains pèlerins rentrèrent en novembre par la route terrestre à partir de Rome. Le bateau lui-même reparut glorieusement le 24 mars, sous les vivats de la foule, les coups de fusils et de canons. Paesschen conduisit les pèlerins vers l’église de Notre-Dame pour y remettre un cadeau officiel des Chevaliers de Malte : deux gros boulets de fer qui restèrent longtemps suspendus sous la nef.
La ville l’adopta ; pour sa part, il avait besoin de son mode de fonctionnement. Il avait acquis son bateau en considérant qu’un bien pouvait représenter un investissement négociable aussi bien qu’à détenir. Il dépendait de clients assez riches et pieux pour consacrer leur temps à faire un long voyage loin de chez eux ; en outre, la distance valait davantage à un endroit où les gens avaient déjà l’habitude de relations éloignées aussi bien que profitables. C’était un atout que l’argent fût disponible à Anvers et que le conseil communal fût prêteur. Ainsi, la ville acheta une rente annuelle d’Arnold van Berchem en 1493, pour laquelle il hypothéqua trois fermes en précisant que cet argent était destiné au pèlerinage de son fils aîné à Jérusalem.38
Il ne se passa pas un an avant que Paesschen ait un concurrent, Wilhelm van der Geest, qui fit construire son propre grand navire pour la traversée jusqu’en Palestine. La situation financière du premier était fragile : sa femme était morte, peut-être d’épuisement après la première traversée, et il était en conflit avec son beau-père au sujet de sa dot. Il parvint tout de même à faire une seconde traversée, mais à l’horizon 1516 sa situation s’était encore détériorée. Il vendit une maison, en hypothéqua une autre et parvint à faire appareiller son Salvator en avril. Quelques jours plus tard, il se drossa sur un banc de sable au large du rivage anglais. Tous les passagers étaient sains et saufs, l’essentiel de la cargaison fut récupéré et l’on parvint même à sortir de l’eau certains canons.
Cette fois encore, il fut sauvé par Anvers qui assurait les navires. Ce système permit à Paesschen d’être remboursé. Il repartit à zéro. Il se remaria, bien que cette nouvelle épouse ne fût pas aussi riche. Dès 1518, il avait financé et fait construire un bateau de plus, « le plus grand jamais vu à Anvers » et le chargeait de passagers en route vers la Terre sainte. Une fois de plus, il triompha des obstacles les plus connus et accosta à Jaffa afin que les pèlerins pussent gagner Jérusalem par voie de terre. Lorsqu’ils débarquèrent, des gardes ottomans les arrêtèrent et les traitèrent en espions puisqu’ils étaient originaires de l’empire rival des Habsbourg : il leur faudrait payer pour rentrer chez eux. Les passagers s’exécutèrent, ils n’avaient pas le choix. Ils revinrent par Venise qui avait des relations plus apaisées avec la Sublime Porte. Le bateau rentra à bon port mais la traversée avait cessé d’être sûre pour les passagers.
Trois années de plus suffirent à couler l’entrepreneur. On réquisitionna son bateau pour diriger une flotte de protection des harenguiers ; peu après sa sortie du port, un gros grain éclata, qui disloqua la flotte. Le bateau de Paesschen sombra au large de Yarmouth. On ne put rien sauver du naufrage et la plupart de l’équipage périt. La chance de Paesschen le quitta. Les archives nous le montrent vendant une autre maison puis repartant naviguer, mais pas à ses frais. Sa seconde épouse, laissée à terre, se trouvait à court d’argent et de ressources et il mourut à Anvers en 1526.
Il avait imaginé un usage de la ville. Il avait vu dans les biens immobiliers une source de capital et avait compris que le système d’assurances diminuait le risque de naufrage et de désastre, si bien qu’il pouvait l’évaluer. Ses entreprises personnelles suscitèrent la fierté communale, l’invention d’une marine marchande anversoise de deux gros navires et il fut honoré par la ville qui avait toujours besoin de nouvelles entreprises. Surtout, il réussit à faire tout cela sur une base financière fragile, preuve de l’optimisme ambiant et d’une vision positive de l’investissement.
Cet optimisme serait mis à l’épreuve encore et encore.
*
Un soir de 1534, l’église de Notre-Dame prit feu. Il avait plu durant des jours sans interruption, les champs avoisinant la ville étaient sous l’eau et la boue, et malgré toute sa magnificence, Notre-Dame partit dans les flammes. C’était « la tour la plus célèbre d’Europe », au toit résonnant de musique sacrée, « remplie de dons d’une énorme opulence », de l’or jusqu’au marbre. Elle occupait une place incontestée dans la vie de la cité ; sur le site du marché de l’emploi où les hommes se présentaient pour trouver une tâche chaque jour ; c’est là que les guildes venaient adorer, en affichant tout l’or et la musique qui prouvaient leur vertu et leur succès. Et voici soudain qu’elle était, comme l’écrit le témoin Cornelius Grapheus dans un poème, « une masse horrible de fumée qui obscurcit la nuit, qui effaça la lumière de la pleine lune ».39
Il y eut le froissement du feu, puis la sonnerie urgente des cloches, puis les flammes crevèrent le toit de l’église. On ouvrit les portes pour laisser entrer les gens avec des échelles et des crochets afin de sauver les tableaux, images, objets d’or et d’argent qui avaient paru en sécurité et si permanents. Les autels étaient en feu, ainsi que les vêtements liturgiques. Grapheus se rappelle que « les oiseaux des hautes tours furent chassés dans une pluie hideuse de plumes et de cadavres. »
Au bout d’un certain temps, il ne put plus distinguer les flammes, masquées par toutes les maisons entourant la cathédrale, les demeures des banquiers sur la Groenplaats**, les maisons des guildes sur le Grote Markt ainsi que l’entrelacs de venelles ; on eût dit que le feu habitait la ville et menaçait tout ce qui était solide. Grapheus découvrit des scènes que des artistes « auraient pu imaginer », des incendies comme ceux qui obsédaient Jérôme Bosch et constituent l’arrière-plan de ses créatures les plus terrifiantes, tant le feu s’imprime dans l’esprit. « Le ciel était en feu », écrit-il. La scène évoquait la fureur de l’Etna, qui correspond à son souvenir de l’Énéide où Virgile ne fait pas que décrire l’éruption du volcan, mais mentionne aussi les forges de feu qu’entretient Vulcain dans ses soubassements. Le feu, pour un dignitaire de la ville comme Grapheus, était un résident permanent.40
La ville tenta de se protéger avec des règles et des normes, dont l’effet fut comme d’habitude limité. On trouvait des édifices en bois à toits de chaume malgré une ordonnance de 1503 qui interdisait le chaume, une autre de décembre 1513 qui imposait les toits en dur, une autre encore de 1520 qui encourageait le démontage des balcons et logettes en bois en assurant qu’on pouvait les remplacer, au même endroit, par l’équivalent en pierres ou en briques. En 1541, la ville s’efforça de débarrasser les galeries surplombant les canaux de leur poix et leurs graisses inflammables, et de s’assurer qu’on les calfaterait avec de l’ardoise, du plomb ou quelque matière « dure ». Mais la situation n’évoluait guère. En septembre 1546, les maisons de bois de Sint-Katelijnevest, près de la jolie Bourse neuve, partirent en flammes et, dans les deux mois suivants, une autre rangée de maisons, encore plus proche de la Bourse, fut réduite en cendres et en éboulis : vingt-deux maisons au total. Neuf jours plus tard, la ville interdit les murs extérieurs en bois et spécifia qu’il était interdit de finir ou réparer des toits ou murs de bois ; ils devaient demeurer en l’état « jusqu’à leur complète dégradation ».41 1582 vit publier le même ordre dans les mêmes termes. Et pourtant, à la toute fin du XIXe siècle, Anvers comptait encore des dizaines de maisons à pans de bois en bon état d’entretien.
Ce n’était pas simple illégalité, c’était un tour d’esprit. Nul ne pouvait ordonner quoi construire à quiconque, même si les voisins pouvaient s’y opposer ; mais une plainte apparemment raisonnable pour privation de lumière pouvait facilement avorter en l’absence d’ordre royal clair ou de convention écrite. Il existait tout un corpus de jurisprudence pour régler les querelles de voisinage, mais les lettres de harcèlement permanent de Charles Quint aux autorités anversoises n’avaient pas dégagé une ligne juridique claire, et pas davantage un mode de fonctionnement. Les villes n’aimaient pas informer l’empereur de leurs coutumes car elles s’attendaient à juste titre à ce qu’il veuille les modifier, les codifier ou les altérer.
Entre-temps, on pouvait construire à peu près tout, mais pas n’importe où. Ce principe fut mis noir sur blanc en 1546, 1570 puis 1582, de telle sorte que l’aptitude de la ville à réaliser son propre tissu urbain était strictement limitée. Il fallut attendre la prise de contrôle des calvinistes en 1582, lesquels tracèrent des rues à travers les terrains des couvents et des monastères, pour que s’appliquent des règles et principes généraux, qu’on dessine des rues droites, « car les rues courbes n’étaient pas favorables à la beauté, à la paix ni à la sécurité de la ville » ; pour que priment les notions d’élégance, de proportion et d’utilité, au lieu d’une série d’expédients parfois brillants qui remodelaient la ville sans toutefois lui donner une vraie forme.42
*
Les drapeaux appartiennent à la France et au Danemark, l’armée vient de la Gueldre au nord des Pays-Bas et son chef s’appelle Maarten van Rossum, un homme si féroce qu’on raconte des histoires stupides sur son compte pour frissonner. Il est censé être si cruel que ses moustaches se hérissent au combat. La nouvelle de son avance était déjà parvenue dans la ville, par les paysans chassés de leurs maisons en flammes. D’autres avaient constaté par eux-mêmes ses destructions et ses pillages dans la ville de Bois-le-Duc. À présent son armée se trouve sous les murs d’Anvers, parce qu’il est l’ennemi des Habsbourg et donc d’Anvers. La grande politique du monde européen, des dynasties et nations distinctes, se rappelle au souvenir d’une ville qui préférerait songer aux contrats et aux profits.
Nous sommes en 1542. Anvers s’est bien trouvée de la stratégie habsbourgeoise consistant à mener sa guerre contre les Valois en Italie, à la distance d’une mer et de quelques montagnes. Malheureusement, les Valois ont dépêché leurs violents supplétifs et van Rossum a lancé son raid au moment où le roi du Danemark Christian menaçait de débarquer des troupes en Hollande et où les Français s’agitaient à la frontière. Les armées impériales étaient ailleurs et occupées. Marie de Hongrie, gouverneure des Pays-Bas espagnols, informa son frère Charles Quint : « Nous sommes attaqués sur tant de fronts que j’ignore lequel traiter en premier. Le pis, c’est que nos ennemis sont prêts et pas nous ; ils nous ont pris tout à fait par surprise. »
La ville fut laissée à sa panique : elle dut faire taire ses cloches, garder les rues éclairées la nuit, envisager d’inonder les pâturages alentour et raser les masures des petites gens appuyées contre les remparts, de peur que l’ennemi ne s’y abrite. La rumeur courait que van Rossum était déjà en ville, qu’il parlait sur le marché aux chevaux, qu’il s’assurait de ses espions. Environ un millier d’hommes originaires de la Gueldre renoncèrent à leur citoyenneté et quittèrent la ville avant de se voir rangés dans le camp de van Rossum.
Les cloches pas plus que les horloges ne sonnaient, de peur que l’ennemi ne s’en serve comme d’un signal. La seule cloche, dans cette ville de cloches, était la grande Carolus : si elle sonnait, on devait démonter les étals, tous les hommes devaient gagner leurs postes et toutes les femmes quitter les rues. La perspective de van Rossum avait figé la ville : plus de commerce, rien dans les rues, plus aucune réaction communale à la menace constante d’incendie car seuls les gens désignés avaient le droit de réagir en cas d’alerte incendie. Les femmes étaient claquemurées à l’intérieur bien qu’elles eussent été précieuses pour déplacer des levées de terre afin de renforcer les murs ou dépaver les rues pour qu’on ait des munitions.
Les murailles présentaient des problèmes spécifiques. De toutes parts affluaient les bandits dans une ville aux faibles défenses médiévales, tout particulièrement entre les portes Rouge et Kipdorp.
La ville appela Breda à l’aide, mais van Rossum prit en embuscade et dans une nasse les troupes dépêchées ; cela se passa le 24 juillet. Ses troupes encerclaient toute la ville. Le 26 juillet, les privilèges s’évanouirent momentanément et l’on incendia quelques nobles demeures accolées aux murailles, un couvent et même un béguinage dont certaines des saintes occupantes furent expulsées. Puis une armée de colosses venus des Flandres – des « géants » selon la légende écrite par la ville sur son passé – arrivèrent pour la sauver en traversant l’Escaut alors même que van Rossum l’encerclait.