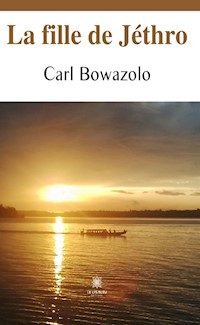
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Carlie Boaz, jeune enseignant, va en Guyane pour y réussir sa carrière. Malheureusement, un coup de théâtre le contraint à rebrousser chemin. De retour en Île-de-France, il trouve un emploi à Montréal, et repart à l’aventure. Ce dernier voyage lui permettra de se réaliser et de développer sa vocation d’écrivain, grâce à sa rencontre avec la fille de Jéthro.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Dans
La fille de Jéthro,
Carl Bowazolo prend le large dans ses pages et lève le voile de son encre pour l’Atlantique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 185
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carl Bowazolo
La fille de Jéthro
Roman
© Lys Bleu Éditions – Carl Bowazolo
ISBN : 979-10-377-5537-7
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Le doctorat fut l’or
Que j’allai chercher dans le Grand Nord,
Un grand merci à la philanthrope tante Helda
Qui, si merveilleusement, m’aida.
Métro noir
De la première à la dernière station,
Il desservira la première ligne
Afin de conduire ses dignes
À leur destination…
Un Métro noir vitré et sans rayure
Traversait le trottoir à vive allure…
Rue Félix Éboué,
Captivant comme un jaguar
Il attirait tous les regards
Même ceux des écroués…
Autour il y avait d’autres Métros sans couleur,
Mais eux ne supportaient la chaleur
Qui était de trop, doré par l’or du ciel tel un Négropolitain
Ce trolley devenu Noir métropolitain
Rayonnait sur son parcours
Faisant ainsi oublier tous ceux qui déraillaient en cours…
Première partie
La vie de prof
D’elle il ne lui restait que les souvenirs de leurs French Kisses. Pendant qu’Ayo lui chantait en boucle Down on my knees1 Carlie suppliait Nat de ne pas oublier leur amour et de revenir car sans elle il ne pouvait plus concevoir son avenir…
Lettre de Carlie à Natacha
Légendaire et inoubliable tu es une Sulamithe. Dans les rues de mon cœur, tu es un mythe à l’image d’une reine indétrônable ! Ton amour, qui me combat, me pousse à l’apologie du célibat ! Mon cœur verrouillé, et depuis sans copine, n’a que ton amour comme code PIN… Mes souvenirs ravivés par les chansons d’Ayo font dire à mon cœur « Na lingui yo »2. Finir par recommencer, je m’en fous ! Si tu reviens, j’annulerai TOUT même une future campagne présidentielle, car ma future compagne c’est toi, mon essentiel ! Je suis nostalgique et solitaire, dans une société qui semble désormais vile tous mes chemins ne mènent plus qu’à toi et à Brazzaville… Si tu reviens, garde-moi attaché à ton corps comme ton pagne afin que partout où tu iras je t’accompagne, si tu reviens…
En sachant qu’une vie sans dessein est comme un livre d’enfant sans dessins il avait vite su qu’il était là pour cultiver sur feuille ses champs de poésie en donnant le la. Il n’y a pas que les poètes maudits qui écrivent sans succès, contrairement à ce que l’on dit dans l’insuccès il y a aussi ceux qui sont bénis… Il avait la force d’un éléphant et le cœur d’un enfant, il était courageux comme un lion malgré ses peurs devenues légion.
Purement innocent mais coupablement décent car moralement son vers tue dans ce monde désormais sans vertu. Ce n’était plus que lit et ratures lorsque l’homme de science tombait amoureux de la littérature, jouissance poétique sans patience ne peut qu’être inachevée comme un premier jet alors il lui fallait plus de temps pour être plus que content de chaque vers immortalisé sur les feuilles de ses projets. L’inspiration était une boisson avec laquelle il remplissait ses journaliers vers, ses sentiments quittaient son cœur, leur terre, et c’était le temps de la moisson. Dans cet océan de rimes, comme en mer, il nageait aussi bien qu’un poisson. Quand l’écrit vint aucun de ses mots ne fut vain, quand l’écrivain se soûlait ce n’était pas avec du vin. Le dernier poète avait une plume chouette aussi légère que sa silhouette. L’encre bleue de sa grisaille noire coulait dans ses veines comme le fleuve de solitude d’un roi sans reine.
Dans son royaume christique il n’y avait jamais eu de place pour le mystique. Prêt à mourir sans jamais renoncer à souffrir, son cœur d’humaniste n’avait de la haine que pour le monde capitaliste qui obligeait l’humain à la peine. Sa tristesse fut un colis déchargé dans des vers de mélancolie sur des feuilles raturées par une plume torturée. L’homme sur qui il fallait miser était du genre à finir comme Thomas Sankara c’est-à-dire inachetable même pour des millions de carats. Son encre coule encore à en éclabousser la foule. L’écriture le soulage tant mais il lui faudra bien plus à trente ans ainsi sur les pas de Miles Davis il découvrait un autre vice celui d’être aussi strong que Louis Armstrong, aussi têtu qu’un âne il s’entêtait à vouloir le talent d’un John Coltrane. Cet oiseau qui se libérait pour être aussi connu que Parker3 se prénommait Carlie…
« Quand sonnait la fin de la récré tandis qu’ils continuaient de parler de chocolatines et de tranches de jambon à la cantine, Alcire choisissait l’exil, attiré par l’océan, le soleil et les îles. Il aurait préféré s’y rendre en bateau afin de profiter de la beauté d’un voyage sur l’eau mais finalement ce fut l’infinie traversée des nuages, les ailes au vent tel un oiseau retrouvant le ciel après des années de cage et de zoo. Chassé de ce paradis tel un ange déchu, il en partait déçu comme un innocent condamné et révolté par le nombre d’années. Mais il n’en était point amer ni ténébreux même chargé comme un bateau-mère sous le regard de son Dieu hébreu. Homme de foi respectant la loi, il était d’une espèce désormais rare comme un politicien ne méritant pas le placard, car ici certains croulaient sous les affaires, et d’autres étaient payés à ne rien faire et se permettaient d’embaucher leurs enfants parfois d’âge scolaire. Seule une minorité méritait honnêtement son salaire. Le monde vieillissait tout en restant jeune comme une bourgeoise mais le pays lui changeait sous le poids des années comme une paysanne. Avec le temps il avait vu venir le changement bien avant que l’autre ne dise “Le changement c’est maintenant”. Tout commençait à changer quand il avait vu arriver le danger au moment où il les voyait chercher l’étranger qui était, pour eux, responsable de tous les maux du pays tel un virus commençant à infecter tout le corps, il fallait vite agir et ceux rassemblés au front étaient prêts pour l’éradication virale, tels des chiens affamés que rien n’aurait calmés. Comme à une autre époque, mais pas si lointaine car les années ne se compteront par centaines, au cœur de l’une des plus belles villes du monde ils ostracisaient l’étranger comme une villageoise aux manières incongrues et pas assez classes pour leur place. Monté en l’air telle une grue dans cette avenue commerçante par milliers ils lui faisaient payer son immigration au prix fort, pas de réduction de peine tant qu’il n’y aura pas plus de sang dans les caniveaux que dans ses veines… Partout où Alcire allait, il fit toujours le même constat l’Homme est mauvais souvent fait à l’endroit naturellement disposé à faire du mal et rarement fait à l’envers naturellement disposé à faire du bien. C’est vrai que l’on naît pour être mauvais mais pourquoi ne pas tenter d’échouer ? se dit-il.
Les grands Prêtres de l’État voulaient du sang dans leur coupe et les têtes à décapiter étaient aussi nombreuses que celles qui mendiaient la soupe dans les rues de Paname aux allures d’une ville sans âme qui n’abritait plus que la peur et les fantômes des victimes des attentats. Ces mendiants étaient souvent des pauvres blancs prolétaires, devenus étrangers dans leur pays, que les riches méprisaient car eux avaient une planque et étaient cyniquement intouchables comme les banques. L’Homme est plein de vices comme le montraient les sévices de certains grands Prêtres car les hommes en devenir le devenaient avant l’heure et les femmes d’avenir le devenaient après les pleurs. L’âge n’était plus une armure,les fruits étaient cueillis avant d’être mûrs pour en faire des friandisesafin d’assouvir leur gourmandise. Un petit cœur au grand chagrin pleurait ses parents ce matin dans les rues du paradis luciférien après avoir goûté des bonbons amers qui lui avaient été offerts par un grand Prêtre vaurien, même s’il buvait toutes les mers sa petite langue en gardera le goût à jamais comme un éternel dégoût. Dans un pays presque en paix, la guerre était dans son cœur, le train du grand amour était sur le quai pour un voyage vers le bonheurmais elle hésitait à le prendre songeant plutôt à se pendre car hantée par ces bonbons amersdont le goût n’avait rien d’éphémère.Si la République est secouée par la vendetta de la morale c’est que dans les rangs de l’État certains raffolaient des gâteries enfantines. Dans une société malsaine la grandeur piétine puisque noir sur blanc c’est écrit sur l’une des pagesdu livre des dictons pervers : “L’amour n’a pas d’âge”.La perversité s’était mondialisée tels des vagabonds désormais ils sévissaient de la Thaïlande au Gabon.À l’image de ces distributeurs d’amers bonbons, rempli de pourritures le monde n’avait plus rien de bon. Dans le paradis de Lucifer les anges vivaient l’enfer pendant que les démons prospéraient car ils y avaient leurs repères. Que d’esclaves de l’immoral ! Tous enchaînés à la cupidité, tous aliénés à la stupidité, tous libérés de la morale. Dans le paradis luciférien, la vie ne valait plus rien, seuls les morts vivaient bien, les vivants se tuaient pour leurs biens. Il n’y avait pas que les chats qui n’avaient pas de piaule car jusqu’à présent loin d’une vie de pacha les sans-abris aussi miaulent…
L’étranger sur le point de perdre sa tête était injustement accusé de vol. Les supposées miettes picorées durant son vol lui valaient des prises de bec qui salissaient indélébilement son plumage que l’on tentera de reblanchir lors des hommages comme pour un ange traîné dans la boue. Sûr et certain ce n’est pas demain qu’il redéploiera ses ailes si le souffle ne lui est coupé. Debout les pattes liées, il était gavé de coups, sous l’insensibilité totale du père fouettard qui avait le cœur d’un négrier bourreau des nègres grillés. Au rythme des coups, il continuait de crier mais le son de son âme n’avait pas d’écho sur le macadam, il était noyé dans un ruisseau de larmes qui affluait vers son fleuve de sang. Ceux qui le regardaient n’avaient pas vu mourir son rêve quand débutait son dernier cauchemar. Ceux qui l’avaient accusé jouaient les effarouchés comme les campagnards à un autre temps quand ils voyaient débarquer un étrange citadin dans leur paisible village, le pouilleux fameux voleur de poules pire ennemi du fermier qu’on aurait lapidé même sous un pommier… Dans le ciel croassait un corbeau et au sol la terre était vidée pour un tombeau. Les charognards s’organisaient à festoyer et le peuple révolté se tenait prêt à tout nettoyer. De loin à l’ombre d’un arbre il observait cette macabre scène, en se disant que l’ignorance est un mal trop souvent sous-estimé. Ne le sauront-ils pas un jour ? Si l’Afrique est le berceau de l’humanité alors à un degré certain un Blanc n’est qu’un nègre qui s’ignore… »
Lettre d’Alcire, avant son départ, à ses amis
À vous que j’aime tant !
Le pays est en plein virage, l’injustice tonne. Avant que mon visage ne devienne le royaume de la pluie comme notre Rennes bretonne je m’en fuis sous les premières gouttes de ce mois d’août. J’ai dissipé mes doutes et choisi de reprendre une nouvelle fois la route. Je quitte le pays tout en restant en France. Finalement la grandeur du territoire est une chance quand il s’agit de fuir pour sauver son cuir. Je m’en vais sous les tropiques découvrir cette France d’Amérique latine. Chers amis soyez forts, que la récompense soit juste pour vos considérables efforts. Gardez la tête haute même quand vous deviendrez ces intègres qui sautent, poussés par ces tueurs de nègres. Dès que possible nous nous aurons au téléphone, comme nous le savons tout ne peut s’écrire ou se dire alors pour le reste je serai manchot et aphone ainsi pour nous autres ce sera moins chaud…
Amicalement,
Alcire
Après environ huit heures de vol, l’oiseau se posa délicatement sur l’une des pistes de l’aéroport Félix Éboué. Carlie avait une forte admiration pour celui dont le nom avait été donné à cette aérogare. Félix Éboué fut l’une des plus grandes figures de l’Afrique-Équatoriale française (A.-É.-F.) qu’il gouverna depuis Brazzaville qui deviendra la capitale de la France libre pendant le début de la Seconde Guerre mondiale faisant de Félix Éboué l’un des pionniers du début de la résistance antihitlérienne. Cette admiration pour ce gouverneur général renforçait son amour pour Brazzaville qu’il montra et fit entendre au grand jour lors de son discours prononcé sur les ondes de F.A.R. (France Afrique Radio) en ce jour anniversaire de l’indépendance de cet ancien Congo français. F.A.R. n’était pas la BBC et lui n’était pas de Gaulle mais son appel à la résistance trouva un écho dans ce pays qui était à l’aube d’une transition politique après des décennies de dictature féroce entretenue par les tentacules des réseaux mafieux et francs-maçons de la Françafrique initiée par de Gaulle dont la conférence de Brazzaville ne changea presque rien pour les colonies car les relations avec la Métropole demeurèrent serviles…
Bordée à l’est par le fleuve Congo, deuxième fleuve le plus puissant du monde et nourrie par d’innombrables rivières et ruisseaux, Brazzaville était une ville d’eau et pourtant certains de ses quartiers n’avaient toujours pas l’eau potable courante. La luciole demeurait encore le must-have car le courant n’y était que passager comme le silence des armes. Malgré le climat favorable et la fertilité des sols, la seule plante qui poussait dans chaque parcelle était celle de la misère et était souvent arrachée par la force du désespoir. Royaume de misères et de misérables, quel malheur ! Qu’avaient-ils à se mettre sur la table quand midi sonnait à chaque heure ? Le sous-sol regorgeait de richesses qui ne profitaient qu’au chef d’État qui n’était qu’un chef de clan à la tête de l’État. Par ailleurs sans soucis écologiques et pour des motifs purement économiques la forêt du Mayombe perdait ses arbres sans palabre. Et l’océan Atlantique, bouche avaleuse du Congo, à Pointe-Noire donnait son pétrole sans consentement. Ainsi la nature était pillée en toute impunité, en aurait-il été autrement si elle avait su crier plus fort que son peuple torturé ? Fini le temps des safaris, car désormais la beauté naturelle est à l’abandon à l’image de ces somptueuses chutes d’eau de Loufoulakari, hélas, ce pays était si beau avant l’arrivée des corbeaux qui ont pris le peuple pour des pigeons en le rendant si indigent pendant qu’eux entre deux vols s’engluent dans le pétrole…
Le Centre hospitalier universitaire n’était plus qu’un mouroir à peine plus équipé qu’un trottoir, faute d’argent on venait s’y éteindre sévèrement comme des lampes tempête sans pétrole dans un pays pétrolier. L’école était en ruine comme le futur de ceux qu’elle devait former, il n’en restait que des classes sans bancs ni tôles. Apprendre était rendu infernal par le climat, quand ce n’était le soleil qui tapait plus fort que le maître c’était la pluie qui mouillait punissablement tout en faisant un monstre bruit. Sans prophétie, malheureusement ces petits ventres vides n’étaient destinés qu’à faire d’énormes bides…
Dans la rue au milieu de petits cailloux et des tessons, près d’un bayou formé par l’eau de pluie qui stagnait depuis que les caniveaux n’étaient plus à niveau, les jeunes brazzavillois jouaient pieds nus à la balle. Pour ceux qui avaient des sandales celles-ci étaient utilisées en guise de poteaux délimitant l’espace qui servait de cage. Ce match de foot aurait eu tout son charme à l’arrivée de l’indépendance mais cinquante ans plus tard seul un mélange de colère et de honte pouvait jaillir en voyant ces conditions aussi pitoyables que misérables dans lesquelles jouaient ces jeunes footeux qui n’ignoraient pas que l’État s’en foutait d’eux ! Les joueurs en herbe n’avaient pas que besoin d’une pelouse car leurs vêtements déchirés par l’usure étaient à peine plus confortables que la boule de haillons qui leur savait de ballon. Leurs célébrations de but étaient souvent interrompues par des vendeurs ambulants de pains et d’eau, mais aussi par les cris des cordonniers et des éboueurs auto-entrepreneurs qui avaient progressivement et définitivement remplacé la voirie Congo. Seule la nuit sifflait la fin des matchs car la luminosité des étoiles était insuffisante pour réaliser leur vœu de prolongation nocturne…
Pendant que les blédards crevaient de faim, certains de la diaspora jouaient avec le caviar. Syndrome postcolonial, comme certains descendants d’esclaves, ils refusaient d’être libres et s’offraient d’autres nouvelles enclaves. À l’heure où leur pays était au bord de son enterrement, ils préféraient jouer aux dandys, en s’achetant des vêtements dont les prix indignes insultaient l’état de santé de l’Afrique. Comédiens dans l’une des pièces les plus grotesques du théâtre africain, les sapeurs brûlaient du fric pourtant gagné pour certains de manière chevaleresque, et pour d’autres de façon suicidaire puisqu’au travail ils s’étaient tués afin de voir leurs corps habillés et décorés par les plus grands couturiers, hélas, à force de voir de belles voitures, le rêve de certains voituriers est d’en acquérir, bien souvent, quitte à se prostituer…
Heureusement qu’il y en avait d’autres qui étaient véritables comme leur couleur. Noirs de la tête aux pieds car ils portaient le deuil de leur paradis assassiné. Loin des terres d’Afrique, déracinés tels des arbres, il ne leur restait plus que leurs feuilles pour coucher leur douleur avec la plume de Césaire, visages pâles et rafales de vers en pleine misère… L’enfer avait essayé de les rouler dessus mais la roue avait finalement tourné, et bientôt au paradis ils retourneront et à bras ouverts ils seront reçus car Dieu ne peut qu’être black puisque la Madone avait la couleur de Tupac. En attendant la dernière Pâque, ils étaient assis au bord d’un lac tentant de noyer leurs peines, cependant aucun ne pleurait son manque de veine car ils avaient tous assez de sang froid pour affronter leur chemin de croix. Même si leur foi n’était pas encore insoluble désormais ils n’avaient plus peur de nager en eau trouble. Ici la vie suivait son amer cours comme le Mississippi, et là-bas c’était le dépit, pendant qu’ils dirigeaient et digéraient au calme, le peuple quant à lui mourait de son foufou accompagné d’une sauce à l’huile de palme. Leurs sages n’étaient que des fous avec des mentalités « Strass et paillettes » dans des pays dont certains vivaient encore presque de chasse et cueillette. Pendant que le monde se réveillait, eux étaient encore au lit et rêvaient de merveilles. C’était l’africaine folie de ces dirigeants de la postindépendance. À force de s’habituer au désert on finit par accepter de jouir dans la misère…
Une fois sorti de l’avion, Carlie fut enlacé par une chaleur étouffante qui ne tarda pas à le faire suer à grosses gouttes au moindre mouvement et à chaque pas. Il faisait chaud aussi chaud que dans une fournaise, même à l’ombre on était chauffé comme un plat sur les braises. Le soleil dominait dans un ciel bleu presque sans nuage, et son feu brûlait la peau des anges, ceux qui aimaient le bronzage avaient de quoi trouver leur bonheur ainsi que leur futur malheur. Il n’y avait pas de vent pour le sécher, lui qui était désormais aussi mouillé qu’une plage venant d’être léchée par une vague. Le temps avait un air d’été des zones tempérées avec des instants parfois légers comme l’accoutrement de certaines femmes à la beauté souvent métissée qui laissaient entrevoir des parties de leurs corps sous le chantage pénible de cette suffocante chaleur tropicale. Quelle canaille ce roi soleil, sans dire un mot il les déshabillait toutes ; à première vue ça n’avait pas l’air de les déplaire, elles qui aimaient tant plaire et être séduites comme des sirènes, au grand bonheur des taureaux les plus libidineux des arènes…





























