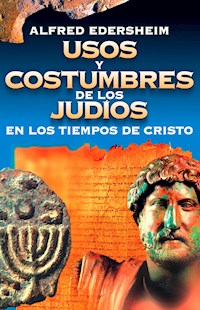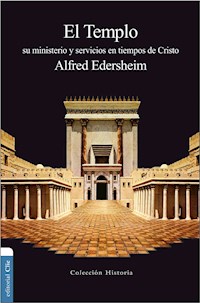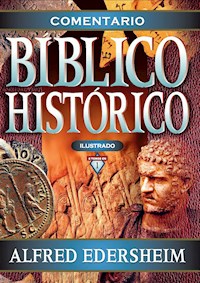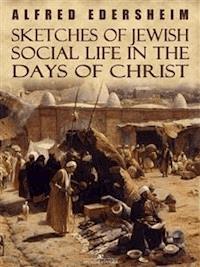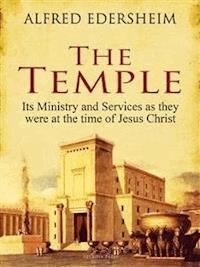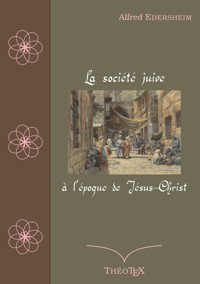
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Alfred Edersheim (1825-1889) est né à Vienne, dans une famille juive qui parlait couramment l'anglais, et qui lui fit apprendre l'hébreu dans la Torah et le Talmud. Converti au christianisme à vingt ans, il devint pasteur de l'Église libre d'Écosse, dans la Vieille Aberdeen, après une année de missionnariat auprès des Juifs roumains. D'une santé fragile il dut ensuite se déplacer, vers le sud : à Torquay, puis à Oxford, où il donnait des cours sur la Septante ; il est mort en France, à Menton. On retient de lui plusieurs ouvrages, dans lesquels il éclaire les textes bibliques par sa connaissance de première main de la culture et de la littérature juives : Histoire de la Bible en sept volumes, Le Temple, ses ministres, son culte au temps de Jésus-Christ, Histoire de la Nation Juive, La Vie et les Temps de Jésus le Messie, etc. L'un deux, que nous rééditons ici, Sketches of Jewish Social Life, fut traduit en français par le pasteur Gustave Roux, et parut en 1896. Il ne fait pas double emploi avec le célèbre livre d'Edmond Stapfer, La Palestine au temps de Jésus-Christ, en ce que s'il est moins méthodique que ce dernier, il nous immerge plus profondément, et avec plus d'empathie, dans l'atmosphère terrestre et spirituelle respirée par le Sauveur, lors de sa première venue. Cette numérisation ThéoTeX reproduit le texte de 1896.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TABLE DES MATIÈRES
Préface
La Palestine il y a dix-huit siècles
Juifs et Gentils dans le pays
La Galilée à l’époque du Seigneur
Voyages en Palestine
En Judée
Habitations des Israélites
Education de l’enfant Juif
Objets d’étude – Instruction donnée au foyer domestique – Education de la femme – Ecoles élémentaires
La mère, la fille, l’épouse Israélites
La Mort et ce qui la suit
Métiers, négociants, associations industrielles
Du commerce
Le peuple et les Pharisiens
Association fraternelle des Pharisiens
Pharisiens, Sadducéens, Esséniens – Leurs rapports avec l’Évangile
Des Synagogues
Culte de la Synagogue
Théologie du Judaïsme
Appendices
I. Mépris des Juifs pour les Païens
II. Mépris des Gentils pour les Juifs
III. Nazareth
IV. Plaine et lac de Génésareth
V. Le Jourdain
VI. La mort et la vie future
VII. Des règlements de la synagogue sur le Sabbat
VIII. Le Talmud
PRÉFACE
Le but que je me suis proposé en écrivant ce volume ne diffère point de celui que j’avais voulu atteindre dans un ouvrage précédent : Le Temple, ses ministres, son culte au temps de Jésus-Christ. Dans ma pensée, l’un et l’autre avaient pour objet de placer le lecteur en pleine Palestine, de le faire vivre à l’époque du Sauveur et de ses apôtres, de lui montrer enfin les scènes et les personnages au milieu desquels se sont accomplis les événements dont le Nouveau-Testament nous offre l’inimitable récit.
C’est ici pour moi plus qu’une hypothèse, c’est ma conviction la plus intime. Lorsque nous faisons revivre ce temps évanoui, quand, pour ainsi parler, nous assistons nous-mêmes aux événements, quand nous entendons la voix des hommes du premier siècle de l’Église, et que nous nous familiarisons avec les habitudes, la manière de penser, les enseignements et le culte des contemporains du Sauveur, nous comprenons aussitôt une foule d’expressions et d’allusions du Nouveau-Testament. Il y a plus. Par là, nous acquérons une preuve toute nouvelle de la vérité de ses récits, aussi bien que de la fidélité avec laquelle ils nous peignent la société que nous décrivent, à leur tour, les écrivains profanes. Chose admirable alors ! Le contraste singulier que présentent les enseignements et le but poursuivi par les contemporains du Seigneur avec ceux du Maître divin, sert ainsi lui-même d’apologie, de notre foi.
Étudiez attentivement cette période, et ce travail laissera dans votre esprit une conviction inébranlable. Vous comprendrez, sans porter aucune atteinte au respect qui lui est dû, que Jésus-Christ fut réellement de son temps, et que le Nouveau-Testament, dans ses narrations, dans son langage et dans ses allusions, est strictement fidèle au siècle et aux circonstances dans lesquelles se placent les événements qu’il fait passer sous nos yeux. A un autre point de vue plus important encore, il n’y a rien de commun entre le Christ et l’époque où il foulait la terre de ses pieds divins. « Jamais homme — de ce siècle ou de ceux qui le suivirent — ne parla comme cet homme, » ne vécut et ne mourut comme Lui. Certainement, s’il était le Fils de David, il est aussi le Fils de Dieu et le Sauveur du monde.
Dans l’ouvrage : Le Temple, son culte et ses ministres, je m’efforçais d’introduire le lecteur dans les saints parvis ; je désirais le faire assister à la célébration des rites solennels et mettre sous ses yeux tous les événements de l’existence des ministres du sanctuaire. Ici je me suis attaché à le mêler à la vie civile des hommes de cet âge. J’ai voulu m’asseoir à leur foyer, entrer dans l’intérieur de la famille, montrer leurs usages, les suivre au milieu des détails les plus humbles de l’existence de chaque jour. Illustrer l’histoire du Nouveau-Testament, en présentant sous une forme populaire les scènes que je décris, tels ont été ma pensée et mon ferme propos.
Ces quelques lignes me semblaient nécessaires pour expliquer le plan du livre et la manière de traiter les sujets que j’y étudie. Dois-je ajouter que j’ai condensé ici le fruit des travaux de plusieurs années ? Je n’ai négligé aucun des moyens d’information qu’il m’a été permis de recueillir. Il semblerait en vérité prétentieux d’énumérer les noms de tous les savants autorisés que j’ai consultés, de tous les livres que j’ai médités dans le cours de ces études. Les citations contenues dans les notes placées au bas des pages ne font connaître que quelquesunes des nombreuses sources dans lesquelles il m’a été donné de puiser de précieux enseignements.
J’ose espérer que ces études faciliteront l’intelligence du Livre divin, et fourniront une preuve inattendue et très puissante, à mon avis, de la vérité « de ces choses qui ont été crues le plus fermement parmi vous ».
Il ne me reste qu’à exprimer, une fois de plus, ma confiance pleine et joyeuse en cette grande et salutaire doctrine à laquelle tout nous conduit : « Christ est la fin de la loi en justice pour tout croyant. » (Rom.10.4)
ALFRED EDERSHEIM.
1 LA PALESTINE IL Y A DIX-HUIT SIÈCLES.
Palestine. — Situation actuelle. — Ce qu’elle était à l’époque de Jésus-Christ. — Sentiments des Rabbins Jonathan et Meir. — Climat. — Végétaux et animaux. — Enthousiasme qu’elle a excité. — Amour des Rabbins pour ce pays. — Les écoles de Babylone. — Idées superstitieuses. — Sentiment des Israélites contemporains. — Nulles reliques des âges passés. — Etendue de la Palestine à l’aube de l’ère, évangélique. — Ses habitants. — Idées que l’on se formait des dix tribus. — Son gouvernement. — Testament d’Hérode le Grand. — Disputes d’Archelaüs et d’Hérode Antipas. — Revenus d’Archelaüs, d’Hérode le Grand et d’Agrippa II. — Monnaies de Palestine. — Division du sol. — Idées que les Juifs se formaient de la Samarie.
Il y a dix-huit siècles et demi, la Palestine offrait à l’œil du voyageur un aspect bien différent du spectacle désolé qu’elle présente, de nos jours, à ses regards. Aujourd’hui ses collines grisâtres dominent des vallées presque incultes ; ses forêts sont tombées sous la hache ; ses terrasses d’oliviers et de vignes s’en vont en ruines ; ses villages remplis de souillures et habités par un peuple misérable, ses routes désertes et sans sécurité, sa population originelle presque éteinte nous disent que son industrie, sa richesse et sa puissance ont été anéanties dans une catastrophe irréparable. Mais alors le pays présentait un spectacle ravissant. Partout l’abondance, le mouvement et une activité sans exemple dans le monde connu. Les Rabbins ne tarissent jamais sur la louange de la patrie de leurs ancêtres lorsqu’ils vous parlent des privilèges que Jéhovah avait accordés à la Palestine soit dans le domaine matériel, soit dans la sphère morale.
« Il arriva, nous dit un des plus anciens commentaires des Hébreux 1, que le Rabbin Jonathan était assis sous un figuier et entouré d’étudiants. Tout-à-coup, il fit remarquer à ses auditeurs que le fruit mûri faisait plier jusqu’à terre les branches de l’arbre, sous le poids de ses richesses et distillait sur le sol ses sucs dorés, tandis qu’à une petite distance la mamelle gonflée d’une chèvre semblait impuissante à contenir plus longtemps le lait dont elle était remplie. « Regardez, s’écria le Rabbin, ne voyez-vous pas que les deux ruisseaux confondent leurs ondes ? Ne distinguez-vous pas ici l’accomplissement littéral de l’antique promesse d’une contrée découlant de lait et de miel ? — Le pays d’Israël ne manque d’aucun des biens de la terre, disait le Rabbin Meir, comme il est écrit : « C’est un pays de cours d’eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d’orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d’oliviers et de miel, pays où tu n’auras pas une nourriture mesquine, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu extrairas l’airain. » (Deut.8.7-9) (Yoma 91 b.)
Ces déclarations n’avaient rien d’exagéré, car la Terre Sainte réunissait toutes les variétés de climat, depuis les neiges de l’Hermon et les fraîches vallées du Liban, jusqu’à l’air doux et fécond du lac de Galilée, jusqu’à la chaleur tropicale de la vallée du Jourdain. Aussi y recueillait-on, non seulement les fruits des arbres, les grains et les produits des jardins de nos latitudes plus froides, avec ceux des climats plus doux, mais on y trouvait encore les épices rares et les parfums des zones les plus chaudes. Les historiens nous disent que toutes les espèces de poissons abondaient dans les eaux de ses rivières et de ses lacs, tandis que les oiseaux au plumage le plus riche remplissaient les airs de leur chant 2.
Dans l’étroit espace qu’il occupe, le pays offrait un charme et une variété d’aspects sans exemple. A l’Est du Jourdain c’étaient de vastes plaines ; des vallées découpaient les hauts plateaux, des forêts luxuriantes et des terres immenses couvertes de moissons et de pâturages s’étendaient devant les regards. A l’Ouest, des collines s’élevaient en terrasses pittoresques couvertes de vignes et d’oliviers. Ici on rencontrait des vallons délicieux, dans lesquels on entendait le murmure des sources, et où les points de vue les plus enchanteurs et la vie la plus active — autour du lac de Tibériade, par exemple — s’offraient aux yeux ravis des voyageurs.
Dans le lointain, c’était la vaste mer étendant, sous le ciel de l’orient, ses flots d’azur, sur lesquels se découpaient les voiles de navires innombrables. Devant nous, la richesse des anciennes possessions d’Issachar, de Manassé et d’Ephraïm. Là bas, par delà les plaines et les vallées, le spectacle des hautes montagnes de Juda, s’inclinant à travers les régions du Sud vers le désert immense, plein de mystère et d’effroi. Et par-dessus tout, tant que la bénédiction de Dieu s’étendit sur cette terre de la promesse, partout la paix et l’abondance. Aussi loin que le regard pouvait parvenir, les troupeaux broutaient sur des milliers de montagnes, les collines se ceignaient d’allégresse, les pâturages « étaient revêtus de brebis, les vallées couvertes de froment et le pays enrichi par la rivière de Dieu » semblait pousser des cris de joie (Psa.65). Un sol si riche, accordé par le ciel à un peuple, et gardé par une main divine, pouvait bien exciter l’enthousiasme le plus profond dans l’âme de ses habitants.
« Nous trouvons, dans un des commentateurs rabbiniques les plus instruits, R. Becchai, qui appuie chacune de ses assertions sur un témoignage de l’Écriture, que « treize choses sont la propriété exclusive du Saint ; béni soit son nom! Ces biens sont les suivants : L’argent, l’or, la sacrificature, Israël, le premier-né, l’autel, les premiers fruits, l’huile de l’onction, le Tabernacle d’assignation, la postérité de la maison de David, les sacrifices, le pays d’Israël, et l’assemblée des anciens. » L’union de la richesse et des plus hautes bénédictions spirituelles donnait à cette terre sacrée une valeur suprême. « Ce n’est qu’en Palestine que se manifeste la Schechinah » enseignaient les Rabbins. Une telle révélation n’est pas possible au-delà de ses saintes limites. Ici, les prophètes ravis ont eu leurs visions ; ici les psalmistes ont recueilli les accords de leurs hymnes célestes. Elle avait Jérusalem pour capitale, et, sur la colline qui dominait la ville, resplendissait dans sa blancheur, pure comme celle de la neige, et tout étincelant de l’éclat de l’or dont il était revêtu, le Temple de marbre, le sanctuaire autour duquel venaient se grouper tous ces précieux souvenirs, ces pensées saintes, ces espérances glorieuses et infinies.
Il n’existe pas, en effet, de religion aussi intimement unie que celle d’Israël aux lieux où elle était professée. Le paganisme adorait, il est vrai, des divinités nationales, et le judaïsme Jéhovah, le Dieu des cieux et de la terre. Mais les dieux nationaux des païens pouvaient être transportés dans d’autres pays, et leurs rites modifiés pour les adapter aux coutumes étrangères. Il en était tout autrement en Israël. Tandis que le Christianisme avait dès sa naissance, dans ses traits particuliers et dans le but divin qu’il révélait à la pensée, un caractère universel, les institutions religieuses et le culte du Pentateuque, même les perspectives ouvertes par les prophètes étaient, en tant que visant Israël, limités à la Palestine, et destinés à cette terre sacrée. Ces institutions ne pouvaient se perpétuer avec la perte du pays. Un judaïsme hors de Palestine, sans sacrificature, sans autels, sans Temple, sans sacrifices, sans dîmes, sans prémices, sans années sabbatiques et de Jubilé, devait d’entrée mettre de côté le Pentateuque. On ne pouvait échapper à cette conclusion, à moins qu’on ne considérât, ainsi que le fait le Christianisme, toutes ces institutions vénérées pendant de longs siècles, comme des fleurs destinées à devenir, au moment de leur maturité, des fruits savoureux, comme des types préfigurant des réalités supérieures, et appelés, en se réalisant, à se perdre dans ces réalités mêmes, qui constituaient leur accomplissement.
Ce n’est pas ici le lieu d’exposer ce que le rabbinisme voulait mettre a la place des sacrifices, etc. Je sais bien que le Judaïsme moderne s’efforce de prouver par des passages tels que les suivants :
— « L’obéissance est plus qu’une belle victime ». (1Sam.15.22).
— « Le sacrifice que Dieu veut c’est un esprit contrit ». (Psa.51.16-17)
— « J’ai à satiété des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux » (Esaïe.1.11-13).
— « J’aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les victimes » (Osée.6.6)
que dans la pensée des prophètes, les sacrifices, et avec eux toutes les institutions rituelles du Pentateuque, n’avaient pas une importance permanente. Au lecteur sans préjugé il semble difficile de comprendre comment l’esprit de parti lui-même peut tirer aussi légèrement des conclusions semblables de telles promesses. Est-il possible d’imaginer jamais que par leurs enseignements, les prophètes avaient pour but non d’expliquer ou d’appliquer, mais de mettre de côté la loi donnée d’une manière aussi solennelle sur le Sinaï ? Quoi qu’il en soit, le moyen n’est pas nouveau. Une voix solitaire ne s’aventurait-elle pas, déjà dans le second siècle, à affirmer que le culte des sacrifices n’avait été organisé par Moïse que dans une pensée d’accommodation, afin de préserver Israël de tomber dans les pratiques des cultes païens.
En dehors du pays le peuple n’était plus lui-même Israël. Pour les Gentils, ses membres étaient des Juifs ; et à leurs propres yeux « les hommes de la dispersion. »
Les Rabbins ne pouvaient manquer de faire cette observation. Aussi, lorsque après la destruction de Jérusalem par Titus, ils s’occupèrent de reconstruire leur état ruiné, ce fut, sur une base nouvelle, mais toujours dans les limites de la patrie vénérée qu’ils cherchèrent à réaliser cette pensée. La Palestine était le mont Sinaï du rabbinisme. Là jaillissait la source de la Halachah ou de la loi traditionnelle ; et c’est de là qu’elle s’écoulait en fleuves toujours plus majestueux dans leurs cours. C’est là qu’était le centre de l’instruction, de l’influence et de la puissance du Judaïsme. Et c’est là toujours qu’ils auraient voulu le perpétuer. Les premiers effets de la rivalité des écoles juives établies à Babylone furent profondément sentis et sévèrement réprimandés 3. Seule la force irrésistible des circonstances fut assez puissante pour contraindre les Rabbins à chercher la sécurité et la liberté dans cet ancien séjour de leur captivité. Là le calme dont ils devaient jouir au point de vue politique, leur permettrait d’amener leur système à son développement parfait.
Le désir de conserver en Chanaan la nation et ses écoles inspirait les pensées que nous allons citer : « L’air même de la Palestine rend sage » disaient les Docteurs. Lorsqu’ils lisaient les détails donnés par le Saint Livre sur les pays situés aux frontières du Paradis et arrosés par le fleuve Havilah, dont il est dit que « l’or de ce pays est bon », ils les appliquaient à leur Eden terrestre. Leurs paraphrases prétendaient même que ces paroles voulaient dire : « Il n’y a pas d’enseignement semblable à celui de la Palestine. » — « Vivre en Palestine, disait un axiome populaire, équivaut à l’observation de tous les commandements. » — « Celui qui a son domicile permanent en Palestine, enseignait le Talmud, est assuré de la vie à venir. » — « Trois choses, lisons-nous dans un autre livre faisant autorité, seront la propriété d’Israël, après avoir été conquises au prix de ses douleurs : La terre sacrée, la science de la tradition et le monde à venir. » Ce sentiment ne fut pas même anéanti, quand le souffle de la guerre et ses désolations eurent passé sur ce malheureux pays. Trois et quatre cents années après Jésus-Christ, les Rabbins enseignaient encore « que celui qui demeure en Palestine est sans péché ».
De longs siècles de dispersion et de changement n’ont pas arraché du cœur du peuple d’Israël cet amour passionné du sol sacré des pères. Ici même, la superstition a quelque chose de touchant. Le Talmud avait déjà exprimé ce principe : « Celui qui est enseveli dans le pays d’Israël repose dans un lieu aussi saint que si sa dépouille était déposée sous l’autel » (Cheth. III : a). Un des plus anciens commentateurs hébreux va même beaucoup plus loin. De l’ordre donné par Jacob et Joseph, et du désir des patriarches d’être ensevelis dans le sol vénéré, il tire la conclusion que ceux qui y reposent seront les premiers « à marcher devant le Seigneur dans la terre des vivants. »(Psa.116.9) « les premiers à se relever d’entre les morts et à jouir du bonheur des jours du Messie. » Toutefois, pour ne pas priver de leur récompense les hommes pieux qui ne jouissent pas du privilège de résider en Palestine, il ajoutait : « L’Éternel ouvrira devant eux des routes souterraines pour arriver dans la terre sainte, et lorsque leurs cendres y seront parvenues, l’Esprit du Seigneur les animera d’une vie nouvelle, ainsi qu’il est écrit : « J’ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai au pays d’Israël, et vous reconnaîtrez que je suis l’Éternel, quand j’ouvrirai vos tombeaux — et je mettrai mon esprit en vous, afin que vous repreniez vie. » (Ezech.37.12,14)
Chacune des prières, chacune des hymnes du peuple de Dieu respire ce même amour. Il est en réalité impossible de faire comprendre par des extraits tout ce qu’il y a de touchant dans quelques-unes des élégies où la Synagogue pleure toujours la perte de Sion ou bien exprime l’ardent désir de son relèvement 4. Quelle que soit sa désolation les descendants d’Abraham sont attachés à ses ruines, ils croient, ils espèrent. Ils appellent par leurs soupirs, avec une exprimable ardeur, dans presque toutes leurs requêtes, le temps bienheureux et attendu où, comme l’antique Sarah, le pays, à la parole du Seigneur, verra sa jeunesse, sa beauté, sa fécondité rétablies par le très Haut. Jour glorieux où une « corne de salut sera élevée pour la maison de David dans le Messie revêtu de sa dignité souveraine et de sa couronne royale. »
[Ce sont les paroles textuelles d’une prière empruntée aux fragments les plus anciens de la liturgie Juive, et répétée probablement depuis 2000 ans, chaque jour, par chaque Israélite.]
On l’a justement remarqué, aucune contrée ne pouvait être plus privée de reliques que la Palestine. Dans ce pays où les contrats les plus solennels ont été conclus entre le ciel et la terre, sur ce sol où tous les vestiges des siècles passés, si nous les connaissions, conservent la mémoire d’un fait auguste, où les rochers, les grottes, les sommets des montagnes rappelleraient les actes les plus saints ; nous ignorons presque entièrement la place exacte des lieux auxquels s’attache un de ces glorieux souvenirs. A Jérusalem même, les vallées, les dépressions du terrain, les collines, ont été transformées par le cours des siècles. Le sol primitif est enseveli sous les ruines accumulées des âges. Ne semble-t-il pas que le Seigneur ait voulu faire de ce pays ce qu’Ezéchias fit pour le serpent d’airain du temps de Moïse, lorsqu’il le mit en pièces, de peur que cette relique ne donnât au peuple l’occasion de célébrer les actes odieux de l’idolâtrie. La situation de la terre et des fleuves, des montagnes et des vallées est la même. Hébron, Bethléem, le mont des Oliviers, Nazareth, le lac de Tibériade, la Galilée sont toujours là ; mais leur aspect a changé, il n’y a aucun lieu auquel on puisse, avec une certitude absolue, rattacher les actes les plus augustes de l’histoire sacrée. Des événements et non des places, des réalités spirituelles et non le milieu dans lequel elles se sont déployées, voilà ce que ce pays a donné à l’humanité.
« Aussi longtemps qu’Israël habita la Palestine, dit le Talmud de Babylone, la contrée était vaste. Mais maintenant elle s’est rétrécie. » Il est facile de trouver une vérité historique sous cette expression étrange. Chaque changement apporté par les âges a diminué la superficie comprise dans ses frontières. Jamais cependant le pays n’a atteint les limites tracées par la promesse qui, à l’origine, fut faite à Abraham : « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d’Egypte jusqu’au grand fleuve, le fleuve Le Phrath, » (Gen.15.18) et qui plus tard fut confirmée aux enfants d’Israël. (Exo.23.31) Les conquêtes de David réalisèrent presque les promesses prophétiques au jour où le sceptre de Judah s’étendit jusqu’à la lointaine rivière de l’Euphrate. (2Sam.8.3-14)
A cette heure, le sol qui porte ce nom sacré est plus petit que dans aucune des précédentes périodes. Comme dans les temps anciens, il s’étend du nord au sud « de Dan à Beersheba », de l’Est à l’ouest de Salcah (la moderne Sulkad) « jusqu’à la grande mer », la Méditerranée. Sa surface est d’environ 12 000 milles carrés, sa longueur de 140 à 180, sa largeur, au sud, d’environ 73, et au nord de 100 à 120 milles. La Palestine actuelle est à peu près deux fois aussi large que le pays de Galles ; elle est plus petite que la Hollande, et d’une dimension presque égale à celle de la Belgique. De la plus haute des montagnes qui la dominent, on peut avoir le coup d’œil de la contrée entière. Telle était l’exiguïté du pays que l’Éternel choisit pour être la scène des événements les plus merveilleux qui s’accomplirent jamais icibas, le foyer d’où il voulait que jaillissent la lumière et la vie pour se répandre sur le monde!
Lorsque Jésus-Christ foulait de ses pieds divins le sol de la Terre Sainte, celle-ci avait déjà passé par bien des changements. L’ancienne division des Tribus n’existait plus. Les deux royaumes de Juda et d’Israël avaient disparu ; le temps des diverses dominations étrangères et la courte période d’indépendance nationale s’étaient également évanouis. Cependant, par suite de l’obstination caractéristique de l’Orient à s’attacher au passé, les noms des anciennes tribus étaient toujours donnés à quelqu’une des provinces que ces dernières avaient précédemment occupées (Matth.4.13,15). Un nombre comparativement petit des exilés étaient revenus en Palestine avec Esdras et Néhémie. La population juive du pays se composait de ceux qui avaient d’abord été laissés dans la Terre Sainte, et des tribus de Juda et de Benjamin. Les questions controversées au sujet des dix tribus, qui attirent de nos jours si vivement l’attention, étaient au temps du Christ débattues avec une rare fureur.
[Ce n’est pas ici le lieu de discuter cette question. Il ne saurait y avoir de doute fondé sur ce point que les colonies de quelques-unes de ces tribus étaient dispersées dans des contrées lointaines. On peut retrouver des traces de celles-ci en Crimée où les dates gravées sur leurs tombes sont reconnues comme étant « de l’ère de l’exil, en 696 avant Jésus-Christ, c’est-à-dire de l’exil des dix tribus, et non 586, lorsque Jérusalem fut prise par Nabucadnezar ». Dr Davidson dans Kitto, Cycl. of Bibl. lett. III, p. 1173. Quanta l’histoire des voyages des dix tribus, voyez History of Jewish Nation, p. 61-63, ainsi que le résultat des dernières découvertes du Dr Wolf dans ses voyages. Les Juifs instruits du Talmud étaient portés à une crédulité extrême sur ce sujet, comme on le voit dans l’appendice au livre Holy Land du Rabbi Schwartz de Jérusalem (pp. 407-422 de l’édition allemande). Les plus anciennes inscriptions Hébraïques en Crimée datent de l’an 6, 30 et 89 de notre ère. Chwolson, Mém. de l’Acad. de St-Pétersbourg IX, 1866. No 7.]
Ira-t-il vers les tribus dispersées parmi les Gentils ? se demandaient les Juifs, lorsque Jésus leur parlait de son départ, en employant le langage vague et mystérieux dont nous enveloppons les choses que nous ignorons, mais que nous prétendons cependant exactement connaître : « Les dix tribus sont jusqu’à présent au-delà de l’Euphrate, et se composent d’une immense multitude, dont on ne peut estimer le nombre » écrit Josèphe, avec le plaisir qu’il éprouve à relever, dans un style pompeux, la grandeur de sa nation.Mais où sont-elles ? C’est ce qu’il nous dit aussi peu que tous les auteurs, ses contemporains. Nous lisons dans la plus ancienne autorité, la Mishnah (Sanh.10.3) : « Les dix tribus ne retourneront plus dans la Terre Sainte, ainsi qu’il est écrit (Deut.29.28) : « et l’Éternel les a arrachés de leur pays, avec courroux, colère et grande irritation et les a jetés dans un autre pays, comme il arrive aujourd’hui. » — « Le jour s’en va et ne revient plus ; ainsi ils s’en sont allés et ils ne reviendront pas. » Telle est l’opinion du Rabbi Akiba. Rabbi Eliezer dit : « De même que le jour s’évanouit dans l’obscurité du soir, et de nouveau se rallume vers l’Orient, ainsi en sera-t-il pour les dix tribus, sur lesquelles s’étendent les ténèbres. La lumière leur sera de nouveau donnée. »
Au moment de la naissance du Christ, la Palestine était gouvernée par Hérode le Grand. Nominalement, elle formait un royaume indépendant mais, en fait, elle était soumise à la suzeraineté de Rome. A la mort d’Hérode, c’est-à-dire presque à l’aurore de l’histoire évangélique, son empire fut divisé pour quelque temps. Les événements qui s’y passèrent illustrent admirablement la parabole du Seigneur rapportée par l’évangéliste saint Luc (Luc.19.12,15-27). S’ils ne constituent pas la base historique de la similitude, ils étaient du moins si récents et présents d’une manière si nette à la mémoire des auditeurs du Christ que leur esprit devait naturellement se reporter sur ces faits. Hérode mourut, comme il avait vécu, cruel et dissimulé. Quelques jours avant sa fin il avait encore une fois modifié son testament, et nommé pour successeur au royaume Archelaüs ; Hérode Antipas (l’Hérode des Évangiles) tétrarque de Galilée et de Pérée ; et Philippe, tétrarque de la Gaulonite, de la Trachonite, de la Batanée et de Panias, provinces dont nous aurons plus tard à parler. Dès qu’Hérode fut déposé dans le sépulcre, et que les circonstances le permirent, Archelaüs, après avoir comprimé une révolte à Jérusalem, se rendit à Rome en toute hâte, pour obtenir de l’empereur la confirmation du testament de son père. Il fut suivi de près par son frère Hérode Antipas, auquel un précédent testament avait accordé ce qu’Archelaüs réclamait maintenant. Ils trouvèrent dans cette ville plusieurs des membres de la famille d’Hérode qui tous avaient une revendication à faire valoir. Ils étaient cependant unis pour demander qu’aucun d’eux ne fût créé roi, et que le pays fût placé sous l’autorité de Rome. Ils ajoutaient que dans le cas contraire ils préféraient hautement Hérode Antipas à Archelaüs. Du reste, chacun des frères avait un parti qui intriguait de toutes les manières pour exercer sur l’empereur une influence favorable à ses vœux. Auguste inclinait d’abord vers Archelaüs. Sa décision fut néanmoins différée à la suite d’une insurrection nouvelle en Judée, que l’on ne réprima qu’avec peine. Sur ces entrefaites, arriva une députation Juive suppliant l’empereur de ne nommer aucun des Hérodiens, les actes infâmes dont ils s’étaient rendus coupables, et qui furent alors révélés à César les en rendant indignes. Elle sollicitait du chef de l’Etat l’autorisation, pour les Juifs, de vivre sous l’empire de leurs propres lois, tout en restant soumis à sa suzeraineté. Auguste se résolut enfin à exécuter la volonté suprême d’Hérode le Grand, mais il ne laissa à Archelaüs que le titre d’ethnarque, à la place de celui de roi, lui promettant de lui donner plus tard le trône d’Hérode, s’il s’en montrait digne (Matt.2.22).
A son retour en Judée, Archelaüs, comme le dit la parabole, tira vengeance de ses concitoyens, et répandit le sang « de ces hommes qui le haïssaient, et qui avaient envoyé des messagers dans la capitale de l’empire pour dire à César : nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. »
La victoire d’Archelaüs fut de courte durée. Des plaintes nouvelles et plus vives arrivèrent au palais impérial. Il fut déposé, et la Judée réunie à la province romaine de la Syrie, mais avec un procurateur chargé du gouvernement. Aussi longtemps qu’il exerça le pouvoir, les revenus d’Archelaüs s’élevèrent au chiffre considérable de 6 millions de francs par an ; et ceux de ses frères au tiers et au sixième de cette somme. Mais qu’était-ce que cela en comparaison des ressources d’Hérode le Grand, qui n’étaient pas inférieures à 17 millions de francs, et à celles d’Agrippa II que l’on estimait à plus de 12 millions ! En lisant ces chiffres, ne perdons pas de vue le bas prix, à cette époque, de toutes les choses nécessaires à la vie. On peut en juger par la faible valeur des pièces alors en circulation ; et par l’infime salaire des journées d’un ouvrier. La monnaie la plus petite, une perutah juive équivalait au seizième d’une pièce de deux sous. Les lecteurs du Nouveau-Testament n’ont certainement pas oublié qu’un ouvrier recevait un denier pour le travail du jour dans le champ ou la vigne du Maître (Matt.20.2), et que le bon Samaritain remit à l’hôtelier pour les soins à donner au pauvre blessé qu’il avait recueilli sur la route de Jéricho, deux deniers seulement (Luc.10.35).
Mais n’anticipons pas. Notre objet est maintenant de parler de la division de la Palestine au temps de Jésus-Christ. Au point de vue politique, elle se composait de la Judée et de la Samarie, assujetties à des procurateurs romains. La Galilée et la Pérée (de l’autre côté du Jourdain) étaient soumises à Hérode Antipas, le meurtrier de Jean-Baptiste, « ce renard » plein de ruse et de cruauté auquel le Seigneur renvoyé par Pilate ne voulut faire aucune réponse. La Batanée, la Trachonite et l’Auranite étaient placées sous la domination du Tétrarque Philippe. Nous aurions besoin de trop longs détails pour décrire d’une manière précise ces dernières provinces. Qu’il nous suffise d’observer qu’elles étaient situées au nord-est, et qu’une de leurs cités principales étaient la ville de Césarée de Philippe, — ainsi nommée en l’honneur de l’empereur Romain et de Philippe lui-même. C’est là que Pierre fit une noble confession de sa foi au « Fils du Dieu vivant », immuable base du rocher sur lequel l’Église devait être bâtie (Matt.16.16 ; Marc.8.29). Ajoutons que l’épouse de ce Philippe, le meilleur de tous les fils d’Hérode, fut poussée par son beau-frère Hérode Antipas à abandonner son mari. Et n’est-ce pas pour plaire à cette femme impudique que ce dernier fit couper la tête à Jean-Baptiste (Mat.14.3 ; Marc.6.17 ; Luc.3.19) ? Au reste, il est bon de le savoir, cette union adultère et incestueuse fut la cause immédiate de troubles et de malheurs nombreux pour Hérode. Elle lui coûta finalement son royaume, et le conduisit à un exil qui dura toute sa vie.
Telle était la division de la Palestine. Habituellement, on y distinguait la Galilée, la Samarie, la Judée et la Pérée. Il est a peine nécessaire d’ajouter que les Juifs ne considéraient pas la Samarie comme appartenant à la Terre Sainte. Pour eux, ce n’était qu’une bande, un lambeau d’un pays étranger, ainsi que le Talmud la désigne (Chag. 25, a) « une bande Cuthite » ou une « langue » qui séparait la Galilée de la Judée. Les Samaritains étaient non seulement mis au rang des Gentils et des étrangers (Mat.10.5 ; Jean.4.9.26), mais le mot même de Samaritain était une injure cruelle (Jean.8.48). « Il y a deux sortes de nations, dit le fils de Sirach (Sira.1.25-26) que mon cœur a en horreur, et la troisième n’est pas une nation; celle qui est assise sur les montagnes de Samarie, et celle qui habite au milieu des Philistins, et ce peuple insensé qui demeure en Sichem. » Josèphe nous présente le récit suivant, pour nous rendre compte de l’exclusion des Samaritains du sanctuaire auguste dans lequel Israël adorait Jehovah. Il nous rapporte que dans la nuit de la Pâques, à l’heure de minuit où, selon la coutume, on ouvrait les portes du lieu saint, un Samaritain étant venu, avait jeté des ossements sous les portiques et dans le temple, pour souiller la maison de l’Éternel. Quelque invraisemblable que la chose paraisse, au moins dans ses détails, ce récit nous montre quels étaient les sentiments du peuple Juif à leur égard. Les Samaritains, à leur tour, devaient certainement répondre par une amère haine et par d’insultants mépris aux traitements dont ils étaient l’objet. Car dans toute leurs épreuves nationales, les Juifs n’eurent jamais d’ennemis plus déterminés et plus infatigables, que ceux qui se proclamaient les seuls représentants fidèles du culte et des espérances d’Israël.
1. V. Hamburger. Real : Encyc. d. Jud. 1, p. 816 n. 37.
2. Comparez les détails que nous donne un naturaliste aussi exact et aussi compétent que le chanoine Tristram.
3. Voyez : History of the Jewish Nation par Edersheim, p. 247, 248.
4. Voyez en particulier la plus belle de ces élégies, celle de Judah-Ha-Levi.
2 JUIFS ET GENTILS DANS LE PAYS.
Limites de la Palestine. — Déclarations des Rabbins sur la sainteté du pays sacré et sur les souillures du sol occupé par les Gentils. — Les trois provinces désignées par le nom de Palestine. — Offrandes permises. — Provinces désignées par le nom de Syrie. — En quoi semblables ou différentes de la Palestine. — Idées que les Juifs avaient des pays païens. — Division du pays d’Israël enseignée par Maimonides. — Lieux où les Rabbins permettaient de prendre les Biccurim et les Thérumoth. — Distinction admise entre les provinces situées à l’orient ou à l’occident du Jourdain. — Suprématie de la Judée sur la Galilée. — Antioche. — Les frontières de Tyr et de Sidon. — Miracles qui y furent opérés. — Provinces de la Palestine à l’époque de Jésus-Christ. — Dialectes. — Propagation de l’Hellénisme. — Divisions du Judaïsme. — Séparation des Juifs Pharisiens et des païens. — Dédain réciproque des Juifs pour les Gentils et de ceux-ci pour Israël.
La Palestine était le pays que le Seigneur avait préparé pour être l’habitation de son peuple, et le berceau de son royaume sur la terre. Bornée à l’orient par la mer Méditerranée, au nord par le Liban, à l’est par le désert de Syrie, au sud par celui de l’Arabie Pétrée, elle est placée au centre des trois parties du monde alors connu. Sa position d’île, au sein d’un continent, aussi bien que l’isolement de son peuple, donnent à cette terre unique ce double caractère. Fermée à l’influence des pays étrangers, elle occupe cependant le centre de l’Univers. Par la constitution même du sol, elle semble présenter d’infranchissables barrières aux délétères influences des contrées étrangères. En même temps, sa situation entre l’Egypte et les grands Royaumes de l’Asie, la proximité de la Phénicie qui faisait commerce avec tout l’Univers, plaçaient la Terre Sacrée au centre de l’activité du monde ancien.
La Palestine est essentiellement un pays de montagnes. Désignée d’abord sous le nom de Canaan ou Pays-bas parce que, d’après Genèse.10.15-19, les Cananéens s’établirent dans les terres basses de la Phénicie d’où ils se répandirent jusqu’à la mer Morte ; elle fut nommée Palestine depuis l’époque des Romains. Sa géographie physique est peut-être marquée d’une manière plus distincte que celle d’aucune autre contrée dans le monde. Le long des côtes de la Méditerranée court la Shephelah et la plaine de la mer. Celle-ci n’est interrompue que par l’élévation altière du Carmel qui s’avance comme un éperon de vaisseau antique dans la grande mer. La portion située au nord du Carmel forme la plaine de Saint-Jean-d’Acre. Les côtes méridionales sont séparées par la colline de Joppé en deux portions : celle du nord qui se nomme la plaine de Saron, et celle du sud que l’on désigne sous le nom de plaine de Shephelah.
Parallèlement à la côte, court une longue rangée de montagnes arrondies pour la plupart et sans grand caractère. Groupées vers le nord, elles forment le pays élevé de la Galilée. Celles du sud embrassent les monts d’Ephraïm (Samarie) et ceux de Juda (Judée). Du côté de l’Orient, ces collines plongent dans la vallée profonde de El-Ghôr, la vallée du Jourdain. Au-delà s’étend la ligne droite, ininterrompue des hauteurs de Moab et de Galaad que les rayons du soleil colorent de leur chaude lumière. D’immenses forêts de chênes y alternent avec de petites plaines, propres à la nourriture du bétail. Ce pays est sillonné par la rivière du Jarmuk qui vient se jeter dans le Jourdain, à quelques milles au-dessous de la mer de Galilée. On donne à la partie septentrionale du plateau oriental le nom de Basan. Au sud du Jarmuk, s’élève la chaîne des montagnes de Galaad, traversées par le torrent de Jabbock. Vers le midi enfin, le plateau de Galaad s’affaisse pour former, en face de Jéricho, une large plaine, la campagne de Moab.
La contrée, en la regardant du nord au sud, peut être représentée par quatre bandes parallèles : le bord de la mer, — le pays des montagnes, — la vallée du Jourdain, — et la ligne des hauteurs qui sont au-delà de ce fleuve.
La Bible et les auteurs classiques font l’éloge de la fertilité exceptionnelle du sol.
C’est, dit la première, un pays découlant de lait et de miel. La population était proportionnée à la fertilité du pays. Habité au temps d’Abraham par des peuples nombreux, il pouvait fournir néanmoins de la place et de la nourriture pour ses troupeaux immenses. Lors du dénombrement de David, il comptait 5 millions d’habitants, environ 10 000 par mille carré. Sa population semble avoir été plus considérable encore au temps de Jésus-Christ. Aussi quel pénible contraste cette terre privilégiée n’offre-t-elle pas aujourd’hui avec l’époque de sa grandeur ! Inféconde, brûlée par le soleil, dépourvue de ces villages qui s’étalaient ou s’échelonnaient sur le penchant de ses collines ou dans ses plaines fertiles, elle est le témoin muet des bénédictions et des châtiments du Très-Haut 5.
Il est difficile de fixer la limite qui, dans la pensée des Rabbins, constituait le pays sacré. Cette question ne les intéressait qu’au point de vue des obligations rituelles imposées à ceux qui habitaient l’une ou l’autre des provinces qui le composaient. Ainsi les environs d’Ascalon, les murailles de Césarée et de Ptolémaïs, étaient considérés comme compris dans les limites de la Terre promise, tandis qu’on regardait les cités elles-mêmes comme placées hors de ses frontières.
Pour les Rabbins, la Palestine était simplement « le pays »et tout le reste de l’univers était désigné par le terme « hors du pays ». Dans le Talmud, l’expression « Terre Sainte », si commune parmi les Juifs des temps postérieurs, et parmi les chrétiens, ne se rencontre jamais 6. Nulle comparaison pour eux n’était permise entre la Palestine et les autres contrées. Elle était seule Sainte. Toutefois, en s’élevant du rivage de la mer qui la bordait jusqu’au lieu très Saint dans le Temple, ils avaient tracé une échelle ascendante de dix degrés de Sainteté (Chel : 1 : 6-9.).
[Un Rabbin moderne à Jérusalem ne connaissait pas la portion du globe qu’il habitait, il n’avait jamais entendu le nom d’Europe, et désignait toutes les autres parties du monde à l’exception de la Palestine par le mot Chutsclorets, c’es’-a-dire « hors de la Terre Sainte » (Franckl. Jews in the East : 11 : 34). G.R.]
Mais « hors du pays » régnaient partout les ténèbres et la mort. La poussière même d’une contrée idolâtre était impure. Elle souillait celui qui en était couvert. On la considérait comme un tombeau ou comme la putréfaction d’un mort. Si un atome de cette poudre païenne touchait une offrande, elle devait aussitôt être brûlée. Bien plus, si par malheur quelques grains de la poussière du territoire idolâtre avaient été apportés dans la Palestine, elle ne pouvait et ne devait pas se mêler avec celle du pays. Jusqu’à la consommation des âges, elle restait ce qu’elle avait été à l’origine, impure, souillée, et maculant tous les objets sur lesquels elle se déposait. Ceci jette quelque lumière sur les directions symboliques du Seigneur à ses disciples (Mat.10.14) lorsqu’il les envoie pour tracer les limites du territoire du véritable Israël, « du royaume des cieux » qui s’approche. « Si l’on ne vous reçoit pas ou si l’on n’écoute pas vos paroles, lorsque vous partirez de cette maison ou de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. » En d’autres termes, non seulement vous devez laisser cette ville ou cette demeure, mais les considérer et les traiter comme si elles étaient païennes, de même que dans un cas semblable mentionné Mat.18.17.
Autour de la Palestine, la Mishna désigne trois pays qui peuvent prétendre à participer à la gloire de cette contrée. Le premier comprend tout le terrain dont les Israélites revenus de Babylone prirent possession dans le pays d’Israël et de Ghezib — trois lieues au nord de Ptolémaïs ; — le second « le territoire dont s’emparèrent ceux qui montèrent d’Egypte depuis Chezib jusqu’à la rivière — de l’Euphrate — à l’est et jusqu’à Amanah ». — On suppose que ce nom désigne une montagne située près d’Antioche en Syrie. — Le troisième enfin était limité, semble-t-il, par certaines lignes idéales et qui paraissent indiquer ce que le pays aurait été selon la promesse originelle de Dieu, bien que jamais Israël n’ait étendu jusque-là son empire.
Pour le moment, nous n’avons besoin d’appliquer « au pays » que la première de ces définitions. Nous lisons en Menachoth, vii : 1 : « Toute offrande de la congrégation ou d’un Israélite peut venir du pays. Si elle provient d’une contrée située hors de ses frontières, elle doit appartenir aux produits nouveaux de l’année ou aux fruits des années précédentes. « Il y avait une exception toutefois, pour l’Omer — les gerbes de Pâques — ou les deux pains — à Pentecôte. — Ils ne pouvaient être empruntés qu’aux produits de l’année courante recueillis dans l’intérieur du territoire sacré.
[Les mots « sacrifice, offrande ou don » ne correspondent pas au mot Hébreu Korban dérivé d’un verbe qui, dans l’un de ses modes, signifie être près, et, dans un autre, rapprocher. Dans l’un des cas il se rapporterait aux offrandes elles-mêmes; dans l’autre à ceux qui les présentent, comme rapprochés, les offrandes rapprochant ces derniers de Dieu. Le second de ces sens me semble, selon l’étymologie et selon la théologie, la vraie explication. Aberbanel les combine tous les deux dans la définition du Korban.]
Nous n’avons pas à nous étendre ici sur les distinctions que les Rabbins auraient voulu établir entre la sainteté de la Palestine située à l’occident du Jourdain, et celle de la contrée placée à l’orient du fleuve. Nous ne dirons rien non plus de la supériorité et de la prépondérance sur la Galilée à laquelle la Judée proprement dite prétendait avoir droit, comme centre du Rabbinisme. Qu’il nous suffise d’ajouter que la Syrie appartenait presque à ce pays privilégié d’après les docteurs. Aussi les zélotes de Jérusalem qui auraient voulu courber la tête de l’Église sous le joug de la loi de Moïse, choisissaient-ils de préférence les communautés florissantes de la Syrie, pour base de leurs opérations (Antioche, Actes.15.1).
Telle est la raison pour laquelle la cité où fut constituée la première église des Gentils (Act.11.20-21) ; celle dans laquelle les disciples furent, pour la première fois, appelés chrétiens (Act.11.26) ; où Paul exerça si longtemps son ministère, et d’où il partit pour ses voyages missionnaires, était à peine placée en dehors du pays d’Israël. La chose est significative.
A la limite du territoire situé autour de celui que les Juifs habitaient, on montrait un cercle épais de nations étrangères avec des rites, des coutumes et un culte idolâtres. Au reste, pour comprendre exactement l’histoire de cette époque et les circonstances dans lesquelles nous transportent les récits du Nouveau-Testament, il est nécessaire de connaître la situation des partis répandus sur le sol de la Terre Sacrée. Ici gardons-nous d’une méprise bien naturelle. Si on espérait y trouver, à cette heure de l’histoire, une nationalité unique, un seul langage, des intérêts identiques, ou même la profession publique d’une seule religion, on serait amèrement désappointé. Ce n’était pas seulement la présence des Romains, ou l’influence d’un nombre plus ou moins considérable d’étrangers, établis dans le pays, qui produisaient ces diversités. La Palestine était habitée par des races diverses, hostiles, mêlées l’une à l’autre, animées d’intérêts contraires. A côté du pharisaïsme le plus étroit et le plus pointilleux, s’élevaient des temples païens, et des cérémonies idolâtres se pratiquaient tous les jours. Cela se conçoit.
Les Juifs qui retournèrent de Babylone, après l’exil, étaient comparativement peu nombreux. Comme on le reconnaît, ils n’occupèrent pas toute l’étendue du pays ancien. Pendant la période troublée qui suivit la délivrance ou constata une immigration constante de païens, et des tentatives incessantes pour introduire et maintenir dans la Terre Sainte les éléments étrangers qui s’étaient mêlés au peuple légitime descendant des pères d’Israël. La langue même des Juifs avait subi une modification importante. Par l’action des siècles, l’ancien hébreu avait été complètement remplacé par le dialecte Araméen excepté dans le culte public et dans les Académies savantes des théologiens. Les mots et les noms que nous rencontrons dans les Évangiles, Raka, Abba, Golgotha, Gabbatha, Akel-dama, Bartholomaüs, Barabbas, Bar-Jésus, et les diverses citations littérales, sont tous Araméens. Ce fut probablement dans cette langue que Paul harangua la foule ivre de colère, lorsqu’il se tenait au sommet des marches qui conduisaient du Temple dans la forteresse Antonia.
[Jésus parlait habituellement, l’Araméen. A cette époque l’Hébreu était une langue morte, connue seulement des gens instruits et qui ne pouvait être acquise que par l’étude. Cependant il est clair que Jésus la connaissait, car quelques-unes de ses citations scripturaires se rapportent directement à l’original hébreu. On pense qu’il doit aussi avoir connu le grec, qui était parlé couramment clans des villes rapprochées de son séjour telles que Sephoris, Césarée et Tibériade. (G.R.)]
A côté de l’Hébreu-Araméen — c’est ainsi que nous voudrions désigner cette langue — le Grec s’était aussi, pendant quelque temps, répandu parmi le peuple. La Mishnah elle-même contient un grand nombre de mots grecs et latins avec des terminaisons hébraïques, qui nous démontrent l’influence profonde que la vie et les coutumes des Gentils avaient exercée sur ceux-là même qui les haïssaient le plus. Nous pouvons, par une conclusion naturelle, comprendre, en même temps, jusqu’à quelle profondeur elles avaient dû pénétrer dans la société Juive en général.
[Toutefois le Sauveur n’a dû posséder qu’une légère connaissance de la culture grecque. Celle-ci était proscrite par les docteurs palestiniens qui enveloppaient dans une même malédiction « celui qui élève des porcs, et celui qui apprend à son fils la science grecque. » — Mishnah, Sanhédrin XI : 1. Comp. 2Macc.4.10 ss. (G.R.)]
Pendant longtemps la politique des dominateurs de la Palestine les avait conduits à favoriser, d’une manière systématique, les sentiments et les pensées provoqués par l’influence de la Grèce. Il fallait l’obstination insurmontable et persévérante, si ce n’est la bigoterie des Pharisiens, pour empêcher leur succès plus complet, et ceci peut nous expliquer en partie l’âpreté de leur opposition à tout ce qui provenait des Gentils. Une esquisse de l’état religieux des provinces limitrophes mettra ce fait en pleine lumière.
Dans la partie du nord-est la plus éloignée se trouvait le territoire qui relevait de l’autorité du tétrarque Philippe (Luc.3.1). Il occupait au moins une portion de l’ancienne possession de Manassé. Plusieurs des lieux qui s’y trouvent (Marc.8.22 ; Luc.9.10 ; Mat.16.13) sont précieux pour l’âme chrétienne. Après l’exil, ces provinces avaient été repeuplées au moyen de populations à peine civilisées, et portées au vol comme les Bédouins de nos jours. Elles habitaient surtout les grottes immenses dans lesquelles elles accumulaient leurs provisions. Attaquées, elles y défendaient leur propre vie, et les troupeaux qui constituaient leur grande richesse. Hérode le Grand et ses successeurs, après les avoir soumises, avaient établi, au milieu d’elles, de nombreux colons Juifs et Iduméens, les premiers amenés de Babylone par un certain chef Zamaris, et attirés, comme les colons Allemands dans quelques territoires de la Russie, par l’affranchissement des impôts. Mais la plus grande partie de la population était toujours composée de Syriens et de Grecs grossiers et barbares.
Le culte des anciens dieux de la Syrie avait bien rarement cédé la place aux rites plus nobles des divinités de la Grèce. C’est dans ce territoire que Pierre fit cette généreuse confession de foi sur laquelle l’Église chrétienne est bâtie comme sur un rocher inébranlable. Or, Césarée de Philippe n’était autre, à, l’origine, que Panéas, la cité consacrée à Pan. Le changement de nom, au surplus, ne voulait point dire que les sentiments des habitants se fussent rapprochés du Judaïsme, Hérode le Grand y avait élevé un temple à Auguste. A peine est-il besoin d’autres détails, car des recherches récentes ont partout mis au jour des reliques du culte de la déesse Phénicienne Astarté, de l’ancien dieu Syrien, le Soleil, et même de l’Ammon Egyptien, à côté de celles des divinités bien connues de la Grèce. On peut en dire autant de l’élégante ville de Damas dont le territoire formait la limite extrême de la Palestine. Si nous passons des frontières de l’Orient à celles de l’Occident, nous voyons que dans les villes de Tyr et de Ptolémaïs les rites des cultes Phrygiens, Egyptiens, Phéniciens et Grecs, se disputaient l’empire des esprits. Au centre de la Terre Sainte, malgré la prétention des Samaritains d’être les uniques et véritables représentants de la religion de Moïse, le seul nom de leur capitale, Sebasta, remplaçant celui de Samarie, montrait combien la province avait été pénétrée par l’influence de la Grèce. Hérode avait aussi fait élever en Samarie un temple magnifique à Auguste ; il est hors de doute que les cérémonies de l’idolâtrie grecque, aussi bien que la langue d’Homère y étaient dominantes.
[Philippe bâtit Paneas vers les sources du Jourdain au nord du lac de Génésareth sur de grandes dimensions. En l’honneur de l’empereur il lui donna le nom de Césarée. Pour la distinguer de la Césarée au bord de la mer, on la nomma Césarée de Philippe. C’est sous ce nom qu’elle est mentionnée dans l’histoire évangélique. Mat.16.13 ; Marc.8.27). Colonisée par des grecs, son nom avait été changé en Panéas en l’honneur d’une cave creusée sous ses hautes collines. Celle-ci avait été arrangée avec art et transformée en une grotte de Pan, ornée de niches qui contenaient les statues des nymphes des forêts. (G.R.)]
Une autre province située aux confins de la Palestine, la Decapolis (Mat.4.25 ; Marc.5.20 ; 7.31) était entièrement grecque dans sa constitution politique, dans son langage et dans son culte. On pouvait la considérer comme une confédération de cités païennes dans le territoire d’Israël. Elle était pourvue d’un gouvernement particulier. Les écrivains du temps nous en disent peu de chose, et les villes mêmes qui composaient cette fédération, sont différentes dans les énumérations qui en sont faites. Nommons celles qui ont plus d’importance pour les lecteurs du Nouveau-Testament. Scythopolis, l’ancienne Beth-Shean (Jos.17.11,16 ; Juges.1.27 ; 1Sam.31.10,12) était la seule située à l’ouest du Jourdain, à 4 lieues au sud de Tibériade. Nous connaissons Gadara la capitale de la Pérée par Mat.8.28 ; Marc.5.1, Luc.8.26. Mentionnons enfin, comme particulièrement intéressante Pella, dans laquelle les chrétiens de Jérusalem obéissant à l’avertissement du Seigneur (Mat.24.15-20) s’enfuirent pour échapper à la ruine de la cité assiégée par l’armée romaine. On n’a pu fixer avec une précision suffisante la situation de cette dernière ville, mais elle se trouvait probablement à une petite distance de l’ancienne Jabez de Galaad.
[L’élément grec dominait à Pella. Les monnaies de ces villes qui commencent à l’époque d’Auguste ne nous montrent que l’image de dieux helléniques ou hellénisés. A Gerasa, Artémis est la divinité dominante, à Gadara c’est Jupiter, Hercule, Vénus et Minerve ; à Philadelphie Hercule et à côté de lui Bacchus, Cérès et d’autres dieux de la Grèce. (G.R.). Pour sa situation voyez. la discussion complète dans Caspari. Chronol. Geogr. Einl. in das Leben J.-C. p. 87-90.]
Revenons à notre sujet. Ces détails nous montrent que seules, la Galilée et la Judée, avaient conservé rigoureusement les idées et les coutumes juives. Nous décrirons plus tard chacune de ces provinces. Remarquons pour le moment que la portion du nord-est, ou la haute Galilée, était habitée, en grande partie, par des Gentils, Phéniciens, Syriens, Arabes et Grecs (Joseph. B. J. III : 9, 3.). De là lui venait son nom de « Galilée des Gentils » (Mat.4.15). Chose étrange, l’élément païen était dominant dans un grand nombre de ces villes, dont le Nouveau-Testament a surtout rendu le nom familier à notre esprit. Tibériade, était, au temps de Jésus-Christ, d’origine toute récente. Bâtie par le tétrarque Hérode Antipas. — l’Hérode de l’histoire évangélique — elle avait été appelée de ce nom en l’honneur de l’empereur Tibère. Bien qu’elle eût été enrichie par son fondateur de privilèges nombreux, maisons, propriétés pour ses habitants, affranchissement des impôts, Hérode eut besoin d’employer la violence pour la peupler de colons. Il en fut ainsi, du moins en ce qui concerne la faible population juive, qu’elle renfermait. On n’ignore pas la cause de leur répugnance. Le terrain sur lequel s’élevait Tibériade avait dans les temps anciens recouvert un lieu de sépulture et le sol tout entier était, par conséquent, impur au point de vue lévitique (Joseph. Ant. XVIII : 2, 3). Quelque célèbre qu’elle soit demeurée dans la suite, comme le siège final du Sanhédrin Juif, elle était à l’origine, non-Juive.
[Tibériade fut le séjour d’une des deux écoles principales de Rabbins. La Gemara de Palestine y fut rédigée en 350. Bâtie au temps de Tibère, dans la partie la plus belle de la Galilée, sur le bord occidental de la mer de Génésareth, près des sources chaudes d’Emmaüs, elle renfermait une population très mélangée. Quant aux édifices splendides, elle ne laissait rien à désirer. Elle avait entre autres une carrière, — pour les jeux — un palais royal qui excitait le scandale des Juifs par ses figures d’animaux, et qui tomba sous les coups du fanatisme des Zélotes, durant la guerre avec les Romains. L’organisation municipale de la ville était conforme aux modèles des villes helléniques. Ella possédait un Conseil de 600 membres, dont 10 avaient une position prédominante, un Archonte, un Eparque, un Agoranomos. Bien que Jésus n’y ait jamais mis les pieds probablement, il doit souvent avoir aperçu à l’horizon ses murailles garnies de tours, sa forteresse massive, et la maison dorée d’Antipas reflétant au loin dans les eaux du lac ses lions de marbre, et ses architraves sculptées. (G.R.)]
Gaza avait ses divinités locales, Ascalon adorait Astarté ; à Joppé, où Pierre eut sa vision, on montrait encore sur les rochers la marque des chaînes qui retenaient Andromède captive, lorsque Persée vint la délivrer. Césarée était, au fond, une cité païenne, bien qu’habitée par des Juifs nombreux. L’un de ses monuments les plus remarquables bâti sur une colline opposée à l’entrée du port était un temple d’Auguste.
[AGaza, que Josèphe appelle simplement une ville grecque, la principale divinité locale était Zeus Marnas — « un Zeus supérieur comme l’indique la signification, qui enveloppé de l’amas des nuages qu’il rassemble, envoie la pluie et la fertilité sur la terre ». — Divinité dont le nom,Marnas, dérive d’un mot hébreu qui signifie Seigneur. En outre, nous rencontrons ici Jupiter Nicephore, Apollon, Artémis, Helios, Hercule, ainsi que les déesses Tyche, Io, Hera, Aphrodite. (Schurer o. c. 379). (G.R.)]
Comment en être surpris, quand, à Jérusalem même, Hérode avait érigé un théâtre et un amphithéâtre magnifiques, dans lesquels on amenait des gladiateurs, et où se célébraient les jeux qui répugnaient le plus aux idées juives (Jos. Ant. 15 : 8, 1). Les favoris, les conseillers dont s’entourait le monarque, étaient, eux-mêmes, idolâtres. Dans tous les lieux où cela leur était possible, lui et ses successeurs élevaient des temples païens, et répandaient partout autour d’eux les idées de la Grèce. En même temps ils faisaient profession de Judaïsme. Loin de heurter les préjugés Israélites, ils rebâtissaient le temple ; ils défendaient à Rome la cause des Juifs qui avaient à se plaindre de quelque injustice ; montrant par tous ces faits qu’ils voulaient se maintenir en bons termes avec le parti national, ou plutôt s’en servir comme d’un instrument docile pour réaliser leurs desseins. Aussi les idées helléniques se répandaient-elles au sein du peuple. Déjà le grec était parlé et compris par toutes les classes instruites de la Palestine. Il était indispensable dans les relations avec les autorités romaines, avec les employés civils et militaires, avec les étrangers. L’inscription des monnaies était grecque, bien que par condescendance pour les Juifs, aucun des premiers Hérode n’y eût fait graver sa propre image. Ce qui est assez significatif, c’est que Hérode Agrippa I, le meurtrier de saint Jacques, qui aurait bien voulu faire mettre à mort l’apôtre Pierre, fut le premier à introduire la pratique non-juive des images sur les monnaies. On le voit, partout à cette époque, l’influence étrangère fait des progrès. Un avenir prochain devait par conséquent amener un changement nécessaire, ou provoquer d’ardentes luttes, entre les divers peuples qui se heurtaient incessamment sur le sol vénéré de l’antique théocratie.
[La monnaie mentionnée dans Mat.22.10, qui portait une image aussi bien qu’une inscription, doit avoir été frappée à Rome, ou provenir du Tétrarque Philippe, le premier qui introduisit l’image de César sur des pièces Juives.]
Le Judaïsme lui-même était alors tristement déchiré par de profondes divisions ; bien qu’aucune séparation extérieure ne se fût encore produite dans le sein de la nation. Les Pharisiens et les Sadducéens professaient des opinions contraires, et se haïssaient réciproquement. Les Esséniens regardaient l’un et l’autre de ces partis du haut de leur orgueil spirituel. Dans le Pharisaïsme même, les écoles de Hillel et de Shammaï se contredisaient mutuellement sur presque tous les sujets ; mais elles étaient unies par leur mépris illimité pour la partie de la nation qu’elles flétrissaient du nom de « population des campagnes ». Elles désignaient par ces mots ceux qui ne possédaient pas la science traditionnelle, et qui dès lors étaient inaptes ou peu portés à prendre part aux discussions, à se charger du poids des ordonnances légales qui constituaient l’objet principal de la science traditionnelle. Mais un sentiment qui était commun à tous, aux nobles et aux gens infimes, aux riches et aux pauvres, aux savants et aux illettrés, c’était celui d’une haine immense pour les étrangers. Les grossiers Galiléens avaient, aussi bien que le plus méticuleux des Pharisiens, l’amour de leur pays. Et de fait, dans la guerre avec Rome, ils fournirent à l’armée juive ses plus nombreux et ses plus braves soldats.
[Le Am-ha-aretz (le peuple de la terre) selon le Rabbin Eleazar est celui qui ne dit pas le Shema (Ecoute ô Israël) le matin et le soir. Selon le R. Josué l’homme qui ne porte pas les tephillim (phylactères). Selon Ben-Assaï celui dont le vêtement n’est pas orné des Tsitzith (glands). — Le R. Nathan nous déclare que c’est celui qui n’a pas la Mezuzah au-dessus de sa porte, et le R. Nathan, fils de Joseph, l’Israélite qui n’instruit pas ses enfants dans la loi. Mais selon le R. Hona, la vraie Halachah (règle) était avec ceux qui définissent le « peuple de la terre » en disant que ce sont ceux qui bien qu’ayant lu les Écritures et la Mishna n’ont suivi l’école d’aucun Rabbin. (G.R.)]
Partout les étrangers étaient l’objet de la haine du peuple. C’était pour eux qu’on levait les taxes, c’était à eux qu’appartenaient les soldats, les tribunaux d’appel, le gouvernement. A Jérusalem ils dominaient sur le Temple par la garde logée dans la forteresse Antonia, ils gardaient même les vêtements sacerdotaux.
[Cet usage s’établit d’une manière assez innocente. Le grand-prêtre Hyrcan, qui fit élever la tour de Baris, y avait déposé ses vêtements splendides. Ses fils firent comme lui. Quand Hérode s’empara du pouvoir, il retint pour des raisons faciles à comprendre, la garde de ces objets sacrés dans la forteresse Antonia qui remplaçait la tour ancienne. Des motifs semblables poussèrent les Romains à imiter Hérode. Josèphe (Ant. XVIII : i, i