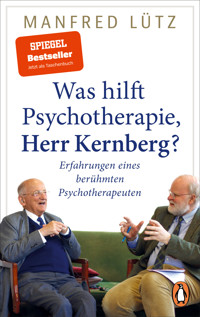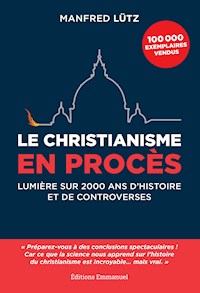
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Dans cet ouvrage écrit d’une plume alerte, l’auteur s’appuie sur les recherches les plus récentes pour raconter l’histoire passionnante du christianisme. Loin de la légende noire et des clichés alimentés par des siècles de controverses, il rétablit la complexité des faits et apporte une lumière bienfaisante sur notre passé, et sur l’histoire de l’Église en particulier.
Un livre salutaire, qui s’adresse « à tous les chrétiens qui n’ont pas peur de la vérité, ainsi qu’à tous les autres, pour qu’ils comprennent mieux d’où ils viennent ».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les citations se trouvent, en règle générale, dans le livre Toleranz und Gewalt d’Arnold Angenendt, référencées à l’index des personnes et des auteurs cités. Il est à noter qu’aucun point de suspension ne figure dans les citations qui présentent des coupures et cela afin d’en faciliter la lecture.
Conception couverture : © Christophe Roger
Composition : Soft Office (38)
Édition originale :
Der Skandal der Skandale. Die geheime Geschichte des Christentums
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau, 2018
www.herder.de
Édition française :
Traduit de l’allemand par Isabelle Schobinger, avec la contribution de Marie Blétry, Anne Kurian et Gabriel Morin, et l’aimable collaboration de Philippe Naszályi
© Éditions Emmanuel, 2019
89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris
www.editions-emmanuel.com
ISBN : 978-2-35389-738-4
Dépôt légal : 3e trimestre 2019
Avant-propos
De toutes les grandes religions, le christianisme demeure la plus méconnue du monde occidental. Cette ignorance n’est pas due à un manque d’informations sur le sujet, mais bien plutôt à une surabondance d’informations, qui présentent d’ordinaire une caractéristique étonnante : elles sont si fausses que cela en devient grotesque…
Quelle importance ? me direz-vous. On vit très bien avec des convictions fausses. Longtemps l’homme a cru que ses artères étaient remplies d’air ou que les dragons existaient. De même, l’idée que la terre était plate ne l’a pas empêché de mener une vie qui avait du sens. Les fake news peuvent même avoir des vertus fort distrayantes. Qui donc se satisferait de voir le monde tel qu’il est à longueur de journée ? D’un point de vue psychologique, la capacité à refouler est indispensable à l’être humain. Celui qui garderait sans cesse à l’esprit les événements douloureux de son existence aurait bien de la peine à vivre !
Mais quant aux fausses idées circulant sur le christianisme, on ne peut se contenter de parler de petites erreurs, d’amateurisme ou d’arrangements avec la vérité, car ces croyances l’ont totalement discrédité et ébranlé jusqu’aux entrailles. Cela n’empêche pas les gens de tenir le pape François ou encore Mère Teresa en haute estime. On les révère non parce qu’ils sont chrétiens, mais en dépit de cela ; en quelque sorte, on ne leur tient pas rigueur de leur religion. De la même manière, on respecte les structures chrétiennes caritatives, et on s’incline volontiers devant les « valeurs chrétiennes » – en méconnaissant bien souvent le sens de ces mots. Mais la foi, l’histoire chrétienne, le christianisme même, tout cela paraît, dans le meilleur des cas, un peu encombrant. Dans les débats intellectuels, toute conviction chrétienne passe dorénavant pour un préjugé. La notion de « fondamentalisme » ne renvoie plus exclusivement à des croyants fanatiques : elle semble s’appliquer désormais à toute prise de position religieuse, à tout témoignage chrétien habité par une certaine conviction et qui ne se contente pas de décrire la religion d’un point de vue purement scientifique. Le temps où le christianisme était perçu comme un ferment culturel est bel et bien terminé.
On pourra toujours objecter que les Églises chrétiennes comptent encore des institutions non négligeables, qui disposent d’énormes moyens financiers – en Allemagne par exemple. Mais n’oublions pas l’énergie considérable absorbée par le démantèlement de ces Églises bien établies, et le fait que le renouveau de l’Église se manifeste aujourd’hui plutôt en périphérie du christianisme institutionnel. La mission chrétienne, en effet, suscite une véritable adhésion quand elle s’adresse directement aux individus, de personne à personne. Les gens ont soif de rencontrer des communautés convaincues et vivantes qui leur permettent de renouveler leur vie personnelle. Mais face à cela, et aussi paradoxal que cela puisse sembler, le christianisme, son histoire, ses institutions, ses représentants relèvent plus du repoussoir que de l’aimant dans le monde occidental. Le christianisme a subi une violente estocade. La conviction, désormais irréfutable, que l’histoire chrétienne n’est qu’une succession de scandales ébranle ainsi le cœur même de la foi chrétienne. Car une religion qui croit que Dieu s’est fait homme, et donc histoire, s’expose, pieds et poings liés, au procès critique de cette même histoire. De fait, ce jugement est implacable. « La malédiction du christianisme1 », tel est le titre que l’éminent philosophe Herbert Schnädelbach a donné à un texte qui a défrayé la chronique en l’an 2000. À son point culminant, l’article allait jusqu’à affirmer que la meilleure chose que le christianisme pouvait faire pour l’humanité était de disparaître ! Pour justifier cette condamnation à mort, le philosophe n’avançait pas des arguments philosophiques, ni même théologiques. Il ne remettait pas en cause la Trinité ou l’incarnation de Dieu. Ses arguments étaient presque exclusivement historiques, non pas fondés sur des études authentifiées et reconnues, mais sur ce large consensus établi autour d’une version sulfureuse de l’histoire du christianisme. Et le philosophe érudit d’évoquer sans discernement le scandale des croisades, la brutalité de l’Inquisition ou l’antisémitisme chrétien comme des réalités aussi incontestables que le fait que la Lune tourne autour de la terre et que l’Everest est le plus haut sommet de notre planète. Point besoin de preuve pour cela ! Le texte entendait ainsi exprimer tout haut ce que tout le monde était supposé penser tout bas. Dix ans après l’effondrement du communisme, c’était là un éloge funèbre bruyant et partisan du christianisme.
Cela aurait pu s’arrêter là, mais, de même que pour le communisme, on trouve toujours quelques indestructibles qui n’ont pas vu le vent tourner et s’entêtent à creuser leur sillon avec nostalgie, comme si de rien n’était. Le texte de Schnädelbach voulait atteindre la religion chrétienne jusqu’à la moelle : à le croire, deux mille ans après sa fondation, le christianisme était bel et bien à bout de course.
Mais avait-il raison ? Les réactions à ce texte prirent des proportions spectaculaires et parfaitement inattendues : un historien de renommée internationale, Arnold Angenendt, releva le défi et entreprit d’examiner rigoureusement les reproches de Schnädelbach en s’appuyant sur les découvertes scientifiques les plus récentes. Qu’y avait-il de vrai dans ses propos ? Qu’y avait-il de faux ? Il publia en 2007 un immense ouvrage2 qui fait aujourd’hui référence pour les tenants d’un débat critique autour du christianisme et de l’Église. Le discours d’Angenendt, convaincant, objectif et d’une grande rigueur scientifique, lui valut un résultat assez rare pour être souligné : Herbert Schnädelbach révisa ses positions, et le remercia de lui avoir « montré quelques erreurs de perspective dans [s]es points de vue ». Certains points de vue largement répandus sur l’histoire du christianisme ne résistaient tout simplement pas à un examen critique sérieux.
Cependant, ce travail considérable n’a absolument pas encore pénétré la conscience collective : qui donc irait consulter pour le loisir un ouvrage scientifique allemand de huit cents pages, agrémentées de trois mille notes, sinon quelque rare énergumène entretenant des liens particuliers avec le christianisme – ne fût-ce que de la haine ?
Il semblait donc assez pertinent de vulgariser les conclusions décisives de l’étude d’Angenendt, afin qu’un public plus large puisse en profiter. La prise de conscience d’un homme aussi érudit que ce philosophe pourrait ainsi devenir celle du grand nombre. Il fallait un travail qui rende ces travaux accessibles, dans le meilleur sens du terme. Ce travail de mise en lumière paraît d’autant plus urgent que la disparition du christianisme, en sa qualité de véritable ciment social, a précipité toute la société dans une crise grave, ce que les observateurs de tous bords reconnaissent. Ainsi, tous les individus qui s’investissent dans la société, y compris les athées les plus rationnels, devraient avoir à cœur de faire la lumière sur le christianisme.
Le philosophe allemand contemporain le plus célèbre, Jürgen Habermas, a réclamé avec vigueur des « traductions salvatrices » de la conception judéo-chrétienne de l’homme créé à l’image et à la ressemblance de Dieu. Pour Habermas, c’est le seul moyen de maintenir une adhésion universelle au concept de dignité humaine, si central dans notre ordre social. Aussi plaide-t-il pour que les chrétiens soient considérés dans le débat public comme des « citoyens religieux ». Mais cet appel porté par un agnostique rencontre des chrétiens plus enclins à vivre leur foi en privé qu’en public, précisément parce qu’ils ont honte de l’histoire du christianisme.
De fait, les chrétiens eux-mêmes abordent leur histoire (et ses scandales) par deux angles dont aucun n’est vraiment pertinent. Les uns ont mobilisé toutes leurs forces pour élaborer une apologétique visant à blanchir l’histoire du christianisme, niant coûte que coûte la moindre défaillance de l’Église. Une histoire chrétienne qui, deux mille ans durant, n’aurait connu que des saints… Jésus lui-même n’avait rien prédit de tel pour son Église ! Dès le début, les apôtres, ces piliers de l’Église qu’il a lui-même appelés, avaient des personnalités fort contrastées. Pourquoi cela aurait-il changé par la suite ? À l’opposé de cette vision, certains chrétiens ne nient pas les faiblesses historiques du christianisme, soulignant même son passé peu reluisant pour mieux exalter le christianisme contemporain. Mais l’épopée telle qu’ils la présentent (« Pendant deux mille ans, le christianisme s’est trompé, c’est alors que je suis arrivé, moi ou le professeur X ou Y, ou le concile Vatican II, ou que sais-je encore ») semble bien naïve ! N’importe quel athée un peu sensé se contentera de répondre : « Eh bien ! attendons de voir si les choses vont s’arranger dans les deux mille années à venir, puis nous aviserons. »
Ces deux rapports à l’histoire du christianisme ne font que le défigurer davantage, tant ils s’éloignent de la réalité. De telles perspectives, en effet, puisent à leur guise dans l’histoire des éléments nourrissant des préjugés variés qui ne résistent pas à la moindre recherche scientifique sérieuse.
La démarche d’Arnold Angenendt diffère du tout au tout. De même qu’il ne cherche jamais à absoudre l’Église à tout prix, il ne prend pas non plus pour argent comptant n’importe quelle histoire sulfureuse sous prétexte qu’elle suscite des sensations fortes ou des gros titres racoleurs. Ce scientifique de renommée internationale s’est servi de sa raison et de ses connaissances scientifiques pour mener une enquête objective, aux résultats impressionnants. C’est ce travail de longue haleine qui sert de point de départ au présent ouvrage.
L’enjeu est ici de décortiquer sans préjugés l’histoire du christianisme et de ses scandales, munis d’un scalpel scientifique. Au bout du chemin, les scandales resteront peut-être des scandales. Et puis, quand bien même la réalité historique offrirait un tout autre tableau, un christianisme exempt de scandales ne suffirait pas à donner envie de devenir chrétien. Après tout, certaines croyances aberrantes ont déjà eu des effets historiques éminemment positifs. Il ne sera donc point ici question de Credo, mais d’histoire, de la véritable et passionnante histoire de la plus grande religion de l’humanité. Pour le lecteur averti, il sera également question de la culture occidentale et des Lumières européennes, au meilleur sens du terme.
La matière historique et scientifique de cet ouvrage, je la dois en grande partie au professeur Arnold Angenendt ainsi qu’à tous ses collaborateurs qui ont veillé à ce qu’il rende compte des avancées les plus récentes de la recherche historique, au-delà du contenu de Toleranz und Gewalt. La structure de l’ouvrage a été totalement refondue et son contenu enrichi de sujets nouveaux, afin d’aborder autant que possible tous les événements communément critiqués de l’histoire de l’Église. Pour éviter toute erreur, j’ai également fait relire cet ouvrage à Heinz Schilling et Karl-Joseph Hummel, professeurs d’histoire contemporaine, aux spécialistes de l’histoire de l’Église Christoph Markschies et Hubertus Drobner, ainsi qu’au théologien Bertram Stubenrauch. Je tiens à les remercier cordialement pour la peine qu’ils ont prise à cette relecture. Enfin, comme d’habitude, mon coiffeur a contrôlé avec soin que le livre était lisible et accessible à tous.
C’est lorsqu’on la raconte que l’histoire se met à vivre. Par-dessus tout, j’ai donc cherché à raconter l’histoire du christianisme, particulièrement les épisodes les plus dramatiques qui, qu’on le veuille ou non, nous concernent encore aujourd’hui.
Nous verrons ainsi dans cet ouvrage comment une petite secte juive de l’époque romaine est devenue une religion mondiale, comment elle a transformé petit à petit l’Empire romain en un Empire chrétien et comment, enfin, les Germains victorieux sont devenus des Germains chrétiens. On découvrira, à la lumière des dernières découvertes historiques, ce qui s’est réellement joué dans les croisades, l’Inquisition, la chasse aux sorcières et les missions en terres indiennes, ainsi que tout ce que nous devons aux Lumières – et ce que nous ne leur devons pas. Le christianisme a-t-il freiné des quatre fers face aux droits de l’homme ou en a-t-il assuré la diffusion ? Quelle est la véritable position du christianisme devant l’Holocauste ? Quid de l’émancipation des femmes et de la révolution sexuelle ?
En fin de compte, ce livre s’adresse à tous les chrétiens qui n’ont pas peur de la vérité, ainsi qu’à tous les autres, pour qu’ils comprennent mieux d’où ils viennent.
Manfred Lütz Bornheim, le 1er janvier 2018
1. Article paru dans l’hebdomadaire allemand Die Zeit, le 11 mai 2000.
2. Toleranz und Gewalt. Das Christentum zwischen Bibel und Schwert [« Tolérance et violence. Le christianisme entre la Bible et le glaive », N.D.T], Münster, Aschendorff, 2007.
Introduction – « Alors là, je ne vous crois pas ! »
Ah le bon vieux temps… tout allait bien mieux ! Depuis que l’histoire existe, tel est le cri de guerre des partisans de la théorie de l’âge d’or. Pour le poète grec Hésiode, l’histoire tout entière n’était rien d’autre qu’un déclin lamentable, et de tout temps il y eut des poètes et penseurs du même avis. Jusqu’à aujourd’hui.
Mais dans l’Antiquité déjà, il y avait aussi les autres, ceux qui voyaient l’humanité sur un chemin de progrès sans fin. Cet état de félicité à la fin de l’histoire, cet u-topos, cette utopie, a surtout fasciné de nombreux penseurs de l’époque moderne, à commencer par les communistes et les socialistes. Pensons à Erich Honecker1 qui, à la veille même de son départ inattendu, une coupe de champagne à la main, lançait la phrase restée célèbre : « Ni le bœuf ni l’âne ne retiendront le socialisme dans sa course. » On sait ce qu’il advint, et ce ne fut la faute ni du bœuf ni de l’âne.
Pour ces deux points de vue, l’histoire, en tant qu’histoire, ne compte pas. Soit elle tire sa valeur uniquement des trésors qu’elle a su préserver depuis l’Antiquité, soit cette valeur lui vient des événements qui l’acheminent vers son terme glorieux. L’histoire elle-même, on peut l’oublier.
Mais peut-on vivre ainsi ? Les personnes sans histoire sont gravement perturbées, car elles ne savent pas qui elles sont. De même, une société qui oublie ou méprise son histoire sera mise en péril par les nostalgiques et les utopistes de tout poil, qui s’évertuent à fuir le présent avec furie.
Cela vaut également pour cette institution vieille de deux mille ans qu’est l’Église. Là aussi s’activent toutes sortes de rétrogrades radicaux et de fanatiques du progrès, éternellement insatisfaits de l’Église.
Mais si on n’aborde pas les choses de manière aussi radicale, alors ces deux perspectives différentes ont leur utilité pour juger l’histoire équitablement. Dans un premier temps, il s’agit de chercher à comprendre les événements de l’histoire dans leur contexte, puis dans un second temps de les évaluer avec notre point de vue d’aujourd’hui. Si on considère les droits de l’homme comme une notion universellement valable, et pas seulement comme le fruit des hasards de l’histoire, on doit pouvoir soupeser les événements de l’histoire pour voir s’ils correspondent à notre propre conception des droits de l’homme.
Par ailleurs, l’histoire de l’Église a aussi besoin d’être éclairée depuis l’autre rive, celle de son origine. L’enjeu sera alors de vérifier si certains développements se sont éloignés ou non de l’idée et de la mission originelles de l’Église telles que Jésus et ses premiers disciples les avaient voulues. Après avoir explicité les faits, nous devrons donc jouer de cet éclairage croisé.
On pourrait bien sûr poser la question fondamentale : le christianisme a-t-il le droit de se développer historiquement ? Car enfin, d’un point de vue chrétien, la Révélation définitive de Dieu fait homme en son fils Jésus Christ a eu lieu il y a deux mille ans ; et la Parole de Dieu, on peut la trouver dans la Bible. Tout ce que les évêques, papes et autres conciles ont produit comme textes et actions depuis deux mille ans ne serait-il pas en fait insignifiant, voire carrément hérétique ? C’est la raison pour laquelle certaines sectes ont parfois exigé sans ménagement un retour au christianisme primitif, souvent au prix du sang versé. Le célèbre historien de l’Église Joseph Lortz s’est emparé de la question. Pour lui, la Révélation ne consiste pas simplement en un événement ponctuel vieux de deux mille ans. L’entrée de Dieu dans l’histoire – telle est la foi des chrétiens – se déploie petit à petit à travers tous les siècles de l’histoire de l’Église. Ainsi, lorsque la foi des chrétiens en un Messie juif fait irruption dans l’univers culturel gréco-romain, cela ne relève pas simplement du hasard. Au contraire, ce processus historique est pour les chrétiens partie prenante de la Révélation. Par conséquent, les premiers conciles et leur définition du Dieu Trinité sont aussi l’expression de la Révélation divine. Sous cet angle, d’autres évolutions historiques peuvent revêtir un caractère de révélation pour les chrétiens : la redécouverte de la philosophie d’Aristote au Moyen Âge, le déploiement de l’individu au début de l’ère moderne, les Lumières, les découvertes des sciences modernes ; pour les chrétiens, tout cela peut mettre davantage en lumière quel est le sens de la Révélation première. Ainsi, la Révélation n’est en rien lettre morte, bien au contraire. Elle est une Révélation vivante dans une histoire vivante. Voilà pourquoi, pour les chrétiens, l’histoire est déterminante.
Mais vu de l’extérieur, et en particulier pour les chrétiens et l’Église, il reste encore un problème de taille : les fake news ! Tous ceux qui se sont appliqués à suivre une campagne électorale – les fadaises qu’un parti peut raconter sur un autre, les déformations intentionnelles, le dénigrement des positions adverses – doivent bien avoir présent à l’esprit que l’Église mène une sorte de campagne électorale depuis plus ou moins deux mille ans.
Que d’aberrations les catholiques n’ont-ils pas répandues sur le compte des protestants, et inversement, et cela depuis cinq cents ans ! Ajoutons-y l’invraisemblable fatras idéologique que les dictatures du XXe siècle, tant de droite que de gauche, ont propagé contre un christianisme qui opposait le Tout-Puissant à leur propre toute-puissance. Pour les nazis, le christianisme était une religion « enjuivée », pour les communistes, il n’était rien d’autre qu’une drogue, l’opium du peuple. À grand renfort d’arguments sommaires et de campagnes de diffamation, on a tout entrepris pour ridiculiser le christianisme et le peindre comme une religion antimoderne et non-scientifique. Les deux systèmes totalitaires ont ainsi mené une guerre à outrance contre le christianisme. Avec un succès étonnant ! Bien que des chrétiens pratiquants, en Allemagne, aient participé à la résistance contre Hitler et que la révolution non-violente de 1989 soit partie des Églises chrétiennes, il ne reste de ces idéologies vermoulues que leur athéisme militant avec tout ce qu’il comporte de dénigrement du christianisme. Qui pourra donc s’étonner de ce que l’Église, plus qu’aucune autre institution, voit son image ainsi déformée jusqu’à l’absurde ? De plus, l’Église catholique est riche de l’héritage de deux mille ans de christianisme, et pas seulement de cinq siècles comme le protestantisme. C’est pourquoi les clichés sur son compte sont particulièrement tenaces, comme si les gens les absorbaient avec le lait maternel.
« Alors là, je ne vous crois pas », rétorqua un élève lorsque Arnold Angenendt remit en question certains de ces clichés. D’ailleurs, chères lectrices et chers lecteurs, peut-être en ira-t-il de même pour vous dans un premier temps. Voilà pourquoi vous ne profiterez de ce livre que si vous ne vous contentez pas seulement de croire, mais que vous cherchez aussi à savoir. Il vous faudra donc passer tous les préjugés possibles au crible des faits. Seul celui qui abordera l’histoire du christianisme et de l’Église sans trop d’amour ni de haine évitera de s’enrhumer. L’enjeu consiste, en l’occurrence, en partant des acquis actuels de la recherche historique, à sonder tous les scandales de l’Église, prétendus ou réels, pour mettre en lumière l’histoire « secrète » du christianisme. Préparez-vous à des conclusions spectaculaires ! Car ce que la science nous apprend aujourd’hui sur les représentations courantes du christianisme est incroyable… mais vrai.
1. Erich Honecker (1912-1994) fut le principal dirigeant de l’Allemagne de l’Est (RDA) de 1971 à 1989, N.D.T.
1
Au diable la religion – Judaïsme, christianisme, islam : le monothéisme, un danger pour l’humanité ?
« Dieu est grand ! » Quel que soit l’endroit de la planète où cette exclamation retentit, vous pouvez être certains qu’elle fera déguerpir tout le monde sur-le-champ. Le terrorisme islamiste a définitivement ruiné la réputation de la religion auprès d’un bon nombre de personnes, qui associent désormais la religion à la violence, l’intolérance et la déraison. Aussi, pour mieux prendre la défense des nombreux musulmans qui demeurent pacifiques, certains chrétiens aiment avancer que le christianisme a lui aussi une histoire marquée par la violence, ce qui n’arrange absolument pas les choses. Quand on entend en plus que certains Hindous incendient des mosquées en Inde, que des Bouddhistes s’apprêtent à exterminer toute une population musulmane au Myanmar, alors il est tentant, au nom de la paix, de se demander si cela n’irait pas mieux sans religions. Au XXe siècle, on l’a tenté. Le résultat fut consternant. Forts de leurs idéologies athées, les dictateurs Joseph Staline, Adolf Hitler et Mao Tsé-Toung ont provoqué la mort de 165 millions de personnes en tout, soit l’équivalent de l’humanité tout entière il y a deux mille ans. Pourtant, le scepticisme antireligieux perdure.
1. Vérité et violence – L’assassinat d’une belle théorie par une hideuse réalité
L’exigence de vérité des religions monothéistes, voilà le fond du problème : cette thèse de l’égyptologue Jan Assmann a fait sensation dans le monde entier. Selon lui, le problème vient du fait que ceux qui croient en un Dieu unique affirment être les seuls à détenir la vérité. Voilà le scandale, aux conséquences prétendument dramatiques. Déjà, le philosophe Odo Marquardt avait vanté les mérites du polythéisme. Selon lui, l’individu qui pouvait choisir librement parmi des dieux divers et variés n’allait pas trucider les adeptes des autres divinités : chacun son goût. De prime abord, l’idée semble plausible… en théorie seulement ! Pour paraphraser Albert Einstein, la science consiste à assassiner les belles théories par des faits hideux. Il convient donc ici de convoquer la science historique et de lui laisser la parole. Nous découvrons alors que les mythes primitifs, avec leurs cieux emplis de dieux propres à chaque peuple, provoquaient de funestes effets secondaires : les droits, surtout le droit de vie et de mort, concernaient exclusivement les membres d’une même peuplade et personne d’autre. Il était donc pour ainsi dire normal de mener des guerres féroces et sans limite contre les autres peuples. Dans ce cas de figure, il ne s’agissait en rien d’assassinats ou de meurtres, puisque rien n’interdisait d’occire des personnes n’appartenant pas au même peuple.
Dans les sociétés tribales, le terme d’« homme » désigne communément le peuple auquel on appartient, ce qui manifeste assez nettement que les autres ne sont pas vraiment des hommes, du moins pas au sens plein du terme. Moses Finley, spécialiste américain d’histoire ancienne, ne décèle, dans l’univers d’Ulysse, encore « aucune conscience sociale, aucune trace de commandements divins, aucun sens des responsabilités sinon à l’égard de la famille, aucune obligation envers quoi que ce soit d’autre que sa bravoure personnelle et son aspiration à la victoire et au pouvoir ». L’égalité entre tous les individus n’existe pas, sans parler de la paix ni de la tolérance. Les religions tribales s’appuyaient sur des récits mettant en scène le passé, le présent et le futur de la vie dans le monde, et sur des rites extérieurs dans lesquels on pouvait se réfugier. Ces mythes avaient ainsi pour fonction de décrire le monde et de permettre d’y vivre sans échouer. Être armé pour la vie supposait d’utiliser ces religions tribales en suivant leur mode d’emploi à la lettre, tout comme de nos jours on utilise un lave-linge. La moindre erreur pouvait avoir des conséquences funestes, donc on se disciplinait, même si c’était fastidieux. Au fond, on ne croyait pas davantage à ces religions tribales qu’on ne croit aujourd’hui en un lave-linge : elles faisaient tout bonnement partie de la vie.
Soudain, quelque chose d’énorme se produisit. Vers 1300 avant Jésus Christ, quelques individus de quelques peuples se sont mis peu à peu à croire, d’abord à tâtons, puis de plus en plus clairement, en un Dieu unique qui aurait créé l’univers, tous les peuples et tous les hommes… Quelle révolution ! Les dieux des tribus n’étaient responsables que de ladite tribu, et il n’était pas rare qu’ils mènent d’âpres et sanglants combats contre les dieux d’autres tribus jugés plus faibles… Alors, un Dieu pour tous ! Le phénomène est probablement apparu en Égypte, sous le pharaon Aménophis IV, dont le nom signifie « Amon est satisfait ». Parmi les innombrables dieux égyptiens, Amon était le dieu de l’Empire. Un jour, Aménophis IV cessa de se réclamer de lui, au profit du seul et unique Dieu soleil : Aton. Et comme le pharaon ne faisait pas les choses à moitié, il changea son nom en Akhenaton, qui signifie « serviteur d’Aton ». Il fit construire une nouvelle capitale, Achet-Aton, et inaugura une esthétique nouvelle représentant les personnes de manière plus réaliste, avec des émotions personnelles. Le charme de son épouse, Néfertiti, enchante encore de nos jours un public stupéfait au Neues Museum de Berlin. Mais le phénomène Akhenaton ne fut qu’un épisode. Après sa mort, on s’empressa de faire disparaître toute trace de lui et de sa foi, pour réhabiliter le panthéon antique et ses multiples divinités.
2. Au diable la noblesse – L’invention de la société mondiale
Outre la liberté, c’est l’égalité de tous devant le Dieu unique que le monothéisme a mis en avant. Ainsi, le cinquième commandement – « Tu ne tueras point » – n’était plus seulement restreint aux membres d’une même tribu : il acquérait une portée universelle. Devant ce Dieu unique, pour la première fois, il devenait raisonnable d’évoquer quelque chose comme une humanité et une histoire universelles. Le christianisme a le mérite d’être la première religion à avoir manifesté cela. Le Christ n’envoie pas seulement les chrétiens vers un peuple élu, mais vers tous les peuples. Même le juif Pierre finit par se rendre à l’évidence : « Je constate en vérité que Dieu ne fait pas acception des personnes, mais qu’en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable » (Ac 10, 34-35). Le christianisme a opté pour l’égalité des droits entre tous les peuples. Le brillant sociologue Niklas Luhmann constate que les religions universelles « anticipent pour ainsi dire la société mondiale ». Aussi peut-on affirmer que, dans l’ancien monde grec, il ne se trouvait « rien d’équivalent à une réglementation juridique ou à une humanisation au sens du droit moderne des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Mais Jésus va encore plus loin : il commande d’aimer ses ennemis ; non pas seulement de renoncer à tuer les ennemis, mais d’aller jusqu’à les aimer. Ses contemporains ont dû percevoir cela comme le comble de la provocation et de l’aberration. Tandis qu’auparavant prévalaient la parenté, le clan, la tribu et la race, le christianisme s’est mis à rassembler dans l’Église des peuples variés, jouissant tous des mêmes droits. Pour les chrétiens, donc, la notion de peuple élu disparaissait, puisque celui-ci était désormais constitué de tous ceux qui, quelle que soit leur origine, croyaient en Jésus Christ. Le christianisme s’adressait d’emblée aux habitants du monde entier. L’évêque Agobard de Lyon (env. 769-840) déclara ainsi – véritable programme pour le règne de Charlemagne – qu’il n’y avait plus « ni Aquitains, ni Lombards, ni Burgondes, ni Alémaniques ». Dans ses arguments religieux, on voit poindre quelques accents d’une révolution sociale : « Tous étant devenus frères, ils s’adressent au même Dieu et Père : le valet aussi bien que le maître, le pauvre aussi bien que le riche, l’ignorant aussi bien que l’érudit, le faible aussi bien que le fort, le serf aussi bien que l’empereur. » Pour parvenir à une telle universalité, la chrétienté mit très tôt en place tout ce qu’elle pouvait pour inciter et apprendre à vivre en bonne intelligence avec les étrangers. En témoigne cette phrase de l’épître à Diognète, au IIe siècle : « Tout pays étranger est leur patrie, toute patrie leur est une terre étrangère. » Le monachisme, dans sa détermination à mettre en œuvre le commandement de Dieu à Abraham : « Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père », fut un moteur de cette ouverture. Le sociologue allemand Karl O. Hondrich voit dans « l’éthique chrétienne de la fraternité universelle un formidable affront à toutes les formes connues de morale » qui jusqu’alors avaient toujours « privilégié la tribu ». Le nationalisme moderne, lui, a remis à l’honneur le peuple et le droit du sang pour mieux nourrir son chauvinisme. Face à cela, au contraire, l’épître aux Colossiens proclame qu’il n’y a plus « ni Juif, ni Grec, ni circoncis ou incirconcis, ni Barbare, ni Scythe, ni esclave, ni homme libre ». Toutes ces barrières sont désormais levées pour la foi chrétienne. L’Évangile de Jean l’atteste dans une formule assez provocante : les chrétiens sont tous enfants de Dieu, à égalité, car ils « ne furent engendrés ni du sang, ni d’un vouloir de chair, ni d’un vouloir d’homme, mais de Dieu » (Jn 1, 13). Ces paroles aujourd’hui familières aux chrétiens représentaient à l’époque une véritable « révolution morale ».
De fait, il n’y a rien contre quoi le Nouveau Testament s’insurge autant que les conventions et les privilèges liés au sang. Ainsi, lorsque, dans un Évangile, on avertit Jésus que sa mère et sa famille l’attendent à l’extérieur, il réagit avec une certaine brusquerie : « Qui sont ma mère et mes frères ? Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là m’est un frère, une sœur, une mère. » Du point de vue de l’histoire, en revanche, on observe que toutes les sociétés de l’époque accordent une importance fondamentale aux qualités de sang et de naissance, déterminantes dans leur organisation. Elles se figurent descendre d’un premier et unique ancêtre, de naissance divine, au sang exceptionnel et auquel tous les membres du peuple sont affiliés à des degrés divers ; en premier, les héritiers de sang pur, puis les nobles et, enfin, les gens ordinaires, de souche plus modeste. Face à cela, le christianisme, en promouvant dès le début l’égalité, adopte une posture littéralement antifamiliale. Les Actes des apôtres rapportent ainsi : « La multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. » Pour Otto G. Oexle, historien de l’Institut Max Planck, ce sont là « les phrases les plus lourdes de conséquences qui aient jamais été écrites ». En découle en effet l’obligation de veiller au bien commun par une compensation sociale. Le spécialiste d’histoire ancienne Jochen Martin en vient à la conclusion suivante : « La victoire du christianisme a signé la défaite de la famille comme unité culturelle. » Le philosophe et politologue canadien Charles Taylor oppose à cela la culture indienne, dans laquelle il est difficile de prendre la moindre décision sans la famille.
Le Nouveau Testament ne connaît pas d’aristocratie. Or, dès l’aube du Moyen Âge, comme le christianisme pénétrait lentement la société, l’aristocratie en place, jusqu’alors complètement étrangère au christianisme, commença à jouer un rôle particulier, y compris dans l’Église. Des mouvements de libération s’y opposèrent régulièrement avec des slogans du genre : « Tandis qu’Adam labourait et qu’Ève filait, où était le noble ? » Au XVIe siècle, lorsque Luther, insistant sur la « liberté du chrétien », voulut rétablir le christianisme égalitaire des origines, il fit radicalement volte-face, terrifié par les soulèvements des paysans. Il décida donc soumettre les Églises protestantes aux seigneurs locaux, ce qui n’empêcha pas certains théologiens protestants d’entrer en résistance contre les seigneurs. Ainsi, l’aristocratie recouvra de facto ses droits. « Le protestantisme rigoureux s’oriente désormais selon l’autorité, la monarchie de droit divin, l’autorité de l’État chrétien ou au moins moral, donc antidémocratique », explique le théologien protestant Heinz E. Tödt. C’est ainsi que les privilèges de la noblesse, parfaitement étrangers au message chrétien, survécurent de différentes manières chez les catholiques comme chez les protestants jusqu’au XXe siècle.
L’Ancien Testament donnait déjà à voir une mutation fondamentale dans ce domaine. Tandis que les Grecs se figuraient les origines du genre humain à travers diverses figures primitives, les Israélites voyaient en Adam l’unique père de toute l’humanité. L’histoire d’Adam et Ève, trop souvent mal comprise dans le cadre de la querelle entre la science et la foi, constitue en fait une proposition politique fondamentale : il ne saurait y avoir de privilèges conférés par la filiation à certaines personnes ou à certains peuples. Au contraire, tous descendent d’un seul et unique couple, tous sont donc égaux en vertu de cette origine commune. Un tel changement de perspective était proprement révolutionnaire. Lorsqu’au XVIIIe siècle, le récit de la Genèse fut reconsidéré à l’aune des sciences naturelles, on mena force débats sur la diversité des tribus à l’origine des races humaines, à tel point que l’idéal universaliste de l’humanité finit par être menacé, tandis que les théories raciales en vinrent à légitimer l’« esclavage des nègres ». Plus tard, lorsque les nazis se mirent à lutter contre les Églises, on peut imaginer à quel point ils voyaient d’un mauvais œil la conception chrétienne d’un genre humain universel.
Les religions tribales étaient quant à elles convaincues que les hommes n’étaient pas égaux entre eux par nature. Elles légitimaient cette idée en postulant que ces inégalités se poursuivraient dans l’au-delà : le roi resterait roi et l’esclave resterait esclave. Le monothéisme, au contraire, offrit les conditions nécessaires pour concevoir les hommes comme égaux et leur reconnaître à tous la même dignité.
Mais le monothéisme recèle en germe une autre nouveauté. Dans les religions cosmologiques de l’antiquité, l’homme était en général associé au soleil et la femme à la lune. Cette dernière n’était donc jamais qu’un pâle reflet de l’homme, et ne jouissait donc pas des mêmes droits. Et voilà que le monothéisme lui confère la même dignité humaine. L’institution du mariage, entre autres exemples, s’en trouvera fort modifiée : avec le temps, elle se fondera de plus en plus sur l’alliance et le consentement mutuel.
C’est donc largement grâce au monothéisme que la liberté, l’égalité et la dignité humaine firent leur entrée dans l’histoire mondiale. C’est sur ces mêmes fondements spirituels que repose également l’État moderne qui, dans ses efforts pour instaurer le droit et la justice, mise sur l’assentiment des citoyens, contribuant ainsi à modérer la violence de manière décisive.
Tandis que les religions tribales s’employaient à maintenir l’ordre établi, le monothéisme se révéla donc véritablement novateur, voire révolutionnaire. Lui seul pouvait donner naissance aux paroles du Magnificat, le chant de louange de la Vierge Marie : « Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles ! » (Lc 1, 52). Pour les chrétiens, le jugement de Dieu représentait avant tout un espoir pour les opprimés, les faibles, les blessés de la vie… L’espoir qu’à la fin, la justice divine l’emporterait.
Il importe donc de prendre en considération tous ces éléments quand on veut mesurer la valeur du monothéisme. Cependant, Assmann a certainement raison quand il affirme que prétendre être les seuls détenteurs de la vérité est une tentation humaine fondamentale. Ainsi certains membres fanatiques des religions monothéistes ont-ils versé dans des excès de violence et d’intolérance, non seulement en théorie, mais bien aussi dans la pratique. La question, déterminante d’un point de vue historique, est de savoir si l’alternative d’un monde sans monothéisme aurait été plus pacifique, plus humaine. Sur ce point, les conclusions des recherches les plus récentes ne laissent aucune place au doute : certainement pas ! Jan Assmann lui-même a corrigé sa thèse originale et a fini par admettre que, si le tournant monothéiste s’est « manifesté dans un certain débordement de violence », les religions tribales passées n’étaient pas non plus exemptes de telles effusions de sang. En réalité, de nombreuses manifestations de cette violence « avaient été endiguées, civilisées voire éradiquées par les religions monothéistes, au contact de leur pouvoir de transformation ». Rien d’étonnant, donc, à ce que Jan Assmann en vienne à la conclusion suivante : « Pour rien au monde je n’irai reprocher au monothéisme d’avoir apporté la violence dans le monde. Au contraire, avec son interdiction de donner la mort, son dégoût pour les sacrifices humains et pour l’oppression, sa défense active de l’égalité des individus devant le Dieu unique, il a tout fait pour freiner la violence dans le monde. »
3. Théorie et pratique – Pourquoi en toute logique l’islam la religion la plus tolérante
Des trois religions monothéistes dans le monde, l’islam est la plus tolérante. Et ce, pour une raison logique : chacune des trois religions monothéistes s’est conçue dès l’origine comme définitive, récusant de ce fait toute version plus récente, qui ne pouvait offrir qu’une vision déformée de cette révélation définitive. Par conséquent, le judaïsme rejeta aussi bien le christianisme que l’islam. Le christianisme refusa le tout jeune islam, mais se trouva obligé de reconnaître partiellement le judaïsme dont il était issu. Cette reconnaissance résulte en partie du principe chrétien de libre adhésion à la religion, qui impliquait de tolérer les alternatives. Mais chacune les trois religions monothéistes revendiquant l’universalité et le monopole de la vérité, elles ne se considérèrent jamais sur un pied d’égalité. L’islam accorda aux juifs et aux chrétiens une certaine liberté de culte (à l’intérieur de la communauté), ainsi que les droits fondamentaux du citoyen, tout en leur imposant certaines contraintes, comme des taxes plus élevées. Le christianisme soumit les juifs à des réglementations comparables. Quant au judaïsme, il se concevait comme la religion originelle, unique, et ne voyait aucune raison d’admettre les deux autres monothéismes. Mais il y a aussi une raison bien différente : hormis le cas du royaume plus ou moins légendaire des Khazars en Extrême-Orient, jamais le judaïsme n’a accédé au statut de religion dominante, tenue d’en tolérer d’autres. Tout au long de son histoire, le peuple juif est demeuré une minorité sans pouvoir, opprimée, rejetée et souvent même massacrée : une « vallée de larmes » de deux mille ans, à laquelle l’historiographie juive continue de faire référence aujourd’hui. Cette histoire marquée par les coups reçus les a cependant préservés d’un enjeu, celui de devoir administrer la tolérance. Le judaïsme n’était pas moins absolu que les deux autres monothéismes, mais n’a simplement jamais eu à définir lui-même le cadre d’une « religion autorisée ». Le politologue américain Gary Remer pense en effet que, si au Moyen Âge il avait existé un royaume juif, « bien des païens auraient eu à subir des persécutions ». C’est aujourd’hui seulement que l’État d’Israël se voit obligé de réglementer la diversité religieuse.
Il n’en va pas de même pour le christianisme, pour qui la question de la tolérance se posa, à l’égard des juifs, dès son accession au pouvoir dans l’Empire romain. Les empereurs chrétiens maintinrent le statut de « religion autorisée » jusque-là concédé aux juifs par leurs prédécesseurs païens. À la fin de l’Empire d’Occident, l’Église prit en charge la protection juridique des juifs. C’est le pape Grégoire le Grand (590-6041) qui posa les bases d’une « politique très équilibrée à l’égard des juifs », selon le spécialiste autrichien du judaïsme Günter Sternberger. Michael Toch, professeur à l’université hébraïque de Jérusalem, abonde dans ce sens : cette politique « devait s’avérer extrêmement pérenne, même dans les contextes, différents, des époques ultérieures, et cela jusqu’à l’époque moderne ».
Avec l’islam, la notion de « religion autorisée » prit son sens le plus large, d’autant plus qu’il s’est développé sur de vastes territoires, essentiellement peuplés de chrétiens. À l’époque de la première expansion, au début du VIIIe siècle, les musulmans, qui devaient représenter 10 % de la population, régnaient sur 90 % de non-musulmans. On estime en fait que l’islamisation de l’Afrique du Nord a eu lieu au XIIe et au XIIIe siècle, et celle de l’Anatolie au XVe et au XVIe siècles. Les « religions du Livre » – c’est ainsi que le Coran désigne le judaïsme et le christianisme – furent alors « protégées » sous réserve de loyauté et de taxes spécifiques, sans compter l’obligation de signaler leur appartenance religieuse par des vêtements particuliers. S’instaura alors une certaine liberté de religion, à condition de la pratiquer strictement dans l’enceinte des lieux de culte dédiés et sans attirer l’attention. Si aucun bâtiment ne pouvait dépasser les minarets, juifs et chrétiens étaient autorisés à jouir d’une forme d’autogestion et d’une juridiction particulière, de la propriété privée et du droit d’acquisition.
Face à cela, les chrétiens auraient également pu accorder le statut de « religion autorisée » aux adeptes du Coran dans les territoires qu’ils contrôlaient. Mais ce que les chrétiens accordaient aux juifs, ils ne pouvaient l’accorder aux musulmans dans la mesure où, précisément, cette « descendance » religieuse était à leurs yeux une imposture. Dans les faits, la tolérance chrétienne resta donc plus limitée. Au XIIe siècle, cependant, lors de la reconquête chrétienne de l’Espagne, une tentative fut menée : les musulmans de Valence obtinrent le droit de fréquenter leurs mosquées sans être inquiétés, la garantie de leurs biens, une juridiction indépendante, une relative autogestion et même l’assurance de ne pas être soumis à des décisions de justice non musulmanes.
Ces zones mixtes étaient cependant rares et disparurent petit à petit, avec d’un côté la rechristianisation d’une série d’îles de la Méditerranée et de certaines parties de l’Espagne, et de l’autre l’islamisation complète de l’Afrique du nord et de l’Anatolie. Selon l’historien anglo-américain Bernard Lewis, l’islam soulevait en outre un problème particulier : en cas de domination chrétienne, les écoles de droit islamique « conseillaient l’émigration et dans la plupart des cas, elles en faisaient une obligation ». Ainsi, celui qui restait de son plein gré sous domination chrétienne devait subir « l’opprobre de tous les émigrants et de tous les musulmans insoumis », car le pire régime musulman valait encore mieux que la plus clémente autorité infidèle. On comprend pourquoi l’émigration actuelle de musulmans dans des pays qui ne le sont pas place l’islam devant un problème radicalement nouveau.
Le système des « religions autorisées » engendra bien sûr une société à deux vitesses, les adeptes de ces religions subissant une certaine pression et de nombreuses discriminations. Ce fonctionnement ne fit qu’encourager le curieux phénomène de la « double religion », avec des crypto-juifs, des crypto-chrétiens et des crypto-musulmans. Au XVe siècle, par exemple, en Espagne, des dizaines de milliers de juifs se firent baptiser, mais, par habitude ou par ignorance, ils adoptèrent en de nombreux endroits une double pratique : on allait à la synagogue pour le sabbat et le dimanche à la messe, on mangeait casher à la maison mais on consommait du porc à l’extérieur. Les musulmans baptisés adoptèrent plus ou moins le même type de comportement. Il y avait aussi des crypto-chrétiens, en Albanie, par exemple, aux pratiques variées : les hommes vivaient comme des musulmans et les femmes comme des chrétiennes ; en famille on était chrétien, en public musulman ; à la maison on observait les préceptes chrétiens du jeûne et le Ramadan à la mosquée ; sur son lit de mort on recevait l’extrême-onction, mais on se faisait enterrer à la manière des musulmans ; pour le percepteur des impôts, le chef de famille se déclarait musulman afin d’éviter d’être taxé aussi lourdement que les chrétiens ; pour le service militaire, on se présentait comme conscrit chrétien à cause des congés spéciaux. Cependant, tous partageaient, et partagent encore souvent, les mêmes lieux de pèlerinage et les mêmes tombeaux de saints.
Toutes ces réglementations empêchèrent réellement que les trois religions monothéistes ne sombrent durant des siècles dans des guerres perpétuelles à cause de leurs revendications respectives. Mais il fallut attendre l’époque moderne pour qu’apparaisse une véritable nouveauté : l’égalité des droits et le libre exercice de la religion pour tous et partout.
1. Pour les papes, les dates indiquées sont celles de leur pontificat, N.D.T.
2
Jusqu’à l’an mil – Une religion de l’amour face à la violence
La tolérance est une invention chrétienne. En latin classique, le terme « tolerantia » désignait l’action de supporter des fardeaux et des peines physiques, par l’injustice, la torture et la violence ; à aucun moment il n’a renvoyé au fait de supporter l’opinion des autres. Ce sont les chrétiens qui ont fait évoluer ce mot de telle sorte qu’il désigne le respect bienveillant d’autres personnes, la déférence à l’égard de ceux qui ont une opinion différente. Cette attitude est liée au double commandement central de la foi chrétienne, ainsi énoncé par le Christ : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force » et « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là » (Mc 12, 30-31). Et Paul d’en déduire : « Tout ce que vous faites, faites-le par amour » (1 Co 16, 14). Cela influença directement l’idée de tolérance, qui revenait à dire : « Aime la personne, mais tiens son péché en horreur. » Voilà le sens chrétien, nouveau, de la tolérance. Quel que soit son péché, l’autre avait tout à fait le droit de vivre, et même d’être aimé. Le grand docteur de l’Église d’Occident, saint Augustin (354-430) offre une explication très claire : « Aime le pécheur, non parce qu’il est pécheur, mais parce qu’il est homme. » On retrouve les mêmes accents chez Thomas d’Aquin (1225-1274), huit cents ans plus tard : « Nous devons en effet détester dans les pécheurs ce qui les rend pécheurs, mais aimer ce qui en fait des hommes. » Un point de vue alors bien éloigné des autres religions, pour lesquelles tout péché méritait systématiquement punition.
1. Que faire des mauvaises herbes ? – La parabole qui révolutionna l’histoire des religions
« Tu aimeras ton Dieu de tout ton esprit » : c’est dans ce commandement que la théologie, qui se donne Dieu comme objet de réflexion, prend naissance. La théologie des débuts du christianisme plaidait déjà pour la tolérance. Dès le IIe siècle, Tertullien (150-220), grand juriste et théologien d’Afrique du nord, combattit avec virulence la contrainte religieuse qui « prive quelqu’un de la liberté de religion et lui interdit de choisir librement sa divinité, de telle sorte qu’il ne puisse plus décider de vénérer qui il veut, mais se trouve contraint de vénérer qui lui déplaît. Personne, pas même Dieu, n’aimerait être vénéré par quelqu’un à contrecœur ». Cette liberté, Tertullien la qualifiait de « droit de l’homme » : une véritable nouveauté pour l’époque.
Pour les chrétiens, alors, la foi en Jésus Christ, Fils de Dieu fait homme, ne relevait pas d’une simple opinion : elle était une vérité divine dont ils se réclamaient et pour laquelle ils étaient prêts, le cas échéant, à mourir sans opposer aucune violence. Dès les débuts de l’ère chrétienne, l’apôtre Paul avait mis en garde contre la tentation de croire en un autre Évangile et insisté pour que les faux prophètes et ceux que l’on appelait faux frères soient exclus de la communauté. Il les avait maudits et remis au jugement de Dieu à la fin des temps. Pour autant, il n’a jamais encouragé la moindre forme de violence à l’égard de ces dissidents : encore une nouveauté.
De son côté, le paganisme, s’il n’a jamais exigé que l’on adhère de tout son cœur et de toute sa raison aux innombrables divinités, entendait que l’on se soumette extérieurement en accomplissant certains rites incontournables. Celui qui s’y refusait pouvait être puni de mort, ce dont les chrétiens des premiers siècles n’ont cessé de faire la triste expérience, par vagues successives. Avant l’époque moderne, dans toutes les religions, un même principe s’imposait : toute personne qui se faisait l’ennemi de Dieu (ou des dieux) devait être éliminé, sous peine que la colère divine se déverse non seulement sur lui et ses proches, mais aussi sur l’État et la société entière. Cette idée que tout sacrilège éveillait la colère divine est à considérer comme l’un des plus puissants mécanismes à l’œuvre dans les religions. Dans quelque culture que ce soit, pour prévenir cette colère et dans l’intérêt du bien commun, il incombait aux dirigeants de susciter la vénération attendue par les dieux et d’empêcher par tous les moyens les offenses, les sacrilèges, bref tout signe d’inimitié à leur égard, afin d’éviter que la vengeance divine dévastatrice ne menace l’existence du peuple. Les ennemis des divinités, on les décapitait, on les brûlait ou on les crucifiait. Près de deux mille ans avant le Christ, le Code du roi de Babylone Hammurabi (1792-1750 av. J.-C.) prévoyait déjà la peine de mort. En Grèce, Socrate (469-399 av. J.-C.) fut la victime la plus célèbre d’une accusation d’impiété. Curieusement, son élève Platon lui-même (env. 428-347 av. J.-C.) plaidait pour la peine de mort pour quiconque niait l’existence des dieux. Par la suite encore, le droit pénal antique demeura fidèle à ce type de règles. Au Ier siècle après Jésus Christ, lorsqu’un membre de la maison impériale des Flaviens se convertissait au judaïsme ou au christianisme, il était décapité. Dans l’ancien Israël, il n’en allait pas autrement : c’est en vertu de ce principe que le chrétien Étienne fut « traîné hors de la ville et lapidé » (Ac 7, 58).
Ce n’est qu’en prenant conscience de tout cela que l’on peut comprendre la formidable nouveauté que représente, dans l’histoire des religions, la rupture radicale du christianisme avec cette coutume consistant à anéantir physiquement tous les ennemis de Dieu. Songeons à cet épisode dans l’Évangile où Jésus rappelle à l’ordre les disciples qui entendent faire tomber « le feu du ciel » sur les Samaritains, que les juifs considéraient comme des impies. De même, dans le sermon sur la montagne, il interdit toute forme de violence : « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin de devenir fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes » (Mt 5, 44-46). Il revenait aux chrétiens de tout faire pour favoriser la conversion de celui qui était dans l’erreur et de prier pour son Salut. Tuer était bel et bien proscrit.
Au lieu de cela, les chrétiens s’employèrent à débattre à grand renfort d’arguments et d’objections. Les discussions étaient animées. Déjà, les Actes des apôtres nous rapportent une dramatique altercation qui opposa les apôtres Pierre et Paul, lors de ce que l’on appelle le 1er concile de Jérusalem, vers l’an 48. Un accord fut finalement trouvé, en ces termes solennels : « L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé… » (Ac 15, 28). Ensuite, les conciles qui jalonnèrent le premier millénaire furent souvent le théâtre de discussions passionnées. Au nom de la foi, on condamna des doctrines, on démit des évêques, on excommunia des communautés entières, mais au bout du compte, nul n’eut jamais à craindre pour sa vie. Ceux qui adoptaient des doctrines déviantes, des hérésies, en refusant une partie de l’enseignement chrétien, n’étaient plus considérés comme catholiques, au sens où le Credo chrétien professe une Église « catholique », c’est-à-dire universelle. La règle était donc la suivante : les hérésies pouvaient être frappées de malédiction, mais pas les hérétiques. Il fallait ménager ces derniers et prier pour leur Salut.
Cette non-violence radicale trouve sa source dans un texte célèbre de l’Évangile selon Matthieu (Mt 13, 24-43), qui a sauvé la vie de milliers de personnes à travers les siècles :
Et Jésus leur raconta encore une autre parabole : « Il en va du Royaume des Cieux comme d’un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu, il a semé à son tour de l’ivraie, au beau milieu du blé, et il s’en est allé. Quand le blé est monté en herbe, puis en épis, alors l’ivraie est apparue aussi. S’approchant, les serviteurs du propriétaire lui dirent : “Maître, n’est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D’où vient donc qu’il s’y trouve de l’ivraie ?” Il leur dit : “C’est quelque ennemi qui a fait cela.” Les serviteurs lui disent : “Veux-tu donc que nous allions la ramasser ?” “Non, dit-il, vous risqueriez, en ramassant l’ivraie, d’arracher en même temps le blé. Laissez l’un et l’autre croître ensemble jusqu’à la moisson ; et au moment de la moisson je dirai aux moissonneurs : Ramassez d’abord l’ivraie et liez-la en bottes que l’on fera brûler ; quant au blé, recueillez-le dans mon grenier.” » […] Ses disciples, s’approchant, lui dirent : « Explique-nous la parabole de l’ivraie dans le champ. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c’est le Fils de l’homme ; le champ, c’est le monde ; le bon grain, ce sont les sujets du Royaume ; l’ivraie, ce sont les sujets du Mauvais ; l’ennemi qui la sème, c’est le Diable ; la moisson, c’est la fin du monde ; et les moissonneurs, ce sont les anges. De même donc qu’on enlève l’ivraie et qu’on la consume au feu, de même en sera-t-il à la fin du monde : le Fils de l’homme enverra ses anges, qui ramasseront de son Royaume tous les scandales et tous les fauteurs d’iniquité, et les jetteront dans la fournaise ardente : là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur Père. »