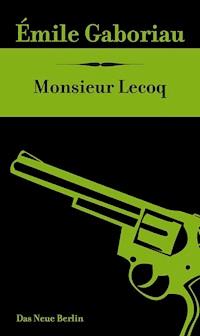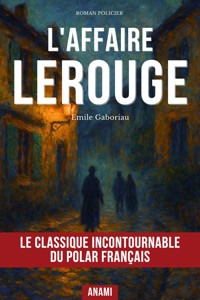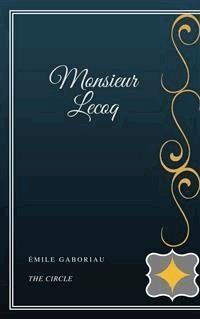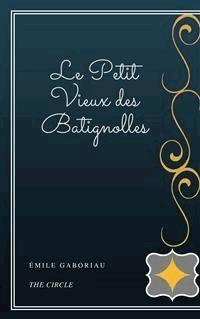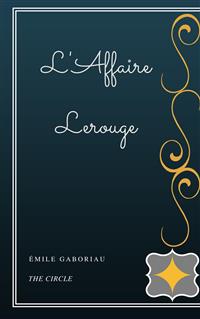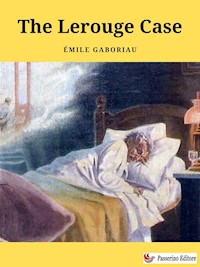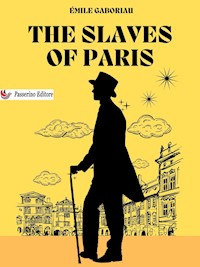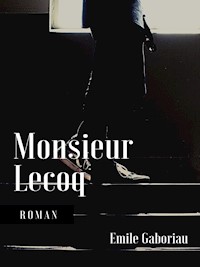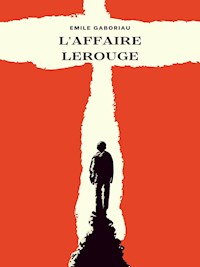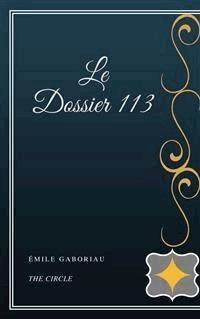
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Henri Gallas
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Französisch
Un vol important vient d'être commis rue de Provence à Paris, au préjudice de la banque Fauvel. Or, deux personnes seulement connaissaient la combinaison du coffre duquel 300000 francs ont été soustraits... Après une enquête sommaire, la police arrête Prosper Bertomy, le caissier principal. Mais une seconde enquête commence, menée par l'inspecteur Fanferlot, surnommé l'Écureuil, qui découvre l'existence de Nina Gipsy, une mystérieuse jeune femme entretenue par le caissier... Fanferlot fait alors appel au redoutable policier Lecoq. Aux côtés de celui-ci, il remonte la piste d'une affaire beaucoup plus complexe. Et nous voilà transportés des années en arrière, sous la Restauration, tandis que l'auteur nous dévoile une mystification d'envergure, historique, tout autant que criminelle.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Le Dossier 113
Émile Gaboriau
Émile Gaboriau (November 9, 1832 - September 28, 1873), was a French writer, novelist, and journalist, and a pioneer of modern detective fiction. Gaboriau was born in the small town of Saujon, Charente-Maritime. He became a secretary to Paul Féval, and after publishing some novels and miscellaneous writings, found his real gift in L'Affaire Lerouge (1866). The book, which was Gaboriau's first detective novel, introduced an amateur detective. It also introduced a young police officer named Monsieur Lecoq, who was the hero in three of Gaboriau's later detective novels. Monsieur Lecoq was based on a real-life thief turned police officer, Eugène François Vidocq (1775-1857), whose memoirs, Les Vrais Mémoires de Vidocq, mixed fiction and fact. It may also have been influenced by the villainous Monsieur Lecoq, one of the main protagonists of Féval's Les Habits Noirs book series. The book was published in the Pays and at once made his reputation. Gaboriau gained a huge following, but when Arthur Conan Doyle created Sherlock Holmes, Monsieur Lecoq's international fame declined. The story was produced on the stage in 1872. A long series of novels dealing with the annals of the police court followed, and proved very popular. Gaboriau died in Paris of pulmonary apoplexy.
Chapitre1
On lisait dans tous les journaux du soir du mardi 28 février 186. le fait divers suivant :
Un vol très considérable, commis au préjudice d’un honorable banquier de la capitale, M. André Fauvel, a mis ce matin en émoi tout le quartier de la rue de Provence. Des malfaiteurs d’une audace et d’une habileté extraordinaires ont réussi à pénétrer dans les bureaux, et là, forçant une caisse qu’on avait tout lieu de croire inattaquable, ils se sont emparés de la somme énorme de trois cent cinquante mille francs en billets de banque.
La police, aussitôt prévenue, a déployé son zèle accoutumé, et ses investigations ont été couronnées de succès. Déjà, dit-on, un employé de la maison, le sieur P. B., est arrêté ; tout fait espérer que ses complices seront bientôt sous la main de la justice.
Quatre jours durant, Paris entier ne s’occupa que de ce vol.
Puis, de graves événements survinrent : un acrobate se cassa la jambe au Cirque, une demoiselle débuta sur un petit théâtre, et le fait divers du 28 février fut oublié.
Mais les journaux, pour cette fois, avaient été – peut-être à dessein – mal ou du moins inexactement renseignés.
Une somme de trois cent cinquante mille francs avait été, il est vrai, soustraite chez M. André Fauvel, mais non de la façon indiquée. Un employé, en effet, avait été arrêté provisoirement, mais on n’avait recueilli contre lui aucune charge décisive. Ce vol, d’une importance insolite, restait sinon inexplicable, du moins inexpliqué.
Au surplus, voici les faits, tels qu’ils se trouvent relatés avec une exactitude méticuleuse aux procès-verbaux d’enquête.
Chapitre2
La maison de banque André Fauvel, rue de Provence, numéro 87, est très importante, et, grâce à son nombreux personnel, a presque les apparences d’un ministère.
C’est au rez-de-chaussée que sont situés les bureaux, et les fenêtres, qui prennent jour sur la rue, sont garnies de barreaux assez gros et assez rapprochés pour décourager toutes les tentations.
Une large porte vitrée donne accès dans un immense vestibule où stationnent du matin au soir trois ou quatre garçons.
À droite, se trouvent les pièces où le public est admis et un couloir qui conduit au guichet de la caisse principale.
Les bureaux de la correspondance, du grand-livre et de la comptabilité générale sont à gauche.
Au fond, on aperçoit une petite cour vitrée sur laquelle ouvrent sept ou huit guichets, inutiles en temps ordinaire, indispensables lors de certaines échéances.
Le cabinet de M. André Fauvel est au premier, à la suite de ses beaux appartements.
Ce cabinet communique directement avec les bureaux par un petit escalier noir, étroit et fort raide, qui débouche dans la pièce occupée par le caissier principal.
Cette pièce, que dans la maison on appelle « la caisse », est à l’abri d’un coup de main, et presque d’un siège en règle, blindée qu’elle est, ni plus ni moins qu’un monito[1] .
D’épaisses plaques de tôle garnissent les portes et la cloison où est pratiqué le guichet, et une forte grille obstrue le conduit de la cheminée.
Là se trouve, scellé dans le mur par d’énormes crampons, le coffre-fort, un de ces meubles fantastiques et formidables qui font rêver le pauvre diable dont la fortune entière tient à l’aise dans un porte-monnaie.
Chef-d’œuvre de la maison Becquet, ce coffre-fort a deux mètres de haut sur un mètre et demi de large. Entièrement en fer forgé, il est à triple paroi, et à l’intérieur se trouvent des compartiments isolés pour le cas d’incendie.
Une clé, petite et mignonne, ouvre ce meuble. C’est que, pour ouvrir, la clé est la moindre des choses. Cinq boutons d’acier mobiles, sur lesquels sont gravées toutes les lettres de l’alphabet, constituent surtout la force de l’ingénieux et puissant appareil de fermeture. Avant de songer à introduire la clé dans la serrure, il faut pouvoir replacer les lettres des boutons dans l’ordre où elles se trouvaient quand on a fermé.
Aussi, chez M. Fauvel, comme partout, du reste, ferme-t-on la caisse avec un mot qu’on change de temps à autre.
Ce mot, le chef de la maison et le caissier le connaissent seuls. Ils ont aussi chacun une clé.
Avec un tel meuble, possédât-on plus de diamants que le duc de Brunswick, on doit dormir sur les deux oreilles.
On ne court, ce semble, qu’un danger, celui d’oublier le mot qui est le « Sésame ouvre-toi » de la porte de fer…
Cependant, le 28 février au matin, les employés de la maison Fauvel arrivèrent à leurs bureaux comme d’ordinaire.
À neuf heures et demie, chacun était à sa besogne, lorsqu’un homme d’un certain âge, très brun, à tournure militaire, en grand deuil, se présenta dans le bureau qui précède la caisse, et où travaillent cinq ou six employés.
Il demandait à parler au caissier principal.
Il lui fut répondu que le caissier n’était pas encore arrivé, et que d’ailleurs la caisse n’ouvre qu’à dix heures, ainsi que l’annonce un grand écriteau placé dans le vestibule.
Cette réponse parut déconcerter et contrarier au dernier point le nouveau venu.
– Je pensais, dit-il d’un ton sec frisant l’impertinence, que je trouverais quelqu’un à qui m’adresser, m’étant entendu hier avec monsieur Fauvel. Je suis le comte Louis de Clameran, maître de forges à Oloron ; je viens retirer trois cent mille francs confiés à la maison par mon frère, dont je suis l’héritier. Il est surprenant qu’on n’ait pas donné d’ordres…
Ni le titre du noble maître de forges, ni ses raisons ne parurent toucher les employés.
– Le caissier n’est pas arrivé, répétèrent-ils, nous ne pouvons rien.
– Alors, conduisez-moi près de monsieur Fauvel.
Il y eut une certaine hésitation, mais un jeune employé nommé Cavaillon, qui travaillait près de la fenêtre, prit la parole.
– Le patron est toujours sorti à cette heure, répondit-il.
– Je repasserai donc, fit M. de Clameran.
Et il sortit, sans saluer ni même toucher le bord de son chapeau, comme il était entré.
– Pas poli, le client, fit le petit Cavaillon, mais il n’a pas de chance, car voici justement Prosper.
Le caissier principal de la maison André Fauvel, Prosper Bertomy, est un grand beau garçon de trente ans, blond, avec des yeux bleus, soigné jusqu’à la recherche et mis à la dernière mode.
Il serait vraiment très bien s’il n’outrait le genre anglais, se faisant froid et gourmé à plaisir, et si un certain air de suffisance ne gâtait sa physionomie naturellement riante.
– Ah ! vous voilà ! s’écria Cavaillon, on est déjà venu vous demander.
– Qui ? un maître de forges, n’est-ce pas ?
– Précisément.
– Eh bien ! il reviendra. Sachant que j’arriverais tard ce matin, j’ai pris mes mesures hier.
Prosper avait ouvert son bureau, tout en parlant, il y entra refermant la porte sur lui.
– À la bonne heure ! s’écria un des employés, voilà un caissier qui ne se fait pas de bile. Le patron lui a fait vingt scènes parce qu’il arrive toujours trop tard, il s’en soucie comme de l’an quarante.
– Il a, ma foi, bien raison, puisqu’il obtient tout ce qu’il veut du patron !
– D’ailleurs, comment viendrait-il matin ; un garçon qui mène une vie d’enfer, qui passe toutes les nuits dehors. Avez-vous remarqué sa mine de déterré, ce matin ?
– Il aura encore joué, comme le mois passé ; j’ai su par Couturier qu’en une seule séance il a perdu mille cinq cents francs.
– Sa besogne en est-elle moins bien faite ? interrompit Cavaillon. Si vous étiez à sa place…
Il s’arrêta court. La porte de la caisse venait de s’ouvrir et le caissier s’avançait d’un pas chancelant.
– Volé ! balbutiait-il, on m’a volé !…
La physionomie de Prosper, sa voix rauque, le tremblement qui le secouait exprimaient si bien une affreuse angoisse, que tous les employés ensemble se levèrent et coururent à lui.
Il se laissa presque tomber entre leurs bras, il ne pouvait plus se soutenir, il se trouvait mal, il fallut l’asseoir.
Cependant ses collègues l’entouraient, l’interrogeant tous à la fois, le pressant de s’expliquer.
– Volé, disaient-ils ; où, comment, par qui ?
Peu à peu, Prosper revenait à lui.
– On a pris, répondit-il, tout ce que j’avais en caisse.
– Tout ?
– Oui, trois paquets de cent billets de mille francs et un de cinquante. Les quatre paquets étaient entourés d’une feuille de papier et liés ensemble.
Avec la rapidité de l’éclair la nouvelle d’un vol s’était répandue dans la maison de banque ; les curieux accoururent de toutes parts ; le bureau était plein.
– Voyons, disait à Prosper le jeune Cavaillon, on a donc forcé la caisse ?
– Non, elle est intacte.
– Eh bien, alors…
– Alors il n’en est pas moins un fait, c’est qu’hier soir j’avais trois cent cinquante mille francs, et que je ne les retrouve plus ce matin.
Tout le monde se taisait ; seul, un vieil employé ne partagea pas la consternation générale.
– Ne perdez donc pas ainsi la tête, monsieur Bertomy, dit-il ; songez que le patron doit avoir disposé des fonds.
Le malheureux caissier se dressa tout d’une pièce ; il s’accrochait à cette idée.
– Oui ! s’écria-t-il, en effet, vous avez raison ; ce sera le patron.
Puis réfléchissant :
– Non, reprit-il d’un ton de découragement profond, non, ce n’est pas possible. Jamais, depuis cinq ans que je tiens la caisse, monsieur Fauvel ne l’a ouverte sans moi. Deux ou trois fois il a eu besoin de fonds, et il m’a attendu ou envoyé chercher plutôt que d’y toucher en mon absence.
– Peu importe, objecta Cavaillon ; avant de se désoler, il faut l’avertir.
Mais déjà M. André Fauvel était prévenu. Un garçon de bureau était monté à son cabinet et lui avait dit ce qui se passait.
Au moment où Cavaillon proposait de l’aller chercher, il parut.
M. André Fauvel est un homme de cinquante ans environ, de taille moyenne, aux cheveux grisonnants. Il est assez gros, légèrement voûté, comme tous les travailleurs acharnés, et il a l’habitude de se dandiner en marchant.
Jamais une seule de ses actions n’a démenti l’expression de bonté de son visage. Il a l’air ouvert, l’œil vif et franc, la lèvre rouge et bien épanouie. Né aux environs d’Aix, il retrouve, quand il s’anime, un léger accent provençal qui donne une saveur particulière à son esprit ; car il est spirituel.
La nouvelle portée par le garçon l’avait ému, car, lui d’ordinaire assez rouge, il était fort pâle.
– Que me dit-on ? demanda-t-il aux employés qui s’écartaient respectueusement devant lui, qu’arrive-t-il ?
La voix de M. Fauvel rendit au caissier l’énergie factice des grandes crises ; le moment décisif et redouté était arrivé ; il se leva et s’avança vers son patron.
– Monsieur, commença-t-il, ayant pour ce matin le remboursement que vous savez, j’ai, hier soir, envoyé prendre à la Banque trois cent cinquante mille francs.
– Pourquoi hier, monsieur ? interrompit le banquier. Il me semble que cent fois je vous ai ordonné d’attendre au jour même.
– Je le sais, monsieur, j’ai eu tort, mais le mal est fait. Hier soir j’ai serré ces fonds, ils ont disparu, et cependant la caisse n’a pas été forcée.
– Mais vous êtes fou ! s’écria M. Fauvel, vous rêvez !
Ces quelques mots anéantissaient toute espérance, mais l’horreur même de la situation donnait à Prosper, non le sang-froid d’une résolution réfléchie, mais cette sorte d’indifférence stupide qui suit les catastrophes inattendues.
C’est presque sans trouble apparent qu’il répondit :
– Je ne suis pas fou, par malheur, je ne rêve pas, je dis ce qui est.
Cette placidité dans un tel moment parut exaspérer M. Fauvel. Il saisit Prosper par le bras, et le secouant rudement :
– Parlez ! cria-t-il, parlez ! qui voulez-vous qui ait ouvert la caisse ?
– Je ne puis le dire.
– Il n’y a que vous et moi qui sachions le mot ; il n’y a que vous et moi qui ayons une clé !
C’était là une accusation formelle, du moins tous les auditeurs le comprirent ainsi.
Pourtant, le calme effrayant du caissier ne se démentit pas. Il se débarrassa doucement de l’étreinte de son patron, et, bien lentement, il dit :
– En effet, monsieur, il n’y a que moi qui aie pu prendre cet argent…
– Malheureux !
Prosper se recula, et, les yeux obstinément attachés sur les yeux de M. André Fauvel, il ajouta :
– Ou vous !
Le banquier eut un geste de menace, et on ne sait ce qui serait arrivé si tout à coup on n’avait entendu à la porte, donnant sur le vestibule, le bruit d’une discussion.
Un client voulait absolument entrer, malgré les protestations des garçons, et, en effet, il entra. C’était M. de Clameran.
Tous les employés réunis dans le bureau se tenaient debout, immobiles, glacés ; le silence était profond, solennel. Il était aisé de voir que quelque question terrible, question de vie ou de mort se débattait entre tous ces hommes.
Le maître de forges ne voulut rien voir. Il s’avança, toujours le chapeau sur la tête, et du même ton impertinent, il dit :
– Il est dix heures passées, messieurs.
Personne ne répondit, et M. de Clameran allait poursuivre, lorsqu’il aperçut le banquier qu’il n’avait pas vu. Il marcha droit à lui.
– Enfin ! monsieur ! s’écria-t-il, je vous trouve, et c’est vraiment fort heureux. Déjà une fois, ce matin, je me suis présenté, la caisse n’était pas ouverte, le caissier n’était pas arrivé ; vous étiez absent.
– Vous vous trompez, monsieur, j’étais dans mon cabinet.
– On m’a cependant affirmé le contraire, et tenez, c’est monsieur que voici qui me l’a assuré.
Et du doigt le maître de forges désignait Cavaillon.
– Cela d’ailleurs importe peu, reprit-il ; je reviens, et cette fois non seulement la caisse est fermée, mais on me refuse l’entrée des bureaux. Bien m’en a pris de violer la consigne ; vous allez me dire si je puis, oui ou non, retirer mes fonds.
M. Fauvel écoutait tremblant de colère ; de blême il était devenu cramoisi ; pourtant il se contenait.
– Je vous serais obligé, monsieur, dit-il enfin d’une voix sourde, de vouloir bien m’accorder un délai.
– Il me semble que vous m’aviez dit…
– Oui, hier. Mais ce matin, à l’instant, j’apprends que je suis victime d’un vol de trois cent cinquante mille francs.
M. de Clameran s’inclina ironiquement.
– Et faudra-t-il attendre bien longtemps ? demanda-t-il.
– Le temps d’aller à la Banque.
Aussitôt, tournant le dos au maître de forges, M. Fauvel revint à son caissier.
– Préparez un bordereau, lui dit-il ; envoyez au plus vite ; qu’on prenne une voiture pour retirer les fonds disponibles à la Banque.
Prosper ne bougea pas.
– M’avez-vous entendu ? répéta le banquier près d’éclater.
Le caissier tressaillit ; on eût dit qu’il sortait d’un songe.
– Envoyer est inutile, répondit-il froidement, la créance de monsieur est de trois cent mille francs, et il ne nous reste pas cent mille francs à la Banque.
Cette réponse, on eût juré que M. de Clameran l’attendait, car il murmura :
– Naturellement…
Il ne prononça que ce mot ; mais sa voix, son geste, sa physionomie signifiaient clairement : « La comédie est bien jouée, mais c’est une comédie, et je n’en suis pas dupe. »
Hélas ! pendant que le maître de forges laissait ainsi percer brutalement son opinion, les employés, après la réponse de Prosper, ne savaient que penser.
C’est que Paris, à ce moment, venait d’être éprouvé par d’éclatants sinistres financiers. La tourmente de la spéculation avait fait chanceler de vieilles et solides maisons. On avait vu des hommes honorables et des plus fiers aller de porte en porte implorer aide et assistance.
Le crédit, cet oiseau rare du calme et de la paix, hésitait à se poser, prêt à ouvrir ses ailes au moindre bruit suspect.
C’est dire que cette idée d’une comédie convenue à l’avance entre le banquier et son caissier pouvait fort bien se présenter à l’esprit de gens, sinon prévenus, au moins très à même de comprendre tous les expédients qui, en faisant gagner du temps, peuvent assurer le salut.
M. Fauvel avait trop d’expérience pour ne pas deviner l’impression produite par la phrase de Prosper ; il lisait le doute le plus mortifiant dans tous les yeux.
– Oh ! soyez tranquille, monsieur, dit-il vivement à M. de Clameran ; ma maison a d’autres ressources, veuillez prendre patience, je reviens.
Il sortit, monta jusqu’à son cabinet, et, au bout de cinq minutes, reparut tenant à la main une lettre et une liasse de titres.
– Vite, Couturier, dit-il à un de ses employés, prenez ma voiture qu’on attelle, et allez avec monsieur jusque chez monsieur de Rothschild. Vous remettrez la lettre et les titres que voici, et, en échange, on vous comptera trois cent mille francs que vous donnerez à monsieur.
Le désappointement du maître de forges était visible ; il sembla vouloir excuser son impertinence.
– Croyez, monsieur, commença-t-il, que je n’avais aucune intention offensante. Voici des années, déjà, que nous sommes en relations et jamais…
– Assez, monsieur, interrompit le banquier, je n’ai que faire de vos excuses. Il n’y a, en affaires, ni connaissances ni amis. Je dois, je ne suis pas en mesure, vous êtes… pressant ; c’est juste, vous êtes dans votre droit. Suivez mon commis, il vous remettra vos fonds.
Puis se tournant vers les employés qu’avait attirés la curiosité :
– Quant à vous, messieurs, dit-il, veuillez regagner vos bureaux.
En un moment la pièce qui précède la caisse fut vide. Seuls les commis qui y travaillent y étaient restés, et assis devant leur pupitre, le nez sur leur papier, ils semblaient absorbés par leur besogne.
Encore sous le coup des rapides événements qui venaient de se succéder, M. André Fauvel se promenait de long en large, agité, fiévreux, laissant par intervalles échapper quelque sourde exclamation.
Prosper, lui, était resté debout, appuyé à la cloison. Pâle, anéanti, les yeux fixes, il paraissait avoir perdu jusqu’à la faculté de penser.
Enfin, après un long silence, le banquier s’arrêta devant Prosper ; il avait pris son parti et arrêté ses déterminations.
– Il faut pourtant nous expliquer, dit-il ; passez dans votre bureau.
Le caissier obéit sans mot dire, presque machinalement, et son patron le suivit, prenant bien soin de refermer la porte derrière lui.
Rien dans ce bureau n’annonçait le passage de malfaiteurs étrangers à la maison. Tout était en place ; pas un papier n’avait été dérangé.
Le coffre-fort était ouvert, et sur la tablette supérieure on voyait un certain nombre de rouleaux d’or, oubliés ou dédaignés par les voleurs.
M. Fauvel, sans se donner la peine de rien examiner, prit une chaise et ordonna à son caissier de s’asseoir. Il était devenu parfaitement maître de soi et sa physionomie avait repris son expression habituelle.
– Maintenant que nous sommes seuls, Prosper, commença-t-il, n’avez-vous rien à m’apprendre ?
Le caissier tressaillit, comme si cette question eût pu l’étonner.
– Rien, monsieur, dit-il, que je ne vous aie appris.
– Quoi ! rien… Vous vous obstinez à soutenir une fable ridicule, absurde, que personne ne croira. C’est de la folie. Confiez-vous à moi, là est le salut. Je suis votre patron, c’est vrai, mais je suis aussi et avant tout votre ami, votre meilleur ami. Je ne saurais oublier que voici quinze ans que vous m’avez été confié par votre père et que depuis ce temps je n’ai eu qu’à me louer de vos bons et loyaux services. Oui, il y a quinze ans que vous êtes chez moi. Je commençais alors l’édifice de ma fortune, et vous l’avez vue grandir pierre à pierre, assise par assise. Et à mesure que je m’enrichissais, je m’efforçais d’améliorer votre position à vous, qui, tout jeune encore, êtes le plus ancien de mes employés. À chaque inventaire j’ai augmenté vos appointements.
Jamais Prosper n’avait entendu son patron s’exprimer d’une voix si douce, si paternelle. Une surprise profonde se lisait sur ses traits.
– Répondez, poursuivait M. Fauvel, n’ai-je pas toujours été pour vous comme un père ? Dès le premier jour, ma maison vous a été ouverte ; je voulais que ma famille fût la vôtre. Longtemps vous avez vécu comme mon fils, entre mes deux fils et ma nièce Madeleine. Mais vous vous êtes lassé de cette vie heureuse. Un jour, il y a un an de cela, vous avez commencé à nous fuir, et depuis…
Les souvenirs de ce passé évoqué par le banquier se présentaient en foule à l’esprit du malheureux caissier ; peu à peu il s’attendrissait ; à la fin, il fondit en larmes, cachant sa figure entre ses mains.
– On peut tout dire à son père, reprit M. André Fauvel, que l’émotion de Prosper gagnait, ne craignez rien. Un père n’offre pas le pardon, mais l’oubli. Ne sais-je pas les tentations terribles qui, dans une ville comme Paris, peuvent assaillir un jeune homme ? Il est de ces convoitises qui brisent les plus solides probités. Il est des heures d’égarement et de vertige où l’on n’est plus soi, où l’on agit comme un fou, comme un forcené, sans avoir, pour ainsi dire, la conscience de ses actes. Parlez, Prosper, parlez.
– Eh ! que voulez-vous que je vous dise ?
– La vérité. Un homme vraiment honnête peut faillir, mais il se relève et rachète sa faute. Dites-moi : « Oui, j’ai été entraîné, ébloui, la vue de ces masses d’or que je remue a troublé ma raison, je suis jeune, j’ai des passions !… »
– Moi ! murmura Prosper, moi !
– Pauvre enfant, dit tristement le banquier, croyez-vous donc que j’ignore votre vie, depuis un an que vous avez déserté mon foyer ? Vous ne comprenez donc pas que tous vos confrères vous jalousent, qu’ils ne vous pardonnent pas de gagner douze mille francs par an. Jamais vous n’avez fait une folie que je n’en aie été prévenu par une lettre anonyme. Je pourrais vous dire le nombre de vos nuits passées au jeu et les sommes perdues. Oh ! l’envie a de bons yeux et l’oreille fine. Je sais quel cas on doit faire des lâches dénonciations, mais j’ai dû m’informer. Il n’est que juste que je sache comment vit l’homme auquel je confie ma fortune et mon honneur.
Prosper essaya un geste de protestation.
– Oui, mon honneur, insista M. Fauvel, d’une voix que le ressentiment de l’humiliation essuyée rendait plus vibrante ; oui, mon crédit, qui aurait pu être compromis aujourd’hui par cet homme. Savez-vous ce que vont me coûter les fonds qu’on va donner à monsieur de Clameran ? Et ces titres que je sacrifie, je pouvais ne pas les avoir, vous ne me les connaissiez pas !
Le banquier s’arrêta comme s’il eût espéré un aveu qui ne vint pas.
– Allons, Prosper, du courage, un bon mouvement !… Je vais me retirer, et vous visiterez de nouveau la caisse ; je parierais que, dans votre trouble, vous n’avez pas bien cherché… Ce soir, je reviendrai, et je suis sûr que dans la journée vous aurez retrouvé, sinon les trois cent cinquante mille francs, au moins la majeure partie de cette somme… et ni vous ni moi nous ne nous souviendrons demain de cette fausse alerte.
Déjà M. Fauvel s’était levé et s’avançait vers la porte ; Prosper le retint par le bras.
– Votre générosité est inutile, monsieur, dit-il d’un ton amer ; n’ayant rien pris, je ne puis rien rendre. J’ai bien cherché, les billets de banque ont été volés.
– Mais par qui, pauvre fou ! par qui !
– Sur tout ce qu’il y a de sacré au monde, je jure que ce n’est pas par moi.
Un flot de sang empourpra le front du banquier.
– Misérable ! s’écria-t-il, que voulez-vous dire ? Ce serait donc par moi ?
Prosper baissa la tête et ne répondit pas.
– Ah ! c’est ainsi, reprit M. Fauvel, hors d’état de se contenir, vous osez !… Alors, entre vous et moi, monsieur Prosper Bertomy, la justice prononcera. Dieu m’est témoin que j’ai tout fait pour vous sauver. Ne vous en prenez qu’à vous de ce qui va arriver. J’ai fait prier le commissaire de police de vouloir bien venir jusqu’ici ; il doit m’attendre dans mon cabinet ; dois-je le faire prévenir ?
Prosper eut ce geste d’affreuse résignation de l’homme qui s’abandonne, et d’une voix étouffée, il répondit :
– Faites !
Le banquier était près de la porte, il l’ouvrit, et après un dernier regard jeté à son caissier, il cria à un garçon de bureau :
– Anselme, priez monsieur le commissaire de police de prendre la peine de descendre.
Chapitre3
S’il est un homme du monde que nul événement ne doive émouvoir ni surprendre, toujours en garde contre les mensonges des apparences, capable de tout admettre et de tout s’expliquer, c’est à coup sûr un commissaire de police de Paris.
Pendant que le juge, du haut de son tribunal, ajuste aux actes qui lui sont soumis les articles du Code, le commissaire de police observe et surveille tous les faits odieux que la loi ne saurait atteindre. Il est le confident obligé des infamies de détail, des crimes domestiques, des ignominies tolérées.
Peut-être avait-il encore, lorsqu’il est entré en charge, quelques illusions ; après un an, il n’en conserve plus.
S’il ne méprise pas absolument l’espèce humaine, c’est que souvent, à côté d’abominations sûres de l’impunité, il a découvert des générosités sublimes qui resteront sans récompense. C’est que, s’il voit d’impudents coquins voler la considération publique, il se console en songeant aux héros modestes et obscurs qu’il connaît.
Tant de fois ses prévisions ont été trompées qu’il en est arrivé au scepticisme le plus complet. Il ne croit à rien, pas plus au mal qu’au bien absolu, pas plus à la vertu qu’au vice.
Forcément, il en arrive à cette conclusion navrante qu’il n’y a pas des hommes, mais bien des événements.
Prévenu par le garçon de bureau, le commissaire de police mandé par M. Fauvel ne tarda pas à paraître.
C’est de l’air le plus calme, il faudrait dire le plus indifférent, qu’il entra dans le bureau.
Un petit homme, tout de noir habillé, portant cravate en corde autour d’un faux col douteux, le suivait.
C’est à peine si le banquier prit la peine de saluer.
– Sans doute, monsieur, commença-t-il, on vous a appris quelles circonstances pénibles me forcent à avoir recours à vos bons offices ?
– Il s’agit, m’a-t-on dit, d’un vol.
– Oui, monsieur, d’un vol odieux, inexplicable, commis dans ce bureau où nous sommes, dans cette caisse que vous voyez là, ouverte, et dont mon caissier – et il montrait Prosper – a seul le mot et la clé.
Cette déclaration parut tirer le malheureux caissier de sa morne stupeur.
– Pardon, monsieur le commissaire, dit-il d’une voix éteinte, mon patron, lui aussi, a la clé et le mot.
– Bien entendu, cela va sans dire.
Ainsi, dès les premiers mots, le commissaire était fixé.
Évidemment, ces deux hommes s’accusaient réciproquement. De leur aveu même, l’un d’eux pouvait seul être le coupable.
Et l’un était le chef d’une maison de banque très importante, l’autre un simple caissier. L’un était le patron, l’autre l’employé.
Mais le commissaire de police était bien trop habitué à dissimuler ses impressions pour que rien, au-dehors, ne trahît ce qui se passait en lui. Pas un muscle de sa figure ne bougea.
Seulement, devenu plus grave, il observait alternativement le caissier et M. Fauvel, comme si de leur contenance, de leur attitude, il eût pu tirer quelque induction profitable.
Prosper était toujours fort pâle et aussi abattu que possible ; il était affaissé sur sa chaise et ses bras pendaient inertes le long de son corps.
Le banquier, au contraire, se tenait debout, rouge, animé, l’œil étincelant, s’exprimant avec une violence extraordinaire.
– Et l’importance de la soustraction est énorme, poursuivait M. Fauvel ; on m’a pris une fortune, trois cent cinquante mille francs ! Ce vol pourrait avoir pour moi des suites désastreuses. Il est tel moment où, faute de cette somme, le crédit de la plus riche maison peut être compromis.
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollst?ndigen Ausgabe!