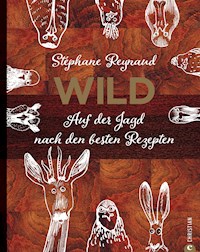Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Aventures en terre imaginaire
Cheng, un jeune ficeleur d’asperges né dans l’empire de Camelote, s’endort malencontreusement dans un container rempli de légumes pour se réveiller à l’autre bout du monde. Dérivant dans un univers où tout est devenu low cost, il vogue de rencontre en rencontre et tente de comprendre qui tire les ficelles de cette société à la recherche perpétuelle du coût le plus bas.
Le Monde selon Cheng est un conte contemporain aigre-doux sur le thème de la valeur. Poussant à l’extrême la logique mercantile du monde tel qu’il tourne, il explore avec brio et simplicité les abysses vers lesquels nous entraîne la quête effrénée du moindre coût.
Une dystopie qui expose et dénonce implicitement les valeurs sociales de notre époque
EXTRAIT
Nous vivons comme des brutes, disait mon père. Depuis que le monde a changé, nous vivons comme des brutes et plus rien n’a de valeur. Quand il parlait ainsi, il prenait un air grave, mais la plupart du temps, c’était un homme joyeux, surtout avec moi. Je m’appelle Cheng l’Asperge, je suis haut comme trois pommes, je sais à peine lire, je sais compter. Je suis né au royaume de Camelote mais j’ai vécu ailleurs. Mon père est ficeleur d’asperges, comme ma mère et mes soeurs. Jusqu’à mon départ, je passais mes journées sur la zone de conditionnement, entre le port et l’aéroport, entre ciel et mer. Avec mon père, ma mère et mes soeurs. Le matin, nous nous levions tôt, nous buvions du soda en regardant des jeux sur le poste de télévision, et nous partions tous ensemble attendre le camion. Il faisait encore nuit. D’abord, nous entendions le moteur, les grincements des suspensions qui ressemblaient à des souffles d’épuisement, ces bruits nous parvenaient par vagues successives, puis nous apercevions les rais des phares qui partaient dans tous les sens parce qu’il y avait des trous énormes dans la route, et enfin nous sentions l’odeur d’huile chaude de la machine. J’aimais m’asseoir à côté de mon père sur le plateau du camion. Mes soeurs dormaient contre ma mère, qui dormait aussi. Pas mon père. Ni moi. Mes soeurs et moi faisions partie des enfants qui n’allaient pas à l’école. Il y avait de plus en plus d’enfants qui n’allaient plus à l’école depuis qu’elle n’était plus obligatoire dans notre région. Mon père m’apprenait à compter. À trois ans, je savais compter jusqu’à cent mille. À quatre ans, j’ai compris l’infini. L’infini, c’est quand on ne peut plus compter. Cela donne le vertige et cela fait peur aussi.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- "En moins de cent pages, Stéphane Reynaud a réussi à raconter le monde tel qu’il ne va pas. Une réussite."
(Mohammed Aïssaoui, Le Figaro)
- "Un conte cruel, doublé d’un joli premier roman."
(VSD)
- "
Micromegas futuriste et malheureusement très plausible sous de nombreux aspects,
Le Monde selon Cheng pose la question de la valeur, et fait le lien entre le côté marchand et le côté éthique de cette notion fondamentale. Un livre incisif et élégant."
(Yaël Hirsch, Toute la culture.com)
- "Une dérive désenchantée qui flingue les ayatollahs du coût bas."
(Télé Poche)
A PROPOS DE L'AUTEUR
Stéphane Reynaud est journaliste, rédacteur en chef des pages « Style et Art de Vivre » au
Figaro. Il est l’auteur de plusieurs essais dont
Glamour business (2008), et
No Low Cost (2009). Il a également publié
Dans les cuisines de la République (2010).
Le Monde selon Cheng est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 119
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À Pascale, Louise et Faustine.
Un mensonge peut tromper quelqu’un mais il vous dit la vérité : vous êtes faible.
Tom Wolfe
CHAPITRE 1 LE GRAND VOYAGE
Nous vivons comme des brutes, disait mon père. Depuis que le monde a changé, nous vivons comme des brutes et plus rien n’a de valeur. Quand il parlait ainsi, il prenait un air grave, mais la plupart du temps, c’était un homme joyeux, surtout avec moi. Je m’appelle Cheng l’Asperge, je suis haut comme trois pommes, je sais à peine lire, je sais compter. Je suis né au royaume de Camelote mais j’ai vécu ailleurs. Mon père est ficeleur d’asperges, comme ma mère et mes sœurs. Jusqu’à mon départ, je passais mes journées sur la zone de conditionnement, entre le port et l’aéroport, entre ciel et mer. Avec mon père, ma mère et mes sœurs. Le matin, nous nous levions tôt, nous buvions du soda en regardant des jeux sur le poste de télévision, et nous partions tous ensemble attendre le camion. Il faisait encore nuit. D’abord, nous entendions le moteur, les grincements des suspensions qui ressemblaient à des souffles d’épuisement, ces bruits nous parvenaient par vagues successives, puis nous apercevions les rais des phares qui partaient dans tous les sens parce qu’il y avait des trous énormes dans la route, et enfin nous sentions l’odeur d’huile chaude de la machine. J’aimais m’asseoir à côté de mon père sur le plateau du camion. Mes sœurs dormaient contre ma mère, qui dormait aussi. Pas mon père. Ni moi. Mes sœurs et moi faisions partie des enfants qui n’allaient pas à l’école. Il y avait de plus en plus d’enfants qui n’allaient plus à l’école depuis qu’elle n’était plus obligatoire dans notre région. Mon père m’apprenait à compter. À trois ans, je savais compter jusqu’à cent mille. À quatre ans, j’ai compris l’infini. L’infini, c’est quand on ne peut plus compter. Cela donne le vertige et cela fait peur aussi.
Avec mon père, j’ai appris à compter le nombre de fois où le camion s’arrêtait. À chaque pause, d’autres familles montaient. Cela sentait mauvais à cause de la fumée d’échappement qui remontait à l’arrière, piquait les yeux et la gorge et faisait tousser. Je connaissais chacun des passagers par son nom. Trente-sept arrêts au village, dont un devant le magasin où mon père nous achetait le soda de la journée, le blanc à bulles dans une bouteille en plastique mou qui tient à peine debout toute seule quand elle est vide, trois autres arrêts à la sortie du village, à côté de l’usine de sacs d’aspirateurs aux odeurs de carton recyclé, et puis onze autres encore. Je comptais les départs, et en même temps, les passagers qui montaient. À la fin, nous étions entre cent trente-huit et cent quarante-trois.
Enfants comme adultes, nous étions tous habillés de la même façon. Avec des pantalons et des chemises en coton de couleur violette. À côté du village, il y avait un autre village avec une teinturerie qui ratait parfois sa teinture. La teinturerie jetait alors dans une grande cuve rouillée les vêtements sur lesquels la teinture avait mal pris. Les gens des villages alentours les récupéraient. Les vêtements étaient tous un peu les mêmes, il y avait des vestes en coton rêche avec des manches larges et très courtes, un col qui aurait dû protéger le cou mais qui ne faisait que le gratter, et trois gros boutons devant qu’il fallait recoudre avec du fil qu’on trouvait sur de vieux emballages. Les pantalons avaient deux poches et ils se resserraient à la taille avec une cordelette. Ces vêtements étaient solides, mais ils déteignaient. Dès que nous suions un peu, notre peau devenait violette. Or, nous étions dégoulinants toute la journée. Les plus vieux avaient la peau très violette et la couleur ne partait plus jamais. Les plus jeunes étaient plus clairs. C’est à cela que nous pouvions deviner l’âge des gens du village. Ici, quand le violet devenait trop foncé, on mourait.
Je ne dormais jamais le matin. Mon père non plus. Nous voyagions dans un état de semi-conscience rassurant, en famille, habitués au défilement du paysage embrumé, aux fossés encombrés de ronces, de détritus et de carcasses de véhicules. C’était notre univers et nous l’aimions. Ma mère et mes sœurs se réveillaient à l’avant-dernier arrêt, ou au précédent. Jamais au dernier. Émerger trop tard, cela signifiait être piétiné par cent trente-huit à cent quarante-trois personnes qui descendaient du camion. Sur la zone de conditionnement, des dizaines de camions arrivaient en même temps. Un jour, j’en ai compté deux cent vingt-trois. Des camions de ficeleurs et des camions d’asperges. Toute la journée nous étions dehors, au grand air. C’était bien parce que dans cette région du royaume de Camelote, il fait presque toujours chaud. Mais parfois il pleuvait, alors le matin, sur la plate-forme du camion, nous nous abritions sous une grande bâche. Et la journée aussi. Nous empilions des bidons de deux cents litres de conservateur pour monter trois ou quatre colonnes de fortune et nous tendions une grande toile en plastique dessus. Quand il ne pleuvait pas, pendant les pauses, avec les autres enfants nous jouions à faire rouler ces mêmes bidons de conservateur, et nous sautions dessus pour faire des numéros de cirque, comme dans les émissions que nous regardions à la télévision le soir. Je comptais à voix haute le temps que chacun d’entre nous passait en équilibre sur le bidon pendant que les autres le poussaient, de plus en plus vite. C’était l’un de nos jeux préférés sur la zone de conditionnement. Et puis après, nous fumions en cachette des cigarettes que certains ficeleurs devaient cacher dans les bottes d’asperges.
La journée, je préparais des bottes d’asperges. Comme mon père, ma mère et mes sœurs. Les asperges arrivaient en camion avant d’être entreposées sur la zone de conditionnement. Les premiers camions déchargeaient chacun à leur tour et alignaient leur cargaison sur une immense ligne de plusieurs dizaines de mètres. Les autres venaient ensuite épaissir cette ligne jusqu’à ce qu’elle forme un carré. Les camions suivants montaient sur cet énorme carré et continuaient. Le matin, c’était une montagne d’asperges derrière laquelle se levait le soleil. C’était très beau. Quand il n’y avait pas de brouillard, les couleurs du ciel, celle des asperges et la teinte de nos vêtements se mélangeaient. Bien plus tard, quand Ingrid m’a expliqué ce qu’était l’harmonie, je me suis souvenu de ces aurores où tout mon univers était violet. J’aimais bien ce moment-là. Je respirais fort et l’air frais me rentrait dans le nez. Plusieurs fois, avec d’autres garçons, à notre arrivée le matin, nous avons grimpé au sommet de cette montagne violette ; je me sentais fort. Tout autour il y avait la brume qui se déchirait. Et au loin, c’était l’infini.
Quand le soleil montait, il faisait de plus en plus chaud, le ciel devenait blanc et la poussière de la montagne d’asperges piquait les yeux et la gorge, un peu comme la fumée des gaz d’échappement le matin. Je buvais une ou deux gorgées de soda et cela passait. Les insectes commençaient à bourdonner. Des nuages de moucherons voletaient au-dessus de nous, il y avait aussi les mouches, les guêpes. Avec la ficelle, je faisais des bottes de vingt asperges. Deux tours de ficelles à la base de la botte et un tour de ficelle en haut. Je devais faire une botte toutes les minutes mais c’était facile et j’en faisais deux toutes les trois minutes, quarante à l’heure, trois cent soixante en une journée. Ensuite il fallait tremper les bottes dans des grands bidons de conservateur, et une fois qu’elles étaient sèches, ranger les bottes dans des boîtes plates en carton marron. Cent cinquante bottes par boîte. Fermer la boîte avec de la ficelle et empiler quinze boîtes. Ficeler les quinze boîtes avec de la ficelle. Charger l’ensemble sur une palette et ranger les palettes dans un container de cinquante mille boîtes. Chaque jour, nous préparions au moins quinze containers de cinquante mille boîtes. Deux cent vingt-cinq millions d’asperges. Nous étions plus de deux mille à faire ça sur la zone de conditionnement numéro un. Il y en avait sept.
À la fin de la journée, je descendais à l’intérieur du container et je rangeais les boîtes pour qu’elles soient bien calées. J’aimais bien ce moment-là parce que dans le container il n’y avait plus le bruit de l’extérieur, c’était plus calme et j’étais tout seul pour faire mes alignements. J’appréciais ces quelques minutes où je pouvais me concentrer et compter encore plus vite mes boîtes. Un jour, très fatigué – j’étais toujours épuisé en fin de journée –, je me suis allongé. J’avais ma bouteille de soda sur moi parce que je ne buvais que cela. Il n’y avait pas d’eau ici. J’ai bu une grande gorgée. C’était tiède. J’ai regardé la poussière de la zone de conditionnement qui volait au-dessus de moi en me demandant où pouvait bien aller toute cette poussière. Le soir, le ciel était violet et c’était très beau aussi. Les insectes semblaient voler moins vite. J’essayais de les compter. Mon père m’avait dit qu’ils ne vivaient qu’une journée et que chaque femelle pouvait pondre des milliers d’œufs. Ce soir-là, je calculais l’évolution du nombre de moustiques sur la zone de conditionnement si les insectes vivaient deux jours au lieu d’une journée. Je me suis assis, je me suis allongé, je me suis endormi.
C’est un bruit métallique sec et fort qui m’a réveillé. J’ai ouvert les yeux mais il faisait noir comme dans la nuit la plus noire. Au début, je n’ai pas réalisé où j’étais, et puis j’ai très vite compris que la grue venait de reposer le couvercle du container. Le soir, la grue reposait les couvercles sur tous les containers. Cette fois avec moi à l’intérieur, comme dans une boîte de conserve. J’ai appelé mon père et ma mère. Je ne le faisais jamais mais c’est venu naturellement. Mon cœur s’est mis à battre très vite. Personne n’a répondu à mon appel, je n’entendais que le ronronnement du moteur de la grue. Le container a vacillé et, cette fois, j’ai hurlé. Il a bougé dans tous les sens. Il y a eu un nouveau choc métallique. On installait le container sur un camion. Je savais très bien comment tout cela se déroulait. J’avais l’impression d’assister au départ du camion. J’avais regardé cela des dizaines de fois. Les camions qui partent à l’aéroport avec les containers, cela voulait dire que la journée était presque terminée, il n’y avait plus qu’à nettoyer la zone de conditionnement avec les grands balais, faire des tas, et repartir. Sauf que, cette fois, j’étais dans le container. Je me suis mis à pleurer. Une fois que le camion sortait de la zone de conditionnement, je n’avais pas la moindre idée d’où il pouvait aller. Même mon père n’aurait pas su me répondre. Pour la première fois, ma vie ressemblait à l’infini, quand les chiffres vont trop loin. J’avais peur.
Le voyage a duré longtemps. Je savais que cela allait être long parce que, les asperges, personne n’en mange dans la région. Il se dit qu’elles rendent aveugles, à cause du conservateur dans lequel nous les plongeons. Il fallait forcément les envoyer très loin, où des gens qui ne le savent pas les achètent. Parfois, nous en parlions sur la zone de conditionnement. Comme personne ne mangeait d’asperges, nous ne pouvions pas en être sûrs. Et puis, nous n’en étions pas fiers. Conditionner des asperges qui rendent aveugles ceux qui les mangent, ce n’est pas très reluisant. Nous n’étions pas à l’aise avec cette histoire mais bon, c’était la seule activité de la région et de toute manière nous n’en étions pas vraiment sûrs. J’allais loin, cela j’en étais sûr.
Au début, j’ai compté les secondes, les minutes, et les heures comme si j’avais une pendule dans la tête. Mais je me suis endormi à plusieurs reprises. Je me réveillais et j’avais soif. Même en buvant mon soda petite gorgée par petite gorgée, seulement quand ma gorge était trop sèche, ma bouteille a fini par être vide. Je me suis aperçu qu’il y avait des gouttelettes d’eau qui se formaient sur le couvercle du container. Sans doute une histoire de condensation, comme mon père me l’avait expliqué un jour, car il adorait la science et les phénomènes scientifiques. Il me suffisait de racler le métal avec le tranchant de ma main pour récupérer quelques gouttes, de quoi me désaltérer. L’eau avait un sale goût de fer. Sinon, j’ai eu froid, tout le temps. Je n’avais jamais eu froid comme cela, comme si mes os gelaient. J’avais mal aux doigts et mal aux pieds. Et cela, pas moyen d’y échapper. Au bout d’un long moment, j’avais tellement faim que je me suis décidé à ouvrir un carton d’asperges et à en croquer une, puis deux. Elles étaient très dures et ce n’était pas bon. Ensuite, j’ai compté jusqu’à sept cent quarante et j’ai été malade. Plusieurs fois. Puis j’ai dormi à nouveau. Quand je me réveillais, j’avais l’impression qu’on me tordait le ventre, je raclais un peu le couvercle du container pour m’hydrater comme je pouvais et je me rendormais.
C’est la lumière qui m’a réveillé. À ce moment-là, je commençais à faire de drôles de rêves éveillés où j’étais dans un récipient rempli d’asperges, j’étais un cube de cuisson comme celui que ma mère mettait dans l’eau pour faire de la soupe et je commençais à fondre, mais à ce moment-là quelqu’un a enlevé le couvercle de la casserole à asperges. J’ai respiré un air inconnu, j’étais loin.
Deux types m’ont sorti du container. Ils étaient grands et gras avec la peau très rouge. Et des petits yeux. Ils portaient une sorte d’uniforme vert avec une inscription jaune devant.
– Ça fait combien de temps que tu es là-dedans ? a demandé l’un des deux. Avant de répondre, j’ai senti son haleine horrible et je me suis dit qu’il fallait absolument que je réponde tout de suite, sinon il allait à nouveau parler et comme son haleine était épouvantable et que je ne me sentais pas en grande forme, cela allait mal tourner, j’allais m’évanouir et mes affaires n’allaient pas s’arranger.
Je leur ai raconté l’histoire, comment je m’étais assoupi dans le container à la fin de ma journée. Et le voyage. Ils m’ont écouté sans rien dire, ils avaient les yeux vitreux et seules leurs mâchoires bougeaient mais ils ne parlaient pas, ils se contentaient de mâcher. Et c’était mieux comme ça mais cela n’a pas duré.
– Tu travailles chez Will Smart ?