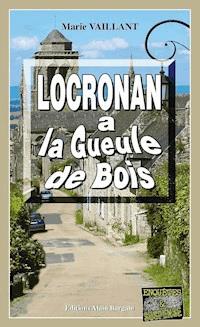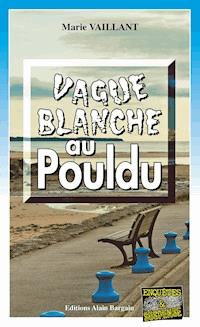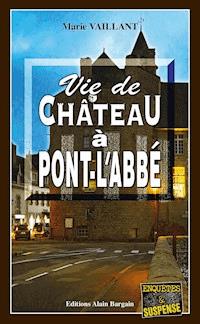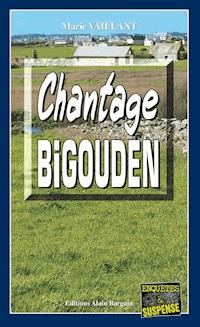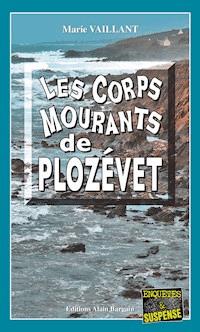
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Les meurtres s'enchaînent à Plozévet...
Parti pêcher le homard en baie d’Audierne, André Kerbelec est retrouvé mort, le lendemain matin. Un accident ? Puis Fanch découvre, sur le chemin de randonnée surplombant Pors Poulhan, le corps d’Antonio, un beau jeune homme qui sait tirer profit de son charme. Le même jour, Jeanine, l’épouse d’André Kerbelec, gît, empoisonnée, à son domicile. Cette fois, plus de doute… L’officier de police judiciaire Aubain doit élucider au plus vite cette série de meurtres qui inquiète la région de Plozévet…
Un polar dont l'enquête s'annonce corsée pour l'officier Aubain
EXTRAIT
Du jour au lendemain, Jeanine s’était retrouvée seule pour gérer la ferme. Quinze jours après la disparition d’André, encore étonnée de ce qui lui arrivait, elle ne parvenait toujours pas à se résigner à vendre ses terres. Le seul fait de l’envisager était pour elle un crève-cœur.
Certes, elle avait bien conscience qu’il ne lui servait à rien de s’entêter à œuvrer comme une bête de somme pour garder un cheptel et un patrimoine dont Erwan n’avait que faire. Cependant, l’atavisme paysan qui veut que l’on transmette ce que l’on a reçu, était encore bien ancré en elle et lui rudoyait la vie.
Lozacmeur s’était pourtant montré obstiné. Il était revenu à la charge et sans perdre de temps. À peine André était-il mis en terre qu’il renouvelait à sa veuve l’offre d’achat faite au défunt, trois ans auparavant. Il l’avait priée d’y réfléchir, mais n’avait obtenu en réponse que la vague promesse qu’elle y penserait.
Réfléchir, avait dit le promoteur. Elle l’avait perçu comme une injonction dérangeante, contrariante. Elle n’avait pas que cela à faire et ne s’y conformerait certainement pas.
À la vérité, Jeanine n’avait désormais plus le cœur de se projeter dans le futur. Elle se cramponnait comme une bernique à ses souvenirs, tous attachés à André et au hameau de Kerhat.
Au-delà d’une journée dont le programme était déjà trop chargé, l’avenir, cet inconnu, lui semblait menaçant. Elle voulait l’occulter et, pour n’y plus penser, elle s’abrutissait de travail.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Marie Vaillant est née et a grandi à Quimper. Peintre et sculpteur, elle a exposé à Pont-Aven et posé un calvaire à la pointe de Bellangenet, en Clohars-Carnoët.
À Tahiti, elle a travaillé la pierre locale pour l’évêché de Papeete. Voici quelques années, elle a troqué le ciseau du sculpteur contre la plume de la romancière pour signer aujourd’hui son troisième roman à suspense..
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« Rien ne m’est sûr, que la chose incertaine. »
François Villon.
REMERCIEMENT :
Merci à vous, amis qui parcourez ces pages.
ILA TETE DU MORT
André Kerbélec vivait à présent seul avec sa femme Jeanine dans une ferme située sur la commune de Plozévet. C’était un gars jeune encore, d’une stature athlétique, façonnée par les rudes travaux de la ferme. Il était doté d’un visage avenant et sympathique, avec toutefois la particularité d’un nez au bout bosselé et séparé en deux hémisphères esquissant la forme d’une cerise, d’une prune ou, comme disaient ses copains, d’une minuscule paire de fesses. Il avait été brun autrefois, comme tous les Bigoudens pure souche, mais sa tignasse ébouriffée par les vents soufflant de la mer, était à présent totalement blanchie.
Jeanine était plutôt jolie, svelte et vive malgré sa petite cinquantaine, brune encore, avec peut-être l’aide discrète de la chimie, des yeux clairs, bleus et rieurs. C’était une femme moderne dans sa façon de vivre et de s’habiller.
Ils vivaient tous deux paisiblement, confiants l’un en l’autre et sans se poser trop de questions ; surtout pas de celles pour lesquelles ils n’avaient pas de réponse. Ils s’aimaient bien aussi, simplement, sans emballement, et semblaient heureux d’être ensemble. Selon le voisinage qui s’autorisait des jugements hâtifs, il n’y avait jamais eu entre eux ce que l’on appelle le coup de foudre. Par ailleurs, chacun convenait que ce n’est pas non plus la condition idoine pour fonder le foyer durable que recherchaient André et Jeanine en se mariant.
La vérité était qu’ils avaient la délicate pudeur des Bigoudens et qu’ils avaient toujours discrètement gardé leurs élans amoureux pour l’intimité de leur foyer.
Les bâtiments de leur exploitation étaient anciens, solidement construits d’épais murs de granit qui s’élevaient en une équerre adossée aux vents dominants, face à une maison d’habitation avenante et fleurie.
Les propriétaires reconnaissaient que la chance les avait comblés en les mettant en bonne place dans le magnifique décor de la baie d’Audierne. Aussi se montraient-ils discrets, pour ne pas éveiller les jalousies qui, comme chacun le sait, ont le sommeil léger.
Leur domaine n’était pas le plus étendu du secteur, mais il occupait un emplacement privilégié sur le versant, face à la mer. Ils avaient là, s’étirant depuis Kerhat jusqu’à Menez Gored, une trentaine d’hectares bien exposés, constitués de bois, de taillis et de belles terres arables qui suffisaient amplement à produire l’alimentation de leur bétail. Ils faisaient profession d’éleveurs en usant encore de méthodes artisanales – enfin presque. Leur vie était rythmée par les saisons et les soins quotidiens à porter aux bêtes. Leur cheptel, composé de porcs, de poulets et de taurillons à l’engrais dans les prés, était assez important pour occuper leurs journées.
Ils n’avaient conçu qu’un fils, Erwan, qu’ils avaient à peine eu le temps de voir grandir que, déjà, il larguait les amarres. De collège en lycée, d’école préparatoire en Centre Hospitalier Universitaire, le gamin était toujours absent et les liens familiaux s’étaient distendus avant même que d’avoir eu le temps de se tisser. Ils n’avaient pas vraiment eu le loisir de faire connaissance. Son père s’interrogeait parfois sur la pertinence de faire tant d’études pour un métier si exigeant qu’il vous empêche de vivre. Perdre sa vie à la gagner ne lui semblait pas digne d’une intelligence supérieure.
L’unique descendant des Kerbelec devait avoir un petit grain de masochisme pour être allé à Rennes s’enfermer avec des malades. Il s’était ainsi privé du spectacle grandiose d’une mer changeante, parfois même capricieuse et dont, selon les saisons, les colères sont aussi magistrales que celles d’une diva.
Il avait troqué une vie saine au grand air contre un concentré de souffrances. Erwan était médecin, jeune diplômé du service de cardiologie au CHU de Rennes.
Désormais, il appartenait à un monde assez éloigné de celui dans lequel vivaient ses parents. Aux antipodes, pourrait-on dire. Déjà, à l’époque de son internat, l’établissement offrait quelques similitudes avec une fourmilière, tant les patients étaient nombreux, et cela ne s’était pas calmé au fil du temps. Il semblait même que Pontchaillou fût devenu le lieu de rendez-vous privilégié de toute la population du Centre-Bretagne, ce qui donnait à penser que nous n’étions plus, désormais, qu’un peuple de malades.
Autrefois, avant l’hégémonie de la chimie et l’avènement de la Sécurité Sociale, il n’était pas tant besoin d’étudier pour soigner son prochain. Pour autant, les populations ne s’en portaient pas plus mal. À part quelques rhumatismes, les anciens qui avaient connu cette époque pouvaient même se targuer d’être sains et en bonne santé, tout au moins physique. Le louzoù1 universel tenait en un coup de gnole qui, aujourd’hui, pulvériserait sans hésiter la totalité des alcootests des commissariats et gendarmeries de tout le territoire français. Pas un virus, pas un microbe n’y résistait. Pour les neurones, il fallait juste leur laisser le temps de s’en remettre et ne pas abuser de la prescription. Actuellement, pour connaître notre groupe sanguin, il faut d’abord trouver un spécialiste apte à séparer l’hémoglobine de tout le potage chimique qui circule dans nos vaisseaux. Il est certain que la Sécurité Sociale ferait d’énormes économies en distribuant gratuitement le livre de Jules Romain. Knock, vous connaissez ? C’est un ouvrage de salubrité publique.
André et Jeanine avaient depuis longtemps compris que leur fils ne reviendrait jamais à Plozévet, et le pire qu’ils pouvaient en dire, c’était qu’il ne multipliait pas les occasions de leur rendre visite. Il leur arrivait même de penser à lui comme ils l’auraient fait d’un concept, possible mais de moins en moins probable. Erwan s’était envolé sur son tapis de diplômes, et le vent d’ouest l’avait poussé en direction de Rennes. Il vivait désormais dans une sphère inconnue de ses géniteurs, mais qui leur semblait redoutable et qu’ils jugeaient préférable d’éviter.
L’homme accompli qu’il était devenu n’avait plus besoin de ses parents et, manifestement, il pensait que c’était réciproque.
Aussi, parfois, lorsque la marée était propice, André Kerbelec ouvrait une courte parenthèse dans les travaux de la ferme afin d’oublier l’indifférence apparente de son grand garçon devenu docteur. Il troquait son outillage agricole contre ses accessoires de plongée, puis il mettait en route le compresseur qui lui servait à gonfler la petite chambre à air sous laquelle était arrimé un casier, servant de vivier flottant en cas de capture. Il chargeait le tout dans la petite fourgonnette qu’il avait récemment acquise auprès des Domaines et partait vers la côte par le chemin des goémoniers. Habituellement, il s’adonnait à la pêche aux homards dans les rochers, depuis Pors Poulhan jusqu’aux falaises de Kerbouron.
Cependant, depuis le début de la saison, il s’obstinait à se cantonner à un endroit précis, parmi ceux de Porzambréval. Une soudaine lubie, semblait-il, qui eut tôt fait d’être relevée par les autres pêcheurs et qui ne manqua pas de les intriguer. Étrangement, pour s’en expliquer, il prétendit que l’endroit était le plus intéressant des gisements parmi ceux qu’il connaissait, bien qu’ils sachent tous, à présent, qu’il n’y avait fait aucune prise depuis des semaines.
Kerbelec serait-il devenu précocement sénile ? Le fait est qu’il se comportait bizarrement, ces derniers temps.
Sur la côte, avant de trouver le sable, il y a, s’étirant tout au long du rivage, un cordon de galets nomades à franchir. La mer s’y fait les dents, les déplace, les disperse ou les regroupe inlassablement, selon son humeur. André avait toujours pensé que le moment favorable à la chasse aux crustacés se situait en fin d’après-midi, lorsque le jusant est bien amorcé. Les flots, en se retirant, donnent alors accès aux amas de rochers entre lesquels plongent les pêcheurs.
C’est aussi le moment où les arthropodes en quête de nourriture sortent faire leur marché. André constatait, chaque fois, qu’ils se faisaient de plus en plus rares. Là aussi, la crise sévissait.
Aussi, en homme soucieux de préserver l’avenir, Kerbelec se limitait aux quelques prises destinées à ses besoins privés. Ces derniers temps, il n’en prenait même plus du tout car, en réalité, dans l’intérêt qu’il portait à ces parties de pêche, les homards passaient au second plan. Ils n’étaient plus qu’un alibi jeté en pâture à la curiosité des gars de la côte et qui les faisait marrer au vu des résultats qu’il obtenait.
Il laissait dire ; il laissait rire.
Ce que pêchait André Kerbelec avec autant d’opiniâtreté, avait autrement de valeur que les quelques crustacés qu’il pouvait prendre, et tenaient en moins de place. Une simple pochette, amarrée à sa ceinture et qu’il dissimulait à l’intérieur de son vêtement de plongée en ressortant de l’eau, pouvait contenir ses prises du jour. Voici déjà quelque temps qu’en toute discrétion, il s’était reconverti à la chasse au trésor. Nul ne partageait son secret, pas même Jeanine dont il n’était pas certain qu’elle sache longtemps rester discrète.
Son butin serait leur assurance-vieillesse à tous les deux.
À environ trois mètres de profondeur, à marée basse, des lambeaux de cuir rongés par le sel avaient, un beau jour, attiré son attention. Ils étaient coincés entre deux rochers et leur état indiquait qu’ils y étaient depuis belle lurette. Lorsqu’il avait tiré dessus, il avait ramené quelques pièces en or d’une vieille monnaie dont il ne s’était toujours pas inquiété de connaître la valeur marchande. Il attendait qu’il n’y en ait plus sous le sable avant de les faire évaluer.
Il ne s’était pas non plus interrogé sur l’identité de l’épave qui lui livrait un tel cadeau. Chaque chose en son temps, à chaque jour suffit sa peine.
En revanche, ce qu’il savait, c’est que depuis des siècles, la baie servait de cimetière à bon nombre de bateaux que la mer avait drossés sur les récifs. Sans compter les vaisseaux qui, venus de loin y livrer bataille, se faisaient “glorieusement” envoyer par le fond, comme le “Droits de l’homme” ou le HSM “Amazon”. Ils avaient souvent le ventre plein, les coffres bien garnis, et nul, découvrant un tel trésor, n’aurait eu la sottise de refuser la chance qui s’offrait à lui.
Il y avait sûrement prescription.
André Kerbelec n’était pas le seul pêcheur sur le secteur, d’où sa discrétion. Pierre Le Gwenn y venait aussi. Mais lui, il possédait une barque à moteur qui lui permettait d’aller plus au large. Il ne pêchait pas uniquement en apnée, mais aussi de façon artisanale, pour ainsi dire, avec des casiers. Peut-être serait-il sage de ne pas divulguer le fait qu’il fournissait discrètement les restaurants de la région… En règle générale, les gens d’ici ne manquent ni de sagesse ni de générosité et, tant qu’ils étaient entre honnêtes gens, le contrevenant pouvait tranquillement continuer à exercer son activité prédatrice sur fonds marins.
L’homme était physiquement massif, il s’en dégageait une impression de force dont la nature bestiale semblait confirmée par un visage fermé, totalement inexpressif. Nul ne savait ce qu’il avait en tête, ni même s’il y avait quelque chose dedans. Il habitait à Scantourec, non loin de son lieu de pêche, dans une petite maison tout en pierre, dont la vocation, depuis l’origine, était d’héberger un pêcheur. Ses abords ressemblaient à un dépotoir de vieux casiers, de barques disjointes et de voitures défuntes. Il y avait encore bien d’autres dépouilles, semées dans le jardin, entre lesquelles serpentait un petit bout de sentier qui menait à l’entrée de la bicoque. C’était là un agencement qui donnait entière satisfaction à la nature frustre de Le Gwenn. Il avait ainsi sous la main toutes les pièces détachées dont il pourrait éventuellement avoir besoin, si l’envie lui venait de bricoler. Il ne l’avait jamais fait, mais sait-on jamais ? Il vivait seul, tout seul, et la majorité du temps, cette compagnie lui suffisait.
Il y avait également, depuis quelques jours, un autre homme qui venait sur cette portion de côte, et personne ne savait d’où il était ni ce qu’il voulait. Il n’était sûrement pas d’ici car il avait le poil rouquin et triste. Cela suffisait pour le mettre en observation pendant quelque temps, avant de l’adopter, éventuellement. L’inconnu se tenait assis, immobile au creux des rochers, face à la mer. Il semblait observer les pêcheurs. Ce n’était ni un touriste ni un pêcheur, car plus loin, un petit monospace gris clair, immatriculé dans le Finistère, était garé sur l’accotement de la route « du vent solaire »2. Il n’était pas connu des habitants du bourg, sauf peut-être de ceux qui, rentrant du travail, passaient par là régulièrement en fin d’après-midi. Mais ils auraient été bien en peine d’en identifier le conducteur.
Ce soir-là, André Kerbelec avait laissé passer l’heure à laquelle il rentrait habituellement. Il était allé jusqu’au bout du filon, pas une seule pièce n’avait pu se soustraire à ses recherches. Pourtant, peut-être par habitude, il avait précautionneusement attendu que le nuage de sable qu’il soulevait pour mettre à jour ses précieuses trouvailles fût retombé, puis, ses fouilles terminées, une poussée du pied l’avait ramené à la surface, toujours au même endroit.
Ce fut la dernière fois. Sa tête affleurait à peine de l’océan qu’il reçut, sur le sommet du crâne, un coup violent, du genre qui fait mal, très mal, même porté sur la tête d’un Breton.
Il n’eut pas le temps de reprendre sa respiration ni même de comprendre ce qui lui arrivait. Ses poumons étant vides, il se maintint quelques instants entre deux eaux, puis, selon les prévisions de son meurtrier, il coula.
Là-bas, vers l’ouest, tout au bout de la terre, indifférent aux drames humains, un soleil hilare contemplait son image cramoisie surfer sur les rides de l’océan.
Simultanément, venant de la direction de Pors Poulhan, on pouvait voir au loin deux randonneurs, un homme et son chien, marchant le long de la côte.
L’homme n’était autre que notre ami Fanch, Fanch Le Berre. Il était retraité, mais toujours gaillard, avec le pas encore vif ; sa silhouette ne s’était qu’à peine épaissie au fil des années. Fanch avait toujours sa casquette de marin vissée sur la tête lorsqu’il parcourait, été comme hiver, les chemins côtiers de sa région. Du nord au sud, ses pas le conduisaient en quelque aimable penty où il savait que l’accueil qui lui était réservé ne manquerait pas de chaleur humaine.
Fanch savait savourer les bons moments de la vie. Paotr aussi, certainement, mais le canidé était trop jeune pour prétendre à la retraite, il était toujours en pleine activité. Il y a peu de temps encore, lorsqu’ils s’étaient rencontrés, il n’était qu’un galvaudeux, un réfugié sans papiers, un SDF souffreteux.
Ce fut, au hasard d’une balade, une des plus belles rencontres qu’ils avaient pu faire, l’un comme l’autre. Une fulgurance réciproquement ressentie ressuscita chez Fanch le sentiment d’une tendresse endormie et permit à l’épagneul de gravir quelques échelons de l’échelle sociale, ce qui pour un quadrupède, avec ou sans pedigree, n’est pas chose aisée.
Avec la fonction d’animal de compagnie – une belle promotion dans sa vie de chien – Paotr faisait une carrière enviable dans la maison de Fanch.
Il jouissait d’une grande liberté, sauf le soir, lorsque le patron fermait boutique. L’harmonie de leur vie commune reposait sur le respect mutuel et l’adhésion aux règles qui régissent la profession. Aussi, conscient de l’importance de la mission qu’il se devait d’assumer, Paotr promenait quotidiennement son copain bipède sur les chemins de randonnée. Il connaissait chacune de ses destinations, surtout celles d’où son patron lui ramenait des friandises, mais pas seulement, il savait d’instinct que son camarade avait atteint l’âge où il est essentiel de se maintenir en forme, et reconnaissait volontiers y avoir quelque intérêt.
Ils vivaient tous deux – le moins souvent possible – dans une petite maison qui semblait avoir poussé là, sur la lande, de façon spontanée et sauvage, un peu à l’écart du bourg. C’était une bâtisse esseulée, qui, vaille que vaille, assumait sa vie solitaire. Personne n’en prenait soin, et nul ne l’agressait à part le chien qui lui apposait chaque jour l’estampille de propriété privée, interdite aux autres clébards. Désormais, Paotr estimait en être le propriétaire, puisque jamais à sa connaissance, Fanch ne l’avait revendiquée comme telle avec aussi peu d’ambiguïté.
En dehors de ces deux-là, la bicoque n’avait de contact qu’avec le vent qui venait des quatre points cardinaux la harceler sans répit, et les mouettes effrontées qui, parfois, et sans vergogne, se délestaient sur sa coiffe en passant.
Le “GR 34” était la promenade favorite des deux compagnons, tout au long des mois d’hiver. La mer s’y donne parfois en spectacle. Un spectacle souvent époustouflant et qui décoiffe, comme disaient autrefois et fort à propos les Bigoudènes. Les jeunes qui ne se soucient pas toujours du sens des mots, font aujourd’hui, à tort ou à raison, perdurer l’expression.
Cependant, nous étions déjà près de la fin juin et, bientôt, le chemin de grande randonnée serait trop fréquenté pour y trouver la sérénité souhaitée. Il faudrait alors qu’ils se trouvent une autre promenade, moins prisée des estivants.
Le GR 34 avait aussi l’avantage de mener aux environs de la maison où vivait une veuve pleine d’agrément aux yeux de Fanch. Il la connaissait de longue date, en raison de son mariage avec l’un de ses amis, décédé aujourd’hui, et savait ainsi à qui il avait affaire. Elle était accueillante, gardait encore belle apparence et les visites qu’il lui faisait de temps à autre, enjolivaient sa retraite.
Il convenait volontiers que la dame en question avait autrement de charmes que la femme qu’il avait autrefois épousée, par erreur certainement, et qui lui avait gâché la vie durant près de trente ans. En prenant de l’âge, celle-ci avait acquis quelques rondeurs fort sympathiques, cependant que sa défunte taulière s’était desséchée au fil des ans. Sa belle amie vivait dans un petit hameau, un peu avant Pors Poulhan en passant par la rue de l’Océan. Ce soir-là, elle l’avait retenu avec une tasse de café et une monstrueuse portion de quatre-quarts sur laquelle il avait discrètement prélevé la part de Paotr.
Décidément, la vie était belle et la veuve qu’il venait d’honorer, avait bien des attraits.
Ce soir-là, Fanch était en retard sur ses horaires habituels. En rentrant, il aperçut la barque de Le Gwenn danser sur les vagues, mais cette fois, elle était ancrée un peu plus loin qu’elle ne l’était ces derniers temps, vers le nord, tout en bout de la pointe rocheuse qui s’enfonce dans l’océan. Le Gwenn venait de changer de terrain de chasse. Il n’aimait probablement pas les indiscrets.
Le pêcheur était penché à bâbord et scrutait attentivement les fonds marins. Il semblait très occupé, probablement à positionner un casier dont il surveillait la descente.
Kerbelec n’était pas visible dans son secteur habituel, il devait être au fond. En revanche, la petite fourgonnette bleu marine était toujours là, ce qui confirmait qu’il était encore dans les parages.
Ils étaient en retard, eux aussi, mais sûrement pas pour la même raison que celle qui mettait Fanch de si joyeuse humeur.
Ce n’était pas le cas du rouquin inconnu. Fanch Le Berre avait déjà eu l’occasion de l’entrevoir lors de ses promenades avec Paotr. Il était venu comme d’habitude et, probablement, était-il reparti comme de coutume, à la même heure. Il semblait respecter un horaire précis. Loin déjà, sur la route du vent solaire, son véhicule monospace suivait une file de voitures qui s’éloignait doucement en direction de Pont-L’Abbé. Il devait y avoir un bouchon au carrefour. Fanch n’avait jamais pu réellement voir le visage du conducteur. Juste sa tignasse fanée. Pour le reste, il n’en connaissait que sa silhouette accroupie, parfois aperçue dans les rochers.
Plus loin encore, mais en remontant vers le bourg, route de la Corniche, le retraité croisa et salua Almeida qui passait au volant de son petit camion gris et poussiéreux. Almeida était maçon et portugais, ce qui n’est pas incompatible. Il œuvrait modestement dans la région en faisant des murs de clôture, des terrasses et diverses réparations ou restaurations. Il jouissait d’une bonne réputation, dont ne bénéficiait pas son fils Antonio. Un “pas grand-chose”, à ce qu’on en disait.
En dépit de ce détail décevant, il avait toujours l’air content, le Portugais. Il avait un heureux tempérament. Sa petite entreprise fonctionnait gentiment, et quand les commandes s’espaçaient un peu, il acceptait les sous-traitances que lui procurait un entrepreneur de Douarnenez. Un nommé Lozacmeur chez qui il avait autrefois travaillé, quand, fuyant le marasme économique de son pays d’origine, il s’était accroché au littoral sur lequel il avait été drossé. Il n’avait pas un escudo en poche à l’époque, ce qui ne l’avait pas empêché de faire son petit bonhomme de chemin. Il en était aujourd’hui très fier, et plus heureux encore.
À cette période de vaches maigres avait succédé le “boom” de l’immobilier qui avait incité Roger Lozacmeur à passer à la vitesse supérieure. Il s’était associé à un cabinet d’architectes et voilà qu’à présent, il s’était auto-promu promoteur. On n’est jamais si bien servi que par soi-même. Il était l’un de ceux qui, depuis quelque temps, convoitaient les terres des Kerbelec pour en faire un complexe touristique.
Une grosse opération, annonçait-il.
Antonio l’avait entendu en parler à son père comme d’une affaire susceptible de lui valoir de bonnes retombées. « À condition toutefois que les fermiers veuillent bien vendre », avait-il précisé. En naïf qui ne savait pas où il mettait les pieds, Antonio s’était vanté « d’enlever aisément le morceau » si toutefois l’entrepreneur reconnaissait la valeur de ses services.
Lui aussi aurait aimé réaliser une bonne opération.
Il avait pour cela quelques atouts dans son jeu, comme l’appui de personnes judicieusement réparties dans l’entourage de Lozacmeur. La comptable n’était autre que sa jeune sœur Adelina, et Carole, l’épouse que Roger Lozacmeur négligeait avec tant de constance, était depuis quelque temps devenue sa maîtresse. De plus, et pour faire bonne mesure, il connaissait Jeanine Kerbelec depuis l’enfance et son fils Erwan était son ami depuis la maternelle.
Toutes personnes biens disposées à son égard.
Ainsi donc, si quelqu’un était de taille à mener l’affaire, c’était bien lui.
De son côté, Lozacmeur s’était montré évasif. Ce garçon n’était qu’un éternel adolescent à ses yeux. Il estima préférable d’ignorer l’offre et la façon dont le jeune homme comptait s’y prendre pour parvenir à ses fins.
Il trouverait bien, dans le métier, quelqu’un d’autrement plus sérieux pour négocier cette affaire.
La ferme des Kerbelec pourrait en effet rapporter une petite fortune à celui qui la ferait lotir, à la condition d’en faire l’acquisition, sans attendre une inévitable flambée des prix, et d’obtenir le permis de construire. À l’ouest du bourg, les champs descendent doucement en direction de la mer et le regard porte aisément jusqu’à la côte. La vue y est superbe, exactement le genre de bien que s’arrachent les touristes.
Les concurrents de Lozacmeur, qui briguaient ces terres depuis quelques années, s’étaient toujours heurtés à une fin de non-recevoir de la part des fermiers. Les Kerbelec n’avaient aucune raison de leur faire plaisir, leurs terres étaient fertiles et des quotas laitiers y étaient associés. Ils bénéficiaient de la fameuse PAC et la totalité des arpents dont ils étaient propriétaires constituait la surface indispensable au périmètre d’épandage du lisier. Les agriculteurs avaient à peine dépassé la cinquantaine, ils avaient toujours vécu sur ces terres et entendaient y rester jusqu’à la fin de leurs jours.
C’est là un vœu légitime mais qui, parfois, allez savoir pourquoi, se réalise plus vite et de manière moins paisible que celle envisagée.
Nul ne devrait présumer du sort qui lui est concocté.
Ce soir-là, comme à chaque fois, Kerbelec était parti en annonçant le menu du lendemain :
— Prépare le nécessaire pour ta sauce, avait-il dit à sa cuisinière favorite, on mangera du homard à l’armoricaine, demain midi.
Nul ne le faisait mieux qu’elle et, au moins, ils savaient tous deux ce qu’ils avaient dans leur assiette.
— Bonne chasse ! avait répliqué Jeanine avec un sourire indulgent.
Elle s’était acquittée de la mission qui lui était confiée, avait vérifié qu’aucun des ingrédients nécessaires à sa recette ne lui ferait défaut au cas – devenu improbable ces derniers temps – où il attraperait quelque chose, puis elle s’était occupée du repas du soir. Brutus, le vieux chien, ainsi nommé par dérision, en raison de son tempérament débonnaire, s’était déjà occupé du sien. Il avait goulûment nettoyé sa gamelle, s’était pourléché les babines et, satisfait, s’était laissé choir sur sa paillasse avec un énorme soupir de satisfaction.
Au moins, celui-là ne risquait pas de déserter la maison.
Puis Jeanine avait patiemment attendu le retour du pêcheur, en veillant à ce que sa tambouille ne refroidisse pas. Elle avait longtemps attendu, trop longtemps. Même le chien qui veillait d’un œil intermittent sur sa maîtresse, paraissait à présent inquiet.
Il n’avait jamais été dans les habitudes du gars André de se faire tant attendre.
Ce ne fut que vers les dix heures du soir, alors que la nuit tombait, qu’elle se décida à appeler le maire.
Alors, comme porté par l’aile noire du malheur, le bruit avait couru dans toutes les rues de Plozévet, que Kerbelec n’était pas rentré.
Le fait avait de quoi surprendre les hommes du bourg. En cette saison, la mer était toujours calme et André connaissait l’endroit mieux que personne. C’était son lieu de pêche favori ; depuis le début de la saison, il n’en avait pas changé, les copains l’avaient assez “chambré” à ce propos.
— Tu devrais quand même leur laisser le temps de se reproduire ! Tu vois bien que tu n’en prends plus ! lui avait-on recommandé, sans qu’apparemment, il ait jugé bon de suivre le conseil. Un conseil qu’il était seul à savoir inutile… Il est rare que des prises du genre de celles qu’il prélevait dans l’océan, se reproduisent spontanément.
La nouvelle atteignit Fanch au bar “Chez Michel”, qu’il avait réinvesti voici quelques mois. Son chagrin avait vieilli, tout comme lui3. Il pensait un peu moins souvent au suicide de Clément et plus personne ne lui en parlait. Ils semblaient tous l’avoir oublié.
Il s’était spontanément joint, et Paotr avec lui, à ceux qui s’étaient rassemblés autour des gendarmes pour explorer la côte. Il était trop tard pour organiser des recherches en mer et l’exploration des rochers s’avérait dangereuse. Ils n’avaient retrouvé le corps de Kerbelec que le lendemain matin, au jusant. La mer l’avait déposé plus au nord, sur un lit de goémon de la petite plage de Prat-Meur, et en haut, dans l’impasse, sa camionnette bleu nuit persistait à l’espérer encore.
Le malheureux avait le crâne enfoncé et les gendarmes chargés de l’enquête avaient rapidement imputé la blessure à la violence du ressac. Hâtive conclusion d’une mort accidentelle, proposée par le docteur Briand et confirmée par les statistiques localement réalisées sur le sujet. Il s’en produit de temps à autre le long de la côte, mais presque toujours ce sont des touristes qui sont impliqués ; les gens du cru, même pintés, surtout pintés, ne s’aventurent pas sur les rochers, le soir, à marée descendante.
Derrière la cravate, ils ont déjà de quoi déraper.
Bien sûr, parmi les habitants présents, il n’y en eut pas un qui fut convaincu par cette explication un peu trop simpliste à leur goût ; surtout que le coup porté sur le sommet du crâne était la seule blessure sérieuse que l’on pût relever sur la dépouille.
Aucun d’entre eux ne fit de commentaire et le rapport de gendarmerie ne mentionna ni la pochette d’André ni son contenu qui avaient disparu.
Un peu plus tard, alors qu’ils s’en revenaient vers le café de Michel, Le Gwenn leur expliqua que, la veille au soir, lorsqu’il avait remonté son dernier casier, il n’avait pas vu Kerbelec et que, tout naturellement, il avait cru qu’il était parti. Comment aurait-il pu se douter, alors qu’il ramenait sa barque au mouillage de Pors Poulhan, qu’il venait de lui arriver malheur ?
Et chacun put en déduire qu’il ne tenait pas non plus à se faire repérer : son activité n’avait pas l’absolution du fisc.
Fanch fit silence sur le fait qu’il aurait dû voir, en dépit de la hauteur des roseaux, la voiture de Kerbelec toujours garée au fond de l’impasse qui bute sur le chemin de grande randonnée. Tout de même, il leur fit observer que, selon lui, il aurait fallu qu’André Kerbelec fût sacrément motivé, pour obtenir tout seul un pareil résultat. D’autant qu’il n’y avait dans le secteur aucun promontoire duquel se jeter, la tête la première et à la verticale, sur les rochers. C’est le genre de facéties qu’ont parfois illustrées Uderzo et Goscinny, mais qui ne sont que très rarement mises en œuvre par les pêcheurs de homards. D’autre part, on ne connaissait chez André Kerbelec aucune velléité suicidaire.
— Et puis, dit-il encore, il y avait aussi ce type entre les rochers, qui vous épiait depuis quelque temps. Qu’est-ce qu’il voulait ?
— Ah ça ! Va savoir !
Cependant, les jours suivants, Fanch remarqua que le monospace de l’inconnu ne stationnait plus le long de la route côtière. Ce détail l’amena à une téméraire extrapolation : il fit mentalement le rapprochement entre la présence du rouquin, propriétaire du véhicule, et les parties de pêche de Kerbelec.
1 Médicament.
2 Route du vent solaire, ainsi désignée par Pierre-Jakez Hélias en raison des nombreux changements d’orientation du vent.
3Chantage Bigouden, même auteur, même collection.
IIQUE LA TERRE EST BASSE !
Du jour au lendemain, Jeanine s’était retrouvée seule pour gérer la ferme. Quinze jours après la disparition d’André, encore étonnée de ce qui lui arrivait, elle ne parvenait toujours pas à se résigner à vendre ses terres. Le seul fait de l’envisager était pour elle un crève-cœur.
Certes, elle avait bien conscience qu’il ne lui servait à rien de s’entêter à œuvrer comme une bête de somme pour garder un cheptel et un patrimoine dont Erwan n’avait que faire. Cependant, l’atavisme paysan qui veut que l’on transmette ce que l’on a reçu, était encore bien ancré en elle et lui rudoyait la vie.
Lozacmeur s’était pourtant montré obstiné. Il était revenu à la charge et sans perdre de temps. À peine André était-il mis en terre qu’il renouvelait à sa veuve l’offre d’achat faite au défunt, trois ans auparavant. Il l’avait priée d’y réfléchir, mais n’avait obtenu en réponse que la vague promesse qu’elle y penserait.
Réfléchir, avait dit le promoteur. Elle l’avait perçu comme une injonction dérangeante, contrariante. Elle n’avait pas que cela à faire et ne s’y conformerait certainement pas.
À la vérité, Jeanine n’avait désormais plus le cœur de se projeter dans le futur. Elle se cramponnait comme une bernique à ses souvenirs, tous attachés à André et au hameau de Kerhat.
Au-delà d’une journée dont le programme était déjà trop chargé, l’avenir, cet inconnu, lui semblait menaçant. Elle voulait l’occulter et, pour n’y plus penser, elle s’abrutissait de travail.
Désormais, elle n’avait plus le temps de ressasser ses chagrins, et, d’ailleurs, il n’en était nul besoin, ils étaient constamment présents, fidèles comme son ombre, démultipliés à l’infini et, sans relâche ni répit, ils lui tenaient compagnie.
Désormais, les soins au bétail passaient avant tout, même avant ceux qu’elle devait à sa propre personne.
Voici quelques jours, elle en était tout de même arrivée à la conclusion qu’à l’avenir, il vaudrait mieux qu’elle ne reprenne plus de porcelets ni de poulets à engraisser. Il lui suffisait bien de mener à terme ceux qui peuplaient ses bâtiments. Des taurillons peut-être, elle verrait.
La mort d’André avait creusé un vide immense dans son univers familier, un vaste cratère au bord duquel, parfois saisie de vertige, elle tentait vaillamment de se maintenir.
Depuis le jour du drame, seul Le Gwenn lui avait rendu une amicale visite, en fin de matinée, la semaine passée. Il venait lui proposer son aide, disait-il, comme s’il s’excusait de ne pas avoir su empêcher le malheur d’arriver. L’idée d’accepter la proposition n’effleura même pas la fermière : il n’était pas agriculteur et elle n’avait pas le temps de l’initier au métier. Néanmoins, elle le remercia et lui affirma que tout allait bien.
— Ne vous inquiétez pas, Le Gwenn, je peux encore gérer. Dans dix ans, ce ne sera peut-être plus le cas, mais pour l’instant, ça va !
Dix ans… Que serait-elle alors ? Et pourquoi pas cent ans ? De telles notions lui étaient devenues tellement abstraites qu’à présent, elle n’en mesurait plus les valeurs.
— Tant mieux ! J’avais peur que vous ne puissiez faire face.
— Voulez-vous visiter l’exploitation ?
Ensemble, ils avaient fait le tour du propriétaire. Elle lui avait montré les élevages porcin et avicole, mais uniquement depuis le seuil des bâtiments, en raison de possibles contaminations. Elle lui avait aussi désigné au passage les taurillons à l’engrais dans un pré, puis, sans façon ni chichis, elle l’avait invité à prendre l’apéro sur un coin de table, sous le cerisier de la cour.
— Je peux vous proposer un pastis, un crémant d’Alsace ou une bière, au choix, avait-elle aimablement précisé.
Le Gwenn avait choisi un pastis. Cela tombait à merveille, la bouteille était largement entamée.
— Avec ou sans eau ?
— Avec, bien sûr !
Elle les avait servis sans refermer le flacon, comme une invite à récidiver, au cas où elle n’y aurait pas mis la dose convenable, puis elle avait ouvert un paquet de cacahuètes.
— Ce sera plus facile dans une coupelle, avait-elle fait remarquer tout en transvasant les graines d’arachides dans un récipient.
Il lui avait raconté les quelques ragots du bourg, tenté quelques prévisions météorologiques et touristiques, puis il avait décliné l’offre d’un second verre et s’en était allé, l’ayant considérablement retardée dans son emploi du temps.
En dépit de ses affirmations, les soins au bétail lui prenaient toutes ses journées et elle allait certainement devoir solliciter les voisins pour les traitements phytosanitaires des maïs. Ils étaient déjà hauts, mais tous les paysans savent que la manipulation des pesticides est une affaire de pros… Pour être tout à fait honnête, Jeanine devait s’avouer que ces produits l’inquiétaient.
Il n’y avait pas que les traitements chimiques qui lui faisaient peur depuis la mort d’André. La solitude aussi lui faisait peur, surtout lorsque descendait la nuit. L’angoisse l’étreignait chaque soir depuis bientôt une semaine, et elle fermait les portes et volets qui restaient sans verrouillage lorsqu’André était à ses côtés. Elle qui n’y prêtait jusqu’alors aucune attention, guettait à présent les bruits furtifs qui se produisent nuitamment autour de la maison. Elle identifiait bien, et Brutus aussi, ceux que provoquaient les bêtes lorsqu’elles sortaient du bois tout proche et se promenaient dans l’obscurité, mais les sauvagines auxquelles elle était habituée, n’utilisent pas de torche et ne jurent pas lorsqu’elles trébuchent.
À n’en pas douter, un nouvel intrus venait fureter alentour ; un homme à en juger par le son de sa voix, un maraudeur.
À quoi pouvait-elle s’attendre de la part d’un maraudeur ?
Celui-ci était déjà venu deux fois. Deux nuits de suite, comme s’il cherchait quelque chose, et son insistance indiquait qu’il ne craignait pas la confrontation avec le propriétaire des lieux.
Vraisemblablement, cet individu était quelqu’un de la région et, par conséquent, il savait qu’il avait affaire à une femme seule.
Que voulait cet énergumène ? Ce n’était pas après le bétail qu’il en avait, il l’aurait déjà trouvé, ni après le tracteur et autres matériels agricoles ; ils se voyaient sous le hangar, comme le nez rouge d’un clown en pleine représentation. Mais, pour savoir ce qu’il cherchait, il faudrait qu’elle ait l’audace – ou l’imprudence – de sortir le lui demander.
Elle aurait alors bien de la chance s’il se sauvait sans demander son reste. Toutefois, elle savait que les plus gros risques encourus étaient qu’il s’en prenne à elle et que ce soit lui qui l’oblige à dire où se trouvait ce qu’il cherchait.
Jeanine ne se sentait pas de taille à affronter un inconnu, seule et dans le noir. Alors, comme une petite fille effrayée, elle se pelotonnait au fond de son lit et attendait que l’homme s’en aille. Jusqu’à présent, il n’avait pas encore tenté de forcer sa porte.
Ce lundi, de bon matin, un brusque sentiment de rébellion contre l’injustice du sort qui lui était fait, la poussa très tôt hors du lit. Elle se leva aux aurores et effectua son travail en se limitant strictement à l’indispensable : charger les mangeoires et les abreuvoirs.
Elle venait de se voter un jour de congé avec un suffrage rarement atteint de cent pour cent. Tout scrupule qui viendrait en opposition à cette volonté totalitaire serait voué à l’échec.
Elle en avait marre soudain du verbe faire. Elle voulait tout simplement y substituer le verbe être et le conjuguer au présent de l’indicatif.
Le plus urgent serait de se réapproprier la parole dont elle était privée depuis des semaines. Parler, non plus avec le chien comme elle le faisait ces derniers jours, simplement pour entendre encore le son de sa voix, mais pour échanger réellement et jouir des idées ou des informations que véhicule le langage. Les conversations avec Brutus tournaient court trop rapidement, la laissant à sa frustration.
Le premier lundi du mois est jour de marché à Plozévet. C’est un petit marché dont l’intérêt réside principalement dans le moment de détente qu’il offre à bien des ruraux. C’est l’endroit où les rencontres peuvent passer pour impromptues, encore qu’elles aient, bien souvent, été manigancées d’avance. Entre potins et médisances, il se peut aussi qu’une opportunité de faire une bonne affaire vous soit dévoilée.
La dernière fois qu’elle y était venue, Jeanine était accompagnée d’André. Tout allait bien alors dans leur vie de petits exploitants agricoles. Mais, du jour au lendemain, tout avait basculé, d’un seul coup, la laissant totalement désemparée.
Lorsqu’elle arriva sur la place du marché, il y régnait déjà une timide animation. Elle trouva rapidement son affaire en la personne de Mariette Le Corre. Avec elle, il y avait à qui parler, de tout, de n’importe quoi, quelqu’un qui vous réponde enfin et qui même surenchérisse parfois.
Un enchantement !
Cependant, même Mariette, aguerrie aux joutes potinières, avait ce jour-là quelques difficultés à endiguer le verbiage de Jeanine. Les vannes étaient ouvertes et il fallait attendre que les mots s’écoulent.
— Il est bien bon, Lozacmeur ! Réfléchir ! Comme si je n’avais que cela à faire. Et où est-ce que j’irai si je vends ? Vous avez vu le prix de l’immobilier ? Non, voyez-vous, madame Le Corre, ce n’est pas possible, d’autant qu’avec ce qu’il me propose, je ne trouverai rien de correct. Même en lotissement. Et puis, qu’est-ce que je ferai ? Je ne suis pas encore à l’âge de la retraite, comment est-ce que je gagnerai ma vie ?
— Vous avez raison, madame Kerbelec, on ne vend son bien qu’une seule fois ! Il ne faut pas vous laisser manœuvrer par les professionnels. Quand vous serez décidée à vendre, demandez à quelqu’un de vous faire des photos et faites passer une annonce sur Internet.
— Et ça marche, ça ?
— Et comment ! C’est comme ça que madame Feunteun a vendu sa maison. Un bon prix en plus.
— Eh bien, madame Le Corre, je ferai comme cela, le moment venu. En attendant, il faut tout de même que je vous en parle : j’ai peur la nuit, à présent.
— C’est vrai que toute seule là-haut, j’aurai peur, moi aussi !
— Sans doute, mais moi j’y étais habituée. Jusqu’à ces derniers jours, je n’avais pas peur. L’idée ne m’en serait même pas venue. Mais maintenant, c’est très différent ; il y a un rôdeur qui fouine autour de ma maison, on dirait qu’il cherche quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Il n’y a rien à voler.
— Vous en avez parlé à quelqu’un ?
— À qui voulez-vous que j’en parle ? À Brutus ? Il est au courant.
— C’est qui, Brutus ?
— Mon chien.
— Ah ! Peut-être aux gendarmes alors, non ?
— Ils vont dire que je rêve ; rien n’a été volé, mais maintenant, je ferme tout à clef, portes et fenêtres.
— Ça fait peur, votre histoire ! J’en parlerai à quelqu’un que je connais, il aura sûrement une idée.
— Merci madame Le Corre. Dites-lui de venir me voir ! C’est vrai que moi, je ne vois plus grand monde à présent. Il n’y a que Le Gwenn qui se soit donné la peine de me rendre visite. Il est venu, il y a quelques jours, me demander si je voulais de l’aide. J’ai refusé, bien sûr, il n’y connaît rien, le pauvre. Non, il n’y a plus que Brutus qui me reste fidèle. Enfin, il y a plus malheureux que moi, n’est-ce pas ? En attendant, il faut que j’aille au poisson avant qu’il n’y en ait plus.
Bien connue dans le village, Mariette Le Corre, la dame en question, faisait de longue date fonction de gazette locale, en concurrence sauvage avec le Michel du bistrot. Sans « exagérer abusivement »– comme disaient certains – à eux deux, ils pouvaient reconstituer la vie de chaque habitant du bourg dans ses moindres détails, et ce, sur deux générations.
Jeanine s’éloigna entre les tentes bariolées de marchands braillards, spécialisés dans la vente d’objets dont nul n’a besoin. Au passage, elle interrompit la danse de l’un des chemisiers fleuris qui, parmi ses semblables jusque-là accrochés au barnum d’un fripier, s’agitait dans le vent.
Ici, la vie des poissons se termine en cuisine. À peine pêchés, ils sont vendus, cuisinés et consommés. Il ne sert à rien de les faire languir. Jeanine acheta l’un des merlus aphones qui, gueule ouverte, entassés dans une caissette, criaient silencieusement leur peur de mourir. Manifestement, ils ne se sentaient pas à l’aise dans ce rôle de comestibles qu’on leur avait imposé sans même les consulter.
Indifférente à tant de souffrance, et puisqu’il faut manger pour vivre, Jeanine y ajouta une grosse poignée de langoustines bondissantes qui tentaient désespérément de se soustraire au destin qui leur était promis.
De retour chez elle, en échaudant ses crustacés, elle reconnut que ce petit break lui avait réussi et, finalement, en les dégustant, le soir venu, la vie lui sembla nettement plus agréable.
Elle prit la décision de s’organiser pour trouver le temps de renouveler l’opération. Une fois par mois, c’était encore dans ses moyens.
La nuit suivante tempéra le mieux-être ressenti à l’issue de son escapade. Le rôdeur semblait s’être fait une habitude de sa prospection autour de la maison. Elle entendit Brutus gronder dans la cuisine, cependant que l’on tentait d’ouvrir la porte d’entrée. Elle était verrouillée fort heureusement. Ensuite, ce fut le volet de la salle que l’on tenta d’écarter, mais là aussi, elle avait veillé à les arrimer de l’intérieur. Brutus se fâcha et se mit à aboyer furieusement, mettant fin à la tentative d’intrusion.