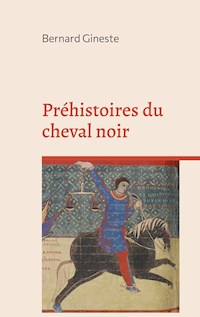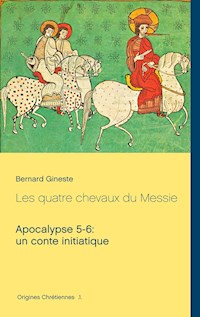
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Sommaire Tout le monde a entendu parler des "Quatre cavaliers de l'Apocalypse". Le récit de cette vision de Jean a une structure très simple, du type des contes de fées. Mais c'est aussi une méditation des Écritures centrée sur le chapitre 53 du Livre du prophète Isaïe. Un personnage trop négligé, "l'un des vingt-quatre Anciens", guide céleste de Jean, s'avère être Isaïe lui-même. Comme la fée marraine de Cendrillon, Isaïe apparaît à son successeur Jean pour l'assister, et, comme elle, il préside à d'étranges métamorphoses qui préparent un mariage. Le Messie, d'abord à la fois Lion et Racine, se transforme en un Agneau égorgé, puis en un Cavalier qui monte tour à tour quatre chevaux respectivement blanc, rouge, noir puis verdâtre. Le code très précis de ces couleurs successives est tiré du Lévitique (manuel des prêtres pour l'identification des lépreux) et du chapitre 5 du Cantique des cantiques (portrait de l'Époux par sa Bien-Aimée). Ces quatre chevauchées représentent donc la carrière terrestre du Messie de l'an 29 à l'an 33, car, selon Isaïe 53,4, il devait être considéré comme un lépreux et rejeté par les autorités religieuses établies, avant d'être reconnu comme le Messie par son épouse l'Église chrétienne. Summary In what context do the so-called Four Horsemen of the Apocalypse arise ? First a basic narrative scheme as in the fairy tale genre, then a meditation centered on Isaiah 53. An under-studied character, "one of the twenty-four elders", John's heavenly guide, turns out to be Isaiah himself. Like Cinderella's Fairy Godmother, he presides over metamorphoses : The Messiah becomes both a Lion and a Root, then a Lamb, then a Horseman riding four horses one after the other. The code of their successive colors, white-red-black-greenish, is taken from Leviticus 13 (the priests' handbook for the identification of lepers) and from Song 5, 10-12 (portrait of the Husband by his Beloved). So they are the four years of the earthly career of the Messiah, who according to Isaiah 53,4 was to be considered a leper and rejected by established religious authorities, before being acknowledged as the Messiah by the Church.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 135
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ Ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φων βροντῆς Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.
SOMMAIRE
Tout le monde a entendu parler des « Quatre cavaliers de l’Apocalypse ». Le récit de cette vision de Jean a une structure très simple, du type des contes de fées. Mais c’est aussi une méditation des Écritures centrée sur le chapitre 53 du Livre du prophète Isaïe. Un personnage trop négligé, « l’un des vingt-quatre anciens », guide céleste de Jean, s’avère être Isaïe lui-même. Comme la fée marraine de Cendrillon, Isaïe apparaît à son successeur Jean pour l’assister, et, comme elle, il préside à d’étranges métamorphoses préparant un mariage : Le Messie, d’abord à la fois Lion et Racine, se transforme en un Agneau égorgé, puis en un Cavalier qui monte tour à tour quatre chevaux respectivement blanc, rouge, noir, puis verdâtre. Le code très précis de ces couleurs successives est tiré du chapitre 13 du Lévitique (manuel des prêtres pour l’identification des lépreux) et du chapitre 5 du Cantique des cantiques (portrait de l’Époux par sa Bien-Aimée). Ces quatre chevauchées représentent donc la carrière terrestre du Messie de l’an 29 à l’an 33, car selon Isaïe 53,4, il devait être considéré comme un lépreux et rejeté par les autorités religieuses établies, avant d’être reconnu comme le Messie par son épouse l’Église chrétienne.
SUMMARY
In what context do the so-called Four Horsemen of the Apocalypse arise? First a basic narrative scheme as in the fairy tale genre, then a meditation centered on Isaiah 53. An under-studied character, “one of the twenty-four elders”, John’s heavenly guide, turns out to be Isaiah himself. Like Cinderella’s Fairy Godmother, he presides over metamorphoses : The Messiah becomes both a Lion and a Root, then a Lamb, then a Horseman riding four horses one after the other. The code of their successive colors, white-red-black-greenish, is taken from Leviticus 13 (the priests’ handbook for the identification of lepers) and from Song 5, 10-12 (portrait of the Husband by his Beloved). So they are the four years of the earthly career of the Messiah, who according to Isaiah 53,4 was to be considered a leper and rejected by established religious authorities, before being acknowledged as the Messiah by the Church.
Sommaire
Un schéma narratif traditionnel
Points acquis, point obscurs
Qui sont les vingt-quatre anciens?
Le tour récurrent εἷς ἐκ τῶν… « l’un d’entre les »?
Qui est le premier guide céleste de Jean?
Origine et traitement de la série des quatre chevauchées
La série chromatique blanc, rouge, noir, verdâtre
« Et nous, nous le considérions comme un lépreux »
Le thème narratif de la mauvaise interprétation
Le thème narratif de l’interprète secourable
Le thème narratif de la métamorphose
Caractère homogène de la série des quatre chevaux
Quatre chevauchées d’un même cavalier
Les quatre années de la carrière publique du Messie?
Le cheval blanc
Le cheval rouge
Le cheval noir
Remarque sur ces trois premières chevauchées
Le cheval vert
Cadre narratif de cette quadruple chevauchée
D’où viennent les quatre montures du Messie?
ÉLÉMENTS D’ICONOGRAPHIE
Origines chrétiennes
Un schéma narratif traditionnel
Dans l’Apocalypse de Jean, l’auteur, en tant que voyant, est transporté dans les cieux, où il assiste au drame suivant : la liturgie grandiose de la cour céleste est soudain perturbée par l’apparition, entre les mains du Très-Haut, d’un livre scellé, qu’il s’agit d’ouvrir. Or cette tâche apparaît si ardue qu’aucun champion ne se propose pour l’accomplir. Le voyant éclate alors en pleurs.
Heureusement, un membre énigmatique de la cour céleste s’en vient le consoler en lui assurant que ne va pas tarder un héros portant ces titres : d’une part Lion de Juda, et d’autre part Rejeton de David. Jusque-là, on est en présence d’une structure narrative tout à fait traditionnelle et parfaitement claire, ainsi que d’un type de héros plutôt commun, à savoir de souche et d’apparence royales.
La suite est plus inattendue, quoique non moins traditionnelle, parce que le héros dont il est question se présente en fait sous une forme disgraciée, voire pitoyable, à savoir celle d’un Agneau égorgé, par un de ces paradoxes violents qui parsèment tout le livre de l’Apocalypse.
Ceci dit, comme dans beaucoup de contes folkloriques1, cet anti-héros fait le job : Il ouvre un par un, et apparemment sans la moindre difficulté, les Sept Sceaux qui empêchaient d’ouvrir ce volume de parchemin écrit sur ses deux faces. Le résultat de cet exploit n’est pas moins déconcertant : à chaque fois qu’il en ouvre un, du moins pour les quatre premiers, surgit un Cheval de couleur différente, dans l’ordre suivant : blanc, rouge, noir et verdâtre. Et chacun de ces destriers successifs est monté par un cavalier que caractérisent à chaque fois des attributs bien déterminés autant qu’énigmatiques.
Nous ne traiterons pas ici de la suite du récit, parce qu’il faut bien nous limiter, et que nous sommes déjà là en présence de plusieurs difficultés à ce jour non résolues. Et l’obscurité ne règne pas seulement dans le détail, où s’embarrassent la plupart des commentaires, mais encore et surtout dans la logique générale du récit : quel est le fil conducteur entre ce lion, cet agneau et ces quatre chevaux? Et qui est le personnage céleste qui guide le voyant dans la compréhension de ces événements évidemment symboliques2?
1 Cette étude a été rédigée, pour l’essentiel, avant de prendre connaissance des travaux suivants consacrés à l’Apocalypse par l’exégèse narratologique anglosaxonne: D.L. BARR, “The Apocalypse of John as Oral Enactment”, Interpretation 40 (1986) 243-256; “Using Plot to Discern Structure in John’s Apocalypse”, Proceedings of the Eastern Great Lakes and Mid-West Biblical Societies 15 (1995) 23-33; Tales of the End. A Narrative Commentary on the Book of Revelation (Santa Rosa 1998; 2e éd. 2012); “Waiting for the End That Never Comes: The Narrative Logic of John’s Story”, in S. MOYISE (ed.), Studies in the Book of Revelation, (Edinburgh 2001) 101-112. — J.R. MICHAELS, “Revelation 1:19 and the Narratives Voices in Apocalypse”, NTS 37 (1991) 604-620. — E. BORING, “Narrative Christology in the Apocalypse”, CBQ 54 (1991) 702-723. — B. WOOTTEN SNYDER, “Triple-Form and Space/Time Transitions: Literary Structuring Devices in the Apocalypse” in E.H. LOVERING (ed.), Society of Biblical Literature 1991 Seminar Papers (Atlanta 1991) 440-460. — A. J. P. GARROW, Revelation (London 1997, reed. 2012). — J.L. RESSEGUIE, Revelation Unsealed. A Narrative Critical Approach to John’s Apocalypse (Leiden 1998) ; Narrative Criticism of the New Testament (Grand Rapids 2005); The Revelation of John: A Narrative Commentary (Grand Rapids 2009). — Y. JANG, “Narrative Function of the Apocalypse”, Scriptura 80 (2002) 186-196; “Narrative Plot of the Apocalypse”, ibid. 84 (2003) 381-390. — G. DESROSIERS, An Introduction to Revelation: A Pathway to Interpretation (London 2000) 10-24 (“the Story”) et 70-75 (“narrative criticism”). — J.K. NEWTON, “Reading Revelation Romantically”, Journal of Pentecostal Theology 18 (2009) 194-215. Le point commun de ces publications est d’analyser l’Apocalypse comme un récit, avec son intrigue, ses personnages, son cadre spatio-temporel, son point de vue narratif, etc. en partant du principe émis par Barr (Tales, p. 2): « The story underlying the Apocalypse is the story of Jesus ».
Points acquis, point obscurs
Avant d’aborder ces questions, rappelons d’abord les quelques points qui font, s’il est possible, l’unanimité.
Jean appartient à la première génération chrétienne, et c’est un prophète dont l’autorité est assez importante pour s’adresser simultanément à sept communautés chrétiennes de la province romaine d’Asie proconsulaire. Il a une connaissance approfondie et fluide des Écritures hébraïques autant que de leurs versions grecques3, et il s’adresse à un public certainement choisi ou très encadré, auquel il ne ressent pas le besoin d’expliquer ses très nombreuses et très précises allusions textuelles.
L’ouvrage en effet est destiné à être lu. Mais par qui, et à qui? dans quel cadre institutionnel, et suivant quel procès de transmission? Quels niveaux de compétences et de formation suppose-t-il chez ses premiers lecteurs, et parmi ses auditoires originels? Ce n’est pas seulement en effet le contenu et la signification de la prophétie de Jean qui restent à ce jour en grande partie enveloppés d’obscurité, mais encore le contexte et le processus médiatiques de sa conception et de sa réception originelles4. Car il est bien certain que la tradition interprétative de l’Apocalypse n’a pas été un long fleuve tranquille. L’ouvrage au contraire a souvent suscité, et semble-t-il dès le départ, non seulement l’incompréhension mais encore la gêne, voire le rejet, puisqu’il a même été écarté pendant plusieurs siècles du canon de la plupart des églises d’Orient5. De nos jours encore la plupart des spécialistes conviennent que l’interprétation de cette prophétie conserve d’importantes zones d’obscurité6.
Cependant la nature de certains des symboles qui y sont évoqués est transparente, au point de faire l’unanimité. Ainsi, le volume scellé dont il est ici question renvoie sans l’ombre d’un doute à un passage très précis de la Bible, à savoir au livre du prophète Daniel. La fin de ce livre en effet annonçait des événements à venir plutôt mystérieux, et le prophète y recevait cette consigne (Daniel 12, 4) : « Toi, Daniel, serre ces paroles et scelle (σφράγισον) le volume (τὸ βιβλίον) jusqu’au temps de la Fin ».
Le début de la vision céleste de Jean que nous étudions ici conclut donc, des plus clairement, la boucle narrative laissée ouverte par celle de Daniel, puisque l’enjeu est désormais l’ouverture de ce volume (βιβλίον) scellé (κατεσφραγισμένον) de sept sceaux. Quant au héros censé mener cette tâche à bien, c’est clairement le personnage qu’attendent depuis plusieurs générations les juifs pieux, à savoir le Messie, qui devait d’après un consensus presque général sortir de la maison de David, elle-même issue de la tribu de Juda.
La suite est moins claire. Tout le monde voit bien que l’Agneau immolé représente lui aussi le Messie, mais cette fois du seul point de vue chrétien. On voit mal cependant comment il se fait qu’on passe ici d’une manière si abrupte du Lion à l’Agneau, sans qu’aucune explication en soit apparemment donnée au voyant, ni au lecteur, ni aux auditeurs de ce lecteur. Et la chose est d’autant plus étrange que Jean a pourtant à sa disposition un guide céleste qui a proposé de lui-même ses services.
De même, tout le monde voit bien que la section dite des quatre cavaliers s’inspire de très près de deux chapitres du Livre de Zacharie. Mais pour autant personne à ce jour n’a trouvé le fil directeur, la logique qui conduit de notre Agneau à ces Chevaux. C’est sans doute pourquoi leur signification générale reste obscure, et plus encore celle des nombreux détails qui caractérisent chacun d’entre eux. Et en effet chaque élément de leur attirail symbolique a inspiré à lui seul une foule d’explications ou d’applications concurrentes aussi ingénieuses que totalement contradictoires, dont le seul relevé pourrait occuper un gros ouvrage. Nous reprenons donc ici le dossier à nouveaux frais, en commençant par identifier s’il est possible le guide céleste de Jean, tâche qui ne nous paraît pas futile, comme à beaucoup de modernes7, puisque que tout le désigne au contraire comme détenant la clé de cette interprétation.
2 De nombreux commentateurs passent discrètement sur ce personnage. Rares sont ceux qui avouent ingénument leur perplexité, comme G.S. MENOCHIO, Brevis explicatio sensus literalis totius S. Scripturae (Cologne 1630) II 520: « Quisnam fuerit hic sanctus incertum est »; L. FROMOND, Commentarius (Louvain 1657) 97: « Qui autem fuerit ille, nemo scire potest. » ; J. DA SILVEIRA, Commentariorum in Apocalypsim tomus I (Lyon 1667) 349: « Quis iste ſuerit, omninò ignoratur ».
3 G.V. ALLEN, “Scriptural Allusions in the Book of Revelation and the Contours of Textual Research 1900-2014”, CBR 14 (2016) 319-339.
4 L. GARCIA UREÑA, “The Book of Revelation: a Written Text Towards the Oral Performance”, in R. SCODEL, Between Orality and Literacy (Leiden 2014) 309-330.
5 Pour un bon résumé de la question, voyez E.B. ALLO, L’Apocalypse (Paris 1933) CCXXXII-CCXXXIV.
6 P. PRIGENT, L’Apocalypse de saint Jean (2e éd. ; Genève 2000, réimpr. 2014) 111, écrit ainsi au détour d’une discussion : « Ce raisonnement est d’une logique parfaite, la seule objection qu’on puisse lui faire est de demander si la logique règne souverainement sur les visions de l’Apocalypse. La réponse est évidente [sic] et l’argument perd alors le meilleur de sa force. »
7 Depuis au moins H. BULLINGER, In Apocalypsin (Bâle 1557) 72: « Nomen ejus non editur, unde et temerè et curiosè requiri videtur ». C. A LAPIDE en 1648, Commentaria in Apocalypsin (Venise 1700) 79: « Verùm haec divinando dicuntur, et merae sunt conjecturae ». J. LE BUY DE LA PERIE, Paraphrase (Genève 1651) 141: « Cette recherche est non seulement curieuse et inutile, mais aussi hors de propos ». J. GILL, An Exposition of the Revelation (London 1776) 61: « These are all fancies and conjectures ». D. DRASH, L’Apocalypse de saint Jean (Paris 1873) 32: « Croirait-on que des interprètes ont recherché quel pouvait être ce vieillard? Les uns ont pensé à S. Luc, d’autres à S. Pierre etc.!!». J.A. SMITH, Commentary (Philadelphia 1884) 84: « There is nothing to identify the elder who speaks ». W.H. SIMCOX , The Revelation (Cambridge 1890) 35 : « One of the elders : It is idle to speculate which. ». On ne trouve même plus un mot sur cette question dans les commentaires les plus copieux du XXe siècle, ceux de CHARLES (1920), ALLO (1921), AUNE (1997) ou PRIGENT (2000). DENIS LE CHARTREUX, Opera omnia, t. 14 (Montreuil 1896) 269, mort en 1471, lui-même extatique et visionnaire patenté, se débarrassait de la question d’une manière plus élégante, en suggérant que ce personnage ne serait de toute façon que purement fantasmatique: « Probabilius autem loqui videntur, qui omnia ista per eumdem angelum Johanni revelata affirmant : qui tamen in vi imaginativa Johannis diversarum personarum formavit effigiem ».
Qui sont les vingt-quatre anciens?
Le personnage qui s’adresse à Jean appartient à un mystérieux collège de vingt-quatre figures célestes formant le troisième cercle autour du trône divin, après les quatre vivants et les sept esprits : Et autour du trône, vingt-quatre trônes, et sur les trônes, vingt-quatre anciens (πρεσβυτέρους) assis enveloppés dans des manteaux blancs, et sur leurs têtes des couronnes d’or.
André Feuillet8 a démontré de façon convaincante, et sans qu’il soit besoin d’y revenir que ces vingt-quatre entités ne peuvent être des anges, et que ce sont au contraire nécessairement des êtres humains, seuls appelés à partager quelque chose de la royauté divine. Ce sont, plus précisément, de saints personnages ayant vécu avant l’avènement du Messie, et qui saluent son avènement avec joie. Reste le problème de leur identification, et de leur nombre précis, problème singulièrement irritant, selon les termes fort judicieux de Pierre Prigent9.
Plusieurs identifications de ce collège ont été proposées. On a évidemment pensé aux vingt-quatre familles de sacrificateurs qui se partageaient à tour de rôle l’exercice du culte dans le Temple de Jérusalem, au témoignage du Premier livre des Chroniques