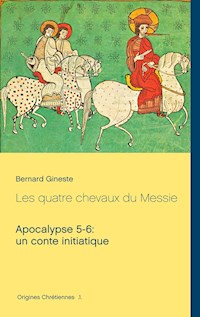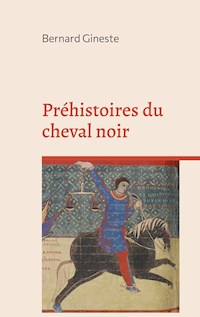
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Origines chrétiennes
- Sprache: Französisch
SOMMAIRE En l'an 33 de notre ère, le christianisme tel que nous le connaissons n'existe pas encore. Ce n'est qu'une nouvelle secte juive parmi d'autres, vouée comme tant d'autres à une disparition rapide. Deux ans plus tard cependant, il commence la conquête de l'Empire romain. Cet événement totalement inattendu, l'un des plus importants de l'histoire de l'humanité, nous est raconté par deux ouvrages généralement incompris de ce point de vue: les Actes des Apôtres et l'Apocalypse de Jean. On y voit s'accomplir à marche forcée un plan prévu de toute éternité, que Dieu avait annoncé par avance, d'abord par la bouche de Moïse, puis des autres Prophètes et Sages d'Israël.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En bas à gauche la troisième des quatre chevauchées du Messie (Manuscrit Add. Ms. 11695 de la British Library, folio 102 verso, 1109)
ΚΑΙ ΟΤΕ ΗΝΟΙΞΕΝ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ ΗΚΟΥΣΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΖΩΟΥ ΛΕΓΟΝΤΟΣ ΕΡΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΟΝ ΚΑΙ ΙΔΟΥ ΙΠΠΟΣ ΜΕΛΑΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΠ ΑΥΤΟΝ ΕΧΩΝ ΖΥΓΟΝ ΕΝ ΤΗ ΧΕΙΡΙ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΗΚΟΥΣΑ ΩΣ ΦΩΝΗΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΖΩΩΝ ΛΕΓΟΥΣΑΝ ΧΟΙΝΙΞ ΣΙΤΟΥ ΔΗΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΧΟΙΝΙΚΕΣ ΚΡΙΘΩΝ ΔΗΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΝΟΝ ΜΗ ΑΔΙΚΗΣΗΣ
65Et lorsqu’il ouvrit le sceau troisième, j’entendis le troisième vivant dire : « Viens ! »
Et je vis, et voici un cheval noir, et celui qui siégeait sur lui, tenant une balance dans sa main.
66Et j’entendis une sorte de voix au milieu des quatre vivants qui disait : « Une mesure de blé à un denier, et trois mesures d’orge à un denier. Et l’huile et le vin, ne t’y attaque pas !»
SOMMAIRE
En l’an 33 de notre ère, le christianisme tel que nous le connaissons n’existe pas encore. Ce n’est qu’une petite secte juive parmi d’autres, vouée comme tant d’autres à une disparition rapide. Deux ans plus tard cependant, il se lance à la conquête de l'Empire romain.
Cet événement totalement imprévu, l’un des plus importants de l’histoire de l’humanité, nous est raconté par deux ouvrages généralement incompris de ce point de vue : les Actes des Apôtres, et l’Apocalypse de Jean.
On y voit s’accomplir à marche forcée un plan prévu de toute éternité, que Dieu avait annoncé par avance, d’abord par la bouche de Moïse, puis des autres Prophètes et Sages d’Israël.
SUMMARY
In 33 AD, Christianity as we know it did not yet exist. It was only a small Jewish sect among others, destined like so many others to disappear quickly. Two years later, however, he set out to conquer the Roman Empire.
This totally unforeseen event, one of the most important in human history, is recounted in two works that are generally misunderstood from this point of view: the Acts of the Apostles, and the Revelation of John.
We see there the forced accomplishment of a plan foreseen from all eternity, which God had announced in advance, first through the mouth of Moses, then through the other Prophets and Wise Men of Israel.
TABLE DES MATIÈRES
1. Introduction
I. Les quatre étapes de l’explosion chrétienne
2. Bref résumé de notre ouvrage précédent
3. Ce que signifie
Préhistoires du cheval noir
4. L’ouverture aux non-juifs selon les
Actes des apôtres
.
5. Première section : Philippe va vers le nord, en Samarie
6. Deuxième section : Pierre et Jean suivent Philippe en Samarie
7. Troisième section : Philippe vire vers le sud
8. Philippe comme nouvel Élie
.
9. Quatrième section : Pierre circule à travers le pays
10. Structure parallèle à celle de
Zacharie
6
6-7
11. Signification originelle de
Zacharie
6
12. Un
pesher
chrétien de
Zacharie
6
II. Le présage de Lydda
13. Pierre à Lydda et la guérison d’Énée
14. Notoriété de la figure d’Énée
15. Énée, une figure respectable
16. La guérison d’Énée comme présage
17. La figure d’Énée comme outil symbolique
18. De la guérison de Lydda au rêve de Troas
19. Paralysé depuis huit ans
20. Une controverse latente contre le polythéisme romain
III. Le présage de la Gazelle
21. Le miracle de Joppé
22. Le nom de Tabitha
23. Tabitha et le
Cantique des cantiques
24. Le Saron
25. Tabitha et le bourgeonnement du monde à venir
26. Le chœur des veuves de Joppé
27. Tabitha filandière, tisserande et couturière
28. Arrière-plan symbolique du filage et du tissage
29. Les filles de Jérusalem comme brodeuses
30. Signification traditionnelle du palanquin de Salomon
31. Identification traditionnelle des
Filles de Jérusalem
32. Incohérence de l’exégèse traditionnelle
33. Sens de ce deuxième présage
IV. Encore des présages
34. Le port de Joppé, troisième présage
35. Simon le tanneur, quatrième présage
36. Le rêve de Pierre, cinquième présage
37. Visions de linges
38. Fauves, reptiles et volatiles
39. Une méditation sous-jacente du
Livre d’Osée
40.
Osée
2, un chapitre longuement médité par Pierre et par Paul
41. Le voile retiré révèle Dieu, et volatilise le péché
42. Excursus : ce qu’Origène disait de ce voile
43.
Osée
2
18
et Genèse 9
8-13
44.
Osée
2 et
Nombres
4 dans la liturgie synagogale
45. La résurrection de Tabitha
V. Portraits croisés de Philippe et de Pierre
46. Pierre comme nouvel Élisée
47. Pierre et Simon dit le Mage
48. Pierre était déjà un nouvel Élisée en Samarie
49. Supériorité d’Élisée sur Élie
50. Le thème de la double puissance d’Élisée
51. Deux ans environ, ou bien trois ans et demi ?
52. Élisée, serviteur supérieur à son maître ?
53. Cornélius, nouveau Naaman
54. Retour sur l’évangélisation de la ville de Samarie
55. Quelques lectures allégoriques du siège de Samarie
56. Qui sont les quatre lépreux ?
57. Simon le Mage et Guéhazi comme disciples
58. Guéhazi comme prototype du disciple chrétien
59. Guéhazi au nombre des quatre lépreux de Samarie
60. La cavalerie invisible
61. Élie et Élisée comme cochers
62. Désuétude de la métaphore du char de guerre
63. Philippe comme cocher
64. En arrière-plan, le char de Joseph le patriarche
65. Philippe en nouveau Joseph
66. Le char de Joseph, son intendance et son épouse
67. De l’exaltation de Joseph à celle de Jésus
68. Pierre, l’Arche, l’Homme vêtu de lin et le Palanquin
69. L’épée comme parole de Dieu qui circoncit les cœurs
70. Pierre et l’édification du nouveau Tabernacle
71. Unanimité des premiers chrétiens sur cette question
72. Pierre comme nouveau Moïse
73. Le nom de Philippe
74. Les
testimonia
équestres
VI. Le verset 6
6
de l’
Apocalypse
75. Retour au cheval noir de l’
Apocalypse
76. L’impasse littéraliste
77. L’impasse astrologique
78. Une parabole agraire ?
79. Un calendrier allégorique
80. Que signifie «
causer du tort »
à l’huile et au vin ?
81. Remarque de botanique biblique
82. Triple arrière-plan scripturaire du verset 6
6
83. Ce que représentent le blé et l’orge
84. Ce que représente le vin
85. Ce que représente l’huile, c’est-à-dire l’olivier
86. Le thème scripturaire de la greffe et de l’adoption
87. Deux oliviers et un chandelier
88. Démultiplication du chandelier originel
89. Foisonnement mondial de l’arbre monothéiste
90. Métamorphose chrétienne de l’olivier monothéiste
91. Conclusion sur le verset 6
6
VII. Le verset 6
5
de l’
Apocalypse
92. Le Messie à la balance
93. Jérémie comme figure christique
94. Jérémie comme figure apocalyptique
95. Jérémie, le prix du sang et le champ du Potier
96. Qui est ce Potier ?
97. La sépulture des étrangers
98. Le Champ du Potier, l’Église
99. Conclusion
100. Annexe : Table des triangles
1. Introduction
Nous cherchons ici à comprendre de quoi parle un verset extrêmement dense et difficile de l’Apocalypse de Jean, auquel personne n’a donné d’explication satisfaisante à ce jour, depuis les presque deux mille ans qu’on le lit et qu’on essaie en vain de le comprendre.
Cette enquête va nous plonger rétrospectivement dans les archives des toutes premières communautés chrétiennes, auxquelles s’adresse l’auteur. C’est le seul moyen de nous faire une idée nette des préoccupations de la première génération chrétienne et des codes qu’elle adopta et utilisa pour les exprimer. Un récit surtout retiendra notre attention, tel qu’il nous a été conservé par le seul Livre des Actes des Apôtres. C’est celui de la fondation des deux premières assemblées messianiques non-juives, qui furent le premier bourgeon du christianisme mondial tel que nous le connaissons.
Ce détour sera long, sans doute, et peut-être parfois fastidieux, mais, à ce que nous espérons, il ne sera pas moins instructif et riche en surprises. En examinant attentivement ces narrations d’apparence parfois naïve, telles qu’elles nous sont parvenues sous une forme évidemment résumée et simplifiée, nous leur trouverons un arrière-plan symbolique en réalité extrêmement riche et condensé. Il s’agit de tout un réseau de réminiscences des saintes Écritures hébraïques, organisées en faisceaux d’une manière étonnamment cohérente et concertée. Nous y verrons comment la mémoire commune de la toute première génération chrétienne s’est construite sur la base d’une méditation continuelle et méthodique des saintes Écritures hébraïques, selon des principes relativement simples, uniformes et constants.
Tout y prend sens, y prend forme, et y prend place dans la mémoire, comme l’accomplissement d’oracles de la Torah eux-mêmes interprétés allégoriquement par des oracles des Prophètes d’Israël, parfois complétés par d’Autres Écrits comme les Psaumes et le Cantique des Cantiques. L’intelligence et la mémoire des événements fondateurs s’organisent autour de textes des Écritures connectés entre eux et mémorisés par petits paquets de trois ou quatre, comme autant de neurones du cerveau collectif de la communauté chrétienne en voie de formation.
On comprendra vite que cette enquête, comme certains romans policiers, vaut moins par son intrigue, par son suspense, et par sa chute finale, que par l’univers qu’elle va nous faire traverser et découvrir. D’un certain point de vue, en effet, on consacre ici des recherches d’une ampleur plutôt disproportionnée, soit plus de 430 pages, à une seule toute petite phrase de l’Apocalypse de Jean, à savoir ses seuls versets 65-6.
Mais chemin faisant, nous découvrirons quelle image avaient d’elles-mêmes ces toutes premières communautés et comment elles se racontaient à elles-mêmes leurs origines. Autrement dit comment elles comprenaient et se remémoraient les événements tout à fait inattendus qui avaient marqué leurs naissances.
Il s’avèrera que plusieurs des représentations allégoriques sous-jacentes à ces narrations sont attestées par d’autres écrits des premiers chrétiens. C’est spécialement le cas de l’Apocalypse de Jean, qui en recycle un grand nombre, de sorte que leur mise à jour est de nature, par ricochet, à éclaircir certains de ses passages des plus énigmatiques, comme celui autour duquel est tissé le présent ouvrage.
Voici le verset en question, qui va donc nous occuper tout du long, et que le lecteur se gardera de perdre de vue, au cours des longues pages qui vont suivent, souvent à travers des détours inattendus.
Apocalypse 65Et lorsque [l’Agneau] ouvrit le sceau troisième, j’entendis le troisième vivant dire : « Viens ! » Et je vis, et voici un cheval noir, et celui qui siégeait sur lui, tenant une balance dans sa main.6Et j’entendis une sorte de voix au milieu des quatre vivants qui disait : « Une mesure de blé à un denier, et trois mesures d’orge à un denier. Et l’huile et le vin, ne t’y attaque pas !»1.
2. Bref résumé de notre ouvrage précédent
Nous ne partons pas de rien. Nous avons déjà étudié le contexte de ces deux versets dans un ouvrage précédent, beaucoup plus bref et intitulé Les quatre chevaux du Messie. Il n’est pas absolument nécessaire de l’avoir lu pour comprendre celui-ci, et pour nous en assurer, résumons-en brièvement les conclusions.
Ce contexte, c’est la section de l’Apocalypse où l’on voit l’Agneau de Dieu se manifester pour la première fois au milieu de la cour céleste, et y ouvrir un livre mystérieux qui est évidemment celui des destinées humaines. Jusqu’à l’avènement de l’Agneau, c’est-à-dire jusqu’au commencement de la prédication chrétienne, ce grimoire céleste était resté impénétrable, parce qu’il était scellé de sept sceaux, que l’Agneau vient enfin briser, l’un après l’autre. Nous nous intéressons ici surtout aux quatre premiers de ces sceaux, qui sont marqués chacun par une mystérieuse chevauchée symbolique, à chaque fois différente.
L’auteur de l’Apocalypse reprend, en la remaniant librement, une vision de son prédécesseur le prophète Zacharie, qui mettait déjà en scène quatre chars, tirés chacun par un attelage de couleur différente. Cependant, Jean y introduit certaines modifications, ainsi que de nouveaux détails extrêmement précis, délibérément énigmatiques, dans l’intention manifeste d’évoquer, de manière codée, un processus bien déterminé et bien connu de ses premiers lecteurs et auditeurs.
Ce dessein l’oblige à modifier notamment la robe des chevaux qu’il emprunte au Livre de Zacharie, ainsi que l’ordre dans lequel ils apparaissent successivement. Il les fait en l’occurrence et pour sa part se succéder selon cette série chromatique bien déterminée : blanc, rouge, noir et vert.
Pour comprendre ce code, il faut se tourner vers les saintes Écritures hébraïques, qui constituaient pour Jean, comme pour tous les premiers chrétiens, la source de toute vérité et de toute légitimité. Pour tous les monothéistes du premier siècle, c’était la pierre de touche de toute l’histoire humaine, et la clef du plan divin. Cette histoire en effet était à leurs yeux secrètement dirigée par Dieu, selon un dessein préétabli connu de lui seul, et que les Écritures n’annonçaient que de manière voilée.
Cette conception des choses est formulée explicitement et fort clairement par la Lettre de Barnabé : « Car le maître de maison (δεσπότης, déspotès) nous a fait connaître les choses qui se sont déjà produites (τὰ παρεληλυθότα, ta parélèluthota) et celles qui sont en cours (τὰ ἐνεστῶτα, ta énéstôta), en nous donnant aussi un avant-goût (ἀπαρχὰς γεύσεως, aparkhas geuséôs) de celles qui sont encore à venir (τῶν μελλόντων, tôn méllontôn). Et comme nous les voyons en train de se réaliser (ἐνεργούμενα, énérgouména) l’une après l’autre, selon ce qu’il avait annoncé, nous lui devons une révérence toujours plus grande et plus profonde. »2
Le propos de Jean dans l’Apocalypse est précisément de relire dans cette perspective l’histoire de sa communauté en pleine expansion. Il veut mettre en lumière le fil directeur de cette aventure, qui est l’accomplissement progressif et méthodique d’un plan qui avait été décidé par avance, depuis l’origine même du monde, par Dieu et son Messie. Dans ce cadre, comme l’a montré notre premier ouvrage, tout commence par ces quatre chevauchées, reflétant un processus initial en quatre étapes, marqué par un code chromatique qui ne peut avoir de sens que dans le cadre d’une réminiscence des Écritures.
Or, dans toute la Bible hébraïque, où les notations de couleur sont extrêmement rares, il n’existe en tout et pour tout que deux autres passages présentant une quelconque série de trois ou quatre couleurs. Ce sont d’une part le chapitre 13 du Lévitique et par ailleurs les versets 510-12 du Cantique des cantiques. Ainsi, l’auteur de l’Apocalypse s’arrange pour composer un texte savamment tissé d’extraits tirés de chacune des trois parties de la Bible hébraïque : la Loi ou Torah3, représentée par le Livre du Lévitique ; les Prophètes4, représentés par le Livre de Zacharie ; et enfin les Autres écrits5, autrement appelés Hagiographes,
Le premier de ces textes, tiré du Lévitique, servait pour les sacrificateurs à identifier les lépreux, en observant leurs plaies et notamment les couleurs qu’elles présentaient. Le deuxième, tiré du Livre de Zacharie, y annonçait sous une forme voilée le déroulement d’un processus en quatre étapes ayant trait à une effusion spirituelle à venir dans une région située du côté du nord. Le troisième, tiré du Cantique des cantiques, était une description par la Bien-Aimée de son Bien-Aimé dans laquelle la tradition unanime reconnaît un portrait allégorique du Messie.
Par une coïncidence remarquable, qu’avaient visiblement remarquée les premiers chrétiens, le Lévitique et le Cantique mentionnent les mêmes quatre couleurs, qui plus est dans le même ordre. Or ce sont encore ces mêmes quatre couleurs, et à nouveau dans le même ordre que l’auteur de l’Apocalypse choisit de donner à ses quatre chevaux, sans craindre pour parvenir à cet effet de modifier à la fois la nature et l’ordre de celles que Zacharie attribuait de son côté à ses quatre attelages.
D’un point de vue rigoureusement mathématique, pour peu qu’on ait la moindre notion du calcul des probabilités, il est absolument impossible de considérer cette double coïncidence comme fortuite. On est au contraire obligé d’en conclure que l’auteur de l’Apocalypse a délibérément modifié la configuration originelle de la vision de Zacharie dans le dessein d’évoquer lui aussi un processus en quatre étapes, analogue à celui qu’avait en vue son prédécesseur et confrère Zacharie, maintenant combiné, dans sa propre vision, avec le code chromatique commun au Lévitique et au Cantique.
Par ailleurs le contexte immédiat de l’épisode des quatre chevauchées nous renvoie à un passage du Livre du prophète Isaïe qui annonce la venue d’un personnage mystérieux et incompris qui sera traité comme un lépreux et égorgé comme un agneau, bien qu’il soit en fait envoyé par Dieu, de manière à prendre sur lui les péchés de son peuple. De la sorte, les quatre chevauchées du Messie se présentent à nous très clairement comme une vision rétrospective de la carrière terrestre de Jésus de Nazareth, qui a été rejeté comme un pestiféré et mis à mort comme un agneau par les autorités religieuses de son peuple, avant d’être cependant finalement reconnu comme Messie et accepté comme époux par la sainte Église de Dieu.
Il faut donc en conclure que la quadruple chevauchée dont nous parle l’Apocalypse ne renvoie pas à autre chose qu’aux quatre années de la carrière publique de Jésus (en fait trois et demie), années considérées comme un déploiement, dans le temps de l’histoire humaine, de la gloire divine du Verbe de Dieu préexistant : il s’agit évidemment de Jésus de Nazareth, rejeté comme un pestiféré par les uns et accepté comme le Messie par les autres.
Dans sa gloire céleste préexistante, le Verbe de Dieu est représenté par l’Apocalypse comme siégeant sur un trône véhiculé par quatre entités angéliques où l’on reconnaît tant les Chérubins de la vision du prophète Ézéchiel que les Séraphins de la vision du prophète Isaïe. Personne n’a jamais contesté ce point. Ce que nous avons mis en lumière, et qui avant nous n’avait été que pressenti par certains auteurs, c’est que l’Apocalypse les identifie également aux quatre chars successifs de la vision du prophète Zacharie, que ce prophète présente explicitement comme envoyés en mission pour visiter le Pays, après s’être tenus devant le Seigneur de tout le pays.
Résumons brièvement ce que représentent sans doute possible ces quatre chevauchées du Messie. L’année du cheval blanc et de la couronne renvoie à la proclamation originelle de l’avènement de la Royauté de Dieu pendant l’année 29-306. L’année du cheval rouge et de l’épée correspond à la montée des oppositions en l’an 30-31. L’année du cheval noir et de la balance correspond aux prodromes d’une ouverture de la prédication chrétienne aux non-juifs, et donc à l’acquisition par Dieu d’un nouveau peuple, dans le courant de l’année 31-32. De fait ce cavalier se porte acquéreur de blé et d’orge, qu’il doit payer fort cher, en argent bien pesé. Enfin l’année du cheval vert et de la Mort, et du Séjour des morts, correspond à celle de la mort et de la résurrection du Messie au printemps de l’an 33.
Dans ce cadre très précis, nous avons montré que chacun des détails dont Jean surcharge la vision de Zacharie trouve sans difficulté, et le plus naturellement du monde, un sens extrêmement clair et précis, corroboré tant par d’autres passages de l’Apocalypse que par le fonds commun des autres écrits du Nouveau Testament. Il n’y a pas à y revenir ici, sauf sur un point, qui va nous occuper tout au long du présent ouvrage.
3. Ce que signifie Préhistoires du cheval noir
Le seul point qui présente encore une quelconque obscurité dans cette affaire autrement parfaitement limpide se trouve au verset 66, lors de la troisième chevauchée du Messie, lorsqu’il monte le cheval noir, portant une balance à la main, pour peser, selon l’usage du temps, l’argent avec lequel il va payer ses achats.
Ce qui reste obscur, pour être plus précis, ce n’est pas le fait que le Messie nous soit ici présenté en train d’acquérir du grain, bien au contraire. Ni même qu’il doive pour cela payer fort cher, bien au contraire. Ce grain, c’est évidemment l’Assemblée messianique qu’il va s’acquérir au prix fort, celui de son sang versé. Mais ce qui reste en revanche très obscur, c’est d’une part la mention par une voix divine de blé, d’orge, d’huile et de vin ; d’autre part la tarification anormale qu’on y trouve des deux premières de ces denrées ; et enfin l’ordre qui est donné au Messie de ne pas s’attaquer aux deux dernières, à savoir ni à l’huile ni au vin.
Ceci considéré, il faut garder à l’esprit la clarté et la cohérence du symbolisme, pourtant complexe et surchargé, que l’auteur utilise par ailleurs dans toute cette section des quatre chevauchées. Par voie de conséquence, il est raisonnable de penser que ce verset faisait lui aussi appel à une logique entièrement compréhensible par le public auquel était originellement adressée le Livre de l’Apocalypse du Messie Jésus, même si cette logique s’est depuis et très vite perdue, et n’a plus été comprise des générations suivantes, jusqu’à nos jours.
Tout le contexte indique que nous sommes ici encore en présence d’une allégorie, dont cependant le code précis nous échappe. Que signifient ici le blé, l’orge, l’huile et le vin ?
Par ailleurs une autre énigme subsiste. Comment la communauté à laquelle s’adresse Jean était-elle en mesure de comprendre tout le symbolisme relativement complexe, non seulement de ces versets précis, mais encore de leur contexte, c’est-à-dire de l’ensemble des quatre chevauchées du Messie qui marque l’ouverture des quatre premiers sceaux ?
Notre premier ouvrage s’appelait : Les quatre chevaux du Messie. Un conte initiatique. Nous y avons montré en effet que le récit fantasmagorique de ces quatre chevauchées est en réalité une fable totalement saturée de réminiscences bibliques, et pourtant parfaitement cohérente, et pourtant intégralement compréhensible dans ses moindres détails. C’est un conte, une parabole. C’est avant tout une histoire.
Mais si cette histoire était parfaitement compréhensible de son premier public, c’est parce que ce public était déjà familier de ce genre de narrations, par lesquelles, en milieu juif, chaque secte se racontait son histoire, sur la base de réminiscences bibliques entremêlées et structurées selon des lois précises et des principes constants7. À cet égard les histoires que nous raconte l’Apocalypse ne sont que l’aboutissement d’une tradition qui a laissé bien d’autres traces dans plusieurs autres écrits du Nouveau Testament.
C’est pourquoi nous intitulons cet ouvrage-ci Préhistoires du cheval noir. Confrontés à un passage difficile de l’Apocalypse, celui où est décrite la mission du Messie lors de sa troisième chevauchée, sur le cheval noir, aux versets 656, nous partons à la recherche d’autres histoires du même genre dans le tout petit corpus que constitue le Nouveau Testament. Nous tentons ici une archéologie de la pensée monothéiste du premier siècle de notre ère.
Il faut bien dire en effet, et reconnaître franchement que la fable des quatre chevauchée du Messie, telle que nous l’avons élucidée, est racontée par l’Apocalypse d’une manière assez ramassée, et plutôt énigmatique. Comment son public aurait-il été en mesure de comprendre ce symbolisme complexe emprunté au Livre de Zacharie, s’il n’en avait pas déjà une connaissance préalable ? Et si c’était bien le cas, comment se fait-il qu’on n’en ait pas d’autre trace dans quelque autre écrit du Nouveau Testament ?
Précisément, nous allons maintenant montrer qu’on en a bien conservé une autre trace, extrêmement claire et reconnaissable, et même indubitable, bien que jusqu’ici elle soit restée à ce qu’il semble totalement inaperçue. Nous allons commencer par là. Le seul récit que nous ayons de la toute première prédication à des non-juifs, dans les Actes des apôtres, est en effet clairement et indubitablement structuré lui aussi comme un accomplissement de la vision du prophète Zacharie et des chevauchées de ses quatre mystérieux attelages aux différentes robes.
Après l’avoir démontré, nous reviendrons périodiquement au texte même de l’Apocalypse, qui, au fil de ces confrontations, retrouvera tout son sens, jusque dans les moindre détails, dans le cadre de cette tradition interprétative qui remonte aux tout premiers commencements de la communauté chrétienne.
C’est à cette lumière que nous espérons trouver la solution de l’énigmatique verset 66, en fouillant dans la préhistoire de ce conte initiatique, dans d’autres récits des origines chrétiennes.
On verra par-là que, dès l’origine, les chrétiens, sous l’influence de la tradition juive et de la liturgie synagogale, ont lié le thème du Messie lépreux, et de ses adeptes, également considérés comme des lépreux, à celui du cheval noir, image de l’expansion de l’Évangile en dehors de la Judée et symbole de l’effusion de l’Esprit saint au-delà même du monde judéen.
4. L’ouverture de la prédication aux non-juifs selon les Actes des apôtres
Le seul récit que nous ayons de la toute première prédication adressée à des non-juifs se trouve au livre dit des Actes des apôtres, du verset 84 au verset 1118.
Disons quelques mots de la manière dont ce récit nous a été conservé et transmis. Dans le Nouveau Testament tel qu’il est édité actuellement, le livre des Actes des apôtres suit immédiatement la série des quatre Évangiles qui ouvre le recueil. Cependant il est clair pour tout le monde, et incontesté, qu’originellement c’était le deuxième tome d’un ouvrage attribué à saint Luc, disciple de Paul, dont le premier était le troisième de nos Évangiles actuels, dit selon saint Luc. Tous deux sont dédicacés à un certain Théophilos, dont l’identité reste obscure, ce qui est d’ailleurs en soi un bon signe de l’ancienneté de cet ouvrage en deux tomes.
Leur composition est visiblement antérieure et à la guerre qui a ravagé la Judée entre 66 et 74, qui n’y trouve absolument aucun écho. De fait le récit de Luc s’arrête abruptement à Rome vers l’an 59. Ce faisant il laisse totalement en suspens le déroulement de la procédure qui vise le personnage central, pourtant en danger de mort. La seule raison qu’on puisse en donner est toute simple : c’est que ce sort est toujours en suspens au moment où Luc compose son récit. Toute autre hypothèse demanderait des arguments extrêmement solides, que personne n’a jamais pu fournir8.
Les deux tomes de cet ouvrage sont munis de préfaces dans le goût et la tradition de l’historiographie hellénistique. Personne ne conteste ce point. L’auteur s’y présente très clairement et délibérément comme un enquêteur, dans la tradition inaugurée dans la littérature grecque par l’historien Hérodote vers 450 avant notre ère. Autre point remarquable, l’aisance avec laquelle il s’exprime en grec quand il ne suit pas une source sémitique préexistante, spécialement dans les passages où il se présente implicitement comme témoin direct des événements qu’il raconte. Tout cela s’accorde merveilleusement avec la tradition qui attribue l’ouvrage à un collaborateur de Paul dénommé Luc qui aurait été médecin et donc pétri de littérature grecque, à la différence de tous les autres auteurs du Nouveau Testament.
Luc n’a pas assisté personnellement aux tout premiers commencements du phénomène chrétien, et il dit clairement que pour cette période il s’appuie sur de premiers essais de rédaction dont il ne cite pas les auteurs, ainsi que sur des témoignages directs. Quant à lui il intervient implicitement comme témoin direct seulement à partir d’un certain moment du récit, où il utilise la première personne du pluriel lorsqu’il parle de l’équipe de Paul, ce qui s’accorde très bien avec certains passages des lettres du dit Paul qui parlent d’un certain Luc, médecin de profession, rangé parmi ses collaborateurs.
Ceci considéré, Luc nous dit clairement dans ses préfaces, sans qu’il y ait lieu d’en douter, bien au contraire, qu’il a fait usage de récits déjà élaborés par la communauté chrétienne avant qu’il ne la rejoigne. C’est spécialement le cas, évidemment, pour le premier tome qu’on a coutume d’appeler l’Évangile selon saint Luc.
Dans le deuxième, traditionnellement dénommé Actes des apôtres, il en va de même, du moins pour la première partie, avant que l’auteur n’y intervienne lui-même comme protagoniste, comme témoin direct et comme tout premier rédacteur. Ce moment crucial est discuté. Généralement on considère qu’il s’agit du verset 1610, alors que Paul arrive à Troas et s’apprête à passer pour la première fois d’Anatolie en Europe, vers l’an 49. D’après certains manuscrits ce serait plutôt dès le verset 131, quelques années plus tôt, alors que Paul est encore à Antioche de Syrie, juste avant le commencement des premières missions d’évangélisation concertées. Quoi qu’il en soit, la toute première expansion du phénomène chrétien en dehors de la sphère strictement juive se place très nettement avant cela, en Palestine, et il est clair que l’auteur ne fait que nous en transmettre un récit dont il n’est pas le premier auteur.
La question des sources utilisées par Luc pour composer son récit, spécialement dans la première partie des Actes des apôtres, a été extrêmement discutée depuis le XIXe siècle, et ne sera jamais absolument et complètement résolue, vu qu’on n’en a pas conservé d’autres versions, comme c’est le cas par exemple pour l’Évangile de Luc, qu’on peut comparer à ceux de Marc et de Matthieu.
Le récit de la toute première intégration de non-juifs à la communauté chrétienne va donc du verset 84 au verset 1119. Il commence à Jérusalem, d’où part Philippe pour prêcher aux premiers non-juifs, et il finit à Jérusalem, où Pierre revient pour se justifier d’avoir admis dans la communauté messianique un groupe de personnes incirconcises avec lesquelles la loi mosaïque lui interdisait même d’avoir le moindre contact.
Au sein de cet ensemble homogène et nettement délimité du point de de la logique narrative et du cadre géographique, Luc a inséré, par souci de synchronisme, l’épisode de la conversion de Paul, qui y intervient comme un corps étranger, mais prépare la suite de l’ouvrage où le personnage de Paul va progressivement éclipser tous les autres.
Dégagé de cette insertion secondaire, le récit de la tout première proclamation de la Parole à des non-juifs, dans la seule Palestine, se compose d’une étrange rapsodie de quatre morceaux narratifs bien distincts, dont le protagoniste principal change à chaque fois. Nous suivrons ici la traduction œcuménique de la Bible (T.O.B.), pour ne pas prêter au soupçon de traduire le texte à notre guise, mais en sautant les passages qui font mention de Paul.
5. Première section : Philippe va vers le nord, en Samarie
Actes des apôtres 81 (…) En ce jour-là éclata contre l’Église de Jérusalem une violente persécution. Sauf les apôtres, tous se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie.2Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de belles funérailles. (…) 4Ceux donc qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la Parole. 5C’est ainsi que Philippe, qui était descendu dans une ville de Samarie, y proclamait le Christ. 6Les foules unanimes s’attachaient aux paroles de Philippe, car on entendait parler des miracles qu’il faisait et on les voyait. 7Beaucoup d’esprits impurs en effet sortaient, en poussant de grands cris, de ceux qui en étaient possédés, et beaucoup de paralysés et d’infirmes furent guéris. 8Il y eut une grande joie dans cette ville. 9Or il se trouvait déjà dans la ville un homme du nom de Simon qui faisait profession de magie et tenait dans l’émerveillement la population de la Samarie. Il prétendait être quelqu’un d’important, 10et tous s’attachaient à lui, du plus petit jusqu’au plus grand. « Cet homme, disait-on, est la Puissance de Dieu, celle qu’on appelle la Grande. »11S’ils s’attachaient ainsi à lui, c’est qu’il les maintenait depuis longtemps dans l’émerveillement par ses sortilèges. 12Mais, ayant eu foi en Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du Règne de Dieu et du nom de Jésus Christ, ils recevaient le baptême, hommes et femmes. 13Simon lui-même devint croyant à son tour, il reçut le baptême et ne lâchait plus Philippe. À regarder les grands signes et miracles qui avaient lieu, c’est lui en effet qui était émerveillé.
Il ne nous est pas possible naturellement de savoir précisément à quel point cette section du récit a été remaniée par l’auteur des Actes des apôtres. Mais il nous faut noter que pour l’essentiel il n’a certainement rien inventé. Tout a commencé par une mise à mort et par une persécution qui a provoqué la dispersion des disciples, jusqu’alors concentrés à Jérusalem. De façon paradoxale cela a entraîné la diffusion du phénomène chrétien non seulement aux alentours immédiats de Jérusalem, c’est-à-dire dans la province de Judée dont elle est le chef-lieu, mais encore au-delà de ses frontières septentrionales, dans la province voisine de Samarie. Voyons la suite.
6. Deuxième section : Pierre et Jean suivent Philippe en Samarie
Actes des apôtres (T.O.B.) 814Apprenant que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, les apôtres qui étaient à Jérusalem y envoyèrent Pierre et Jean. 15Une fois arrivés, ces derniers prièrent pour les Samaritains afin qu’ils reçoivent l’Esprit Saint. 16En effet, l’Esprit n’était encore tombé sur aucun d’eux ; ils avaient seulement reçu le baptême au nom du Seigneur Jésus. 17Pierre et Jean se mirent donc à leur imposer les mains, et les Samaritains recevaient l’Esprit Saint.
Carte de la Palestine au Ier siècle. En orangé, les villes citées par les Actes : Jérusalem, Samarie, Gaza, Azot, Lydda, Joppé, Césarée.
18Mais Simon, quand il vit que l’Esprit Saint était donné par l’imposition des mains des apôtres, leur proposa de l’argent. 19« Accordez-moi, leur dit-il, à moi aussi ce pouvoir, afin que ceux à qui j’imposerai les mains reçoivent l’Esprit Saint. »20Mais Pierre lui répliqua : « Périsse ton argent, et toi avec lui, pour avoir cru que tu pouvais acheter, avec de l’argent, le don gratuit de Dieu. 21Il n’y a pour toi ni part ni héritage dans ce qui se passe ici, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. 22Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur : la pensée qui t’est venue au cœur te sera peut-être pardonnée. 23Je vois en effet que tu es dans l’amertume du fiel et les liens de l’iniquité. »24Et Simon répondit : « Priez vous-mêmes le Seigneur en ma faveur, pour qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit. »25Pierre et Jean, après avoir rendu témoignage et annoncé la parole du Seigneur, retournèrent alors à Jérusalem ; ils annonçaient la Bonne Nouvelle à de nombreux villages samaritains.
Si l’on veut bien y prêter attention, ce rebondissement a quelque chose d’étrange. On commence par nous dire que tous les disciples ont été chassés de Jérusalem, et que par suite le phénomène chrétien s’est répandu dans toute la Judée et la Samarie. On s’attend à qu’il soit ensuite question de ces différentes courses de divers personnages à travers la Judée et la Samarie, mais ce n’est pas exactement le cas. Le récit au contraire se concentre sur l’évangélisation de la seule Samarie, et il s’attarde même à en distinguer deux étapes de longueur à peu près égale, et de structure parallèle.
On nous précise avec insistance que l’effusion de l’Esprit n’a eu lieu que lors la deuxième de ces courses missionnaires. N’est-ce pas étrange ? Pourquoi le récit a-t-il été stylisé et mémorisé de cette manière ? Mais laissons cette question en suspens et voyons la suite.
1Apocalypse 66 : Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ’ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.
2Barnabé 17 : ἐγνώρισεν γὰρ ἡμῖν ὁ δεσπότης διὰ τῶν προφητῶν τὰ παρεληλυθότα καὶ τὰ ἐνεστῶτα, καὶ τῶν μελλόντων δοὺς ἀπαρχὰς ἡμῖν γεύσεως, ὧν τὰ καθ’ ἕκαστα βλέποντες ἐνεργούμενα, καθὼ ἐλάλησεν, ὀφείλομεν πλουσιώτερον καὶ ὑψηλότερον προσάγειν τῷ φόβῳ αὐτοῦ.
3 La Loi ou Torah, ou Pentateuque, composée de cinq livres : la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome.
4 Les Prophètes ou Nébiim, constitués des livres de Josué, des Juges, de Samuel, des Rois, d’Isaïe, de Jérémie, d’Ézéchiel et des Douze petits prophètes
5 Les Hagiographes ou Kétoubim, constitués des livres des Psaumes, des Proverbes et de Job, du Cantique des cantiques, de Ruth, des Lamentations de Jérémie, de l’Ecclésiaste et d’Esther, de Daniel, d’Esdras, de Néhémie et des Chroniques.
6 Ces années commencent en automne dans le calendrier liturgique du temps.
7 C’est ce qu’on voit notamment dans la littérature retrouvée au XXe siècle dans les grottes de Qumrân, mais aussi bien dans la littérature rabbinique postérieure, héritière d’une autre secte juive : c’est le fond culturel commun des sectes essénienne, pharisienne et chrétienne.
8 À cet égard il ne faut pas se laisser impressionner par le consensus en vigueur dans le monde exégétique, qui n’a que les formes extérieures d’une communauté scientifique.
7. Troisième section : Philippe vire vers le sud
Le récit abandonne maintenant Pierre et Jean, qui avaient suivi les traces de Philippe en direction du nord, et il revient à ce dernier qui se dirige cette fois nettement vers le sud9, sur la route de l’Égypte et du royaume de Méroé, où s’en retourne aussi, sur un char, un eunuque éthiopien. Philippe monte sur ce char et y trouve l’eunuque en train de lire le passage du Livre d’Isaïe qui annonce un Messie qui sera égorgé comme un agneau, texte auquel, comme on s’en souvient, se réfère aussi l’Apocalypse juste avant d’emprunter au prophète Zacharie sa vision des quatre chevauchées sur des chevaux de couleurs variées.
Actes des apôtres (T.O.B.) 826L’ange du Seigneur s’adressa à Philippe : « Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza ; elle est déserte. » 27Et Philippe partit sans tarder. Or un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Ethiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, 28retournait chez lui ; assis dans son char, il lisait le prophète Esaïe. 29L’Esprit (τὸ πνεῦμα, to pneuma) dit à Philippe : « Avance et rejoins ce char (ἅρματι, harmati). »30Philippe, accourant (προσδραμὼν, prosdramôn), entendit l’eunuque qui lisait le prophète Esaïe et lui dit : « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ? »31 — « Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n’ai pas de guide ? » Et il invita Philippe à monter s’asseoir près de lui. 32Et voici le passage de l’Ecriture qu’il lisait : Comme une brebis que l’on conduit pour l’égorger, comme un agneau muet devant celui qui le tond, c’est ainsi qu’il n’ouvre pas la bouche. 33Dans son abaissement il a été privé de son droit. Sa génération, qui la racontera ? Car elle est enlevée de la terre, sa vie. 34S’adressant à Philippe, l’eunuque lui dit : « Je t’en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi ? De lui-même ou de quelqu’un d’autre ? »35Philippe ouvrit alors la bouche et, partant de ce texte, il lui annonça la Bonne Nouvelle de Jésus. 36Poursuivant leur chemin, ils tombèrent sur un point d’eau, et l’eunuque dit : « Voici de l’eau. Qu’est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ? »37Il donna l’ordre d’arrêter son char (ἅρμα, harma) ; tous les deux descendirent dans l’eau, Philippe et l’eunuque, et Philippe le baptisa. 38Quand ils furent sortis de l’eau, l’Esprit du Seigneur (πνεῦμα Κυρίου, pneuma Kuriou) emporta (ἥρπασεν, hèrpasén) Philippe, et l’eunuque ne le vit plus (καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι, kaï ouk eïdén auton oukéti), mais il poursuivit son chemin dans la joie. 39Quant à Philippe, il se retrouva à Azot et il annonçait la Bonne Nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu’à son arrivée à Césarée.
Cette troisième section du récit est d’une longueur analogue aux deux précédentes, mais d’un style tout différent. Elle baigne dans une atmosphère spécialement onirique. Rien ne la rattache clairement au fil des événements qui précèdent ni à ceux qui suivent : aucune indication ne la date ni même ne la situe clairement dans le cours du récit général10. Aucun lien non plus de cause à effet avec ce qui précède, ni avec ce qui suit. L’action du personnage principal n’est pas motivée par quelque circonstance historique concrète que ce soit. Elle lui est dictée, à un moment et dans un lieu indéterminés, directement par Dieu, qui d’ailleurs l’arrache au monde ordinaire à sa guise, en le transportant miraculeusement d’un lieu à un autre.
En revanche les notations de lieu y abondent et en premier lieu la direction de cette nouvelle course, vers le midi, c’est-à-dire vers le sud, à l’opposé de la première. Cette orientation est ensuite largement développée et explicitée par la mention de lieux précis, sur la route de Jérusalem à Gaza, avec une mention en conclusion de la ville d’Azot, par laquelle passe cette route, et depuis laquelle Philippe s’en retourne finalement vers le nord en suivant la côte jusqu’à Césarée-sur-Mer, de ville en ville. Elle est également développée par la mention de la destination finale de l’eunuque, qui se trouve au sud même de l’Égypte, à la frontière méridionale du monde connu. L’eunuque après cela, quant à lui, poursuit son chemin vers le lointain royaume de Méroé.
Cette insistance étrange à marquer la direction prise par le personnage a tellement étonné le grand Eberhard Nestle, qu’il suppose de comprendre le texte différemment que l’on ne fait généralement : « La locution que nous traduisons par vers midi, à l’heure de midi, était rendue dans nos anciennes versions par vers le midi, dans la direction du sud. Mais cette indication eût été oiseuse, puisque Philippe avait ordre de se rendre sur le chemin de Gaza. Dans les Septante cette expression est toujours employée pour désigner le temps. »
Cependant personne n’a suivi Nestle sur ce point, et à juste titre. En effet c’est bien au contraire l’indication d’une heure de la journée qui serait ici oiseuse et bizarre, dans une péripétie par ailleurs aussi totalement dépourvue de quelque indication temporelle que ce soit.
On doit plutôt considérer cette indication initiale, vers le sud, d’une certaine manière, comme le titre ou le fil directeur de cette troisième aventure. Car précisément le seul lien narratif qu’on puisse relever entre cette péricope et le reste du récit, outre le retour du personnage initial, c’est un lien d’opposition radicale en matière de lieu. Philippe, que des circonstances historiques précises avaient au départ conduit à se diriger vers la Samarie, à savoir la lapidation d’Étienne et la persécution qui s’ensuivit, se dirige maintenant vers le sud, sur la seule initiative de Dieu lui-même. En contact direct avec le monde angélique, il échappe désormais aux contingences de ce monde, au point même que le Messager du Seigneur peut très bien l’arracher soudain d’un lieu pour le transporter dans un autre, sans autre raison claire, apparemment, qu’une manifestation de puissance surnaturelle.
Philippe sur le char de l’eunuque éthiopien (Manuscrit grec 1613 de la Bibliothèque vaticane, folio 107, vers l’an 1000)
Ceci considéré, une question se pose, dont la réponse est loin d’être évidente. Pourquoi ces événements sont-ils rapportés à ce point du récit plutôt qu’ailleurs ? En effet cette troisième étape du récit met en scène à nouveau le seul Philippe, et elle se termine par la mention de son arrivée à Césarée-sur-Mer. Or à l’étape suivante du récit, étape dont Philippe va disparaître à nouveau, pour laisser à nouveau toute la place à Pierre, ce dernier sera lui aussi conduit à Césarée, sans que Philippe paraisse encore y être arrivé.
Ainsi donc, du simple point de vue narratif, et en dehors de toute question d’historicité, rien n’imposait à Luc ni à sa source de disposer les quatre étapes de ce récit dans l’ordre où elles se présentent à nous. La deuxième course de Philippe aurait pu aussi bien être racontée après la première, ou bien encore après les deux voyages de Pierre, ainsi que nous l’avons fait remarquer. Pourquoi ces quatre étapes ont-elles donc été rassemblées dans cet ordre précis ? Pourquoi l’ensemble du récit a-t-il été stylisée et mémorisé d’une manière en apparence aussi décousue11 ?
Nous laisserons aussi en suspens cette question-là, pour l’instant. Par ailleurs, avant de passer à la quatrième et dernière section de notre récit, il nous faut relever certains aspects de la figure de Philippe dans notre récit. Cette figure d’autant plus importante qu’elle est à l’origine d’un processus déterminant pour toute la suite de l’histoire humaine, à savoir l’extension du phénomène chrétien en dehors du seul monde juif. Or il est absolument indubitable que Philippe est implicitement comparé au prophète Élie dans cette troisième péripétie12.
9 J. A. Fitzmyer, The Acts of the Apostles (New York, 1997) 410 : « The preceding episode told of the Hellenist Philip’s evangelization of Samaria to the north of Jerusalem; now Philip is told to turn his attention to the south, to the road that goes from Jerusalem to Gaza. »
10 F. J. Foakes-Jackson, The Acts of the Apostles (Londres, 1931) 75 : « La conversion et le baptême du trésorier de la reine Candace est un incident séparé du reste du récit et complètement isolé du reste de l’histoire ; il ne semble pas probable que Luc ait eu l’intention, en le relatant, de marquer la progression de l’histoire de l’approche de ceux qui se trouvent en dehors de l’alliance juive. » — D. G. Dunn, The Acts of the Apostles (Grand Rapids, 1996) 103-104 : « Le récit de l’eunuque est ajouté de manière plutôt maladroite (…) ; tout cela reste plutôt vague, ne mène nulle part et n’a pas de suite. ». — S. D. Butticaz, L’identité de l’Église dans les Actes des apôtres (Berlin, 2011) 225 : « récit au caractère privé, dont les conséquences immédiates en termes de publicité et d’ecclésialité sont nulles. » 227 : « épisode dramatique, aux liens lâches avec son environnement littéraire. » — Avis contraire de F. F. Bruce, The Acts of the Apostles (Leicester, 1952) 195 : « Que l’eunuque soit prosélyte ou non, sa conversion marque un pas en avant dans l’évangélisation des païens. »
11 Selon É. Trocmé, Le Livre des Actes et l’Histoire (Paris, 1957) 89, « Les deux blocs de tradition étaient sans lien entre eux et l’auteur ad Theophilum n’a pas remédié à cet état de choses. »
12 Ce point a été souligné par bien des auteurs dont au moins par R.B. Rackham, The Acts of the Apostles. 7e édition (Londres, 1901) 121 ; J. Munck, The Acts of the Apostles (Garden City, 1967) 79 ; Scott Spencer, The Portrait of Philip in Acts. A Study of Roles and Relations (Londres, 1992) ; J.G.D. Dunn, The Acts of the Apostles (Valley Forge, 1996) 115 ; J. Jervell, Die Apostelgeschichte (Göttingen, 1998) 274 ; Rick Strelan, « The Running Prophet (Acts 8:30) », Novum Testamentum 43 (2002) 31-38 spéc. 32-33.
8. Philippe comme nouvel Élie
Le prophète Élie, comme son disciple et successeur le prophète Élisée, sont des figures importantes du monothéisme palestinien à l’époque qui nous occupe, et cela pour différentes raisons. D’abord sans doute parce que l’imagination populaire s’empare plus facilement de personnages pittoresques que d’ennuyeux auteurs dont on n’a conservé que les grimoires. Ces deux-là en effet n’ont pas laissé d’écrits mais un souvenir très vivace dans le folklore palestinien. Leurs aventures miraculeuses y formaient un cycle qui nous a été conservé par les deux Livres des Rois.
L’épisode de ces aventures qui frappait le plus les imaginations est sans nul doute la fin mystérieuse de la carrière du prophète Élie. Soudain surgissent entre lui et son disciple Élisée un char de feu (ἅρμα πυρὸς, harma puros) et des chevaux de feu (ἵπποι πυρὸς, hippoï puros), et le prophète est entraîné dans le ciel par un tourbillon : il a été enlevé (ἀνελήμφθη, anélèphthè), laissant à son disciple son manteau ainsi qu’une double part de son esprit13. Il en a découlé d’innombrables spéculations dont déjà se fait écho le livre assez tardif du prophète Malachie, dans les deux tout derniers versets de la Bible hébraïque, qui annoncent un mystérieux retour de ce prophète à la fin des temps, avant la venue du jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Ce retour à venir d’Élie devient dès lors un dogme pour la plupart les sectes judéennes du premier siècle, dont les premiers chrétiens, ainsi qu’on le voit par exemple dans les Évangiles, mais aussi dans la tradition juive ultérieure, jusqu’à nos jours.
Un autre trait caractéristique de ce prophète est sa faculté miraculeuse de disparaître soudain d’un lieu pour réapparaître dans un autre lorsqu’il est saisi par le souffle divin. C’est ce que lui dit un officier royal chargé de l’arrêter : Si je m’écarte de toi, l’esprit du Seigneur (πνεῦμα κυρίου, pneuma Kuriou) t’emportera (ἀρεῖ, areï) dans un pays que je ne connais pas.14 De même après sa disparition définitive, une troupe de prophètes se lance en vain à sa recherche dans cette pensée : Peut-être l’Esprit du Seigneur l’a-t-il emporté (ἦρεν, èrén) et jeté dans le Jourdain ou sur quelque mont ou dans quelque vallon. Notons encore comment sa disparition est évoquée du point de vue de son disciple Élisée : et il ne le vit plus (καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν ἔτι, kaï ouk eïdén auton éti). Une autre fois15, il conseille au roi Achab d’atteler son char (ἅρμα, harma) et de s’en aller pour éviter l’orage qui arrive. Le roi s’exécute et part pour Itzréel. Mais soudain la main du Seigneur (χεὶρ κυρίου, kheïr Kuriou) est sur Élie, qui court (ἔτρεχεν, étrékhén) derrière Achab jusqu’à Itzréel, d’ailleurs sans raison claire, ce passage du récit étant plutôt obscur.
Troisième trait d’Élie, sa docilité immédiate à la parole du Seigneur, régulièrement soulignée au début de ses aventures. 1 Rois 172-5Et il y eut une parole du Seigneur (Κυρίου, Kuriou) à l’adresse d’Élie : « Va depuis ici vers l’orient (πορεύου … κατὰ ἀνατολὰς, poreuou .. kata anatolas), etc. » Et Élie fit selon la parole du Seigneur. (…) 181-2Et il y eut après de nombreux jours encore une parole du Seigneur (κυρίου, Kuriou) à l’adresse d’Élie trois ans plus tard qui disait : « Va (πορεύθητι, poreuthèti) et montre-toi à Achab etc. » Et Élie alla (ἐπορεύθη, époreuthè) se faire voir d’Achab. (…) 2 Rois 13-4Et le messager du Seigneur (καὶ ἄγγελος Κυρίου, angélos Kuriou) parla à Élie le Tishbite en lui disant (ἐλάλησεν πρὸς Ηλιου τὸν Θεσβίτην λέγων, élalèsén pros Èliou ton Thésbitèn légôn) : « Lève-toi d’ici (ἀναστὰς δεῦρο, anastas deuro) à la rencontre des messagers d’Ozochias roi de Samarie et dis-leur, etc. » Et Élie y alla (ἐπορεύθη, époreuthè) et le leur dit. (…) 15Et le messager du Seigneur (καὶ ἄγγελος Κυρίου, kaï angélos Kuriou) parla à Élie et lui dit (ἐλάλησεν ἄγγελος Κυρίου πρὸς Ηλιου καὶ εἶπεν, élalèsén angélos Kuriou pros Èliou kaï eïpén) : « Descends avec lui etc. » Et Élie se leva (ἀνέστη, anéstè) et descendit avec lui etc.
On retrouve tous ces traits d’Élie chez Philippe tel qu’il apparaît dans cette aventure, qui plus dans les termes précis des deux Livres des Rois : c’est presque du copié-collé, comme on dit aujourd’hui. Lui aussi se déplace avec docilité sous l’impulsion directe de Dieu et dans la direction qui lui est précisée. Et le messager du Seigneur (καὶ ἄγγελος Κυρίου, kaï angélos Kuriou) parla à Philippe en lui disant (ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων, élalèsén pros Philippon légôn): « Lève-toi et pars vers le midi (Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν, anastèthi kaï poreuou kata mésèmbrian), etc. » Et, s’étant levé, il partit (καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη, kaï anastas époreuthè).
Lui aussi court16 derrière un char transportant non certes un roi mais du moins un fonctionnaire royal. Lui aussi est enlevé par Dieu sous les yeux de son disciple, et il ne vit plus (καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι, kaï ouk eïdén auton oukéti). Lui aussi il est transporté soudain et sans raison bien claire dans un autre lieu : quant à lui, Philippe se retrouva (εὑρέθη, euréthè) à Azot. Les mêmes verbes d’ailleurs sont utilisés par les Évangiles pour clore leur récit de la Transfiguration, lors de laquelle Élie et Moïse viennent de se manifester aux côtés de Jésus. Ainsi dans l’Évangile de Marc 98 : et soudain ils levèrent les yeux et ils ne virent plus personne (οὐκέτι οὐδένα εἶδον, oukéti oudéna eïdon) sinon le seul Jésus avec eux. Et dans celui de Luc : Jésus se retrouva (εὑρέθη, euréthè) seul.
Il y aurait beaucoup à dire encore sur cette section du baptême de l’Éthiopien et sur les spéculations théologiques et scripturaires qu’elle reflète au sein de la toute première communauté chrétienne. Mais la plupart de ces observations seraient ici prématurées, et nous nous contenterons pour conclure de relever cursivement un denier parallèle entre la seconde course de Philippe et l’une de son prédécesseur Élie.
Nous avons vu en effet que Philippe, après avoir fui Jérusalem pour l’ancien royaume du nord, qui en son temps s’appelle Samarie, reçoit l’ordre de se diriger vers le sud (πορεύου κατὰ μεσημβρίαν, poreuou kata mésèmbrian), alors que son prédécesseur avait reçu celui de se porter vers l’orient (πορεύου… κατὰ ἀνατολὰς, poreuou kata anatolas).
Il faut noter qu’il est arrivé également au prophète Élie lui aussi de fuir vers le sud. Et c’était déjà en conséquence d’une persécution, dont le menaçait la femme d’Achab roi de Samarie, à savoir la fameuse Jézabel.
Que fait alors Élie ? Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Bersabée en Juda et y laissa son serviteur. Lui-même alla dans le désert à un jour de route, etc.17 On sait bien que dans les Écritures et la tradition la ville de Bersabée représente l’extrémité méridionale de la Terre Sainte, qui va comme le dit le proverbe, de Dan à Bersabée.
Philippe et l’eunuque éthiopien (Manuscrit 190 de la Bibliothèque municipale de Cambrai, folio 73 verso, 1266)
Par ailleurs, au terme de ce voyage, Élie finit par rebrousser chemin pour remonter vers le nord triomphalement, avec pour mission d’y instituer deux rois et un prophète18, de même que Philippe rebrousse chemin à partir d’Azot en évangélisant les villes de la côte jusqu’à Césarée, c’est-à-dire pour lui aussi instituer en tout lieu les prêtres, rois et prophètes que sont tous les chrétiens, individuellement et collectivement19.
Et en effet c’est le programme divin jadis énoncé par le prophète Joël et récemment encore rappelé par Pierre à Jérusalem le jour de la Pentecôte de l’an 33 : « Alors, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos fils et vos filles seront prophètes. » Or c’est bien c’est ce qui se passe au moins à Césarée, où vingt ans plus tard, au printemps de l’an 55, arrivent Paul et ses compagnons, dont l’auteur lui-même des Actes des Apôtres 21, 8-10 : Repartis le lendemain [de Ptolémaïs], nous avons gagné Césarée où nous nous sommes rendus à la maison de Philippe l’Évangéliste, l’un des Sept, et nous avons séjourné chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Alors que nous passions là quelques jours, il est arrivé un prophète de Judée, nommé Agabus, etc.
Mais les chrétiens sont tous également rois et prêtres, selon la promesse du Livre de l’Exode 196, Je vous tiendrai pour un royaume de sacrificateurs (mamlekhet kohanim), une nation sainte, promesse qui ne s’est vraiment réalisée que la par la constitution de l’Assemblée messianique, c’est-à-dire de l’Église chrétienne, comme l’enseignent expressément Pierre dans sa Lettre et Jean dans son Apocalypse20.
Ainsi donc, de même qu’Élie après s’être enfui vers le sud, avait fini par remonter triomphalement vers le nord, où il devait sacrer le nouveau roi de Syrie, le nouveau roi d’Israël, et le prochain prophète qui devait lui succéder, à savoir Élisée, de même Philippe remonte triomphalement vers Césarée, siège officiel de la puissance d’occupation romaine, évangélisant et baptisant en route tous ceux qu’il rencontre, pour en faire une royauté de prêtres, tous destinés à devenir des prophètes
Mais en voilà assez sur ce point. Nous avons établi que les faits et gestes de Philippe sont continuellement racontés en des termes empruntés au cycle du prophète Élie, sans pour autant calquer aucun épisode précis du dit cycle, ce qui, soit dit entre parenthèses, est un excellent indice d’historicité pour les faits qui sont ainsi stylisés. De même, le caractère à la fois implicite et extrêmement cohérent de tout ce symbolisme nous permet de remonter à des spéculations et à des vues théologiques extrêmement anciennes dans la communauté chrétienne originelle des années 30 et 40 de notre ère.
9. Quatrième section : Pierre circule à travers le pays
Nous en venons donc maintenant à la quatrième et dernière section de notre récit, qui est aussi de loin la plus longue, puisqu’elle se divise elle-même en quatre sous-sections de taille inégales21.
Il s’agit maintenant d’un nouveau voyage de Pierre. On commence par nous dire que Pierre parcourt tout le pays, avant de nous raconter les quatre étapes finales de son voyage. Il arrive d’abord à Lydda, où il guérit un certain Énée paralysé depuis huit ans. De là il passe en continuant vers l’ouest au port de Joppé, où il ressuscite une jeune fille appelée Gazelle. Il vire ensuite vers le nord jusqu’à Césarée où il baptise un centurion de la cohorte italique et toute sa famille, avant de s’en revenir vers le sud-est jusqu’à Jérusalem où il doit se justifier de cette dernière initiative.
Il y aurait beaucoup à dire de ces pérégrinations de Pierre, dont le récit a été clairement stylisé et mémorisé sur la base de méditations très précises des Écritures et de l’actualité du temps, au sein d’une communauté chrétienne en pleine métamorphose. Mais nous nous contenterons ici et pour l’instant de reprendre les premiers mots de cette section, qui suffiront à notre propos : Il arriva que Pierre, circulant partout (διερχόμενον διὰ πάντων, diérkhoménon dia pantôn), arriva aussi chez les saints qui résidaient à Lydda, etc.
Pourquoi le récit de ce dernier voyage, important surtout pour ce qui s’y passe à Césarée, commence-t-il précisément à Lydda, à partir d’où Pierre va faire une boucle qui le ramènera à Jérusalem ?
10. Structure parallèle à celle de Zacharie 66-7
Récapitulons. Premièrement Philippe part de Jérusalem vers le nord, jusqu’en Samarie. Deuxièmement Pierre et Jean partent aussi de Jérusalem, dans la même direction, ce deuxième voyage se distinguant du premier par une effusion de l’Esprit saint qui n’avait pas eu lieu lors du premier. Troisièmement Philippe se dirige en sens inverse, vers le sud, route sur laquelle il rejoint un char, sur lequel il monte même quelque temps et annonce l’Évangile. Quatrièmement et dernièrement Pierre traverse le pays en tous sens, et finit ce périple par une boucle jusqu’à Césarée avant de s’en revenir à Jérusalem où il est appelé à rendre compte de ce qui s’est passé. Voilà un bon résumé des allées et venues de ces tout premiers évangélisateurs de non-juifs, ou du moins un résumé dont aucun point n’est contestable.