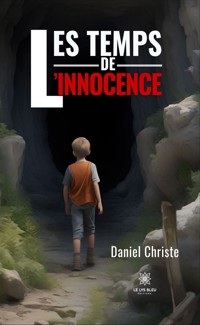
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En 1944, Paul, âgé de onze ans, découvre un soldat allemand caché dans une cave parmi les maisons détruites par les bombardements. Malgré son jeune âge, débrouillard, volontaire et plein d’humour, il décide de lui venir en aide à tout prix avec le soutien de ses parents. Ce sont ces moments vécus intensément que l’auteur fait revivre dans ce roman poignant et drôle à la fois.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Daniel Christe s’est lancé dans une série de concours de nouvelles et le talent qu’il a déployé dans certaines de ses créations a su retenir l’attention du jury. Dès lors, l’idée de les laisser sommeiller dans un tiroir lui est apparue comme un gâchis, l’incitant de fait à une initiative audacieuse : les partager avec le monde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Christe
Les temps de l’innocence
Roman
© Lys Bleu Éditions – Daniel Christe
ISBN :979-10-422-2220-8
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Avant-propos
Je vous confirme, chers lecteurs, qu’il s’agit bien d’un roman. Mais Hans, Paul et Angélique, les héros de cette fiction, ont tous les trois peut-être réellement existé et vécu durant une délicate époque parfois laborieuse, mais incontestablement cruelle. Sauf dans le cas de faits historiques vérifiés, toute ressemblance avec des personnes vivantes ou mortes serait purement fortuite.
L’auteur
Prologue
Paul fut soudain pris d’une envie folle de retrouver sa ville quittée au milieu des années cinquante pour rejoindre un premier emploi, alors qu’il allait fêter ses dix-huit ans. Vingt ans qu’il n’avait pas revu ses clochers, le quartier de son enfance et le centre-ville dont la reconstruction venait juste de débuter après plus de quatre ans d’occupation allemande.
Il laissa volontairement la voiture sur la place de l’hôtel de ville, préférant fouler les trottoirs maintenant élargis de la principale et nouvelle avenue créée de toute pièce et baptisée au nom du glorieux Maréchal De Lattre. De magnifiques boutiques, presque toutes reconstruites en pierres de taille dorées provenant des carrières de la région, lui donnaient belle allure. Enlacé par deux bras d’une Seine tout juste née, son cœur gravement atteint par les bombes ennemies était devenu encore plus harmonieux qu’avant sa destruction. Une ville moderne et accueillante.
Neuf heures sonnèrent au clocheton de la mairie, seul bâtiment officiel avec l’ancienne sous-préfecture reconvertie en école maternelle à ne pas avoir subi les blessures des bombes, quand Paul aperçut un léger voile de brume s’échapper de la rivière pour se perdre dans un ciel d’un bleu pur et intense. La journée promettait d’être belle, comme le sont celles annonçant l’été. Le second pont de Seine franchi, Paul emprunta la rue du maréchal Leclerc, autre grande figure de la victoire française, anciennement appelée rue de l’Isle et traversant l’ancien cœur de la cité. À croire que les crédits s’étaient rétrécis au fur et à mesure de la reconstruction, car les moellons bien tranchés avaient fait place aux parpaings de béton heureusement dissimulés derrière de chatoyants crépis.
Aussitôt, lui revinrent en mémoire ces matins où, en retard pour l’école, il courait à perdre haleine parmi les décombres et les rues défoncées, véritables carrières de pierres, afin d’arriver à l’heure. Continuant son chemin, il reconnut la maison Philandrier de style Renaissance devenue un superbe musée abritant un joyau du cinquième siècle avant J.-C. : le réputé Trésor de Vix. Il s’agit en fait d’une sépulture princière de la dame de Vix, princesse gauloise, datant de la fin du premier âge de fer et probablement offerte par les Romains en guise de droit de passage sur le domaine gaulois. Celle-ci, allongée sur un chariot funéraire en bois, était parée de bijoux précieux dont un torque en or de plus de six cents grammes, chef-d’œuvre de l’orfèvrerie celte. À ses côtés fut retrouvé un cratère de bronze d’une dimension hors du commun (un mètre soixante-quatre) à l’esthétique admirable témoignant la puissance de l’art grec et servant au transport de vin ou d’huile.
À quelques dizaines de mètres, l’église Saint-Nicolas, fière de son nouveau clocher détruit par une bombe incendiaire, invita Paul à lui rendre visite. C’est ici qu’il y fut baptisé et célébra sa première communion. Les vitraux, inondés de soleil, lui semblèrent encore plus majestueux. La rue du même nom menait tout droit chez ses parents aujourd’hui décédés. Tout lui parut réduit, rapetissé par rapport aux images confiées à sa mémoire d’enfant. La rue du même nom, qu’il trouva bien moins longue et moins large qu’il ne le pensait, restait cependant toujours aussi pentue. En haut, l’ancienne prison, également de style renaissance, avait fait place à la bibliothèque municipale. C’était bien plus rassurant et engageant.
Reprenant son souffle, il gravit un escalier de seulement quelques marches, raccourci protégeant les piétons de la circulation de la rue des Avocats où se tenait l’ancien palais de justice toujours aussi majestueux, mais aujourd’hui reconverti en salle des ventes, ce qui prête tout de suite moins au respect. Sans qu’il y prenne garde, le souvenir de Théa, son premier chagrin d’amour, lui revint en mémoire. Il lui suffisait d’un léger détour pour retrouver sa maison, mais si par hasard ils devaient se croiser, se reconnaîtraient-ils ? Oseraient-ils cette fois se parler ? Il renonça aussitôt à cette futile démarche.
Sur les décombres qui furent longtemps son terrain de jeu et celui de ses copains, les maisons détruites étaient toutes reconstruites. Dans les rues, pas un souffle de vent ni le moindre cri d’enfants. Révolus, les rassemblements de commères comme il les avait connus, debout, bras croisés sur leurs ventres bedonnants, les cancans étant inévitablement à l’ordre du jour et pouvant les occuper pendant parfois plusieurs heures. L’atelier de son père, condamné définitivement au silence, ajoutait encore à la morosité du quartier. À croire que ses habitants devenus des vieillards étaient tous vautrés dans leur fauteuil à regarder la télévision.
Son regard fut néanmoins aussitôt attiré par la vue d’une belle et grande demeure occupant maintenant pratiquement tout l’espace tenu auparavant par trois maisons. Curieux, Paul s’approcha du portail resté entrouvert et redécouvrit l’entrée de ce qu’il appela longtemps le « souterrain » enrichie dorénavant d’une solide porte en chêne, gardienne de tous ses secrets d’alors. Avec un peu d’imagination, il entendrait presque le bruit des machines de son père et les éclats de voix d’enfants construisant des cabanes ou jouant à la guerre.
Oui, la guerre, la véritable, la cruelle guerre était passée par là. Après quatre ans d’occupation, chassés par la Résistance et les troupes françaises, les Allemands quittèrent enfin la ville en septembre mil neuf cent quarante-quatre, abandonnant une cité détruite et ruinée. Juste derrière la maison de ses parents, bien que dégagée de ses pierres et des gravats, une végétation sauvage s’était accaparée des lieux devenus vite un espace de divertissement offert aux garnements du quartier. Heureusement, leurs jeux furent loin d’être aussi sanglants, les rares blessures étant dues soit à l’effondrement de tôles dissimulant une entrée de cave recouverte d’herbes et de ronces, soit à une pierre lancée par hasard, juste pour prouver la force et la précision du geste de l’apprenti guerrier. Il en garde d’ailleurs encore des traces. Mais pourquoi ce souterrain éveilla-t-il aussitôt de si lointains et émouvants souvenirs ?
Appuyé contre le portail, Paul ferma alors les yeux, s’enfonçant avec bonheur dans sa mémoire d’enfant sans toutefois connaître les véritables raisons le poussant à se retourner sur les sentiers du passé. Il repensa au gamin qu’il était, « le gavroche » comme, l’appelait son père. C’était un gamin déluré, intrépide et moqueur, mais brave cœur, faisant néanmoins figure de petit chef aux yeux de ses copains de jeux.
À l’entendre, il avait toujours été comme un oiseau au bord du nid. Prêt à s’envoler, à profiter d’une vie qu’il inventait presque au jour le jour. Même à onze ans, il restait toutefois conscient qu’auprès des siens, il vivait une jeunesse intense et heureuse, emprunte d’une liberté que beaucoup d’enfants lui envieraient aujourd’hui. Il avait cependant toujours su se faire petit, une poussière de garçon turbulent afin de trouver un espace de liberté. D’instinct, il avait choisi les décombres, là où il pouvait construire son propre toit, une cabane creusée dans les ruines des maisons détruites par la guerre.
Ses parents travaillaient, le nourrissaient, sans trop jamais s’inquiéter de ce qu’il pouvait faire, ignorant jusqu’aux verbes aimer, cajoler, encourager, embrasser. Mots bizarres qu’ils n’avaient certainement jamais entendus eux-mêmes, donc bien incapables de reproduire. Mais comme Paul ne connaissait pas ces verbes, il n’avait donc jamais souffert de leur absence. Pas de violence à son égard ni de jugements haineux envers leurs prochains, des petits riens qui forment et éduquent un enfant et dont il leur en sait gré ! Dans sa première enfance, ils avaient toujours pris soin de laisser place à ses rêves, à ses rires, à ses jeux, et à gérer une autonomie dont il n’avait d’ailleurs jamais abusé. Jusqu’à dix ans, date de sa première révolte, ils étaient fiers l’un envers l’autre, le fils admirant l’enthousiasme et la culture de son père. À compter de ce jour, leur comportement changea brutalement, faisant semblant de s’ignorer. Adolescent, Paul fut encore plus sévère dans ses jugements envers son paternel, alors qu’il adorait sa mère.
Chapitre 1
C’est pourtant au moment où tout semble perdu, où le désespoir est total, que soudain la lumière nous éclaire.
Les souterrains, les cavernes, il en avait une peur bleue, sa mère lui ayant raconté des histoires de disparitions d’enfants imprudents perdus dans le ventre de la terre sans jamais que leurs corps ne soient rendus. Guidé par la curiosité et d’un peu de courage coloré d’un soupçon d’appréhension, Paul, onze ans, décida néanmoins de franchir cette ouverture donnant accès à un endroit qu’il ne sut jamais exactement qualifier. Caverne, tunel, souterrain ? Il préféra le mot souterrain, beaucoup plus mystérieux. Au-dessus de cinq mètres de roche et de terre, se trouvaient en effet le jardin et le poulailler de madame Quidi, voisine de l’atelier de son père.
C’est avec une certaine appréhension qu’il pénétra prudemment dans ce lieu méconnu. Ses yeux mirent de longues secondes avant de s’habituer à l’obscurité. La fraîcheur le surprit. Parmi un tas de feuilles rapportées par le vent, Paul perçut le discret bruissement de quelques rongeurs et une affreuse odeur d’urine et de merde. Quel monstre inconnu pouvait-il bien abriter ? Il avait lu tant d’histoires sur les revenants et les fantômes, qu’il hésita à poursuivre son exploration. L’inventaire fut néanmoins vite fait. En dehors d’une vieille charrette à bras, étroite et vermoulue encombrée d’un reste de paille, il remarqua quelques bouteilles vides jonchant le sol et plusieurs poutres de bois en parfait état de décomposition. Le lieu lui parut désolément vide et beaucoup moins profond qu’il ne l’avait envisagé. Malgré le vent qui s’y engouffrait à son aise, l’insoutenable puanteur l’obligea cependant à quitter les lieux plus tôt qu’il ne l’aurait voulu malgré son insatiable curiosité.
Conscient de n’avoir certainement pas tout exploré, obstiné, Paul décida d’y retourner le jeudi suivant, mais cette fois muni d’une lampe empruntée en cachette à son père. Il fut surpris de constater que les mauvaises odeurs étaient nettement moins fétides ce jour-là. Lorsqu’il dirigea le faisceau lumineux droit devant lui, il découvrit que le souterrain se prolongeait au-delà d’un mur de séparation doté d’une entrée donnant accès à une autre cave. Malgré sa peur d’enfant, le tremblement de ses jambes et le cœur en nette accélération, le jeune curieux eut fortement envie de poursuivre son exploration. Tout au fond, un pudique rai de lumière provenant d’une minuscule ouverture aux trois quarts, comblée par des gravats, lui permit ainsi de mieux découvrir l’espace. Paul n’avait cependant pas fait deux mètres quand il entendit, avec stupeur et effroi, une voix gutturale vociférer : Raus ! Schnell !
N’ayant pas jusque-là remarqué la moindre présence humaine, l’explorateur en herbe, prenant ses jambes à son coup, déguerpit précipitamment sans se retourner ni même avoir éteint la lampe fourrée au fond de sa poche. Sans qu’il y prenne garde, une fois l’air libre retrouvé, son corps trembla des pieds à la tête sans qu’il puisse retenir ses larmes. De trouille. De honte aussi, s’estimant un piètre explorateur.
De retour à la maison, étonnée de son état, sa mère questionna son chenapan de fils : Mais où étais-tu donc fourré ? T’es certain d’avoir fait tes devoirs et appris tes leçons ? Elle le crut sur parole quand il lui répondit par l’affirmative. Approche un peu ! lui dit-elle, qu’est-ce donc qui brille au fond de ta poche ? Ainsi la lampe venait de le trahir. Penaud, il lui avoua l’avoir empruntée pour rechercher le couteau de son copain Bernard égaré dans leur cabane mal éclairée. Elle acquiesça tout en le prévenant : heureux que ton père ne soit pas là. Il a horreur que l’on touche à ses affaires. Paul s’inquiéta, non pas que son paternel fût mis au courant, mais qu’on lui interdise d’emprunter cette foutue lampe. Oserait-il d’ailleurs encore poursuivre son exploration sachant ce souterrain habité par un inconnu ne parlant même pas le français ?
Bernard se vantait souvent d’avoir une mère connaissant plusieurs langues. Aussi, oubliant volontairement de lui donner trop de détails, Paul lui demanda si elle pouvait traduire ces quelques mots incompris reçus en pleine tronche et qui lui avaient fait si peur.
— Ben, t’aurais pu d’mander à ton père, lui qu’a fait la guerre. Maman croit qu’en allemand, ça veut dire : fous le camp ! Et en vitesse ! Mais où est-ce que t’as entendu ça « Gav » ?
— Ben c’est l’voisin, tu sais ce vieux soûlard alsacien qu’on chahute quand y cuve son vin dans la ruelle. J’m’étais approché p’t-êt un peu trop près, quand y’m’bafouilla ces mots dont j’ne compris pas l’sens.
Inconsciemment, Paul avait cependant bien saisi leur signification quand, gagné par la peur, il s’était sauvé à toute vitesse. Apparemment, il s’agissait donc probablement d’un Boche qui se planquait dans ce souterrain. Ben ça alors ! Qu’est-ce qu’il foutait là, deux mois après leur départ de la ville ? Peut-être un traître ou un lâche n’ayant pas voulu regagner son pays ? Voire aussi un criminel ? Autant de questions l’encourageant à continuer malgré tout son enquête.
Le jeune explorateur s’était longtemps creusé les méninges pour savoir comment, sans lampe, il pouvait envisager une prochaine expédition. Entendant son chien aboyer, la solution lui vint immédiatement à l’esprit. Pourquoi n’y avait-il pas pensé plus tôt ? Bobette, croisée de labrador et de berger belge (ou peut-être bien allemand) allait donc pouvoir le guider et éventuellement le défendre en cas d’attaque du squatteur. À moins qu’il ne soit malveillant et armé ! Ce qui le fit réfléchir sans toutefois qu’il envisage une seconde d’abandonner son projet.
À la seule vue de la laisse, Bobette savait qu’elle allait l’accompagner pour une balade le plus souvent champêtre, lui arrivant même de la lui apporter sans être sollicitée. Évidente invitation pour une sortie quelconque. C’est elle aussi qui se chargeait de veiller sur le landau où se tenait son jeune frère Michel lorsque sa mère, se trouvant dans les longues files d’attente devant l’épicier ou le boucher, devait le délaisser pour parfois de longues heures.
Lorsqu’ils furent proches de l’entrée, Paul décida de mettre Bobette en laisse tout en la priant de ne pas aboyer. Ce qu’elle savait faire sur demande. Quand les ténèbres le surprirent, il se fia à la capacité de sa chienne à se diriger dans l’obscurité, même la plus complète. Reniflant tout sur leur passage, elle s’immobilisa net, comme un chien de chasse à l’arrêt, tout en interrogeant son maître du regard. Pas un bruit, pas le moindre mouvement perceptible alors que Paul savait y trouver ce squatteur. Ils avancèrent lentement, prenant mille précautions, quand l’animal se mit à grogner et tirer énergiquement sur la laisse. Tout juste entrés dans la deuxième partie du souterrain, ils se trouvèrent alors face à un homme, bras levés, comme s’il s’était senti menacé par une arme. D’une voix que Paul crut suppliante, il s’adressa à lui, mais cette fois en français.
— Ne crains rien mon petit. Je ne suis pas armé. Surtout tiens bien ton chien en laisse, je ne te ferai aucun mal.
— Vous m’avez quand même foutu une sacrée trouille. Qui êtes-vous et que faites-vous dans c’te sinistre endroit, lui dit-il d’un ton mal assuré et le cœur battant ?
— Cela fait bientôt deux mois que je me terre ici. À la libération de la ville, je n’ai pas voulu suivre mon régiment en fuite pour un nouveau front. Je suis un poltron qui ne voulait plus ou pas de cette guerre. Mon pays et ma famille me manquent, mais il m’est dorénavant impossible d’y retourner. Je suis un homme abattu et perdu. Tu sais, la solitude et la faim ne font pas toujours bon ménage.
— Comment qu’vous faites alors pour vous nourrir, vous laver, vous soigner et vivre sans l’moindre contact avec le monde ?
— Ce n’est pas facile, mais j’y parviens. J’ai appris auprès des Français à devenir débrouillard, ce que je n’étais pas jusque-là. J’aurai au moins découvert cette qualité. Si c’en est une !
— Puis-je vous aider ?
— Oui, bien sûr. Surtout en ne me dénonçant pas à la police ni à aucun de tes voisins. Et si tu le veux bien, en devenant mon ami.
— OK. J’reviendrai vous voir régulièrement, l’jeudi matin d’préférence, si mon père n’m’embauche pas à son atelier d’ébénisterie ou si j’n’ai pas répétition à la chorale des p’tits chanteurs. L’après-midi, j’vais au patronage du curé. C’est super. On joue au foot, ensuite y a toujours un jeu de piste préparé par l’abbé. À dix-sept heures, chocolat chaud, puis les épisodes de Tintin au cinéma muet. En fait, c’est comme une bande dessinée projetée sur un grand écran d’au moins un mètre carré. Ça m’plaît beaucoup.
— Programme chargé dis-donc. Tu ne t’ennuies jamais !
— J’n’ai pas l’temps. En plus, v’là qu’mon père s’est mis dans la tête de m’inscrire à la musique. Répétitions tous les mardis soir. C’est sans compter que dès l’mois d’avril j’vais, avec les copains, r’pérer les nids de pies et de corbeaux avant qu’ne poussent les feuilles. En juin, on va les dénicher en récoltant les œufs qu’la société d’chasse nous rachète à dix centimes pièce. Ça paie nos cibiches et nos pains au chocolat.
— Cibiches… ?
— Des cigarettes, quoi !
— C’est pour moi un mot inconnu. Alors comme ça, tu n’aimes pas la musique ?
— J’ne comprends rien au solfège. Mon père avait appris le violon et la flûte m’a-t-il confié un jour, mais j’ne l’ai jamais entendu en jouer.
— Pour ma part, j’adore le violon, mais ne suis qu’un débutant. Ça me plaisait beaucoup d’aller aux répétitions. Mobilisé en mai trente-neuf, ce fut une autre musique !
— Lui aussi a fait la guerre. Sur le front belge. Il a été décoré, mais nous a assuré n’avoir tué aucun Allemand. Il dit toujours qu’il n’a pas eu l’temps, devant fuir un ennemi allant plus vite que lui. C’est moche quand même de s’taper dessus sans savoir pourquoi !
— Tu sais mon petit, les Français et les Allemands n’avaient aucune envie de se battre et encore moins de mourir ou devenir infirmes. La faute en revient à nos dirigeants assoiffés de conquête et de gloire. Leurs ordres ne sont pas toujours reçus avec enthousiasme, mais nous, pauvres citoyens lambda, devons obéir sous peine d’être fusillés. C’est la même chose dans les deux camps, tu sais. Je n’ai jamais cru que nous gagnerions cette guerre, aussi, je fus presque heureux et soulagé de voir les Anglais et les Américains se joindre à vos côtés. Et je m’en réjouis chaque jour, malgré ma condition devenue par ma faute plus que précaire.
— Vous avez tué des Français ?
— Si j’en ai blessé ou tué, c’est par inadvertance, car je ne les visais jamais. C’est peut-être pour ça qu’on m’a rapidement relégué à l’intendance : cuisine et corvées ménagères. J’étais presque un planqué. Quand nous sommes arrivés dans votre charmante petite ville, tout a changé pour moi, grâce à l’oberlieutnant Freitag (lieutenant-colonel) qui me confia une mission bien plus pacifique dont je te parlerai plus tard si cela t’intéresse. Pour vous, sa présence fut également opportune. C’était un homme autoritaire, mais droit et épris de justice et qui n’appréciait pas les méthodes nazies, et encore moins leurs crimes.
Eh bien voilà, en peu de temps, Paul venait de se faire un super copain ! Il avait cependant encore beaucoup de choses à lui demander au sujet de la guerre, des détails que son père refusait de lui confier. T’es bien trop jeune pour comprendre tous ces évènements vécus depuis bientôt cinq ans, affirmait-il dès que son fils désirait se renseigner. Des mots nouveaux et inconnus revenaient pourtant souvent dans les conversations comme : collabo, maquisard, opportuniste, magouilleur, marché noir, cupide, traître et bien d’autres qualificatifs qui n’avaient aucune signification pour un enfant. Jules, son instituteur préféré, avait bien expliqué l’inutilité des guerres et leurs désastreuses conséquences lors de ses cours d’histoire, mais Paul demeurait curieux de savoir comment cela s’était précisément passé dans sa ville pendant ces quatre années d’occupation. Par contre, son père n’hésitait pas à lui parler avec toujours beaucoup d’empathie et de respect, de Frantz, ce soldat allemand que la Kommandantur lui avait imposé à l’atelier et dont la présence ne fut jamais une gêne, bien au contraire.1
Maisaujourd’hui, accepterait-il que son gamin devienne l’ami d’un déserteur en situation irrégulière et dont il ne se méfie pas suffisamment ? Pas sûr ! Mais Paul savait être discret et ne lui raconta rien, ayant promis de se taire comme le lui avait demandé celui dont il ne connaissait même pas encore le prénom.
Ce soir-là, dans le silence de sa chambre, il revécut ces instants un peu fous d’une rencontre tout à fait inattendue et essaya de se remémorer la haute silhouette de cet inconnu au visage mangé par une barbe rousse et fournie. Dans la semi-obscurité des lieux, l’apprenti explorateur avait été surpris par la douceur de son regard et la surprenante couleur de ses yeux très clairs. Son uniforme crasseux lui fit penser aussitôt au père Calsson, clochard vivant lui aussi dans des conditions précaires tout en bénéficiant d’une liberté dont était privé son futur ami. Il se demanda toutefois où pouvait le mener cette nouvelle amitié avec un homme bien plus âgé que lui. En fait, il ressentait fortement ce besoin essentiel d’explorer, de rendre aussi service à ceux se trouvant en difficulté, sans jamais réfléchir aux éventuelles déconvenues. Et puis, il aimait manifestement l’aventure, le risque aussi. Il n’avait donc, selon lui, aucun mérite.
Toujours, en quête de projet, Paul pensait déjà à sa prochaine visite, jugeant toutefois préférable que Bobette ne l’accompagne pas. Par pure discrétion. Il aurait aimé surprendre son nouvel ami en lui apportant une orange, comme on le fait à ceux que l’on va visiter en prison. Il paraît que ça se fait.
Malheureusement, il ne connaissait ce fruit que de nom, sa mère lui ayant expliqué toutes les qualités de cet agrume qu’elle avait eu la chance de goûter une seule fois chez ses anciens patrons. Elle promit, la guerre finie, que le père Noël en apporterait une ou deux à son jeune frère ainsi qu’à lui, à la seule condition que les tickets de rationnement soient supprimés et les magasins approvisionnés. Cela allait demander encore quelques années. Voilà bien longtemps que Paul ne croyait plus à ce brave et généreux vieillard venu, une fois par an, distribuer quelques confiseries, mais faisait semblant, juste pour ne pas décevoir son frangin.
Résolu à en connaître un peu plus sur ses conditions de vie et les raisons l’ayant poussé à trahir son engagement militaire, Paul se présenta à nouveau devant cet étranger sans aucune appréhension.
— Bonjour monsieur.
— Ah te voilà ! Bonjour, jeune homme. Au fait, comment te prénommes-tu ?
— Pour de vrai, c’est Paul, mais les copains m’appellent « gav », pour gavroche. Et vous ?
— C’est chouette et élogieux comme surnom !
— Vous croyez ?
— Sais-tu que ce mot a comme origine : Paix ? C’est pas formidable ?
— Vous en connaissez des choses. Alors, vous n’m’avez toujours pas dit comment vous vous appeliez !
— Hans ! Prénom pas trop difficile à retenir. Tu peux me tutoyer, tu sais. Où habites-tu ?
— À cent mètres d’ici, juste un peu plus haut. Vous… tu… n’connais pas l’coin ?
— Je te mentirais en te disant non. Mais bien entendu, je ne sors que la nuit, quand tous les chats sont gris. Je suis devenu, par obligation, un véritable noctambule.
Noctambule ?... Curieux, Paul retint ce qualificatif dans un coin de sa mémoire. Sa mère allait certainement lui expliquer la définition de ce mot méconnu. Du tac au tac, il lui répondit toutefois :
— Tu sais, mon chat est blanc, même la nuit !
— Tu as raison. C’est juste un dicton français.
— J’peux te poser une question ?
— Bien entendu.
— T’es un Boche toi ?
— Si tu veux, mais je préfère que l’on dise Allemand. Cet horrible qualificatif vient de bosch, traduction de têtu, obstiné ou borné. En français vous dites « tête de lard » ! Ce que je ne suis pas, je pense.
— Bon, alors on s’ra copains ! Mais où est-ce que t’as appris à parler l’français, en plus presque sans accent ?
— Avant la guerre, poursuivant des études de langues étrangères à Paris, j’ai travaillé comme garçon de café pour me faire un peu d’argent de poche. Rue de la Paix en plus. Rien de tel pour apprendre à parler correctement. J’ai rencontré beaucoup de touristes, des Britishs, des Italiens et quelques Amerloques.
— Et tu parles toutes ces langues ?
— Je me débrouille. Mais le français est celle que je préfère. Je m’améliore chaque jour, sauf depuis mon enfermement volontaire. Mais avec toi, je suis certain de progresser.
— Tu m’apprendras l’allemand ?
— Nein ! Tu risquerais de me trahir et toi aussi par la même occasion.
— Dommage. Alors, raconte-moi comment tu fais pour manger, dormir et tout l’reste.
— J’avais déjà remarqué que tu étais un petit curieux. Je vais tout t’expliquer puisque cela te semble important. Mais… chut. Ne dis rien à qui que ce soit.
— Ok Hans !
— Je vais te raconter l’histoire de mon arrivée dans ta ville. Ainsi, tu comprendras beaucoup mieux pourquoi j’ai désiré et pu néanmoins m’adapter à cette vie de taupe. Parlant couramment votre langue, je fus chargé par le chef de la Kommandantur de la traduction de toutes les lettres anonymes de dénonciation ou des plaintes d’habitants mécontents du comportement de nos soldats. C’est fou ce que j’ai été amené à lire. Je fus même étonné de voir vos concitoyens, parfois même des bourgeois, aller jusqu’à dénoncer et trahir leurs prochains. C’est pourquoi je connais beaucoup de choses, le courage de certains, mais aussi la lâcheté, la cupidité et la haine viscérale envers leurs propres voisins pour d’autres. J’avais souvent du mal à croire et accepter que l’on puisse être aussi félon avec ses congénères et sa patrie. J’entrerai dans le détail plus tard si tu le désires. Pour l’heure, et pour répondre à ta question « alimentaire », je sais où me ravitailler à pas cher. Pour rien même, puisque je me retiens de voler. Sous le porche où la mère Malard stocke ses cageots vides, je trouve toujours, si les rats ne sont pas passés avant moi, quelques fruits ou légumes défraîchis que je me suis habitué à manger crus. Ici, impossible de faire le moindre feu au risque d’alerter le voisinage, même si la première maison encore debout est à plusieurs dizaines de mètres. De plus, la rue est très passante. Je n’ai donc pas avalé le moindre morceau de viande depuis bientôt trois mois. Je trouve aussi du pain, dur il est vrai, mais bien meilleur que celui que l’on nous servait à la cantine. Il suffit de visiter les poubelles des notables ou tout simplement celles des deux boulangers en bas de la rue Saint-Nicolas. Pour me laver et nettoyer mes sous-vêtements plus qu’usés, je vais au lavoir sur la route de Montbard, alimenté par un bras de Seine. Sauf lorsqu’il fait trop froid. Alors je pue et cela me contrarie énormément.
— Ben ici aussi ça chlingue, et puis pas qu’un peu !
— Que veux-tu dire par chlingue ? C’est du patois d’ici ?
— Non, c’est pas du patois. Chlinguer est un verbe familier, explique le Larousse, pour dire puer ou « ça sent pas la rose » si tu préfères.
— Jà, jà… nous utilisons presque le même verbe pour dire à quelqu’un qu’il sent mauvais de la bouche. Je comprends, mais tu sais, je n’ai pas d’autres endroits pour faire mes besoins sous peine de me faire repérer.
— Bon, alors finis ton histoire.
— Il m’arrive aussi d’emprunter, je n’ose pas dire voler, quelques fringues oubliées sur des fils à linge. Voilà, tu sais tout concernant ma façon de survivre. Parfois, je l’avoue, je rêve aussi d’une bonne choucroute et d’un verre de riesling, mais je me fais vite une raison.
— Ah, j’comprends maintenant pourquoi qu’la Germaine s’plaint parfois d’voir disparaître les caleçons du Pierrot !
— Pauvre Pierrot ! Qu’il me pardonne ! Privé de cet indispensable sous-vêtement, il doit être bien malheureux !
— Oh, tu sais, j’n’en porte pas et mon père non plus. Il dit qu’on n’a pas les moyens. Ça doit peut-être coûter cher ? À l’école, y en a plusieurs qu’en portent pas !
— Les Français m’étonneront toujours ! Mais ce n’est pas grave, c’est justement cette décontraction qui me plaît chez vous. Franchouillards, aussi bien dans leur humour que dans leur comportement, j’admire leur courage et leur détermination, car il en fallait pour entrer dans la Résistance et combattre l’armée allemande considérée jusque-là comme la plus puissante d’Europe. Chez nous, en Allemagne, tout est beaucoup plus strict, rigide et réglementé. Une majorité d’entre nous ont suivi Hitler comme des moutons égarés, jusqu’à laisser leurs enfants s’engager dans les jeunesses hitlériennes. Nous sommes différents, mais votre mentalité est loin de me déplaire.
— Sur ce, il est temps que je regagne la maison, car même si nous n’sommes pas très disciplinés, comme tu dis, j’risque quand même de m’faire engueuler si j’rentre trop tard. Dis-moi Hans, qu’est-ce qui t’ferait plaisir que j’puisse t’apporter à ma prochaine visite ? Tu n’penses pas que tu devrais te débarrasser d’ton infect uniforme ?
— Merci, Paul, c’est surtout de ta visite dont j’ai le plus besoin. Pour le reste, je me débrouille !
Dire que Hans était au courant de plein de choses ! Comme ancien garçon de café, Paul pensa qu’il connaissait peut-être même sa tante, serveuse à la brasserie « Onrit », rue de la gare. Ça aurait été un rien rigolo s’ils avaient pu se retrouver. Futée comme elle est, elle lui aurait vite trouvé une solution pour le sortir de ce trou malsain.
Paul interrogea sa mère sur le sens du mot noctambule, certain, contrairement à son père, qu’elle lui répondrait sans lui poser tout un tas de questions.
— On dit d’une personne qu’elle est noctambule ou couche-tard, quand elle traîne la nuit dans les rues, pour parfois faire la fête.
Il pensa aussitôt à Hans. Ça ne pouvait pas être son cas de faire la fête en pleine nuit. Ou alors il lui mentait. Quand Paul lui avait proposé son aide, il s’était demandé quel surprenant cadeau serait susceptible de lui plaire. Grâce à quelques pièces glanées en revendant de vieux cartons chez l’unique chiffonnier de la ville, il lui acheta un paquet de P4 comptant seulement 4 cigarettes de tabac gris pour le prix dérisoire de cinq francs (de l’époque) et réservé aux fumeurs plutôt fauchés. On appelait ça « Les Parisiennes ». Quand il lui offrit, Hans le regarda d’une façon étonnée pendant plusieurs secondes, retournant l’emballage dans tous les sens, surpris qu’un aussi jeune gamin, apparemment démuni, puisse avoir eu cette attention. Il s’approcha, puis le prit dans ses bras avant de lui baiser tendrement le front et les cheveux. Pour la première fois, l’enfant constata qu’effectivement il puait. Puis, sourire revenu, il lui rendit le cadeau.
— Je suis désolé mon ami, mais je n’ai jamais fumé de ma vie. De toute façon, je n’aurais même pas de quoi en allumer une.
— Merde ! J’ai oublié les allumettes.
— Offre-les à ton père, ça lui fera certainement plaisir.
— Pis quoi encore ! On va les fumer dans la cabane avec les copains. Pour tromper les parents, on allume alors un p’tit feu qui la plupart du temps nous enfume, comme ça, ni vu ni connu j’t’embrouille !
— Traduction ?
— Ben comme ça ils ignorent qu’nous fumons aussi. D’ailleurs, y n’viennent jamais nous voir. Surtout les miens.
Déçu, Paul pensa aussitôt à une autre idée qui cette fois rendrait certainement service à son nouvel ami. Discrètement, il alla donc fouiller dans le grenier où il savait trouver un vieux réchaud à alcool ayant appartenu à ses grands-parents. Après l’avoir bien nettoyé, surtout son superbe réservoir en cuivre, il l’enveloppa dans un journal jauni datant presque de la même époque et se mit en quête d’un litre d’alcool à brûler trouvé à la droguerie installée provisoirement au cours l’Abbé. C’est d’ailleurs dans ces baraquements temporaires, mais malgré tout confortables, que tous les commerçants sinistrés avaient été regroupés. Juste avant d’offrir son cadeau à Hans, il vérifia l’étanchéité du système d’alimentation qui, heureusement, ne cachait ni trou ni faille et n’oublia surtout pas les indispensables allumettes.
Le jeune aventurier se demanda toutefois qu’elles pouvaient être les raisons l’incitant à faire ce cadeau à un individu qu’il connaissait à peine. Qu’attendait-il de lui ? Une amitié, une protection ou une aide quelconque ? Après tout, avait-il besoin de savoir ? Quand il se présenta, fier et souriant, le squatteur ne vit que le paquet emballé grossièrement. Croyant tout d’abord à une farce, il s’en saisit tout en remerciant son généreux bienfaiteur.
— Ça m’a l’air bien lourd pour être des cigarettes cette fois. Qu’as-tu donc encore inventé ?
— Ben déballe, tu verras bien !
Apparemment, Hans ne parut pas pressé, comme s’il voulait prolonger son plaisir, alors que Paul attendait sa réaction avec beaucoup d’impatience. Faisant l’étonné, il regarda l’objet comme s’il n’en avait jamais vu de semblable.
— Alors, voyons… À quoi cela peut-il bien servir ?... Ne serait-ce pas un chauffage d’appoint ?
— Tu brûles. C’est l’cas d’le dire. Tu donnes ta langue au chat puisque tu n’sembles pas capable d’savoir de quoi il s’agit ?
— Malheureux ! Tu n’y penses pas ! Tu me vois sans langue ?
— Vouai, mais rassure-toi, j’doute que nos chats apprécient les langues allemandes ! En fait, où tu fais l’imbécile ou t’es vraiment bête. C’est un réchaud, pour qu’enfin tu puisses manger chaud.
— Super ! Explique-moi comment ça marche.
Paul alla chercher le litre d’alcool caché à l’entrée du souterrain et remplit le réservoir avec mille précautions.
— Bon, jusque-là tu suis ? Maintenant, t’ouvres ce p’tit robinet et dès que t’aperçois couler l’alcool, tu craques une allumette que voici et l’liquide s’enflamme aussitôt. Tu peux aussi régler l’débit et la puissance du feu. Il suffit qu’tu mettes ta gamelle contenant par exemple des patates ou d’l’eau et l’tour est joué. Pour plus d’sécurité, installe-le derrière le mur, car en pleine nuit on pourrait repérer la lueur des flammes.
— Merveilleux ! Dommage, je n’ai ni gamelle ni patates !
— Y t’manque toujours quelque chose toi ! Pour la gamelle, c’est pas trop difficile, j’te trouverai bien une boîte de conserve vide. Pour le reste, t’iras voir dans les cageots d’la mère Mallard !...
— T’es un petit rigolo, mais un adorable ami. Je te remercie du fond du cœur. Je me souviendrai longtemps de toi.
— Parce que tu penses bientôt partir ?
— De mon plein gré peut-être pas, mais je ne pourrai pas passer ma vie dans cette caverne. Il faudra bien qu’un jour je me rende. J’ai très peur des prisons françaises et surtout de ne plus te voir.
— Dis-moi Hans, je pourrais bien faire tes courses si t’as besoin d’ravitaillement.
— J’ai besoin de tout, mais ne dispose pas du moindre argent. Il doit me rester quelques deutsche marks, juste de quoi acheter des allumettes.
— C’est d’jà ça ! Vous n’étiez donc pas payés comme soldats ?
— Au début si. Mais depuis le débarquement des alliés, nous ne recevions plus notre solde. Les transferts d’argent étant soi-disant bloqués par Berlin. Où par celui auquel on doit tous nos malheurs. Tu vois de qui je veux parler ?
— Ah oui ! l’mec à la p’tite moustache ?
Hans ne répondit pas, occupé à découvrir son nouveau jouet. Triste, l’air dubitatif, il fixa son ami comme s’il avait l’intention de lire dans ses pensées. Décidément, Paul allait devoir faire preuve d’ingéniosité afin de trouver une solution permettant à Hans de trouver un meilleur abri avant l’hiver.
Chapitre 2
Quand ils se réveillèrent, tous furent surpris de constater qu’il avait beaucoup neigé durant la nuit. Les toits, les arbres et même les décombres apparaissaient, comme par miracle, d’une éclatante blancheur. En l’espace de quelques heures, la nature était subitement redevenue magnifique. Un leurre bien chimérique cependant. Lilo, le père de Paul, unique tache sombre dans cet univers immaculé, s’évertuait à tracer un chemin carrossable sur les trente mètres séparant la maison de son atelier. Puis le gel fit son apparition. Comme souvent, février s’annonçait rigoureux. Paul ne cessa cependant jamais d’aller visiter son ami qui lui confia avoir renoncé à ses sorties nocturnes et ses difficultés à se nourrir. Plus rien dans les cageots restés vides de la mère Mallard. D’ailleurs, démunis et en manque de légumes, les commerçants ne savaient plus comment venir en aide à la population craignant sérieusement pour leur santé.





























