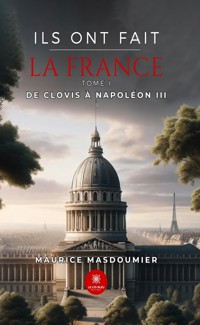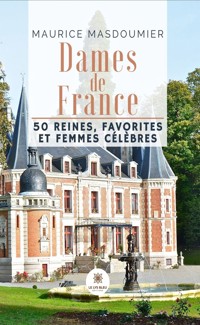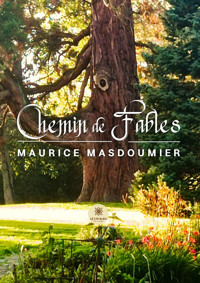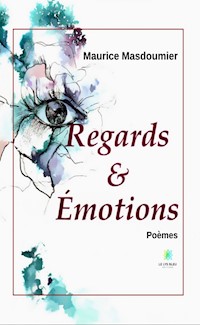Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Lucien des Alois" est un jeune garçon qui, après le départ de son père pour la guerre, se retrouve presque avec la responsabilité de veiller sur les siens. La famille, qui vivait plutôt confortablement, est maintenant dispersée, chacun devant se débrouiller pour survivre. L’aîné des garçons, grâce à son courage, ses compétences personnelles, sa curiosité, son ouverture d’esprit et ses capacités d’observation, guide les siens vers un retour à une vie décente. Ce périple de vingt-cinq ans n’est pas exempt de difficultés, avec ses moments de joie et de tragédie, mais il raconte l’histoire d’une vie de famille.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Maurice Masdoumier est arrivé à l’écriture par la poésie, art que lui a fait découvrir son professeur de français alors qu’il était en classe de première. Entre une existence passée en entreprise industrielle et ses multiples voyages, il a toujours trouvé le moyen de s’offrir un temps de détente pour écrire, représenter une scène, un paysage, un fait divers, exprimer un ressenti ou une trace… Comme autant de bornes sur un chemin de vie. De plus, Maurice a une profonde fascination pour l’histoire. Ainsi, après avoir publié deux recueils de poésie, un ouvrage sur les fables et une étude concernant les femmes dans l’histoire de France, il nous livre un roman sur l’histoire des siens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurice Masdoumier
Lucien des Alois
Roman
© Lys Bleu Éditions – Maurice Masdoumier
ISBN : 979-10-422-2174-4
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
À chacun son chemin.
Ce roman est l’histoire d’une vie : celle de mon père. Il est dédié à ma fille Christine, mon fils Sébastien, mes petits-fils Jean-Guillaume et Pierre-Evan pour qu’ils sachent, un peu plus, qui nous sommes et d’où nous venons.
C’est notre patrimoine commun que je leur transmets, il rejoindra d’autres documents que nous possédons déjà.
C’est notre « trace » et notre « sens ».
Bernadette, mon épouse a partagé souvent avec mon père quelques-uns de ces souvenirs, elle en retrouvera certains.
Une dédicace particulière à Agnès « ma petite sœur ».
J’ai choisi la forme du roman à partir de faits réels (ce sont ceux que mon père, Lucien, nous a rapportés), le décor et le contexte sont romancés, mais le fond est authentique. Il trace le parcours de celui à qui je rends hommage dans ce petit ouvrage : ce fut « son chemin ».
Ici sont relatées les années les plus marquantes de son existence. Ce sont celles qui l’ont forgé, celles qui ont indiscutablement influencé ses choix et son parcours.
Et le fait qu’il m’ait transmis ce vécu a aussi influencé ma vie, il m’a transmis cet esprit de combat devant les difficultés et l’adversité.
J’y ai aussi puisé le sens du respect pour autrui.
Qu’il en soit remercié.
Que ces valeurs perdurent au fil des générations.
Les lieux et les noms des personnes ont été volontairement modifiés, car il ne servirait à rien de culpabiliser tel nom ou tel autre.
Ce qui compte ce sont le fond et le sens de l’histoire que je narre.
D’épines et de miel
Les choix d’une mère
En ce seize mai 1918, Amélie était assise devant le moulin sur le banc de pierre, en réalité c’était un long bloc de granit grossièrement taillé et posé sur deux autres, plus petits, auxquels la nature avait donné l’allure de gros pavés rectangulaires.
Elle était vêtue d’une robe taillée dans de la toile grise, un tablier noir complétait sa tenue. Les cheveux tirés en arrière et rassemblés dans un petit chignon plat et rond comme le font toutes les femmes limousines : c’est sur ce socle qu’elles posent la coiffe ou « barbichet » pour les grandes cérémonies.
Une paire de sabots de bois vernis était posée devant elle.
Amélie soupira et redressa son buste, ce qui mit en lumière la croix dorée qu’elle arborait. C’était un bijou de famille qui venait de sa belle-mère et qu’elle s’efforcerait de transmettre à son aînée.
D’un geste calme, elle saisit le bijou, le porta à ses lèvres puis le remit en place.
Elle venait de terminer le nettoyage des pissenlits qu’elle avait ramassés le matin même autour de son petit jardin, celui qu’elle avait conservé près du moulin.
Dans le creux de son tablier ne restaient que les déchets qu’elle évacua devant elle d’un geste machinal pour le plus grand plaisir des poules.
Ses bras revinrent se poser mollement sur ses genoux dans une attitude montrant toute sa lassitude.
Assis sur une souche, à quelques pas d’elle, son fils, Lucien, l’aîné des garçons et son quatrième enfant, taillait un bâton dans une branche de noisetier.
Lucien avait eu neuf ans quelques jours plus tôt et le couteau dont il se servait était son cadeau d’anniversaire, mais c’était surtout le couteau que son père, Jean, avait laissé en partant rejoindre les troupes françaises en pleine guerre.
Jean s’était porté volontaire au nom des grandes et généreuses idées qu’il défendait et auxquelles Amélie ne comprenait rien.
Tout ce qu’Amélie avait retenu c’est qu’il la laissait seule, à trente-cinq ans avec six enfants, âgés de treize à deux ans, et le moulin.
Ce moulin qui les avait fait vivre et qu’elle avait dû quitter, incapable, bien sûr, de le faire tourner.
Elle était maintenant installée dans une maisonnette attenante de deux pièces avec pour seul moyen de subsistance un travail de servante et un petit jardin pentu, mais dont la terre était bonne.
Amélie était de ce genre de femme qui ne renonce jamais.
Elle ne se plaignait pas, ne montrait point de colère et se battait pour élever ses enfants.
Le Sieur Le Marmant l’avait aidée et, même si la meilleure affaire était pour lui, elle considérait que dans le fond elle ne s’en était pas mal tirée : elle avait un toit, un jardin, quelques volailles et un travail.
Le Marmant avait récupéré le moulin, les droits qui y étaient associés et la maison d’habitation qui pouvait abriter une grande famille.
Il avait argumenté tout cela du prétexte qu’il fallait assurer la continuité du fonctionnement pour le village et les environs, que Jean n’avait pas l’obligation de partir, qu’il les avait laissés tomber, et quelque part, trahis et que lui, bourgeois et riche propriétaire terrien, était le principal consommateur du moulin.
Amélie s’était sentie coupable et n’avait pas discuté, un lourd fardeau s’était posé sur elle.
Le Marmant lui avait expliqué que ce qu’il lui offrait généreusement ne pourrait faire vivre toute sa famille, que les trois filles aînées étaient grandes et qu’elles devaient travailler.
Il lui avait proposé de placer les trois filles dans de bonnes et recommandables familles parisiennes.
Bien sûr, elles seraient nourries, habillées et logées : elles ne toucheraient aucune rémunération sauf les pourboires que pourraient leur remettre les invités de ces riches personnes qui recevaient beaucoup.
C’est ainsi que Madeleine, quatorze ans, Catherine, douze ans, et Marie Louise, dix ans s’étaient retrouvées dans les beaux quartiers de la capitale.
Amélie, quant à elle, se voyait proposer la place de cuisinière chez Le Marmant. La précédente venait de partir pour suivre le régisseur qui s’installait chez le gendre des Le Marmant dans une grande propriété du Berry.
La nourriture de Lucien, d’Auguste et d’Yvonne, la petite dernière âgée d’à peine trois ans, était assurée pendant leur scolarité et pour les occuper en dehors de l’école, on les ferait participer aux travaux domestiques.
Amélie était également nourrie, Madame Le Marmant lui fournirait une robe par an, ainsi qu’un chapeau de paille et de la laine ; mais aucune rémunération sonnante ou trébuchante.
Telle était la transaction établie par Le Marmant, et selon ses dires : c’était équilibré, voire généreux face à l’embarras causé par Jean.
Cet « équilibre » pouvait paraître suffisant, mais en réalité il n’assurait qu’une survie, une stagnation et un maintien dans la pauvreté et l’asservissement.
Ce n’était pas ce qu’Amélie voulait. Elle avait beau être peu éduquée, quasiment illettrée, elle avait vécu autrement avec Jean et elle voulait autre chose pour ses enfants : qu’ils puissent accéder à une vie meilleure.
Elle devait se battre.
Lucien avait neuf ans, il était fort, il savait se débrouiller seul. Il fallait trouver à le placer lui aussi, mais en réclamant le vrai paiement de son travail et en préservant une présence à l’école.
La foire de Jons, quelques jours plus tard, lui fournit l’opportunité d’engager son projet.
Elle avait rencontré le père Pourataud, paysan installé aux Champs de Jons, sur une ferme de taille conséquente, où il vivait avec sa femme, son gendre et sa fille, mais hélas sans descendance.
Les Pourataud avaient la réputation de braves gens et leur relative aisance ne les avait pas pour autant rendus fiers ou méprisants.
Ils étaient clients du moulin et Jean n’avait jamais eu à se plaindre de la relation, bien au contraire.
En voyant Amélie, ce fut lui qui l’interpella : Alors Mélie ! Comment ça va ? Il s’était arrêté, lui serrant la main et la conversation s’était engagée au milieu du va et vient du bétail, des volailles et autres marchandises.
En confiance, elle lui avait expliqué la situation et le souhait qu’elle avait pour Lucien.
Pourataud lui répondit :
Je ne peux pas te le prendre chez moi, du moins pas tout de suite, mais l’année prochaine ou à Toussaint, mon domestique va partir aux armées et là je te promets que je le prendrai ! en attendant, faut regarder. Je sais que Carmaux cherche un garçon vacher.
Elle connaissait la réputation des Carmaux et un voile passa sur son visage, ce qui n’échappa point à Pourataud qui ajouta :
Ils sont un peu pingres, mais je ne crois pas tout ce que l’on dit sur eux. Et puis ce serait transitoire. Si tu veux, j’en fais mon affaire en le lui demandant comme un service pour moi.
Amélie se remémorait les engueulades entre Jean et Carmaux qui discutait sans arrêt les prix, traînait à payer, voire trichait sur la marchandise, tout cela se mélangeait dans sa tête. D’une voix faible et troublée, elle dit :
Il faut que je voie, vous croyez que…
Pourataud l’interrompit :
Écoute Mélie, dans ta situation tu n’as guère le choix et je te le redis ce n’est qu’une affaire d’une petite année, plus probablement de quelques mois vu la situation, je te le prendrai, ton Lucien et j’en ferai un bon paysan et la Mariette sera tellement heureuse de s’occuper de son éducation jusqu’au certificat !
On a aussi des prés qui touchent les leurs alors, je jetterai un œil sur le petit.
Réfléchis et viens me retrouver sur la place de la bascule. J’ai des porcs à vendre et le domestique est en train de les installer, ça te laisse une paire d’heures !
Il l’avait laissée là et était parti s’occuper de ses affaires.
Amélie avait arpenté les bancs de la foire presque sans les voir. Elle hésitait, non pas sur la proposition qui correspondait à ce qu’elle souhaitait, mais sur la réputation des Carmaux.
L’engagement de Pourataud de le prendre chez lui d’ici quelques mois, une année au plus, la satisfaisait. Surtout qu’avec sa fille Mariette qui s’occuperait de son éducation, c’était parfait, mais c’était ces Carmaux qui n’avaient pas bonne réputation. La bonne saison arrivait, cela devrait aller, mais cet hiver, comment serait nourri le gamin ? Peut-être que le domestique de Pourataud partirait plus tôt aux armées… avec cette guerre !
Dans sa déambulation, elle se retrouva devant l’église dont la porte était ouverte et c’est une habitude les jours de foire. Quelques femmes y pénètrent pour se recueillir et certaines déposent des denrées : légumes, beurre ou fromage pour le Père Curé.
Amélie entra, se glissa au fond, elle se recueillit puis s’assit, son chapelet dans ses mains, elle resta là un long moment la tête droite, le regard planté sur la statue de la Vierge Marie comme si elle sollicitait son conseil.
Un bruit de sabots sur les pierres de l’entrée la sortit de sa profonde contemplation, elle se leva et partit.
Hors de l’église, en se retournant vers l’horloge du clocher, elle vit qu’il était bientôt midi.
Sa décision était prise et à l’heure dite, elle était face à Pourataud qui avait vendu tous ses porcs et se préparait à rembarquer son équipement. Elle lui déclara :
C’est d’accord pour une période chez Carmaux avec la nourriture et le logement contre son travail. Et quand il sera chez vous, l’éducation en plus.
Tout en continuant à charger sa charrette, il répondit :
Chez moi, on en reparlera Mélie, je ne reviendrai pas sur ce que je t’ai dit, sois tranquille, il ne manquera de rien avec nous.
Je te ferai donner la réponse dimanche prochain par mon domestique qui rentre chez lui pour la noce de sa sœur.
Elle rentra aux Alois, il fallait maintenant l’annoncer à Lucien, son garçon. Elle avait le sentiment qu’elle l’avait vendu à la foire comme le bétail.
Et puis il fallait le dire au sieur Le Marmant. Comment allait-il le prendre ? Il perdait une charge de nourriture et elle comptait bien lui demander quelques pièces en échange. Il fallait qu’elle obtienne cela pour s’assurer quelques possibilités.
Le dimanche suivant vers six heures le domestique de Pourataud avait frappé à sa porte et il lui avait débité :
Pourataud a dit que c’est d’accord pour votre gamin, il le prendra le matin de la prochaine foire de Jons. Faut qu’il aille prendre des bois de charrue aux Bastilles et il le mènera le soir chez Carmaux.
Puis il avait disparu aussitôt.
Lorsqu’elle fit part de sa décision au sieur Le Marmant, il entra immédiatement dans une grande colère. Ce dont il était coutumier face à son personnel, sans doute afin de mieux l’impressionner.
Elle ne broncha pas.
La colère s’apaisa. Suivit un long silence pesant. Il arpentait la pièce en la toisant, elle ne dit rien, debout, très droite, plantée devant le grand bureau de merisier pur style Louis XV qui faisait la grande fierté de la famille puisque celui-ci aurait servi de table de repas au général Bonaparte lors d’une visite de troupes stationnées dans les bois de l’Abbaye.
Il reprit la parole plus calmement et demanda des explications complémentaires.
Le Marmant avait vite compris que la situation qu’Amélie créait lui serait moins coûteuse. Comment lui refuser la rémunération qu’elle demandait ?
D’autant plus qu’elle avait mis dans la balance le fait que « si ça ne convenait pas, elle pourrait partir ».
Il savait très bien qu’il ne pouvait se passer de ses services, sa situation et surtout le caractère de son épouse l’en empêchaient.
Elle parla peu, mais négocia durement en s’en tenant à son idée.
Il employa toutes les ruses et arguments possibles à son service. Il lui fit remarquer le grand honneur qu’il lui faisait de lui permettre de travailler pour sa famille.
Il lui fit miroiter l’éducation de Lucien, il essaya de la vexer en lui rappelant la désastreuse gestion après le départ de Jean qui avait, selon lui, conduit le moulin à la ruine et allant même jusqu’à lui déconseiller de disposer du moindre pécule.
Elle encaissa tout sans répondre à la provocation, droite face à lui, et pour les quelques propos qu’elle tint Dieu seul sait ce qui l’inspira.
À la fin, il céda. Les quelques pièces qu’elle obtenait pour sa paie, même si elles étaient insuffisantes pour rémunérer justement ce qui lui était dû, étaient pour elle la première lueur d’espoir depuis le départ de Jean.
Mais il fallait attendre le départ de Lucien et les premières économies pour commencer à entreprendre quoi que ce soit.
Cette attente qui commençait lui paraissait pesante d’autant qu’elle savait que Le Marmant ne raterait aucune occasion pour revenir sur leur accord.
En route
Dans la douceur de ce matin de juin, Lucien avait perçu le bruit de l’attelage de Pourataud bien avant Amélie dont le regard semblait perdu au-dessus de l’étang.
Il ferma soigneusement le couteau qu’il tenait dans sa main, il le serra très fort comme pour y puiser quelque force : un couteau, ça vous fait un homme, avait dit un jour son père. Peut-être inconsciemment cherchait-il ce qui le reliait encore à son père dont ils étaient sans nouvelles.
Il glissa doucement le couteau dans la double poche de son pantalon court que sa mère avait confectionné en prélevant du tissu dans la gabardine la plus neuve que son père avait laissée. Puis il se releva calmement et rentra dans la cuisine.
Amélie n’avait pas bougé.
Depuis qu’il savait qu’il allait partir, Lucien se sentait différent. Ses résultats à l’école avaient progressé et l’instituteur, surpris pas ces bonnes performances, l’avait félicité et cité en exemple à plusieurs occasions.
Il avait soif d’apprendre. Peut-être inconsciemment engrangeait-il un maximum de savoir ? Il avait toujours été, assez naturellement, un bon élève et le calcul lui plaisait particulièrement.
Le départ de son père l’avait plongé, comme sa mère et ses sœurs, dans une espèce de torpeur, une sorte d’emprisonnement. Sans doute avaient-ils tous pris conscience de la peur du lendemain. Et cela, Lucien le ressentait très fort.
Lorsqu’il avait appris qu’il allait partir, Lucien n’avait marqué aucune émotion comme s’il s’attendait inéluctablement à ce que cela arrive.
Les petits avaient beaucoup pleuré, il les avait entendus le soir dans leur lit à l’autre bout de la chambre.
Le fait de quitter le moulin avait été dur. Certes, ils n’étaient pas très riches et ils auraient pu l’être davantage si Jean avait été moins fantasque dans ses différentes sorties accompagnant les livraisons de farine dans de gros bourgs environnants et surtout si elles avaient été moins fréquentes.
Au moulin, ils pouvaient manger tous à leur faim. Les enfants avaient chacun leurs tâches qu’ils réalisaient le matin avant de partir à l’école ou le soir en rentrant. Mais ils étaient vêtus correctement et chaussés de galoches neuves chaque année.
Amélie avait malgré tout fait un gâteau partagé équitablement et avait tricoté une paire de mitaines pour chacun en prévision d’un hiver dont tout le monde s’accordait pour dire qu’il serait rigoureux… Et il le fut.
Ces galoches qui leur tombaient invariablement du ciel le matin de Noël accompagnées d’un de ces succulents gâteaux dont Amélie avait le secret et d’une babiole achetée à la foire de Jons.
Ils étaient, en ce début de siècle, une famille non pas aisée, mais dont beaucoup de gens enviaient la situation matérielle.
Le Noël passé qui avait suivi de quelques semaines le départ de Jean avait été tout autre.
Il n’y avait pas eu de galoches neuves pour tout le monde et l’on avait transmis celles des plus grands encore portables, ou réparées, aux plus petits. Lucien avait eu des neuves, car rien ne correspondait à son pied.
Les filles étaient parties en février en pleine tempête de neige.
Il avait fallu attendre un long mois pour recevoir de leurs nouvelles par le canal de Le Marmant qui d’ailleurs avait été très bref, comme si cela lui coûtait.
A priori tout allait bien, au moins elles étaient arrivées et installées et elles seraient autorisées à écrire en avril quand la sœur de Monsieur viendrait faire sa visite annuelle au domaine.
Lucien, qui s’était retrouvé l’homme de la maison, avait du mal à supporter la vue et le chant du moulin qu’un autre que son père faisait tourner et surtout ce qu’il n’admettait pas c’était que « ce foutu creusois » à la tignasse rousse lui interdise l’entrée et l’approche à moins de dix pas du moulin.
Qu’avait bien pu raconter Le Marmant à ce gaillard qu’il avait eu tôt fait de recruter au départ de Jean ?
Ce moulin des Alois que Lucien connaissait par cœur, dont les bruits faisaient partie de son être profond. Il était né là et il se voyait plus tard conduire l’ensemble étant l’aîné des garçons.
Car comme son père et son grand-père et plus loin encore avant eux il se devait de continuer dans le métier : là avec son père pour commencer et puis à son propre compte, ailleurs, comme l’avaient fait ses ancêtres avant lui depuis plusieurs générations.
Il pensait à cet ancêtre dont le Père parlait qui avait été le directeur des moulins d’Alger.
Il tenait cela de Jean qui dans les rares moments d’intimité avec son fils aîné lui avait confié l’histoire et transmis l’envie.
Jean avait reçu le moulin des Alois par son père qui l’avait installé, comme ses deux autres frères. Il avait reçu une bonne éducation chez les Frères Grandmontains.
C’est ainsi qu’il savait lire, écrire et compter couramment, il savait faire les comptes. Et son savoir connu et respecté faisait qu’il était fréquemment sollicité par les paysans et les artisans pour les aider, voire par les bourgeois. Nul ne s’avisait à le tromper sur le terrain de l’argent et des comptes.
Le rêve était brisé.
Lorsqu’il ressortit de la cuisine un paquet de linge roulé dans un torchon de drap jauni sous le bras gauche, le bâton qu’il venait de finir de marquer de ses initiales à la main droite et le béret bien enfoncé sur la tête, Amélie tourna vers lui son regard.
Il a passé le chêne buffant, il descend vers l’étang, annonça Lucien.
Amélie ne dit rien, mais ses yeux parlaient pour elle. Elle se leva, ils firent quelques pas sur le chemin, très proches l’un de l’autre.
À la sortie du bois, au bout de l’étang, l’attelage apparut : deux chevaux de trait à la robe fauve tirant une remorque bien remplie.
Le train était pesant, mais régulier.
Pourataud avait affaire à la foire et il s’agissait de ne pas le retarder.
Il fit tourner son attelage avant de s’arrêter et lança joyeusement :
Bonjour Mélie. Bonjour petit… Alors on est prêt ?
Elle lui répondit :
Bonjour. Et merci à vous, Léon, il a bien déjeuné et je lui ai donné des châtaignes boursées avec un quignon de mêlée pour midi. Merci encore.
Puis s’adressant à Lucien :
Va, mon grand. Sois poli et honnête. Donne-moi de tes nouvelles par les gens de la foire, je m’arrangerai pour y aller avec Madame.
Sa voix s’étrangla, nul ne le remarqua, car les chevaux avaient couvert son silence, mais leurs regards s’étaient croisés un court instant : eux savaient, et c’était suffisant.
Ce fut Pourataud qui répondit.
Tu en auras des nouvelles, je t’en donnerai moi à chaque foire de Jons, ou la Louisa quand elle vient avec moi, ou bien le domestique quand il rentre chez lui chaque mois. Ne t’en fais pas j’aurai un œil.
Lucien s’avança vers la voiture, Amélie lui effleura l’épaule.
En deux pas, il fut près de la roue, Pourataud lui tendit sa main rude et déjà brunie, et il le hissa littéralement à côté de lui sur le banc du conducteur.
Un coup de fouet en l’air et l’attelage se remit en route, et Pourataud lança :
Au revoir Mélie.
Lucien ne se retourna pas, mais il emportait une image qui ne le quitterait jamais, celle de sa mère et de sa douceur. Et c’était profondément ancré dans son cœur.
La foire de Jons
En arrivant à Jons, ils croisèrent quelques personnes qui redescendaient du bourg : les matinaux qui viennent à la foire pour acheter un outil ou quelque marchandise et s’en repartent très vite pour vaquer à leurs occupations quotidiennes.
À mesure qu’ils approchaient du bourg, et dès les premières maisons, l’on sentait l’effervescence en ce jour particulier.
La foire de Jons c’est une grosse foire, l’on y vient de loin, et même pendant cette période difficile où la guerre fait rage, il y a abondance de gens.
Il faut dire que Jons c’est un bourg, un vrai bourg, les communes alentour sont faites de hameaux et de fermes dispersées dans la nature, et le seul vrai bourg c’est Jons. Et puis il y a le train et ça compte énormément pour faire vivre le territoire.
Il y manque certes les jeunes hommes, tous sont à la guerre, certains ne reviendront jamais et le nombre d’hommes mûrs portant un crêpe sur leur veste et de femmes vêtues de noir n’avait jamais été aussi conséquent. Malgré tout cela, il régnait sur le bourg une ambiance de vigoureuse animation.
Cela ne va pas être facile de trouver une place, soupira Léon.
Lucien sortit soudainement de sa torpeur, car l’homme et le garçon n’avaient échangé aucun mot depuis le départ. Il se sentit responsable de la difficulté à se caser, c’était le passage par les Alois qui avait mis Pourataud en retard.
Et comme si ce dernier avait senti la gêne du garçon, il ajouta : C’est une grosse foire aujourd’hui, il va y avoir du bétail, il y en a qui sont arrivés depuis hier soir, j’en ai vu passer par deux fois.
— Et le vôtre, il est où ? hasarda Lucien.
Pourataud le regarda en souriant et lui répondit :
Les miens y sont au pré. Vois-tu aujourd’hui je viens pour acheter, il faudrait que je trouve deux génisses, tout au moins une, pour amener du sang neuf dans le troupeau, mais il faut que j’en trouve des belles.
À Saint-Ferrand la semaine dernière j’en ai vendu trois et ramené deux, mais il m’en faut d’autres. Des pures races, vois-tu ! La limousine ce n’est pas n’importe quoi… Il y en a qui mélangent ça avec d’autres races pour faire du poids, mais moi je dis que c’est mauvais pour la viande, d’ailleurs elles se vendent moins cher et puis si on veut tuer la race il n’y a qu’à continuer.
C’est alors que Lucien intervint :
Chez m’sieur Le Marmant y a que des limousines, et chez Brugères aussi. Les brettes ne sont pas dans les mêmes prés.
Pourataud, surpris, le regarda, et continua le dialogue :
C’est vrai petit, tu as bien observé, c’est bien, mon garçon. Le Marmant, c’est un bourgeois, mais il s’y connaît. Ils sont sur leurs terres depuis des siècles et leur bétail, il est beau.
Il y a deux ans, je lui ai vendu un taurillon, une belle bête ! Un cou fort et bas du cul ! Il m’a fait batailler ferme, mais on a fini par se mettre d’accord.
Et après un silence, il ajouta : Bien vendu ! bien acheté ! C’est ce qui fait une bonne affaire, et le respect.
Lucien à l’aise avec son interlocuteur prolongea la discussion.
Il a mené du bétail aujourd’hui, je les ai vus rassembler les bêtes hier soir dans le pré derrière chez nous, les domestiques les préparaient et puis ce matin y avait plus rien.
Et tout en regardant autour d’eux, comme s’il cherchait un endroit pour s’arrêter, Pourataud déclara :
Tu vois, Le Marmant, il prépare son bétail, toujours propre, et il te vend pas une livre de merde avec. Je sais qu’il en a mené, j’ai vu les bouses fraîches sur le chemin. Mais je n’aimerais autant pas acheter chez lui, faut que je trouve du sang neuf.
La conversation s’arrêta, ils étaient arrivés et l’attelage tentait de se frayer un chemin. Lucien comprit que Pourataud voulait aller se garer sur sa route de retour en direction des Champs de Jons, et pour cela il fallait traverser le bourg où les étalages commençaient à prendre place. Chacun avait cherché le meilleur emplacement selon des critères personnels, c’était un jeu, un rituel.
Il se disait que tel ou tel avait le mauvais œil ou attirait la poisse et si l’on était à côté de lui, on était sûr de rater sa journée.
Il y avait à cette époque beaucoup de croyances et bon nombre d’histoires se racontaient dans les veillées d’hiver au coin de la cheminée. Il y avait aussi les « dons » que certaines personnes possédaient pour soigner telle ou telle affection, c’étaient généralement des choses qui se transmettaient de génération en génération et les gens respectaient tout cela.
Amélie pour sa part avait reçu de la vieille tante Aurélie le don de « lever le coup », et bon nombre de personnes s’étant donné un vilain coup avait vu celui-ci fortement atténué, voir enlevé, et n’avait éprouvé aucune gêne pour continuer leur travail après l’action de la bonne Amélie. Lucien pouvait en témoigner.
Si sur certains cela ne marchait pas, c’est qu’ils n’y croyaient pas ou que le coup était trop vieux.
Amélie n’avait jamais rien demandé pour ce genre de service « un don ne se paye pas, ou bien c’est plus un don », disait-elle. Cela n’empêchait pas les bénéficiaires de montrer parfois leur gratitude autrement qu’avec de l’argent.
Certains porteurs de dons se faisaient payer, fournissaient des breuvages, des poudres ou des onguents. Les langues allaient bon train à leur égard, ils étaient plutôt considérés comme sorciers et entraînaient la méfiance.
L’attelage s’arrêta au lavoir où en ce matin d’intense activité du bourg se tenait une seule lavandière.
Ce lavoir constitué d’un vaste abreuvoir en bordure de la route, alimenté par une eau abondante et limpide, c’est qu’ici les sources ne manquent pas. L’eau sortait d’un bloc de granit taillé avec un bec déversoir qui la faisait buller jusqu’au milieu de l’abreuvoir.
Cette réserve permettait au bétail et attelages de passage de satisfaire leur soif : c’est ce que firent les chevaux qui depuis cinq heures du matin étaient à l’ouvrage.
Les deux hommes ne descendirent pas du siège. Lucien regardait la lavandière et ses gestes fermes qu’il avait vus maintes fois accomplir par sa mère au bord du chenal en aval du moulin où avaient été installés trois postes de lavage.
L’abreuvoir se déversait, par deux trop-pleins latéraux, dans le premier bac du lavoir. Celui-ci servait de bac de rinçage et à son tour il se déversait dans le bac de lavage. Celui-ci se vidait dans une rigole empierrée et pentue, évacuant l’eau par-dessous le mur du fond, vers le petit ruisseau des prés, juste derrière.
Les chevaux burent leur saoul et relevèrent la tête quasiment en même temps, sans que leur maître intervienne. Ils se remirent sur le chemin et dégagèrent l’accès au lavoir.
Quelques mètres plus bas, la route s’élargissait permettant le stationnement, et visiblement l’attelage connaissait l’endroit.
Ho ! là : tout le monde descend, dit Pourataud en souriant, puis il descendit de son siège et passa à l’avant. Il attacha les chevaux à un piquet de clôture puis, de sous le siège, il dégagea deux seaux remplis d’avoine qu’il mit sous le nez des chevaux. Ceux-ci se mirent à manger sans attendre.
Et s’adressant à Lucien :
Tu vas rester là jusqu’à ce qu’ils aient fini, puis tu remettras les deux seaux bien calés sous le siège. Ensuite, tu pourras aller te promener et faire le tour de la foire… Quand tu auras mangé, viens me rejoindre au café Marceau, c’est là que je serai.
Le jeune garçon se mit droit instinctivement et répondit : Oui M’sieu, comptez sur moi.
Pourataud lui donna une tape amicale sur le genou.
Lucien s’assura que son bâton et son baluchon étaient bien à l’abri sous un morceau de bâche, puis il descendit à son tour.
Il regarda autour de lui : les lieux lui étaient familiers, il connaissait le bourg du village, car c’est là qu’il venait à l’école. Il avait fréquemment accompagné son père pour les livraisons de farine et aucune rue ni aucun habitant ne lui était inconnu.
Au café Ronzier, c’était un va-et-vient continuel, il faut dire que sur cette entrée du bourg c’était la première halte possible, et tous les arrivants venaient laver la poussière du chemin.
En cette heure encore matinale, les verres de vin rouge s’étalaient sur le comptoir et se vidaient d’un trait, les pièces résonnaient et les hommes repartaient très vite.
Lucien fit le tour de la voiture et s’avança près de l’encolure des chevaux, ils levèrent la tête et replongèrent dans leur picotin qu’ils avaient presque fini. Il leur passa sa main sur la crinière, pour mieux faire connaissance, les animaux lui répondirent par un mouvement de tête tournée vers lui.
L’horloge de l’église sonna neuf heures. D’habitude, cela indiquait à Lucien et aux autres gamins de la commune que les jeux étaient terminés et qu’il fallait entrer en classe. Pour ceux qui s’étaient attardés sur le chemin, c’était l’annonce d’une punition ou tout au moins d’une réprimande.
La punition, en général, consistait, lors de la récréation, à effectuer des travaux de jardinage dans le potager de l’instituteur ou s’il pleuvait à rentrer le bois dans les classes et chez l’instituteur. Celui-ci surveillait chaque puni qui s’acquittait de sa tâche.
Lucien avait fait sa part, comme à peu près tous les élèves de la classe, il se souvint de la fois où il avait eu à désherber un rang de haricots en pousse et comment il avait discrètement pissé sur les jeunes carottes arrosées du matin.
L’un des chevaux tapa de la patte sur le sol pour chasser les mouches et secoua sa crinière.
Cela fit constater au jeune garçon qu’ils avaient terminé leur avoine, il ramassa les deux seaux, les rangea sous le banc, s’assurant qu’ils étaient bien calés.
Il jeta un regard sur l’ensemble de l’attelage puis ayant tâté ses poches pour s’assurer que son repas y était bien ainsi que son couteau, il entreprit de remonter la rue de la Poste : c’est ainsi que se nommait cette entrée du bourg ; d’autres la nommaient route de Saint Veyrand, parce qu’elle menait à cette commune voisine.
Le bourg de Jons était établi sur une sorte de plateau, à environ quatre cents mètres d’altitude, bordé à l’ouest par un petit massif s’élevant jusqu’à sept cents mètres. À l’est, le plateau s’étendait sur plusieurs kilomètres avant la vallée de la rivière.
Cette situation géographique protégeait en partie des vents dominants ouest et nord-ouest.
L’église occupait, avec le presbytère, le centre du bourg et la foire s’étalait autour de cet îlot central. Deux voies avaient structuré la configuration du village, la route de Saint-Veyrand, vers le sud-est, et celle de Chateaulieu, plein est.
Les maisons s’étendaient largement tout au long de ces deux voies.
Le bourg était concerné par une troisième voie de communication, celle-ci suivait le plissement montagneux et traversait donc la partie bâtie accrochée au pied du mont, à la naissance du plateau. C’était la route de Limoges à Guéret, la plus importante du village.
À côté du café Ronzier se trouvait l’atelier de Laguillaume le tonnelier, Lucien connaissait bien cet atelier, il y venait avec son père et il appréciait l’odeur des bois servant à faire les fûts.
Il connaissait surtout le fils de l’artisan qui lui aussi se prénommait Lucien, mais que tous appelaient Lulu, chez lui comme à l’école.
Laguillaume avait sorti toutes sortes de tonneaux de tailles différentes.
D’un côté de l’atelier étaient empilés des tonneaux neufs ou réparés et portant tous, soit le nom de leur propriétaire marqué au fer rouge, soit de belles initiales, voire des marques particulières qui les identifiaient.
De l’autre côté, des tonneaux neufs et sans marquage attendaient preneur, avec des baquets et des seaux pour les lavandières.
Tous ces produits étaient fabriqués en bois de châtaignier ou de chêne que le père Laguillaume choisissait lui-même sur pied, en suivait la coupe et assurait chez lui le stockage.
Quelques fûts étaient en bois de fruitiers, mais c’était pour des commandes particulières, généralement des tonnelets pour l’eau-de-vie.
L’artisan fabriquait aussi des paniers en fines lamelles de châtaignier tressées avec une anse harmonieusement courbée. Ces paniers que l’on retrouvait au bras des femmes et dans lesquels elles transportaient de multiples affaires, que ce soit à la foire ou pour un usage plus courant à la maison ou dans les champs.
Lucien resta un long moment derrière l’empilement de tonneaux à observer l’artisan : son geste sûr, la varlope, le rabot ou la plane dans les mains, sa force pour plier les lamelles de bois ou son adresse pour cintrer les anses.
Les clients se succédaient, les échanges étaient brefs, juste le temps du paiement ou d’une courte explication. Laguillaume était peu bavard sauf avec son bois ou ses outils, il leur parlait comme pour les guider.
Ce fut l’horloge qui sortit Lucien de son point d’observation. Onze heures !
Pourataud était parti depuis deux heures, avait-il fait affaire ?
Lucien remonta la rue de la Poste où étaient installés les enclos de bois montés par les paysans pour les volailles : poulets, pintades, lapins, et pour les porcs et moutons.
Ces emplacements pour les volailles étaient tenus par les femmes en général, les hommes s’occupaient du bétail, mais ils y plantaient souvent le domestique qui les accompagnait pour aller au bistro.
Les bistros, les jours de foire, regorgeaient de personnes de tous horizons, c’était un commerce florissant, à Jons il y en avait plus de vingt.
Pour un village de mille cinq cents habitants, cela faisait une belle concentration, pourtant pour les jours de foire chacun d’eux faisait de bonnes affaires.
À Jons il y avait foire chaque mois, dont quatre, plus importantes, avec concours d’animaux, et deux d’entre elles duraient deux voire trois jours
Arrivé à la bascule, Lucien s’arrêta.
Il y avait grande affluence, car c’est là que se finalisaient les affaires, du moins prenaient-elles un tournant décisif. Le poids de la bête convoitée se révélait, et si le vendeur avait trop exagéré la vente était compromise.
Les discussions étaient très animées, les ventres tâtés avec dextérité révélaient ce que le vendeur avait fait ingurgiter à sa bête pensant gagner quelques kilogrammes.
Parfois, quelques jurons fusaient et il arrivait qu’un béret s’envole dans la bousculade. Mais tout finissait par rentrer dans l’ordre : les uns se séparaient en maugréant, d’autres se tapaient dans la main pour conclure, d’autres allaient vers leur bistro favori pour trouver un terrain d’entente.
Lucien inspecta rapidement les lieux et les gens. Pourataud n’était pas là, alors sans hésiter il prit la direction du champ de foire, laissant derrière lui l’atelier en plein air du charron et la boutique du sabotier, traversant les étalages à même le sol de divers et variés outils pour le travail des champs et de la terre.
Le champ de foire, espace d’environ trente ares, en pente, contenait la majorité des bovins que l’on avait attachés aux barres métalliques dessinant des rangées successives au fil de la pente.
Les jours de grande foire, il ne suffisait pas et le bétail s’étalait dans la rue remontant devant le presbytère ainsi que dans celle menant au cimetière et sur la route de Chateaulieu devant l’école de filles. C’était le cas de cette foire de juin.