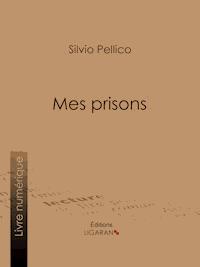
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
Extrait : "Le vendredi 13 octobre 1820, je fus arrêté à Milan et conduit à Sainte-Marguerite. Il était trois heures après midi. On me fit subir un long interrogatoire pendant tout ce jour et pendant d'autres encore. Mais de cela je ne dirai rien. Semblable à un amant maltraité de sa belle et dignement résolu à lui tenir rigueur, je laisse la politique où elle est, et je parle d'autre chose. A neuf heures du soir de ce pauvre vendredi, le greffier me consigna au concierge."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SILVIO PELLICO est né vers 1789 à Saluces, petite ville du Piémont. Il appartenait à une famille dont la condition, comme il le dit lui-même dans MES PRISONS, n’était pas la pauvreté « et qui, en vous rapprochant également du pauvre et du riche, vous donne une exacte connaissance des deux états ». Après une enfance embellie par les plus doux soins, il fut envoyé à Lyon, auprès d’un vieux cousin de sa mère, M. de Rubod, homme fort riche, afin d’y compléter ses études. « Là, dit-il encore, tout ce qui peut enchanter un cœur avide d’élégance et d’amour, avait délicieusement occupé la première ferveur de ma jeunesse ». Rentré en Italie vers 1818, il alla demeurer avec ses parents à Milan. « J’avais, ajoute-t-il, poursuivi mes études et appris à aimer la société et les livres, ne trouvant que des amis distingués et de séduisants applaudissements. Monti et Foscolo, bien qu’adversaires déclarés, avaient été également bienveillants pour moi. Je m’attachai davantage à ce dernier, et cet homme si irritable, qui par sa rudesse avait provoqué tant de gens à se désaffectionner de lui, n’était pour moi que douceur et cordialité, et je le révérais tendrement. D’autres littérateurs fort honorables m’aimaient aussi comme je les aimais moi-même. L’envie ni la calomnie ne m’atteignirent jamais ou, du moins, elles partaient de gens tellement discrédités qu’elles ne pouvaient me nuire. À la chute du royaume d’Italie, mon père avait reporté son domicile à Turin, avec le reste de la famille ; et moi, remettant à plus tard de rejoindre des personnes si chères, j’avais fini par rester à Milan, où j’étais entouré de tant de bonheur que je ne savais pas me résoudre à la quitter.
Parmi mes autres meilleurs amis, il y en avait trois à Milan qui prédominaient dans mon cœur : Pierre Borsieri, monseigneur Louis de Brême et le comte Louis Porro Lambertenghi. Plus tard, s’y joignit le comte Frédéric Confalonieri. M’étant fait le précepteur des deux enfants de Porro, j’étais pour eux comme un père, et pour leur père comme un frère. Dans cette maison affluait non seulement tout ce que la ville avait de plus cultivé, mais une foule de voyageurs de distinction. Là je connus Mme de Staël, Davis, Byron, Hobhouse, Brougham, et un grand nombre d’autres illustres personnages des diverses parties de l’Europe… J’étais heureux ! je n’aurais pas changé mon sort contre celui d’un prince ».
C’est dans ce milieu intellectuel hors ligne que Silvio Pellico composa et fit représenter ses deux premières tragédies, LEODAMIA et FRANCESCA DA RIMINI. Il avait alors trente ans. FRANCESCA DA RIMINI obtint un très vif succès, et rendit promptement populaire le nom de son auteur. C’est la seule du reste des œuvres dramatiques de Pellico qui ait survécu et qui soit restée au répertoire. Byron, alors en Italie, en fit une traduction.
La célébrité que le succès deFRANCESCA avait attachée à son nom devait appeler sur Silvio Pellico l’attention des patriotes italiens qui, à cette époque, luttaient de toutes façons contre le despotisme de l’Autriche. Une recrue de cette valeur était précieuse pour eux, et ils ne négligèrent rien pour se l’attacher. Ils avaient pour organe un journal appelé LE CONCILIATEUR, feuille littéraire et dont la politique était ostensiblement bannie, mais qui ne laissait échapper aucune occasion d’exalter l’amour de la patrie et de la liberté. LE CONCILIATEUR, qui comptait parmi ses principaux écrivains tous les amis de Silvio, les Berchet, les Gioja, les Romagnesi, les Maroncelli, les Confalonieri, etc., avait pour bailleur de fonds le comte Porro, dont Silvio élevait les deux enfants, et qui était pour lui « comme un frère ». Il était donc tout naturel qu’il fit partie de la vaillante phalange. C’en était assez pour être suspect aux yeux des autorités allemandes. Aussi fut-il compris parmi les nombreuses personnes arrêtées, à la suite de la découverte d’une vaste conspiration organisée par les sociétés secrètes.
Le 13 novembre 1820 il fut conduit à Sainte-Marguerite. Puis, de là, il fut transféré à Venise, sous les Plombs, et y demeura pendant tout le temps que dura l’instruction de son procès. Après deux années et demie d’alternatives cruelles, il fut enfin condamné à la peine de mort, laquelle fut commuée en celle de quinze années de carcere duro. Au commencement de l’année 1822, il fut conduit au Spielberg, forteresse située près de la ville de Brünn, en Moravie, et où étaient détenus une grande partie des patriotes italiens condamnés pour politique. Il ne devait en sortir que huit ans après, le 1er août 1830.
C’est l’histoire de ces dix ans de captivité que Silvio a racontée dans son livre intitulé : MES PRISONS.
Libre, Silvio revint à Turin, où il s’occupa exclusivement de littérature. Bien qu’il eût renoncé absolument à la politique, il eut encore à lutter contre la censure qui voulait voir dans ses pièces des allusions constantes aux évènements du jour.
En 1832, Silvio Pellico alla à Paris, où il reçut de tout le monde l’accueil le plus sympathique. On assure même que la reine Marie-Amélie lui offrit un emploi à la cour, mais qu’il refusa. Cela paraît peu probable. Si la reine avait eu réellement cette intention, elle n’aurait pu y donner suite qu’avec l’assentiment de son mari, et jamais Louis-Philippe, dont la prudence était proverbiale, n’aurait permis une manifestation que l’Autriche aurait été en droit de qualifier d’hostile. Le sentimentalisme n’était pas la vertu dominante du vieux monarque.
La vérité, c’est que Silvio, après un assez court séjour en France, retourna en Piémont. Il alla habiter le château de Camerano près d’Asti. C’est là qu’il composa, ou tout au moins qu’il acheva et mit au point MES PRISONS, qui parurent en 1833. Malgré le succès éclatant du livre, Silvio vécut très retiré, opposant un refus absolu à tous ceux, et ils étaient nombreux, qui cherchaient à l’entraîner dans les luttes politiques. Il avait surtout fort à faire pour repousser les offres des jeunes gens que l’exemple de la révolution de 1830 avait exaltés, et qui lui demandaient de se mettre à leur tête, ou tout au moins d’être leur conseiller. Rien ne put le fléchir. Il se renferma plus que jamais dans sa solitude, et partageait son temps entre Asti et Turin, où le marquis Barolo l’avait nommé son bibliothécaire. Lorsqu’il mourut, en 1854, il était sinon oublié, du moins tout à fait inconnu de la génération nouvelle à qui il allait être donné d’arracher enfin la malheureuse Italie à la domination de ses maîtres étrangers, et d’en faire une nation libre et indépendante.
Mais il n’en était pas de même de son œuvre. MES PRISONS sont un de ces livres définitivement adoptés par la postérité, comme LE VICAIRE DE WAKEFIELD, PAUL ET VIRGINIE, qui ont été traduits dans toutes les langues, sont devenus comme un patrimoine commun à l’humanité tout entière, et qui seront éternellement lus tant qu’il y aura des natures sachant s’émouvoir à des récits pathétiques, c’est-à-dire toujours. Mais ce qui constitue pour l’œuvre de Silvio Pellico une incontestable supériorité sur les autres chefs-d’œuvre, c’est qu’elle n’est pas une fiction plus ou moins bien trouvée, plus ou moins bien rendue. Elle a été vécue. Ce ne sont pas des aventures, des souffrances imaginaires que l’écrivain présente au public ; ce sont des souffrances réelles, les siennes. Son livre n’est pas un roman, c’est une histoire ; histoire lamentable, mais qui est aussi une leçon. Elle nous apprend que les tortures ne sont pas un moyen suffisant pour terrifier les nations, ou du moins pour les empêcher d’accomplir leurs destinées. Les cachots du Spielberg ont bien pu dévorer les patriotes italiens ; ils n’ont pu faire que l’Autriche n’ait pas été obligée de rendre à heure dite et la Lombardie et la Vénétie. Alors à quoi bon les cruautés déployées ? Et cela doit encore être un espoir. De nos jours, un autre État européen, se basant sur la force qui prime le droit, détient et opprime une province qui ne veut pas de lui. Il arrivera de cette situation ce qui est arrivé pour la Lombardie et la Vénétie, qui sont revenues à leur ancienne patrie.
Quelles que soient donc les critiques plus ou moins justes qu’on puisse lui adresser au point de vue de la mansuétude étrange qu’il témoigne envers les bourreaux de son pays, le livre de Silvio Pellico aura été pour une bonne part dans ce résultat. Et qui sait ! Peut-être l’auteur, qu’il l’ait voulu ou non, que ce soit de sa part habileté ou faiblesse, a-t-il été bien inspiré en bannissant de son livre toute récrimination politique ! Il y a intéressé tout le monde ; il a ému tous les cœurs généreux à quelque parti qu’ils appartinssent, et son action n’en a été que plus forte, ayant opéré sur un champ plus vaste. S’il eût transformé son œuvre en pamphlet, il aurait contenté sans doute une certaine portion de ses lecteurs, mais la masse n’aurait pas été remuée.
Au contraire, tous, femmes, enfants, hommes faits, vieillards, dans quelque condition sociale que la vie les ait jetés, de quelque nationalité qu’ils dépendent, ont lu et dévoré le récit de Silvio Pellico, ont plaint ses malheurs immérités, ont maudit ses bourreaux. Tous ont été séduits par le style touchant de cette œuvre sincère, qui, nous le répétons, a pris sa grande place parmi les chefs-d’œuvre de l’esprit humain.
F. REYNARD.
Ai-je écrit ces Mémoires par vanité de parler de moi ? Je désire que cela ne soit pas, et, autant qu’on puisse se constituer son propre juge, il me semble avoir eu de plus hautes visées : – celle de contribuer à réconforter quelque malheureux avec le tableau des maux que j’ai soufferts et des consolations que, par expérience, j’ai vu qu’on peut obtenir dans les plus grandes infortunes ; – celle d’attester qu’au milieu de mes longs tourments je n’ai cependant pas trouvé l’humanité aussi inique, aussi indigne d’indulgence, aussi pauvre de grandes âmes, qu’on a coutume de la représenter ; – celle d’inviter les nobles cœurs à aimer beaucoup, à ne haïr aucun mortel, à n’avoir de haine irréconciliable que pour les basses tromperies, la pusillanimité, la perfidie, toute dégradation morale ; – celle de redire une vérité déjà bien connue, mais souvent oubliée : c’est que la Religion et la Philosophie commandent l’une et l’autre une énergique volonté et un jugement calme ; et que, sans ces conditions réunies, il n’y a ni justice, ni dignité, ni principes assurés.
Le vendredi 13 octobre 1820, je fus arrêté à Milan et conduit à Sainte-Marguerite. Il était trois heures après midi. On me fit subir un long interrogatoire pendant tout ce jour et pendant d’autres encore. Mais de cela je ne dirai rien. Semblable à un amant maltraité de sa belle et dignement résolu à lui tenir rigueur, je laisse la politique où elle est, et je parle d’autre chose.
À neuf heures du soir de ce pauvre vendredi, le greffier me consigna au concierge ? et celui-ci, après m’avoir conduit dans la chambre qui m’était destinée, m’invita d’une façon polie à lui remettre, pour me les restituer en temps voulu, ma montre, mon argent, et tous les autres objets que je pouvais avoir dans ma poche ; puis il me souhaita respectueusement la bonne nuit.
« Attendez, mon cher, lui dis-je ; aujourd’hui je n’ai pas dîné ; faites-moi apporter quelque chose.
– Tout de suite : l’auberge est ici près, et monsieur verra quel bon vin !
– Du vin, je n’en bois pas ».
À cette réponse, le sieur Angiolino me regarda tout stupéfait et espérant que je plaisantais. Les concierges de prison qui tiennent cabaret ont horreur d’un prisonnier qui ne boit pas de vin.
« Je n’en bois pas, en vérité.
– J’en suis fâché pour monsieur ; il souffrira doublement de la solitude… ».
Et, voyant que je ne changeais pas d’intention, il sortit ; et en moins d’une demi-heure j’eus à dîner. Je mangeai quelques bouchées, je bus avec avidité un verre d’eau, et on me laissa seul.
La chambre était au rez-de-chaussée et donnait sur la cour. Prisons deçà, prisons delà ; prisons au-dessus, prisons en face. Je m’appuyai à la fenêtre, et je restai quelque temps à écouter les allées et venues des gardiens et le chant frénétique de quelques-uns des détenus.
Je pensais : « Il y a un siècle, ceci était un monastère ; les vierges saintes et pénitentes qui l’habitaient auraient-elles jamais imaginé que leurs cellules retentiraient aujourd’hui, non plus de gémissements de femmes et d’hymnes de dévotion, mais de blasphèmes et de chansons obscènes, et qu’elles renfermeraient des hommes de toute sorte et pour la plupart destinés aux fers ou à la potence ? Et, dans un siècle, qui respirera dans ces cellules ? Ô fuite rapide du temps ! ô mobilité perpétuelle des choses ! Peut-il, celui qui vous considère, s’affliger si la fortune a cessé de lui sourire, s’il vient à être enseveli en prison, s’il est menacé du gibet ? Hier j’étais un des plus heureux mortels du monde ; aujourd’hui je n’ai plus aucune des douceurs qui réconfortaient ma vie ; plus de liberté, plus d’entourage d’amis, plus d’espérances ! Non ; s’illusionner serait folie. Je ne sortirai d’ici que pour être jeté dans les plus horribles cachots, ou livré au bourreau ! Eh bien, le jour qui suivra ma mort sera comme si j’avais expiré dans un palais, et si j’avais été porté au tombeau avec les plus grands honneurs ».
Ces réflexions sur la fuite rapide du temps rendaient la vigueur à mon âme. Mais me revinrent à la pensée mon père, ma mère, mes deux frères, mes deux sœurs, une autre famille que j’aimais comme si elle eût été la mienne ; et les raisonnements philosophiques ne valurent plus rien. Je m’attendris, et je pleurai comme un enfant.
Trois mois auparavant j’étais allé à Turin, et j’avais revu, après quelques années de séparation, mes chers parents, un de mes frères et mes deux sœurs. Toute notre famille s’était toujours tant aimée ! Aucun fils n’avait été plus que moi comblé de bienfaits par son père et sa mère. Oh ! comme, en revoyant les vénérés vieillards, j’avais été ému de les trouver notablement plus accablés par l’âge que je ne me l’imaginais ! Combien j’aurais alors voulu ne plus les abandonner, et me consacrer à soulager leur vieillesse par mes soins ! Combien je regrettai, pendant les jours si courts que je restai à Turin, d’être appelé par quelques autres devoirs hors du toit paternel, et de donner une si faible partie de mon temps à ce couple aimé ! Ma pauvre mère disait avec une mélancolique amertume : « Ah ! notre Silvio n’est pas venu à Turin pour nous voir » ! Le matin où je repartis pour Milan la séparation fut très douloureuse. Mon père monta dans la voiture avec moi, et m’accompagna pendant un mille ; puis il s’en revint tout seul. Je me retournais pour le regarder, et je pleurais, et je baisais un anneau que ma mère m’avait donné, et jamais je ne sentis une telle angoisse à m’éloigner de mes parents. Peu crédule aux pressentiments, je m’étonnais de ne pouvoir vaincre ma douleur, et j’étais forcé de dire avec épouvante : « D’où me vient cette inquiétude extraordinaire » ? Il me semblait vraiment prévoir quelque grande infortune.
Maintenant, en prison, je me ressouvenais de cette épouvante, de ces angoisses ; je me ressouvenais de toutes les paroles que j’avais entendues, trois mois auparavant, de mes parents. Cette plainte de ma mère : « Ah ! notre Silvio n’est pas venu à Turin pour nous voir » ! me retombait comme du plomb sur le cœur. Je me reprochais de ne m’être pas montré mille fois plus tendre pour eux. « Je les aime tant, et je le leur ai dit si faiblement ! Je ne devais plus jamais les revoir, et je me suis si peu rassasié de leurs chers visages ! et j’ai été si avare des témoignages de mon amour » ! Ces pensées me déchiraient l’âme.
Je fermai la fenêtre ; je me promenai pendant une heure, croyant n’avoir pas de repos de toute la nuit. Je me mis au lit, et la fatigue m’endormit.
S’éveiller la première nuit en prison est chose horrible. « Est-ce possible (dis-je en me rappelant où j’étais), est-ce possible ! moi ici ! et n’est-ce pas maintenant un rêve que je fais ? C’est donc hier qu’on m’a arrêté ? hier qu’on me fit subir ce long interrogatoire qui doit continuer demain, et qui sait combien de temps encore ? C’est hier soir, avant de m’endormir, que j’ai tant pleuré en pensant à mes parents » ?
Le repos, le silence absolu, le court sommeil qui avait réparé mes forces mentales, semblaient avoir centuplé en moi la puissance de la douleur. En cette absence totale de distractions, l’inquiétude de tous ceux qui m’étaient chers, et en particulier de mon père et de ma mère, lorsqu’ils apprendraient mon arrestation, se peignait à mon imagination avec une force incroyable.
« En ce moment, disais-je, ils dorment encore tranquilles, ou bien ils veillent en pensant avec douceur à moi, bien éloignés de soupçonner le lieu où je suis ! Heureux si Dieu les enlevait de ce monde avant que la nouvelle de mon malheur arrive à Turin ! Qui leur donnera la force de supporter ce coup » ?
Une voix intérieure sembla me répondre : « Celui que tous les affligés invoquent et aiment et sentent en eux-mêmes ! Celui qui donnait la force à une Mère de suivre son Fils au Golgotha, et de se tenir sous sa croix ! l’ami des malheureux, l’ami des hommes » !
Ce fut là le premier moment où la religion triompha de mon cœur ; et c’est à l’amour filial que je dois ce bienfait.
Jusque-là, sans être hostile à la religion, je la suivais peu et mal. Les vulgaires objections avec lesquelles on a la coutume de la combattre ne me paraissaient pas valoir grand-chose, et cependant mille doutes sophistiques affaiblissaient ma foi. Déjà, depuis longtemps, ces doutes ne tombaient plus sur l’existence de Dieu, et j’allais me répétant que, si Dieu existe, une conséquence nécessaire de sa justice est une autre vie pour l’homme qui a souffert dans un monde si injuste : de là, la suprême raison d’aspirer aux biens de cette seconde vie ; de là, un culte d’amour de Dieu et du prochain, une perpétuelle aspiration à s’ennoblir par de généreux sacrifices. Déjà, depuis longtemps, j’allais me redisant tout cela, et j’ajoutais : « Et quelle autre chose est le christianisme, sinon cette perpétuelle aspiration à se rendre meilleur » ? Et je m’étonnais que, l’essence du christianisme se manifestant si pure, si philosophique, si inattaquable, il fût venu une époque où la philosophie osât dire : « C’est moi qui désormais prendrai sa place. – Et de quelle façon la prendras-tu ? En enseignant le vice ? Non certes. En enseignant la vertu ? Eh bien, ce sera l’amour de Dieu et du prochain ; ce sera précisément ce que le christianisme enseigne ».
Bien que, depuis quelques années, j’éprouvasse ces sentiments, j’évitais de conclure : « Sois donc conséquent ! sois chrétien ! Ne te scandalise plus des abus ! Ne te révolte plus contre quelques points difficiles de la doctrine de l’Église, puisque le point principal est celui-ci, et il est très lucide : Aime Dieu et le prochain ».
En prison, je me décidai enfin à embrasser cette conclusion, et je l’embrassai. J’hésitai un peu en pensant que, si quelqu’un venait à me savoir plus religieux qu’auparavant, il se croirait en droit de me considérer comme un hypocrite ou comme avili par le malheur. Mais, sentant que je n’étais ni hypocrite ni avili, je me complus à ne tenir aucun compte des blâmes possibles non mérités, et je résolus d’être et de me déclarer désormais chrétien.
Je restai plus tard affermi dans cette résolution, mais je commençai à la ruminer, et presque à la vouloir pendant cette première nuit de captivité. Vers le matin mes fureurs étaient calmées, et je m’en étonnais. Je repensais à mes parents et aux autres personnes aimées, et je ne désespérais plus de leur force d’âme, et le souvenir des vertueux sentiments que je leur avais autrefois connus me consolait.
Pourquoi tout d’abord un tel trouble en moi en m’imaginant le leur, et pourquoi maintenant une telle confiance dans l’élévation de leur courage ? Cet heureux changement était-il un prodige ? Était-ce un effet naturel de ma croyance en Dieu ravivée ? – Eh ! qu’importe d’appeler prodiges ou non les réels et sublimes bienfaits de la religion ?
À minuit, deux secondini (ainsi s’appellent les garçons guichetiers qui dépendent du concierge) étaient venus me visiter et m’avaient trouvé de très mauvaise humeur. À l’aube ils revinrent, et me trouvèrent serein et cordialement disposé à la plaisanterie.
« Cette nuit Monsieur avait une mine de basilic, dit Tirola ; maintenant il est tout autre, et je m’en réjouis : c’est un signe qu’il n’est pas, – pardon de l’expression, – un coquin ; car les coquins (je suis vieux dans le métier et mes observations ont quelque poids), les coquins sont plus enragés le second jour de leur arrestation que le premier. Monsieur prend-il du tabac ? – Je n’ai pas l’habitude d’en prendre, mais je ne veux pas refuser votre gracieuseté. Quant à votre observation, excusez-moi, mais elle n’est pas de l’homme expérimenté que vous semblez être. Si ce matin je n’ai plus la mine d’un basilic, ne pourrait-il pas se faire que ce changement fût une preuve de sottise, de facilité à m’illusionner, à rêver ma prochaine mise en liberté ?
– Je n’en douterais pas si Monsieur était en prison pour d’autres motifs ; mais pour ces affaires d’État, au jour d’aujourd’hui, il n’est pas possible de croire qu’elles finissent ainsi sur deux pieds. Et Monsieur n’est pas assez simple pour se l’imaginer. Que Monsieur me pardonne : veut-il une autre prise ?
– Donnez. Mais comment peut-on avoir un visage aussi gai que le vôtre en vivant toujours parmi des malheureux ?
– Monsieur croira que c’est par indifférence pour les douleurs d’autrui ; je ne le sais pas positivement moi-même, à dire vrai ; mais je puis lui assurer que bien des fois voir pleurer me fait mal. Et alors je feins d’être gai, afin que les pauvres prisonniers sourient, eux aussi.
– Il me vient, brave homme, une pensée que je n’ai jamais eue : c’est qu’on peut faire le métier de geôlier et être de très bonne pâte.
– Le métier ne fait rien, Monsieur. Au-delà de cette voûte que vous voyez, par derrière la cour, il y a une autre cour et d’autres prisons, toutes pour les femmes. Ce sont… je ne trouve pas l’expression… des femmes de mauvaise vie. Eh bien, Monsieur, il y en a qui sont des anges quant au cœur. Et si monsieur était guichetier…
– Moi » ? (Et j’éclatai de rire).
Tirola s’arrêta déconcerté par mon rire, et ne poursuivit pas. Peut-être il voulait dire que, si j’avais été guichetier, j’aurais eu de la peine à ne pas me prendre d’affection pour quelqu’une de ces malheureuses.
Il me demanda ce que je voulais pour déjeuner. Il sortit, et quelques minutes après il m’apporta-le café.
Je le regardais fixement en face, avec un sourire malicieux qui voulait dire : « Porterais-tu un billet de moi à un autre infortuné, à mon ami Pierre » ? Et il me répondit avec un autre sourire qui voulait dire : « Non, Monsieur ; et si vous vous adressez à un de mes camarades, prenez garde que celui qui vous dira oui ne vous trahisse ».
Je ne suis pas véritablement certain qu’il me comprît, ni que je le comprisse. Ce que je sais bien, c’est que je fus dix fois sur le point de lui demander un morceau de papier et un crayon, et que je n’osai pas parce qu’il y avait quelque chose dans ses yeux qui semblait m’avertir de ne me fier à personne, et moins encore aux autres qu’à lui.
Si Tirola, avec son expression de bonté, n’avait pas eu en même temps ces regards si faux, s’il avait eu une physionomie plus noble, j’aurais cédé à la tentation d’en faire mon ambassadeur, et peut-être un billet de moi, parvenu à temps à mon ami, lui aurait donné le moyen de réparer quelque erreur, – et peut-être cela aurait-il sauvé non pas lui, le pauvret, qui était déjà trop compromis, mais plusieurs autres et moi.
Patience ! Il devait en arriver ainsi.
Je fus appelé pour la continuation de l’interrogatoire, et cela dura toute cette journée et plusieurs autres, sans aucun intervalle que celui des repas.
Tant que le procès ne fut pas clos, les jours s’envolaient rapides pour moi, si grande était ma tension d’esprit pour ces interminables réponses à des demandes si variées, et pour me recueillir aux heures du dîner et le soir, afin de réfléchir à tout ce qui m’avait été demandé et à ce que j’avais répondu, ainsi qu’à tous les points sur lesquels je serais probablement encore interrogé.
À la fin de la première semaine, il m’advint un grand déplaisir. Mon pauvre Pierre, désireux autant que je l’étais moi-même de pouvoir établir entre nous quelque communication, m’envoya un billet et se servit, non de l’un des guichetiers, mais d’un malheureux prisonnier qui venait avec eux faire quelque service dans nos chambres. C’était un homme de soixante à soixante-dix ans, condamné à je ne sais combien de mois de détention.
Avec une épingle que j’avais je me piquai un doigt, et je fis avec mon sang quelques lignes de réponse que je remis au messager. Il eut la malchance d’être épié, fouillé, trouvé avec le billet sur lui, et, si je ne me trompe, bâtonné. J’entendis des cris aigus qui me parurent venir du malheureux vieillard, et je ne le revis jamais plus.
Appelé à l’interrogatoire, je frémis en me voyant représenter mon petit papier barbouillé de sang qui, grâce au Ciel, ne parlait pas de choses pouvant nuire et avait l’air d’un simple bonjour. On me demanda avec quoi je m’étais tiré du sang ; on m’enleva l’épingle, et on rit de ceux qu’on avait joués. Ah ! moi, je ne ris pas ! Je ne pouvais ôter de devant mes yeux le vieux messager. J’aurais volontiers souffert quelque châtiment pour qu’on lui pardonnât, et quand arrivèrent à mes oreilles les cris que je soupçonnais être de lui, mon cœur s’emplit de larmes.
En vain je demandai plusieurs fois de ses nouvelles au geôlier et aux guichetiers. Ils secouaient la tête et disaient : « Il l’a payé cher celui-là ; il n’en refera plus de semblables ; il jouit maintenant d’un peu plus de repos ». Ils ne voulaient pas s’expliquer davantage.
Faisaient-ils allusion à l’étroite prison où était tenu cet infortuné, ou parlaient-ils ainsi parce qu’il était mort sous la bastonnade ou de ses suites ?
Un jour il me sembla le voir de l’autre côté de la cour, sous le portique, avec une charge de bois sur les épaules. Le cœur me palpita comme si j’avais revu un frère.
Quand je ne fus plus martyrisé par les interrogatoires et que je n’eus plus rien pour occuper mes journées, alors je sentis amèrement le poids de la solitude.
On me permit bien d’avoir une Bible et Dante ; le concierge mit bien à ma disposition sa bibliothèque, consistant en quelques romans de Scudéry, du Piazzi et pire encore ; mais mon esprit était trop agité pour pouvoir s’appliquer à quelque lecture. J’apprenais par cœur chaque jour un chant de Dante, et cet exercice était cependant si machinal, que je le faisais en pensant moins à ces vers qu’à mes malheurs. Il m’en arrivait de même en lisant d’autres choses, excepté parfois certains passages de la Bible. Ce divin livre que j’avais toujours beaucoup aimé, alors même que je me croyais incrédule, était maintenant étudié par moi avec plus de respect que jamais. Toutefois, en dépit de mon bon vouloir, je le lisais le plus souvent ayant l’esprit à autre chose, et je ne comprenais pas. Peu à peu je devins capable de le méditer plus fortement et de le goûter toujours davantage.
Une telle lecture ne me donna jamais la moindre disposition à la bigoterie, c’est-à-dire à cette dévotion mal entendue qui rend pusillanime ou fanatique. Au contraire, elle m’enseignait à aimer Dieu et les hommes, à désirer toujours davantage le règne de la justice, à abhorrer l’iniquité tout en pardonnant aux hommes iniques. Le christianisme, au lieu de défaire en moi ce que la philosophie pouvait y avoir fait de bon, l’affermissait, le rendait meilleur par des raisons plus élevées, plus puissantes.
Un jour, ayant lu qu’il faut prier sans cesse, et que la véritable prière ne consiste pas à marmotter beaucoup de mots à la façon des païens, mais à adorer Dieu avec simplicité, tant en paroles qu’en actions, et à faire que les unes et les autres soient l’accomplissement de sa volonté sainte, je me proposai de commencer consciencieusement cette incessante prière, c’est-à-dire de ne plus me permettre une pensée qui ne fût animée du désir de me conformer aux décrets de Dieu.
Les formules de prière que je récitais dans mon adoration furent toujours peu nombreuses, non par mépris (car je les crois au contraire très salutaires, à ceux-ci plus, à ceux-là moins, pour fixer l’attention dans le culte), mais parce que je me sens ainsi fait, que je ne suis pas capable d’en réciter beaucoup sans tomber dans des distractions et mettre l’idée du culte en oubli.
L’attention à me tenir constamment en présence de Dieu, au lieu d’être un sujet de crainte, était pour moi une très suave chose. En n’oubliant pas que Dieu est toujours à côté de nous, qu’il est en nous, ou plutôt que nous sommes en lui, la solitude perdait de plus en plus chaque jour de son horreur pour moi. « Ne suis-je pas en sublime compagnie » ? me disais-je ; et je me rassérénais, et je chantonnais, et je sifflais avec plaisir et avec attendrissement.
« Eh bien ! pensai-je, n’aurait-il pas pu m’arriver une fièvre qui m’aurait mis au tombeau ? Tous ceux qui me sont chers, qui, en me perdant, se seraient abandonnés aux larmes, auraient cependant acquis peu à peu la force de se résigner à mon absence. Au lieu d’une tombe, c’est une prison qui m’a dévoré ; dois-je croire que Dieu ne les munira pas d’une force égale » ?
Mon cœur exhalait les vœux les plus fervents pour eux, quelquefois avec des larmes ; mais les larmes elles-mêmes étaient mêlées de douceur. J’avais pleine confiance que Dieu nous soutiendrait, eux et moi. Je ne me suis pas trompé.
Vivre libre est beaucoup plus beau que de vivre en prison ; qui en doute ? Pourtant, même dans les misères d’une prison, quand on pense que Dieu y est présent, que les joies du monde sont fugaces, que le vrai bien est dans la conscience, et non dans les objets extérieurs, on peut sentir du plaisir à la vie. Pour moi, j’avais pris en moins d’un mois mon parti, je ne dirai pas complètement, mais d’une façon supportable. Je vis que, ne voulant pas commettre l’indigne action d’acheter l’impunité en poursuivant la perte d’autrui, mon sort ne pouvait être que la potence ou un long emprisonnement. Il était nécessaire de s’y résigner. « Je respirerai jusqu’à ce qu’ils me laissent un souffle, dis-je, et quand ils me l’enlèveront, je ferai comme tous les malades quand ils sont arrivés au suprême moment. Je mourrai ».
Je m’étudiais à ne me plaindre de rien, et à donner à mon âme toutes les jouissances possibles. La plus ordinaire était de renouveler rémunération des biens qui avaient embelli mes jours : un père excellent, une excellente mère, des frères et des sœurs excellents, eux aussi, tels et tels amis, une bonne éducation, l’amour des lettres, etc. Qui plus que moi avait été comblé de félicité ? Pourquoi ne pas en rendre grâces à Dieu, bien que maintenant tout cela soit tempéré par l’adversité ? Alors, en faisant cette énumération, je m’attendrissais, et je pleurais un instant ; mais le courage et la gaieté finissaient par revenir.
Dès les premiers jours, je m’étais fait un ami. Ce n’était pas le geôlier, ni aucun des guichetiers, ni aucun des juges du procès. Je parle pourtant d’une créature humaine. Qui était-ce ? – Un petit enfant, sourd et muet, de cinq ou six ans. Son père et sa mère étaient des voleurs, et la loi les avait frappés. Le malheureux petit orphelin était maintenu entre les mains de la police, avec quelques autres enfants dans la même situation. Ils habitaient tous dans une chambre en face de la mienne, et à de certaines heures on leur ouvrait la porte pour qu’ils sortissent prendre l’air dans la cour.
Le sourd-muet venait sous ma fenêtre, me souriait et gesticulait. Je lui jetais un beau morceau de pain ; il le prenait en faisant un bond de joie, courait à ses camarades et en donnait à tous ; puis il venait manger sa petite portion près de ma fenêtre, exprimant sa gratitude avec le sourire de ses beaux yeux.
Les autres enfants me regardaient de loin, mais n’osaient pas m’approcher ; le sourd-muet avait une grande sympathie pour moi, non pas seulement par un motif d’intérêt. Quelquefois il ne savait que faire du pain que je lui jetais, et me faisait signe que lui et ses camarades avaient bien mangé et ne pouvaient prendre plus de nourriture. S’il voyait venir un guichetier dans ma chambre, il lui donnait le pain pour qu’il me le rendît. Bien qu’il n’attendît alors rien de moi, il continuait à folâtrer devant ma fenêtre avec une grâce tout aimable, se réjouissant que je le visse. Une fois un guichetier permit à l’enfant d’entrer dans ma prison ; celui-ci, à peine entré, courut m’embrasser les jambes en poussant un cri de joie. Je le pris dans mes bras, et je ne saurais décrire le transport avec lequel il me comblait de caresses. Que d’amour dans cette chère petite âme ! Comme j’aurais voulu pouvoir le faire élever, et le sauver de l’abjection dans laquelle il se trouvait !
Je n’ai jamais su son nom. Lui-même ne savait pas en avoir un. Il était toujours gai, et je ne le vis jamais pleurer qu’une fois qu’il fut battu, je ne sais pourquoi, par le geôlier. Chose étrange ! vivre en de semblables lieux semble le comble de l’infortune, et pourtant cet enfant avait certainement autant de félicité que peut en avoir à cet âge le fils d’un prince. Je faisais cette réflexion, et j’apprenais ainsi que l’humeur peut se rendre indépendante du lieu. Gouvernons l’imagination, et nous serons bien presque partout. Un jour est vite passé, et quand le soir on se met au lit sans faim et sans douleurs aiguës, qu’importe que ce lit soit plutôt entre des murs qui s’appellent prison, ou entre des murs qui s’appellent maison ou palais ?
Excellent raisonnement ! Mais comment faire pour gouverner l’imagination ? Je m’y essayais, et il me semblait bien parfois y réussir à merveille ; mais d’autres fois elle triomphait tyranniquement, et moi, plein de dépit, je m’étonnais de ma faiblesse.
« Dans mon malheur, je suis pourtant heureux, disais-je, qu’on m’ait donné une prison au rez-de-chaussée, sur cette cour, où, à quatre pas de moi, vient ce cher petit enfant, avec lequel j’entretiens si doucement une conversation muette ! Admirable intelligence humaine ! Que de choses nous nous disons, lui et moi, par l’expression infinie des regards et de la physionomie ! Comme il règle ses mouvements avec grâce, quand il sourit ! Comme il les corrige, quand il voit qu’ils me déplaisent ! Comme il comprend que je l’aime, quand il caresse ou qu’il régale un de ses camarades ! Personne au monde ne se l’imagine, et pourtant moi, debout près de la fenêtre, je puis être une espèce d’éducateur pour cette pauvre petite créature. À force de répéter notre mutuel exercice de signes, nous perfectionnerons la communication de nos idées. Plus il sentira qu’il s’instruit et qu’il s’ennoblit avec moi, plus il m’affectionnera. Je serai pour lui le génie de la raison et de la bonté ; il apprendra à me confier ses douleurs, ses joies, ses désirs ; moi, j’apprendrai à le consoler, à le rendre meilleur, à le diriger dans toute sa conduite. Qui sait si, en tenant mon sort indécis de mois en mois, on ne me laissera pas vieillir ici ? Qui sait si cet enfant ne croîtra pas sous mes yeux, et ne sera pas employé à quelque service dans cette maison ? Avec autant d’intelligence qu’il en montre, que pourra-t-il devenir ? Hélas ! rien de plus qu’un excellent guichetier, ou quelque autre chose de semblable. Eh bien, n’aurai-je pas fait une bonne œuvre, si j’ai contribué à lui inspirer le désir de plaire aux honnêtes gens et à lui-même, à lui donner l’habitude des sentiments de bienveillance » ?





























