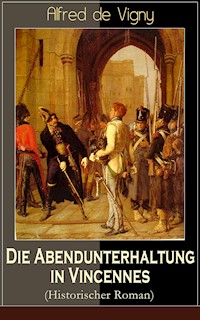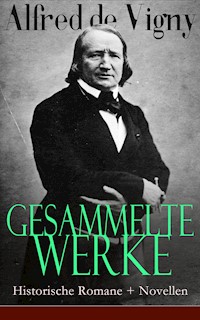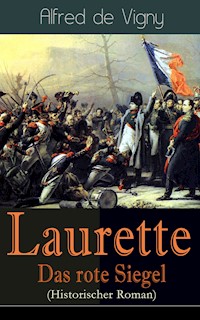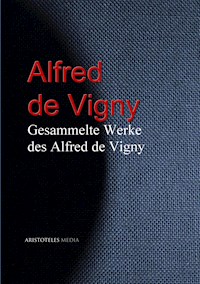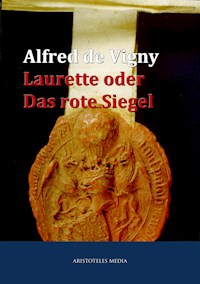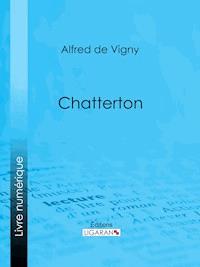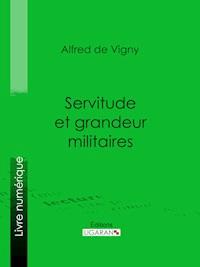
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "S'il est vrai, selon le poète catholique, qu'il n'y ait pas de plus grande peine que de se rappeler un temps heureux, dans la misère, il est aussi vrai que l'âme trouve quelque bonheur à se rappeler, dans un moment de calme et de liberté, les temps de peine ou d'esclavage. Cette mélancolique émotion me fait jeter en arrière un triste regard sur quelques années de ma vie, quoique ces années soient bien proches de celle-ci..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ave, Cœsar, morituri te salutant.
S’il est vrai, selon le poète catholique, qu’il n’y ait pas de plus grande peine que de se rappeler un temps heureux, dans la misère, il est aussi vrai que l’âme trouve quelque bonheur à se rappeler, dans un moment de calme et de liberté, les temps de peine ou d’esclavage. Cette mélancolique émotion me fait jeter en arrière un triste regard sur quelques années de ma vie, quoique ces années soient bien proches de celle-ci, et que cette vie ne soit pas bien longue encore.
Je ne puis m’empêcher de dire combien j’ai vu de souffrances peu connues et courageusement portées par une race d’hommes toujours dédaignée ou honorée outre mesure, selon que les nations la trouvent inutile ou nécessaire.
Cependant ce sentiment ne me porte pas seul à cet écrit, et j’espère qu’il pourra servir à montrer quelquefois, par des détails de mœurs observés de mes yeux, ce qui nous reste encore d’arriéré et de barbare dans l’organisation toute moderne de nos armées permanentes, où l’homme de guerre est isolé du citoyen, où il est malheureux et féroce, parce qu’il sent sa condition mauvaise et absurde. Il est triste que tout se modifie au milieu de nous, et que la destinée des armées soit la seule immobile. La loi chrétienne a changé une fois les usages féroces de la guerre ; mais les conséquences des nouvelles mœurs qu’elle introduisit n’ont pas été poussées assez loin sur ce point. Avant elle, le vaincu était massacré ou esclave pour la vie, les villes prises saccagées, les habitants chassés et dispersés ; aussi, chaque état épouvanté se tenait-il constamment prêt à des mesures désespérées, et la défense était aussi féroce que l’attaque. À présent les villes conquises n’ont à craindre que de payer des contributions. Ainsi la guerre s’est civilisée, mais non les armées ; car non seulement la routine de nos coutumes leur a conservé tout ce qu’il y avait de mauvais en elles, mais l’ambition ou les terreurs des gouvernements ont accru le mal, en les séparant chaque jour du pays, et en leur faisant une servitude plus oisive et plus grossière que jamais. Je crois peu aux bienfaits des subites organisations ; mais je conçois ceux des améliorations successives. Quand l’attention générale est attirée sur une blessure, la guérison tarde peu. Cette guérison sans doute est un problème difficile à résoudre pour le législateur, mais il n’en était que plus nécessaire de le poser. Je le fais ici, et si notre époque n’est pas destinée à en avoir la solution, du moins ce vœu aura reçu de moi sa forme, et les difficultés en seront peut-être diminuées. On ne peut trop hâter l’époque où les armées seront plus identifiées à la Nation, si elle doit acheminer au temps où les armées et la guerre ne seront plus, et où le globe ne portera plus qu’une nation unanime enfin sur ses formes sociales, évènement qui, depuis longtemps, devrait être accompli. Je n’ai nul dessein d’intéresser à moi-même, et ces souvenirs seront plutôt les mémoires des autres que les miens ; mais j’ai été assez vivement et assez longtemps blessé des étrangetés de la vie des armées pour en pouvoir parler. Ce n’est que pour constater ce triste droit que je dis quelques mots sur moi. J’appartiens à cette génération née avec le siècle, qui, nourrie de bulletins par l’Empereur, avait toujours devant les yeux une épée nue, et vint la prendre au moment même où la France la remettait dans le fourreau des Bourbons. Aussi dans ces modestes tableaux d’une partie obscure de ma vie, je ne veux paraître que ce que je fus, spectateur plus qu’acteur, à mon grand regret. Les évènements que je cherchais ne vinrent pas aussi grands qu’il me les eût fallu. Qu’y faire ? On n’est pas toujours maître de jouer le rôle qu’on eût aimé, et l’habit ne nous vient pas toujours au temps où nous le porterions le mieux. Au moment où j’écris, un homme de vingt ans de service n’a pas vu une bataille rangée. J’ai peu d’aventures à raconter ; mais j’en ai entendu beaucoup. Je ferai donc parler les autres plus que moi-même, hors quand je serai forcé de m’appeler comme témoin. Je m’y suis toujours senti quelque répugnance, en étant empêché par une certaine pudeur, au moment de me mettre en scène. Quand cela m’arrivera, du moins puis-je attester qu’en ces endroits je serai vrai. Quand on parle de soi, la meilleure muse est la Franchise. Je ne saurais me parer de bonne grâce de la plume des paons ; toute belle qu’elle est, je crois que chacun doit lui préférer la sienne. Je ne me sens pas assez de modestie, je l’avoue, pour croire gagner beaucoup en prenant quelque chose de l’allure d’un autre, et en posant dans une attitude grandiose, artistement choisie, et péniblement conservée aux dépens des bonnes inclinations naturelles et d’un penchant inné que nous avons tous vers la vérité. Je ne sais si de nos jours il ne s’est pas fait quelque abus de cette littéraire singerie, et il me semble que la moue de Bonaparte et celle de Byron ont fait grimacer bien des figures innocentes.
La vie est trop courte pour que nous en perdions une part précieuse à nous contrefaire. Encore si l’on avait affaire à un peuple grossier et facile à duper ! mais le nôtre a l’œil si prompt et si fin qu’il reconnaît sur-le-champ à quel modèle vous empruntez ce mot ou ce geste, cette parole ou cette démarche favorite, ou seulement telle coiffure ou tel habit. Il souffle tout d’abord sur la barbe de votre masque et prend en mépris votre vrai visage dont, sans cela, il eût peut-être pris en amitié les traits naturels.
Je ferai donc peu le guerrier ayant peu vu la guerre ; mais j’ai droit de parler des mâles coutumes de l’armée, où les fatigues et les ennuis ne me furent point épargnés, et qui trempèrent mon âme dans une patience à toute épreuve en lui faisant rejeter ses forces dans le recueillement solitaire et l’étude. Je pourrai faire voir aussi ce qu’il y a d’attachant dans la vie sauvage des armes toute pénible qu’elle est, y étant demeuré si longtemps, entre l’écho et le rêve des batailles. C’eût été là assurément quatorze ans perdus si je n’y eusse exercé une observation attentive et persévérante, qui faisait son profit de tout pour l’avenir. Je dois même à la vie de l’armée des vues de la nature humaine que jamais je n’eusse pu rechercher autrement que sous l’habit militaire. Il y a des scènes que l’on ne trouve qu’à travers des dégoûts qui seraient vraiment intolérables, si on n’était forcé de les tolérer.
J’aimai toujours à écouter, et quand j’étais tout enfant, je pris de bonne heure ce goût sur les genoux blessés de mon vieux père. Il me nourrit d’abord de l’histoire de ses campagnes, et, sur ses genoux, je trouvai la guerre assise à côté de moi ; il me montra la guerre dans ses blessures, la guerre dans les parchemins et le blason de ses pères, la guerre dans leurs grands portraits cuirassés, suspendus, en Beauce, dans un vieux château. Je vis dans la Noblesse une grande famille de soldats héréditaires, et je ne pensai plus qu’à m’élever à la taille d’un soldat.
Mon père racontait ses longues guerres avec l’observation profonde d’un philosophe et la grâce d’un homme de cour. Par lui, je connais intimement Louis XV et le grand Frédéric ; je n’affirmerais pas que je n’aie pas vécu de leur temps, familier comme je le fus avec eux par tant de récits de la guerre de sept ans.
Il avait pour Frédéric II cette admiration éclairée qui voit les hautes facultés sans s’en étonner outre mesure. Il me frappa tout d’abord l’esprit de cette vue, me disant aussi comment trop d’enthousiasme pour cet illustre ennemi avait été un tort des officiers de son temps ; qu’ils étaient à demi vaincus par là, quand Frédéric s’avançait grandi par l’exaltation française ; que les divisions successives des trois puissances entre elles et des généraux français entre eux l’avaient servi dans la fortune éclatante de ses armes ; mais que sa grandeur avait été surtout de se connaître parfaitement, d’apprécier à leur juste valeur les éléments de son élévation, et de faire, avec la modestie d’un sage, les honneurs de sa victoire. Il paraissait quelquefois penser que l’Europe l’avait ménagé. Mon père avait vu de près ce roi philosophe, sur le champ de bataille de Clostercamp et de Crefelt, où son frère, l’aîné de mes sept oncles, avait été emporté d’un boulet de canon ; il avait été souvent reçu par le Roi sous la tente prussienne avec une grâce et une politesse toute française, et l’avait entendu parler de Voltaire et jouer de la flûte après une bataille gagnée. Je m’étends ici, presque malgré moi, parce que ce fut le premier grand homme dont me fut tracé ainsi, en famille, le portrait d’après nature, et parce que mon admiration pour lui fut le premier symptôme de mon inutile amour des armes, la cause première d’une des plus complètes déceptions de ma vie. Ce portrait est brillant encore, dans ma mémoire, des plus vives couleurs, et le portrait physique autant que l’autre. Son chapeau avancé sur un front poudré, son dos voûté à cheval, ses grands yeux, sa bouche moqueuse et sévère, sa canne d’invalide faite en béquille, rien ne m’était étranger, et, au sortir de ces récits, je ne vis qu’avec humeur Bonaparte prendre chapeau, tabatière et gestes pareils ; il me parut d’abord plagiaire, et qui sait si, en ce point, ce grand homme ne le fut pas quelque peu ? qui saura peser ce qu’il entre du comédien dans tout homme public toujours en vue ? Frédéric II n’était-il pas le premier type du grand capitaine tacticien moderne, du roi philosophe et organisateur ? C’étaient là les premières idées qui s’agitaient dans mon esprit, et j’assistais à d’autres temps racontés avec une vérité toute remplie de saines leçons. J’entends encore mon père tout irrité des divisions du prince de Soubise et de M. de Clermont, j’entends encore ses grandes indignations contre les intrigues de l’Œil de Bœuf, qui faisaient que les généraux français s’abandonnaient tour à tour sur le champ de bataille, préférant la défaite de l’armée au triomphe d’un rival ; je l’entends tout ému de ses antiques amitiés pour M. de Chevert et pour M. d’Assas, avec qui il était au camp la nuit de sa mort. Les yeux qui les avaient vus mirent leur image dans les miens, et aussi celle de bien des personnages célèbres morts longtemps avant ma naissance. Les récits de famille ont cela de bon, qu’ils se gravent plus fortement dans la mémoire que les narrations écrites ; ils sont vivants comme le conteur vénéré, et ils allongent notre vie en arrière comme l’imagination qui devine peut l’allonger en avant dans l’avenir.
Je ne sais si un jour j’écrirai pour moi-même tous les détails intimes de ma vie, mais je ne veux parler ici que d’une des préoccupations de mon âme. Quelquefois, l’esprit tourmenté du passé et attendant peu de chose de l’avenir, on cède trop aisément à la tentation d’amuser quelques désœuvrés des secrets de sa famille et des mystères de son cœur. Je conçois que quelques écrivains se soient plu à faire pénétrer tous les regards dans l’intérieur de leur vie et même de leur conscience, l’ouvrant et le laissant surprendre par la lumière, tout en désordre et comme encombré de familiers souvenirs et des fautes les plus chéries. Il y a des œuvres telles parmi les plus beaux livres de notre langue, et qui nous resteront comme ces beaux portraits de lui-même que Raphaël ne cessait de faire. Mais ceux qui se sont représentés ainsi, soit avec un voile, soit à visage découvert, en ont eu le droit, et je ne pense pas que l’on puisse faire ses confessions à voix haute, avant d’être assez vieux, assez illustre ou assez repentant, pour intéresser toute une nation à ses péchés. Jusque-là, on ne peut guère prétendre qu’à lui être utile par ses idées ou par ses actions.
Vers la fin de l’Empire, je fus un lycéen distrait. La guerre était debout dans le lycée, le tambour étouffait à mes oreilles la voix des maîtres, et la voix mystérieuse des livres ne nous parlait qu’un langage froid et pédantesque. Les logarithmes et les tropes n’étaient à nos yeux que des degrés pour monter à l’étoile de la Légion d’Honneur, la plus belle étoile des cieux pour des enfants.
Nulle méditation ne pouvait enchaîner longtemps des têtes étourdies sans cesse par les canons et les cloches des Te Deum ! Lorsqu’un de nos frères, sorti, depuis quelques mois, du collège, reparaissait en uniforme de houssard et le bras en écharpe, nous rougissions de nos livres et nous les jetions à la tête des maîtres. Les maîtres même ne cessaient de nous lire les bulletins de la grande armée, et nos cris de : Vive l’Empereur ! interrompaient Tacite et Platon. Nos précepteurs ressemblaient à des hérauts d’armes, nos salles d’étude à des casernes, nos récréations à des manœuvres, et nos examens à des revues.
Il me prit alors plus que jamais un amour vraiment désordonné de la gloire des armes ; passion d’autant plus malheureuse, que c’était le temps précisément où, comme je l’ai dit, la France commençait à s’en guérir. Mais l’orage grondait encore, et ni mes études sévères, rudes, forcées et trop précoces, ni le bruit du grand monde où, pour me distraire de ce penchant, on m’avait jeté tout adolescent, ne me purent ôter cette idée fixe.
Bien souvent j’ai souri de pitié sur moi-même, en voyant avec quelle force une idée s’empare de nous, comme elle nous fait sa dupe, et combien il faut de temps pour l’user. La satiété même ne parvint qu’à me faire désobéir à celle-ci, non à la détruire en moi, et ce livre même me prouve que je prends plaisir encore à la caresser, et que je ne serais pas éloigné d’une rechute. Tant les impressions d’enfance sont profondes, et tant s’était bien gravée sur nos cœurs la marque brûlante de l’aigle romaine !
Ce ne fut que très tard que je m’aperçus que mes services n’étaient qu’une longue méprise, et que j’avais porté dans une vie tout active, une nature toute contemplative. Mais j’avais suivi la pente de cette génération de l’Empire, née avec le siècle, et de laquelle je suis.
La guerre nous semblait si bien l’état naturel de notre pays que, lorsque échappés des classes, nous nous jetâmes dans l’armée, selon le cours accoutumé de notre torrent, nous ne pûmes croire au calme durable de la paix. Il nous parut que nous ne risquions rien, en faisant semblant de nous reposer, et que l’immobilité n’était pas un mal sérieux en France. Cette impression nous dura autant qu’a duré la Restauration. Chaque année apportait l’espoir d’une guerre, et nous n’osions quitter l’épée, dans la crainte que le jour de la démission ne devînt la veille d’une campagne. Nous traînâmes et perdîmes ainsi des années précieuses, rêvant le champ de bataille dans le Champ-de-Mars, et épuisant dans des exercices de parade et dans des querelles particulières une puissante et inutile énergie.
Accablé d’un ennui que je n’attendais pas dans cette vie si vivement désirée, ce fut alors pour moi une nécessité que de me dérober, dans les nuits, au tumulte fatigant et vain des journées militaires : de ces nuits, où j’agrandis en silence ce que j’avais reçu de savoir de nos études tumultueuses et publiques, sortirent mes poèmes et mes livres ; de ces journées, il me reste ces souvenirs dont je rassemble ici, autour d’une idée, les traits principaux. Car, ne comptant pour la gloire des armes ni sur le présent, ni sur l’avenir, je la cherchais dans les souvenirs de mes compagnons. Le peu qui m’est advenu ne servira que de cadre à ces tableaux de la vie militaire et des mœurs de nos armées, dont tous les traits ne sont pas connus.
L’Armée est une nation dans la Nation ; c’est un vice de nos temps. Dans l’antiquité, il en était autrement : tout citoyen était guerrier, et tout guerrier était citoyen ; les hommes de l’Armée ne se faisaient point un autre visage que les hommes de la cité. La crainte des dieux et des lois, la fidélité à la patrie, l’austérité des mœurs, et, chose étrange ! l’amour de la paix et de l’ordre, se trouvaient dans les camps plus que dans les villes, parce que c’était l’élite de la nation qui les habitait. La paix avait des travaux plus rudes que la guerre pour ces armées intelligentes. Par elles la terre de la patrie était couverte de monuments ou sillonnée de larges routes, et le ciment romain des aqueducs était pétri, ainsi que Rome elle-même, des mains qui la défendaient. Le repos des soldats était fécond autant que celui des nôtres est stérile et nuisible. Les citoyens n’avaient ni admiration pour leur valeur, ni mépris pour leur oisiveté, parce que le même sang circulait sans cesse des veines de la Nation dans les veines de l’Armée.
Dans le Moyen Âge et au-delà, jusqu’à la fin du règne de Louis XIV, l’Armée tenait encore à la Nation, sinon par tous ses soldats, du moins par tous leurs chefs, parce que le soldat était l’homme du noble, levé par lui sur sa terre, amené à sa suite à l’armée, et ne relevant que de lui ; or son seigneur était propriétaire et vivait dans les entrailles mêmes de la mère-patrie. Soumis à l’influence toute populaire du prêtre, il ne fit autre chose, durant le Moyen Âge, que de se dévouer corps et biens au pays ; souvent en lutte contre la couronne, et sans cesse révolté contre une hiérarchie de pouvoirs qui eût amené trop d’abaissement dans l’obéissance, et par conséquent d’humiliation dans la profession des armes. Le régiment appartenait au colonel, la compagnie au capitaine, et l’un et l’autre savaient fort bien emmener leurs hommes, quand leur conscience, comme citoyens, n’était pas d’accord avec les ordres qu’ils recevaient comme hommes de guerre. Cette indépendance de l’Armée dura en France jusqu’à M. de Louvois, qui, le premier, la soumit aux bureaux et la remit, pieds et poings liés, dans la main du Pouvoir souverain. Il n’y éprouva pas peu de résistance, et les derniers défenseurs de la Liberté généreuse y des hommes de guerre furent ces rudes et francs gentilshommes qui ne voulaient amener leur famille de soldats à l’Armée, que pour aller en guerre. Quoiqu’ils n’eussent pas passé l’année à enseigner l’éternel maniement d’armes à des automates, je vois qu’eux et leurs soldats se tiraient assez bien d’affaire sur les champs de bataille de Turenne. Ils haïssaient particulièrement l’uniforme qui donne à tous le même aspect, et soumet les esprits à l’habit et non à l’homme. Ils se plaisaient à se vêtir de rouge, les jours de combat, pour être mieux vus des leurs, et mieux visés de l’ennemi ; et j’aime à rappeler, sur la foi de Mirabeau, ce vieux marquis de Coëtquen, qui, plutôt que de paraître en uniforme à la revue du Roi, se fit casser par lui à la tête de son régiment : – Heureusement, sire, que les morceaux me restent, dit-il après. C’était quelque chose que de répondre ainsi à Louis XIV. Je n’ignore pas les mille défauts de l’organisation qui expirait alors, mais je dis qu’elle avait cela de meilleur que la nôtre, de laisser plus librement luire et flamber le feu national et guerrier de la France. Cette sorte d’Armée était une armure très forte et très complète dont la Patrie couvrait le Pouvoir souverain, mais dont toutes les pièces pouvaient se détacher d’elles-mêmes, l’une après l’autre, si le Pouvoir s’en servait contre elle.
La destinée d’une armée moderne est tout autre que celle-là, et la centralisation des Pouvoirs l’a faite ce qu’elle est. C’est un corps séparé du grand corps de la nation, et qui semble le corps d’un enfant, tant il marche en arrière pour l’intelligence, et tant il lui est défendu de grandir. L’armée moderne, sitôt qu’elle cesse d’être en guerre, devient une sorte de gendarmerie. Elle se sent comme honteuse d’elle-même, et ne sait ni ce qu’elle fait ni ce qu’elle est ; elle se demande sans cesse si elle est esclave ou reine de l’état : ce corps cherche partout son âme et ne la trouve pas.
L’homme soldé, le Soldat, est un pauvre glorieux, victime et bourreau, bouc émissaire, journellement sacrifié à son peuple et pour son peuple, qui se joue de lui ; c’est un martyr féroce et humble tout ensemble, que se rejettent le Pouvoir et la Nation toujours en désaccord.
Que de fois, lorsqu’il m’a fallu prendre une part obscure, mais active, dans nos troubles civils, j’ai senti ma conscience s’indigner de cette condition inférieure et cruelle ! Que de fois j’ai comparé cette existence à celle du gladiateur ! Le peuple est le César indifférent, le Claude ricaneur auquel les soldats disent sans cesse en défilant : Ceux qui vont mourir te saluent.
Que quelques ouvriers, devenus plus misérables à mesure que s’accroissent leur travail et leur industrie, viennent à s’ameuter contre leur chef d’atelier, ou qu’un fabricant ait la fantaisie d’ajouter, cette année, quelques cent mille francs à son revenu ; ou seulement qu’une bonne ville, jalouse de Paris, veuille avoir aussi ses trois journées de fusillade ; on crie au secours de part et d’autre. Le gouvernement, quel qu’il soit, répond, avec assez de bon sens : La loi ne me permet pas de juger entre vous, tout le monde a raison, moi, je n’ai à vous envoyer que mes gladiateurs, qui vous tueront et que vous tuerez. En effet, ils vont, ils tuent, et sont tués. La paix revient, on s’embrasse, on se complimente, et les chasseurs de lièvres se félicitent de leur adresse dans le tir à l’officier et au soldat. Tout calcul fait, reste une simple soustraction de quelques morts ; mais les soldats n’y sont pas portés en nombre, ils ne comptent pas. On s’en inquiète peu. Il est convenu que ceux qui meurent sous l’uniforme n’ont ni père ni mère, ni femme ni amie à faire mourir dans les larmes. C’est un sang anonyme.
Quelquefois (chose fréquente aujourd’hui), les deux partis séparés s’unissent pour accabler de haine et de malédictions les malheureux qui ont été condamnés à les vaincre.
Aussi le sentiment qui dominera ce livre sera-t-il celui qui me l’a fait commencer, le désir de détourner de la tête du Soldat cette malédiction que le citoyen est souvent prêt à lui donner, et d’appeler sur l’Armée le pardon de la Nation. Ce qu’il y a de plus beau après l’inspiration, c’est le dévouement ; après le Poète, c’est le Soldat ; ce n’est pas sa faute s’il est condamné à un état d’ilote.
L’Armée est aveugle et muette. Elle frappe devant elle, du lieu où on la met. Elle ne veut rien et agit par ressort. C’est une grande chose que l’on meut et qui tue ; mais c’est aussi une chose qui souffre
C’est pour cela que j’ai toujours parlé d’elle avec un attendrissement involontaire. Nous voici jetés dans ces temps sévères où les villes de France deviennent tour à tour des champs de bataille, et, depuis peu, nous avons beaucoup à pardonner aux hommes qui tuent.
En regardant de près la vie de ces troupes armées que, chaque jour, pousseront sur nous tous les Pouvoirs qui se succéderont, nous trouverons bien, il est vrai, que, comme je l’ai dit, l’existence du Soldat est (après la peine de mort) la trace la plus douloureuse de barbarie qui subsiste parmi les hommes, mais aussi que rien n’est plus digne de l’intérêt et de l’amour de la Nation que cette famille sacrifiée qui lui donne quelquefois tant de gloire.
Les mots de notre langage familier ont quelquefois une parfaite justesse de sens. C’est bien servir en effet, qu’obéir et commander dans une armée. Il faut gémir de cette Servitude, mais il est juste d’admirer ces esclaves. Tous acceptent leur destinée avec toutes ses conséquences, et en France, surtout, on prend avec une extrême promptitude les qualités exigées par l’état militaire. Toute cette activité que nous avons, se fond tout à coup, pour faire place à je ne sais quoi de morne et de consterné.
La vie est triste, monotone, régulière. Les heures sonnées par le tambour sont aussi sourdes et aussi sombres que lui. La démarche et l’aspect sont uniformes comme l’habit. La vivacité de la jeunesse et la lenteur de l’âge mûr finissent par prendre la même allure, et c’est celle de l’arme. L’arme où l’on sert, est le moule où l’on jette son caractère, où il se change et se refond pour prendre une forme générale imprimée pour toujours. L’homme s’efface sous le soldat.
La Servitude militaire est lourde et inflexible comme le masque de fer du prisonnier sans nom, et donne à tout homme de guerre une figure uniforme et froide.
Aussi, au seul aspect d’un corps d’armée, on s’aperçoit que l’ennui et le mécontentement sont les traits généraux du visage militaire. La fatigue y ajoute ses rides, le soleil ses teintes jaunes, et une vieillesse anticipée sillonne des figures de trente ans. Cependant une idée commune à tous a souvent donné à cette réunion d’hommes sérieux un grand caractère de majesté, et cette idée est l’Abnégation. L’abnégation du guerrier est une croix plus lourde que celle du martyr. Il faut l’avoir portée longtemps pour en savoir la grandeur et le poids.
Il faut bien que le sacrifice soit la plus belle chose de la terre, puisqu’il a tant de beauté dans des hommes simples qui, souvent, n’ont pas la pensée de leur mérite et le secret de leur vie. C’est lui qui fait que de cette vie de gêne et d’ennuis il sort, comme par miracle, un caractère factice, mais généreux, dont les traits sont grands et bons comme ceux des médailles antiques.
L’abnégation complète de soi-même, dont je viens de parler, l’attente continuelle et indifférente de la mort, la renonciation entière à la liberté de penser et d’agir, les lenteurs imposées à une ambition bornée, et l’impossibilité d’accumuler des richesses, produisent des vertus plus rares dans les classes libres et actives.
En général, le caractère militaire est simple, bon, patient, et l’on y trouve quelque chose d’enfantin, parce que la vie des régiments tient un peu de la vie des collèges. Les traits de rudesse et de tristesse qui l’obscurcissent lui sont imprimés par l’ennui, mais surtout par une position toujours fausse vis-à-vis de la Nation et par la comédie nécessaire de l’autorité.
L’autorité absolue qu’exerce un homme le contraint à une perpétuelle réserve. Il ne peut dérider son front devant ses inférieurs, sans leur laisser prendre une familiarité qui porte atteinte à son pouvoir. Il se retranche l’abandon et la causerie amicale, de peur qu’on ne prenne acte contre lui de quelque aveu de la vie, ou de quelque faiblesse qui serait de mauvais exemple. J’ai connu des officiers qui s’enfermaient dans un silence de trappiste, et dont la bouche sérieuse ne soulevait jamais la moustache que pour laisser passage à un commandement. Sous l’Empire, cette contenance était presque toujours celle des officiers supérieurs et des généraux. L’exemple en avait été donné par le maître ; la coutume sévèrement conservée et à propos, car, à la considération nécessaire d’éloigner la familiarité, se joignait encore le besoin qu’avait leur vieille expérience de conserver sa dignité aux yeux d’une jeunesse plus instruite qu’elle, envoyée sans cesse par les écoles militaires, et arrivant toute bardée de chiffres, avec une assurance de lauréat, que le silence seul pouvait tenir en bride.
Je n’ai jamais aimé l’espèce des jeunes officiers, même lorsque j’en faisais partie. Un secret instinct de la vérité m’avertissait qu’en toute chose la théorie n’est rien auprès de la pratique, et le grave et silencieux sourire des vieux capitaines me tenait en garde contre toute cette pauvre science qui s’apprend en quelques jours de lecture. Dans les régiments où j’ai servi j’aimais à écouter ces vieux officiers dont le dos voûté avait encore l’attitude d’un dos de soldat, chargé d’un sac plein d’habits et d’une giberne pleine de cartouches. Ils me faisaient de vieilles histoires d’Égypte, d’Italie et de Russie, qui m’en apprenaient plus sur la guerre que l’ordonnance de 1789, les règlements de service et les interminables instructions, à commencer par celles du grand Frédéric à ses généraux. Je trouvais au contraire quelque chose de fastidieux dans la fatuité confiante, désœuvrée et ignorante des jeunes officiers de cette époque, fumeurs et joueurs éternels, attentifs seulement à la rigueur de leur tenue, savants sur la coupe de leur habit, orateurs de café et de billard. Leur conversation n’avait rien de plus caractérisé que celle de tous les jeunes gens ordinaires du grand monde ; seulement les banalités y étaient un peu plus grossières. Pour tirer quelque parti de ce qui m’entourait, je ne perdais nulle occasion d’écouter, et le plus habituellement j’attendais les heures de promenades régulières, où les anciens officiers aiment à se communiquer leurs souvenirs. Ils n’étaient pas fâchés de leur côté d’écrire dans ma mémoire les histoires particulières de leur vie, et, trouvant en moi une patience égale à la leur et un silence aussi sérieux, ils se montrèrent toujours prêts à s’ouvrir à moi. Nous marchions souvent le soir dans les champs, ou dans les bois qui environnaient les garnisons, ou sur le bord de la mer, et la vue générale de la nature ou le moindre accident de terrain leur donnait des souvenirs inépuisables : c’était une bataille navale, une retraite célèbre, une embuscade fatale, un combat d’infanterie, un siège, et partout des regrets d’un temps de dangers, du respect pour la mémoire de tel grand général, une reconnaissance naïve pour tel nom obscur qu’ils croyaient illustre ; et, au milieu de tout cela, une touchante simplicité de cœur qui remplissait le mien d’une sorte de vénération pour ce mâle caractère, forgé dans de continuelles adversités, et dans les doutes d’une position fausse et mauvaise.
J’ai le don, souvent douloureux, d’une mémoire que le temps n’altère jamais ; ma vie entière, avec toutes ses journées, m’est présente comme un tableau ineffaçable. Les traits ne se confondent jamais ; les couleurs ne pâlissent point. Quelques-unes sont noires, et ne perdent rien de leur énergie qui m’afflige. Quelques fleurs s’y trouvent aussi, dont les corolles sont aussi fraîches qu’au jour qui les fit épanouir, surtout lorsque une larme involontaire tombe sur elles de mes yeux, et leur donne un plus vif éclat.
La conversation la plus inutile de ma vie m’est toujours présente à l’instant où je l’évoque, et j’aurais trop à dire si je voulais faire de ces récits qui n’ont pour eux que le mérite d’une vérité naïve ; mais, rempli d’une amicale pitié pour la misère des armées, je choisirai dans mes souvenirs ceux qui se présentent à moi comme un vêtement assez décent, et d’une forme digne d’envelopper une pensée choisie, et de montrer combien de situations contraires aux développements du caractère et de l’intelligence, dérivent de la servitude grossière et des mœurs arriérées des armées permanentes.
Leur couronne est une couronne d’épines, et, parmi ses pointes, je ne pense pas qu’il en soit de plus douloureuse que celle de l’obéissance passive. Ce sera la première aussi dont je ferai sentir l’aiguillon. J’en parlerai d’abord, parce qu’elle me fournit le premier exemple des nécessités cruelles de l’Armée, en suivant l’ordre de mes années. Quand je remonte à mes plus lointains souvenirs, je trouve dans mon enfance militaire une anecdote qui m’est présente à la mémoire, et, telle qu’elle me fut racontée, je la redirai, sans chercher, mais sans éviter, dans aucun de mes récits, les traits minutieux de la vie ou du caractère militaire, qui l’un et l’autre, je ne saurais trop le redire, sont en retard sur l’esprit général et la marche de la Nation, et sont par conséquent toujours empreints d’une certaine puérilité.
La grande route d’Artois et de Flandre est longue et triste. Elle s’étend en ligne droite, sans arbres, sans fossés, dans des campagnes unies et pleines d’une boue jaune en tous temps. Au mois de mars 1815, je passai sur cette route, et je fis une rencontre que je n’ai point oubliée depuis.
J’étais seul, j’étais à cheval, j’avais un bon manteau, un casque noir, des pistolets et un grand sabre ; il pleuvait à verse depuis quatre jours et quatre nuits de marche, et je me souviens que je chantais Joconde à pleine voix. J’étais si jeune ! – La Maison du roi, en 1814, avait été remplie d’enfants et de vieillards ; l’Empire semblait avoir pris et tué les hommes.
Mes camarades étaient en avant, sur la route, à la suite du roi Louis XVIII ; je voyais leurs manteaux blancs et leurs habits rouges tout à l’horizon au nord ; les lanciers de Bonaparte, qui surveillaient et suivaient notre retraite pas à pas, montraient de temps en temps la flamme tricolore de leurs lances à l’autre horizon. Un fer perdu avait retardé mon cheval : il était jeune et fort ; je le pressai pour rejoindre, mon escadron ; il partit au grand trot. Je mis la main à ma ceinture, elle était assez garnie d’or ; j’entendis résonner le fourreau de fer de mon sabre sur l’étrier, et je me sentis très fier et parfaitement heureux.
Il pleuvait toujours et je chantais toujours. Cependant je me tus bientôt, ennuyé de n’entendre que moi, et je n’entendis plus que la pluie et les pieds de mon cheval qui pataugeaient dans les ornières. Le pavé de la route manqua ; j’enfonçais, il fallut prendre le pas. Mes grandes bottes étaient enduites, en dehors, d’une croûte épaisse de boue jaune comme de l’ocre, en dedans elles s’emplissaient de pluie. Je regardai mes épaulettes d’or toutes neuves, ma félicité et ma consolation ; elles étaient hérissées par l’eau, cela m’affligea.