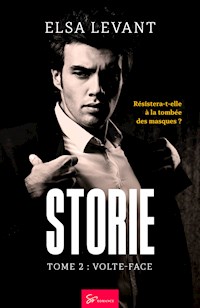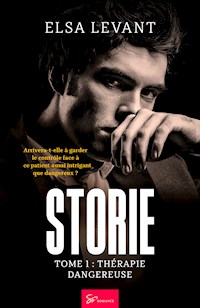
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: So Romance
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Storie
- Sprache: Französisch
Quand la frontière entre soin et séduction devient floue, le danger est inévitable...
Lou Fauris, psychologue reconnue, a toujours su garder ses distances avec ses patients. Jusqu'à l'arrivée de Monsieur Guerrand : un homme charismatique, manipulateur et dénué d'empathie. Ce pervers narcissique ébranle ses certitudes et défie ses limites professionnelles.
Alors que Lou tente de l'aider, elle se retrouve prise dans une spirale où ses propres blessures refont surface. Peut-elle maintenir son objectivité face à un patient qui la pousse à bout ? Leur relation franchira-t-elle la ligne rouge ?
Points forts du roman :- Relation interdite entre thérapeute et patient
- Manipulation mentale et tension psychologique
- Exploration des limites éthiques et personnelles
- Personnages complexes et introspectifs
- Ambiance sombre et captivante
EXTRAIT
Samedi dernier, j’ai confié le récit de mes déboires professionnels à d’anciennes camarades de promotion restées des amies. Juliane a rapidement fait remarquer :
— Il exploite ton trouble de l’attachement sans aucune considération pour ta personne. En alternant alliance thérapeutique et attaque du cadre, il instaure une relation ambivalente. Il réactive tes schémas d’abandon et de carence affective.
Un jargon qui signifie : « Il appuie là où ça fait mal ». Marion a ajouté :
— Sans parler de ta mère, son fonctionnement est semblable à celui de ton ex, Swan. Il va raviver tes douleurs passées et l’enfer de cette histoire.
Je me suis défendue, vexée par leur perspicacité :
— Il ne peut pas m’atteindre de la même façon, mon rôle professionnel m’aide à prendre du recul. J’ai envie de poursuivre la thérapie, de relever le défi. Il a les capacités cognitives pour changer, j’en suis persuadée. Pour l’instant, il ignore comment exploiter son intelligence et il la gâche dans un jeu pervers, mais je pressens qu’il peut évoluer. D’ailleurs, la relation qu’il m’a détruite…
Stoppant net ma harangue, j’ai dévisagé Marion avant de rectifier :
— Décrite.
Un beau lapsus... Marion a tranché :
— Lou, tu dois absolument le réorienter. Poursuivre cette thérapie te mettra en danger personnellement et professionnellement : tu ne peux pas suivre convenablement un tel patient.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Amatrice de psychologie, Elsa Levant cherche à déconstruire les stéréotypes souvent infondés que nous avons de la psychologie. L'écriture est une part inhérente à sa vie. Elle a d'ailleurs publié un premier roman, Avec lui, j'aurai aimé, aux Éditions Harlequin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À mon père
Effronté comme un enfant
« Le risque est l’essence même de la vie »
Un acrobate décédé
Séance une
Le concept peut sembler incompréhensible. En proie à des troubles qui nous dépassent, nous nous rendons chez une inconnue qui, jusqu’à présent, ignorait tout de notre existence. Souvent, elle possède un caractère et une vision du problème opposés aux nôtres. Notre famille, notre conjoint, nos amis proches ont beau être exemplaires, cette personne nous aidera mieux que quiconque. Elle ne nous révélera rien d’elle, mais nous lui vouerons une confiance aveugle. Ses paroles revêtiront une importance démesurée. Nous en rêverons, nous la fantasmerons, nous l’adulerons jusqu’à en tomber amoureux dans les cas les plus graves.
Mon métier consiste à éclaircir les motivations, comprendre la raison des agissements, adoucir les souvenirs, réformer les pensées et les comportements. Lors de la première séance, le malaise des patients est palpable. Ils fondent parfois en larmes avant d’avoir articulé un mot. Dans un sourire inversé et compatissant, je leur tends une boîte de mouchoirs triple épaisseur. Au rythme de leurs phrases lourdes d’émotions, je hoche la tête pour témoigner de mon empathie. L’exercice n’est pas difficile, car c’est bien connu : les semelles des cordonniers prennent la pluie. Nous ne sommes pas mieux armés contre les soucis en tant que psys, nous en sommes juste plus conscients.
Les patients sont convaincus que nous allons bien, immunisés contre les désagréments quotidiens. Ils nous attribuent une sagesse dont nous ne possédons qu’une once. Les miens m’imaginent stable, réfléchie, d’humeur égale, épanouie, sans faille. S’ils savaient… Tous les psys que je côtoie souffrent d’anxiété ou de dépression, d’un passé composé de déchirures, d’absences, de négligences ou d’abus… Seulement, nous intégrons mieux ces épreuves à nos vies, suffisamment pour accueillir les problèmes d’autrui, comme un terrain partiellement défriché sur lequel les fleurs prennent racine.
Notre véritable avantage réside dans notre expérience. Nous entendons tellement d’histoires différentes que nous cessons d’envier une normalité à laquelle il faudrait appartenir. L’être humain est un miracle de combinaisons. Toutes les associations de traits de caractère, de sentiments profonds, de questionnements existent. Une diversité exceptionnelle qui devrait nous nourrir plutôt que nous inhiber !
Lorsqu’un patient décrit une histoire, un problème, une émotion similaires aux nôtres, nous nous sentons impliqués tout en veillant à conserver la bonne distance. En nous identifiant à l’excès, nous l’encouragerions à suivre notre propre cheminement. Nous dissocions constamment le vécu de notre interlocuteur du nôtre, pour ne pas l’influencer. Tout en restant concentrés sur le but de la thérapie, nous gérons les émotions du patient et nos propres réminiscences. Un psy ne soigne pas exclusivement les autres, il se soigne aussi à travers eux. Nous devenons psys pour éviter d’être patients. Souvent, quand je termine ma journée de travail, je réalise à quel point ma vie est agréable.
Dans le centre de consultation où j’exerce travaillent un psychiatre et une autre psychologue d’obédience différente. Psychanalyste, elle examine les relations selon le prisme freudien. Elle s’appuie sur le petit Hans, l’homme aux rats, Elisabeth von R. et toute la clique. Je l’écoute distraitement comme si elle parlait de ses neveux. Nous ne sommes jamais d’accord sur l’origine de la psychopathologie des patients. Elle me dévisage comme si j’étais naïve et j’estime ses interprétations tirées par les cheveux. Agacées par nos analyses divergentes, nous avons renoncé à évoquer des situations cliniques et, de temps en temps, quand nous déjeunons ensemble dans la petite cuisine du cabinet, nous parlons littérature ou cinéma.
Le psychiatre, lui, estime que tout est chimique. Un traitement adapté, voilà ce qu’il leur faut ! Le blabla est réservé aux patients résistant aux médicaments. Il n’avoue jamais qu’il hésite sur un cas ou qu’il ne propose pas l’outil adéquat pour soigner un patient. Quand il nous adresse quelqu’un, il argumente : « Il a besoin de parler et je n’ai pas le temps ». N’accusons pas les progrès de la médecine…
Situé en banlieue, notre cabinet de consultation offre un cadre reposant, loin du Paris effréné. Le bâtiment se trouve à l’angle de deux rues arborées et peu fréquentées. Ancien centre ophtalmologique, les bureaux sont spacieux et les néons aveuglants. Dans la salle d’attente, de gros clous plantés à égale distance le long des murs restent nus. Les tableaux ont disparu avec les trois spécialistes de la vue lors du déplacement de leur activité à Paris.
Dès la visite, les lieux m’ont charmée. Les locaux paraissaient intacts tout en affichant des signes d’anomalies à l’approche du regard. Les lignes des murs présentaient des inclinaisons douteuses et la peinture de drôles de reflets à la lumière. Les imperfections visibles avaient toujours fait partie de ma vie ; certains défauts rendent l’ensemble harmonieux. J’ai signé le bail dès le lendemain de la visite. Je ne connaissais pas encore mes colocataires. L’humain a la capacité de s’adapter à tout.
Arrivée dans mon bureau, je pends ma veste et mon sac au portemanteau. La pièce est baignée de soleil jusqu’à midi par beau temps, mais ce matin, le ciel est épais, poisseux. J’ouvre les fenêtres pour dissiper l’odeur végétale régnante. La présence de plantes m’a toujours apaisée. Sur les étagères, la commode et le rebord des fenêtres, j’ai disposé philodendron, ficus, misère, plantes grasses : toutes les espèces survivant à quinze jours de vacances sans eau.
En consultant mon agenda, je me rappelle qu’un nouveau patient m’attend à neuf heures trente, ce jeudi 4 avril. Nous avons discuté au téléphone la semaine dernière, un appel fluide, annonciateur d’un bon travail en thérapie. Il était soulagé que je le recontacte et disponible à ma convenance. Voix veloutée, sourire audible, il désirait parler de sa délicate situation professionnelle.
Un homme se lève à l’instant où je pénètre dans la salle d’attente. Nous n’avons pourtant pas été présentés. Grand, regard sombre, cheveux drus châtain foncé. La trentaine environ, il s’avance vers moi. Je demande :
— Monsieur Guerrand ?
— Lui-même.
— Enchantée.
La première poignée de main est intéressante, car elle reflète souvent la séance à venir. Poignée de main indolente : un dépressif ; humide : un anxieux ; exagérément ferme ou sèche : un dépressif ou un anxieux qui s’ignore. Celle de Monsieur Guerrand est à la fois moite et assurée. Le regard profond qui l’accompagne semble transmettre un appel à l’aide. Sous des mèches de cheveux en pagaille, son front ridé transpire l’inquiétude. Une lueur dérangeante brille néanmoins dans ses yeux. Un besoin de domination peut-être, ou un instinct animal affûté. Une intelligence stratégique que l’on retrouve chez les grands dirigeants ou les joueurs d’échecs. Que l’on pourrait croiser chez un général fier de contempler son armée massacrer les légions adverses.
Je lui ouvre la voie dans le couloir. Une dizaine de pas plus loin, j’invite l’homme à entrer dans notre espace de travail. Après avoir refermé la porte, je m’assois dans un fauteuil molletonné derrière mon bureau.
D’habitude, les patients s’installent sur une des deux chaises, face à moi. Ils tentent de justifier leur venue sans savoir par où commencer. Parfois, ils gardent le silence jusqu’à ce que je les encourage à se lancer. Ils prennent alors une profonde inspiration et entament le récit de leur vie. Celui-ci se déroulera comme un tapis rouge et ne s’interrompra que pour incorporer les réponses à mes questions. Il prendra fin à mon signal, quarante-cinq minutes plus tard.
Monsieur Guerrand, lui, arpente la pièce à pas lents. Encadrées par un long manteau noir, ses épaules fendent l’espace. Il s’approche d’une table haute sur laquelle un pot de fleurs coloré héberge plusieurs plantes grasses. Son profil au nez rectangulaire m’évoque les séries de Portraits de Picasso. Bien que ses traits ne soient pas grossiers, ils forment un assemblage saugrenu. Ses pommettes saillantes creusent deux sillons ombrés sur ses joues. Ses lèvres claires ressemblent à une ligne tracée au pastel, tandis que deux sourcils épais assombrissent ses yeux.
Il s’immobilise devant une photographie de trois voiliers penchés sur une ligne d’horizon. Ce jour-là, l’océan Atlantique devait être rageur, car ses vagues semblent aimantées par le ciel. Mon père m’a offert cette affiche en noir et blanc, signée Beken of Cowes, au salon nautique l’an passé. « Fais-la encadrer » avait-il préconisé. Impatiente de l’intégrer à mon cadre de travail, j’avais troué le papier glacé de punaises.
Après s’être imprégné de cette image maritime, Monsieur Guerrand se tourne vers moi, embrassant la pièce d’un coup d’œil. Son regard inquisiteur s’attarde sur d’autres affiches, les Mille et une nuits de Matisse, Cercles dans un cercle de Kandinsky. Seule derrière mon bureau, un peu embarrassée, j’attends qu’il s’installe.
— Vous êtes optimiste, n’est-ce pas ?
Je hausse les sourcils, laissant transparaître ma surprise.
— On peut dire ça, oui.
— Et résiliente.
Ignorant sa dernière remarque, je l’invite à prendre place d’un signe de la main.
Il fait glisser son manteau le long de ses bras et le dépose avec soin sur le dossier de la chaise. Son torse se dessine sous une chemise cintrée. Après s’être assis, il croise les jambes puis les bras. Il n’a visiblement pas envie d’être là. Plusieurs secondes s’écoulent avant qu’il ne plante ses yeux dans les miens.
— Je suppose qu’on commence par vous raconter ce qui nous amène ?
— Par exemple, oui.
— Sinon, je ne serais pas ici.
Sa voix est rocailleuse. J’acquiesce d’un air entendu. Il passe les doigts sur sa barbe naissante.
— Je suis ingénieur en propulsion aérospatiale. Il y a trois mois, au travail, j’ai déraillé. J’ai attrapé mon ordinateur portable et je l’ai fracassé sur le bureau. Le collègue avec qui je travaille sur le projet m’avait induit en erreur en me fournissant de mauvais relevés : tous mes calculs étaient faux. Pour une fois que je n’avais pas vérifié derrière lui, une seule fois ! Je lui avais accordé ma confiance, nous travaillons ensemble depuis six ans ! Une semaine de calculs à partir de ses relevés pour déterminer le niveau d’hydrogène liquide nécessaire à un décollage. Et là, après tout ce boulot, je réalise que... vous ne prenez pas de notes ?
— Non, jamais.
Les lèvres entrouvertes, il retient une question, étudie mon visage, puis opine du chef. Il murmure :
— Je vois.
Il n’est pas le premier à s’étonner de cette particularité. Ma mémoire est fidèle comme un bon chien de chasse : elle rapporte le gibier traqué. Sans trop d’efforts, je retiens les événements de vie, les prénoms des enfants, conjoints, collègues, amis, parents, frères et sœurs de mes patients en plus du déroulement des séances passées. J’ai toujours préféré écouter mon interlocuteur sans baisser le regard pour griffonner. Les patients ont pour fâcheuse manie de déchiffrer nos notes à l’envers, perdant le fil de leurs confidences.
Je souris avec bienveillance pour inciter Monsieur Guerrand à poursuivre son récit. Il prend son temps, comme pour souligner qu’il décide seul de la suite de l’entretien. Il rugit soudain :
— Tous ces chiffres torturés pour un résultat erroné, ça m’a excédé ! J’ai hurlé contre ces incapables qui collaborent avec moi ! Mon collègue est devenu blanc, et de le voir se ratatiner de la sorte, j’ai eu envie de le piétiner. Mon N+1 est arrivé et pour me calmer, il m’a posé une main sur l’épaule. Par réflexe — je pratique le Taekwondo depuis tout petit – je lui ai fait une clef de bras pour le plaquer sur le bureau. En le promenant de droite à gauche, j’ai balayé tous les dossiers posés là. Tout le monde me regardait sans oser intervenir. Mon supérieur a tellement hurlé que j’ai fini par le lâcher. On aurait dit un Yorkshire qui se faisait écraser la patte. J’ai pris ma veste et je suis parti. Mon médecin généraliste m’a mis en arrêt un mois et m’a prolongé deux fois depuis. Il paraît que je fais un burn-out. C’est à la mode, non ? Je suis dans le coup !
Je ne souris pas à sa blague. Son récit me laisse dubitative et légèrement choquée. Il évoque une scène violente avec une distance inappropriée, sans éprouver de regrets quant à son comportement. Il se donne le beau rôle dans cette situation abusive, se vantant presque de malmener ses collègues et son supérieur. Après l’avoir interrogé sur ses conditions de travail — stressantes mais supportables selon lui — une impression d’incohérence me gagne. Quelqu’un de son niveau prône rarement la violence et je soupçonne son burn-out d’être le symptôme d’une problématique plus large. Je demande :
— Avez-vous souvent des relations compliquées avec votre entourage ?
— Bingo ! Vous êtes de taille !
J’ignore le compliment. Ses défenses, elles aussi de taille, entravent déjà notre travail.
Quand on fait ce métier, on apprend à aimer tous ses patients, ceux qui nous sont antipathiques, comme ceux qui n’appliquent jamais nos conseils. Malgré ma tolérance, je ne peux échapper au mauvais pressentiment que m’inspire Monsieur Guerrand. Je n’approuve pas sa façon d’entrer en relation en se mesurant à l’autre, en lui imposant son rythme. Au téléphone, je l’avais trouvé agréable, dans la salle d’attente, soucieux ; à présent, il me semble agressif.
Serait-il plus judicieux d’adresser ce patient à une consœur, un confrère ? Un psy plus âgé qui lui inspire davantage de respect ? À vingt-neuf ans, puis-je asseoir mon autorité face à un tel personnage ? J’exerce pourtant ce métier depuis bientôt sept ans. Après le bac, j’ai étudié la psychologie comme une évidence. J’étais destinée à ces études bien avant l’heure.
Monsieur Guerrand s’est arrangé pour ne pas répondre à ma question sur ses difficultés relationnelles. Tel un présentateur télé qui félicite un participant, il a pris le contrôle de la séance, alors qu’il est de mon rôle de diriger l’échange. Émanant de sa résistance, une forme de défi me pousse à éclaircir ses motivations.
— Qu’avez-vous ressenti juste avant de « dérailler » ?
— J’étais très énervé d’avoir trimé une semaine pour rien.
— Votre énervement résultait-il uniquement de ce mauvais calcul ?
— Que voulez-vous dire ?
— Indépendamment du travail, d’autres événements ont-ils participé à provoquer ce débordement ?
— Bien vu ! Décidément !
Son sourire plaqué s’affaisse avec les secondes. Rembruni, il s’égare dans ses pensées. Il garde le silence, promenant son regard le long des arrêtes joignant les murs au plafond. Je reprends :
— Regrettez-vous quelque chose ?
— Pas le moins du monde.
Un certain charisme irradie de lui, de sa posture, sa voix grave, ses traits ciselés et ses yeux bruns. Je me représente mal cet homme tordre le bras de son supérieur. Pourtant, si son récit est vrai, il peut se montrer brutal. Son absence de regrets ne laisse rien présager de bon. Pourvu que je ne sois pas tombée sur un psychopathe ! Troublée, je peine à rassembler mes idées pour poursuivre l’entretien. Pas de remise en question de son comportement, pas de culpabilité, pas de lien avec un événement antérieur... Je choisis la facilité.
— Avez-vous encore vos parents, des frères et sœurs ?
— J’ai ma mère, oui. Je n’ai pas vraiment connu mon père. J’ai un jeune frère dont je ne m’occupe pas. Il me sollicite sans arrêt, alors je ne lui réponds plus. Il est majeur et vacciné, il n’a qu’à se débrouiller.
— Vous paraissez détaché...
— Je ne chéris pas l’espèce humaine, vous savez. Je trouve les chiens beaucoup plus sympathiques. Dans le règne vivant, les hommes sont les animaux les plus hypocrites que je connaisse, mais je les vois venir de loin, alors ils ne sont pas menaçants. Et puis, mon métier m’aide. Je travaille à mettre des abrutis dans des fusées pour les envoyer dans l’espace. Puisque tuer est défendu par la loi, je les expédie là où ils ne me gêneront plus.
Le mot « prédateur » me vient à l’esprit.
— Vous n’avez aucun ami ?
— Je n’en ai pas besoin. Je me contente de relations courtes.
— N’avez-vous jamais eu de lien plus développé avec quelqu’un ?
— Mon ex, mais ça s’est terminé il y a quatre mois.
La chronologie des faits révèle que cette rupture pourrait être un facteur déclenchant de son burn-out.
— Certains êtres humains sont donc dignes d’intérêt ?
— Certains.
Son regard puissant se fixe dans le mien. Deux billes d’un marron virant au noir. Je hasarde :
— Et les autres ?
— Ils servent les intérêts des plus futés.
Sidérée par cette affirmation, je guette un signe de sarcasme sur son visage, mais il reste de marbre. Quelle vision réductrice ! Comment peut-il manquer d’humanité à ce point ? Pour lui montrer qu’une relation peut être différente d’un rapport dominant-dominé, je dois insister sur le positif. Dans sa vie, un lien amoureux a duré, c’est bon signe.
— Quel a été le problème avec votre ex ?
— Elle sortait trop, elle voyait des amis, elle rentrait tard. Je voulais être en couple, moi, pas en communauté !
J’explore plus amplement les raisons des conflits qui l’opposaient à elle. Il ne manifeste guère d’empathie à son égard. Dans l’équation, son désir, sa vision des choses et ses exigences paraissent présider seuls.
— Vous ne semblez pas très bienveillant envers votre prochain.
— Eh bien ! oui, c’est mon vice. Déplaire est mon plaisir, j’aime qu’on me haïsse ! Mon prochain, je le baise.
Un silence embarrassant s’installe. Il le tranche brusquement :
— Je dois dire tout ce qui me passe par la tête, c’est bien ça ?
— Vous pouvez, si vous voulez.
— En ce moment, je pense : « Elle est mignonne, la psy. Je vais la séduire et la faire tomber ».
Je laisse échapper un rire court comme un hoquet.
Les attaques du cadre thérapeutique sont fréquentes, mais rarement aussi frontales. L’essentiel est d’éviter la réponse impulsive, la justification ou la surenchère. Il vaut mieux pointer l’agressivité dans le processus relationnel plutôt que s’offenser d’une remarque et s’enliser dans un conflit.
— Pour vous, la relation est synonyme de rapport de force ?
— Surtout avec la gent féminine. La séduction me saisit, me rend vivant. N’est-ce pas le sentiment le plus grisant ?
— Peut-on séduire son prochain sans le « baiser » ?
— Avec une femme, il est impossible de communiquer sans toucher. Comment saurait-on où commence et où s’arrête la séduction ? Mon moment préféré, c’est l’attente. Rester tapi dans les hautes herbes comme un chasseur. J’observe, j’écoute, je prends mon mal en patience. J’étudie toutes les stratégies, une effusion mentale incroyable. Finalement, une partie de chasse, c’est 99 % d’excitation pour 1 % de plaisir. Le tout est d’armer discrètement et de débusquer sa proie. Si la femme se sent en confiance, elle offre d’elle-même son ventre et on le lui gratte du bout du canon. Vient la meilleure partie où l’on s’interroge : quel sera le coup fatal ? Une attention ? Un geste ? Une discussion ? Chaque femme a un point faible. S’en approcher doucement pour le cerner, analyser les moyens de la faire tomber... Là, je ressens des choses !
Trop estomaquée par l’ensemble de sa description, je me fixe sur un détail.
— Qu’entendez-vous par « la faire tomber » ?
— La séduire totalement. Lui faire jouer le premier rôle dans sa propre perte. Parfois, je fais même participer ses proches. C’est encore plus excitant quand il y a un ex insistant ou un autre prétendant dans l’histoire. En confident exemplaire, je la mets en confiance, je la fais parler d’eux. Je retiens leurs traits de caractère et je prédis leurs réactions. Je lui conseille d’adopter tel comportement qui les rendra fous et leur fera commettre un impair. Je les écarte un à un, car mon objectif est de m’approprier son esprit et son corps.
— Et après ?
— Après, ça ne m’intéresse plus.
Un psychologue est capable d’entendre autant de problématiques qu’il existe de patients, mais certaines demeurent plus difficiles à envisager que d’autres. Comment peut-on trouver du plaisir à terrasser quelqu’un ? Je repense à sa métaphore du canon sur le ventre de la femme. Elle aurait fait jaser un congrès entier de psychanalystes...
Je regarde discrètement l’horloge numérique derrière lui. Il reste quinze minutes. J’aimerais m’arrêter là et je le pourrais. Sa description de la « chasse à la femme » m’a été insupportable. Me provoquait-il ou m’expliquait-il réellement sa façon de procéder ? Suis-je en présence d’un pervers ? Différemment d’un psychopathe qui ressent peu d’émotions, un pervers agit avec plaisir, dans la jouissance vicieuse de malmener l’autre. Prend-il son pied à me décrire ses fantasmes ? Son but est-il de me choquer ? Un tel patient est à fuir, mais ne consulte-t-il pas justement pour travailler sur son fonctionnement ?
Sceptique, je poursuis mon interrogatoire :
— Ne ressentez-vous jamais de culpabilité ?
— De quoi ?
Il s’esclaffe. Il est le seul à s’amuser. Irritée, je m’autorise à le provoquer, moi aussi. Mon ton est celui de quelqu’un qui perd patience.
— Qui éclate de rire acquiesce ?
— Qui éclate de rire s’en fout.
Une malice brille dans son regard. Il se délecte de m’avoir fait sortir de mes gonds. J’ai relevé son défi et il a gagné : nous sommes à présent dans une opposition contre-productive. Le silence qui s’ensuit attise mon sentiment d’échec. Indifférent à mon trouble, mon interlocuteur se lisse l’intérieur de la main droite du pouce gauche. Il masse ses articulations comme on le fait après avoir donné un coup de poing.
Ignorant son affront, je décide de persévérer. S’il doit débuter une thérapie ici, j’aimerais évaluer ses capacités d’introspection et d’ouverture à l’autre.
— Vous mettez-vous parfois à la place de ces jeunes femmes ?
— Sans culpabilité ni empathie.
Ce répondant ! Je saisis évidemment la référence à la devise « Sans foi ni loi ». Me met-il en garde ? Vais-je m’embarquer dans un jeu relationnel glissant ? Tentée de rebondir sur ses derniers mots, je contiens fermement mon envie de répliquer. Une thérapie n’est pas un combat d’ego. Ce patient suscite en moi un sentiment d’infériorité que je cherche à contrer. Dans l’impasse, je choisis de résumer sa problématique. Reformuler relance souvent l’échange thérapeutique.
J’articule lentement :
— Vous vous décrivez réfractaire aux relations humaines qui provoquent pourtant chez vous de fortes émotions. Par votre absence de considération morale, vous malmenez les femmes alors qu’elles participent à vous rendre vivant.
Pas une ride ne bouge sur son visage et je réalise que mon intervention ne l’invite pas à répondre. Il soutient mon regard comme pour me renvoyer mon affirmation grotesque. Mes derniers mots se teintent d’un sentiment de honte rarement ressenti avec un patient. En tant que psys, nous prêtons une attention particulière à nos émotions. Un manipulateur orchestre en nous la gêne, la culpabilité, la dépréciation ; c’est ainsi qu’on l’identifie.
Monsieur Guerrand se retourne vers le dossier de sa chaise pour attraper son manteau.
— Alors, Madame Fauris, pouvez-vous faire quelque chose pour un cas désespéré comme le mien ?
Son sourire chaleureux me déroute. Nous étions dans l’opposition une minute auparavant ! Indifférentes au contexte, ses expressions de visage ne coïncident pas avec ses propos. Son absence manifeste de logique est destinée à me désarçonner pour tester mes réactions. Plus de doute : je suis en présence d’un pervers.
Saisissant mon agenda, j’annonce :
— La séance prend fin, Monsieur Guerrand.
Il sort un petit carnet de la poche droite de son manteau. À présent, il joue à l’enfant docile.
— Je vous écoute pour la date du prochain rendez-vous.
Je chasse l’agaçante impression qu’il se moque de moi. Les patients souffrant d’un trouble de la personnalité épuisent les soignants. Souvent dans la provocation ou sujets à des réactions non maîtrisées, nous leur imposons constamment des limites. Leurs thérapies s’avèrent longues et éprouvantes, parfois vaines.