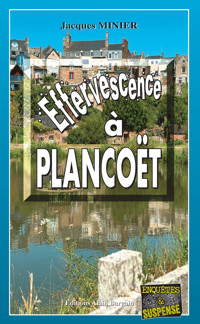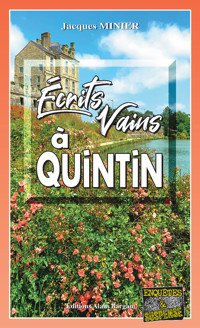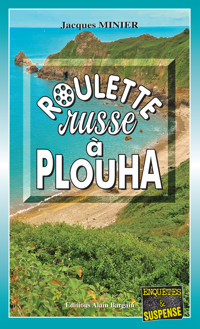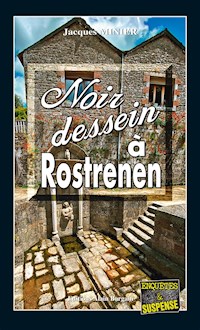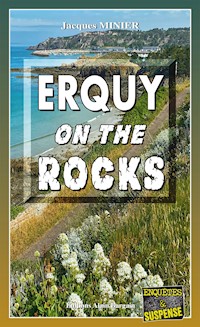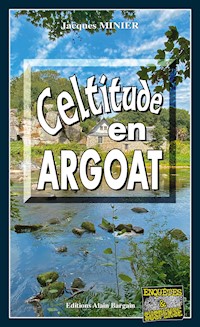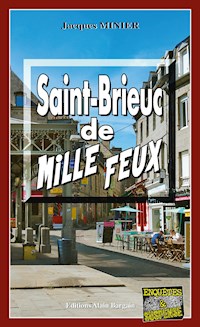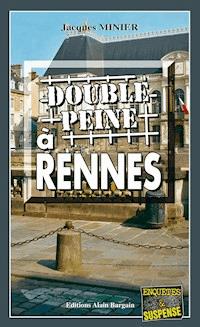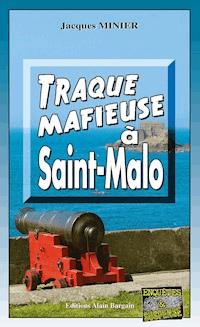
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Audrey Tisserand, Lieutenant de police
- Sprache: Französisch
Pourquoi un banal jeune homme suscite-t-il autant d'intérêt chez ses agresseurs ?
Jonathan Fauvel est un homme désespéré. Après la mort de sa compagne dans un accident de la route, il est la cible de plusieurs inexplicables tentatives d’enlèvement auxquelles il parvient à échapper de justesse. L’enquête policière, menée par le lieutenant Audrey Tisserand et son équipier, piétine. Tous deux s’interrogent : pourquoi Fauvel suscite-t-il un tel intérêt pour ses agresseurs ? Des zones d’ombre dans son passé vont jeter le doute sur ses dires et ses actes. Jonathan décide donc de disparaître.
De la cité corsaire aux falaises du cap Fréhel, le lecteur se lance avec ce polar dans une course infernale qui le mènera au cœur d’un ténébreux passé, à la découverte d'une terrible vérité ! Découvrez le premier tome palpitant des enquêtes d'Audrey Tisserand !
EXTRAIT
Mai 1979
Dans le lit dévasté, la jeune femme s’accroche au drap, inspire à petits coups en haletant, puis pousse très fort ; la douleur est si intense qu’elle la fait
hurler. Elle entend la voix apaisante de la sage-femme qui scrute entre ses cuisses écartées l’apparition de la tête de l’enfant qui va naître :
—Là ! C’est bien ! Respirez bien à nouveau, puis poussez fort en expirant à fond ! Oui ! C’est ça ! Je vois la tête ! Il arrive ! Reprenez votre souffle et poussez encore ! Oui ! C’est bien ! Le voilà ! C’est un beau garçon !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Traque mafieuse à Saint-Malo est le premier roman écrit par Jacques Minier [...] L'enquête va longtemps piétiner avec un final surprenant. -
Le Télégramme
Éditions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jacques Minier, Breton né à Saint-Brieuc en 1958, vit à Trégueux, ville de l’agglomération briochine. Professeur des écoles, maintenant retraité, il situe ce premier roman dans la belle ville de Saint-Malo, évoquant aussi la Rance et la Côte d’Émeraude, des sites qu’il connaît bien pour y avoir beaucoup navigué à la voile.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Michèle
PROLOGUE
Mai 1979
Dans le lit dévasté, la jeune femme s’accroche au drap, inspire à petits coups en haletant, puis pousse très fort ; la douleur est si intense qu’elle la fait hurler. Elle entend la voix apaisante de la sage-femme qui scrute entre ses cuisses écartées l’apparition de la tête de l’enfant qui va naître :
— Là ! C’est bien ! Respirez bien à nouveau, puis poussez fort en expirant à fond ! Oui ! C’est ça ! Je vois la tête ! Il arrive ! Reprenez votre souffle et poussez encore ! Oui ! C’est bien ! Le voilà ! C’est un beau garçon !
Quelques heures plus tard, un homme à la stature impressionnante et aux traits impérieux pénètre dans la chambre. Il jette à peine un regard vers le lit où la belle jeune femme, lavée et apaisée, se remet des douloureux efforts de l’accouchement. L’imposant personnage se dirige vers la fenêtre, s’immobilise devant la croisée, les jambes légèrement écartées et les mains croisées dans le dos. Toujours silencieux, il porte son regard sur l’extérieur, s’abandonnant à la contemplation du vaste domaine qu’il dirige en maître absolu.
Après quelques instants d’un silence pesant, sans se retourner, il s’adresse à la jeune femme terrifiée. Elle sait déjà ce qui l’attend ; quelques jours plus tôt, il lui a déjà fait part du sort qu’il lui réserve. Sa voix caverneuse résonne à travers l’atmosphère étouffante de la chambre.
— Tu vas passer ta dernière nuit ici. Demain, dès la première heure, tu quitteras le domaine à jamais ! Tu ne fais d’adieux à personne, pas même à tes parents ! Tu pars et tu ne reviens jamais plus ! C’est bien clair ? Tu sais que, si tu désobéis, je n’aurai aucune pitié pour ton père et ta mère. Je les chasserai de mes terres et j’embaucherai d’autres métayers pour les remplacer à la ferme du domaine. Hors d’ici, ils n’auront plus de toit et auront beaucoup de mal à trouver du travail. Donc si l’envie te prend de revenir ou de répandre des ragots sur mon compte, tu penses à eux et au malheur auquel tu les exposeras… J’ai pris du bon temps avec toi, tu m’as donné ce que je voulais, mais c’est maintenant terminé ; je ne veux plus de toi ! Adieu !
La pauvre jeune femme s’effondre en larmes, le visage enfoui dans son oreiller, tandis que le maître des lieux quitte la chambre d’un pas pressé.
Le lendemain, dès l’aube brumeuse de ce jour de la fin du mois de mai, la jeune femme sort du magnifique manoir par une porte latérale. Elle frissonne dans la fraîcheur matinale, tire son châle sur ses épaules par-dessus son ample blouse, le croisant sur sa poitrine et sur le bébé qu’elle porte contre elle. Aidée par la sage-femme, la seule qui soit venue assister à son départ et la réconforter, elle a emmailloté son enfant dans un drap noué autour de son cou et dans son dos. Ainsi harnaché, repu de la tétée qu’il vient de prendre, le nourrisson dort tranquillement contre sa mère, inconscient du terrible drame qu’elle est en train de vivre. Maintenant, elle marche dans l’allée du parc qui mène à la sortie du domaine. Elle passe devant la maisonnette du gardien à l’entrée ; le large et haut portail est clos, mais la petite porte de côté est inhabituellement ouverte, sans doute suivant la consigne donnée au gardien. Au moment de franchir la porte, elle voit bouger les rideaux à la fenêtre de la petite maison : le gardien guettait son passage, mais a visiblement reçu l’ordre de ne pas lui parler… Malheureuse comme les pierres, elle avance sur la petite route, tournant à jamais le dos au domaine où elle a toujours vécu, aux gens qu’elle a toujours connus…
I
Samedi 17 mai 2014, 23 heures 45 ; sur une petite route côtière près du cap Fréhel.
Dans un crissement de pneus, deux voitures stoppèrent en amont du virage qui surplombait la mer. Le conducteur jaillit du premier véhicule, tandis que trois hommes sortaient du second, les moteurs tournant toujours ; les phares étaient restés allumés, peinant à trouer l’épaisse nappe de brume. Le chauffeur de la première voiture la contourna pour ouvrir la portière du passager avant. Il agrippa le corps de la jeune femme inanimée recroquevillée sur le siège, l’attira contre lui pour l’extraire de l’habitacle, tout en s’adressant aux trois autres :
— Vite ! Aidez-moi ! Faut pas traîner ici ! Quelqu’un pour lui prendre les jambes !
L’un des trois hommes se précipita pour saisir la femme sous les genoux. La jupe avait remonté assez haut sur les cuisses, révélant des jambes au galbe parfait.
— Waouh ! Un chouette lot ! apprécia-t-il. C’est quand même con qu’on doive lui régler son compte tout de suite ! Elle dort bien après le pain que j’lui ai mis. On aurait pu s’amuser avec elle avant de la zigouiller !
— Espèce de connard ! Tu penses vraiment qu’à ça ! le rembarra vertement le premier homme qui dirigeait l’équipe. On a déjà assez merdé pour ce soir, tu crois pas ? On finit le boulot et on se casse ! Si tu crois qu’on va se faire féliciter par le chef, tu te goures ! Alors ferme ta gueule !
Les deux hommes portèrent leur fardeau jusqu’à la portière côté conducteur, installèrent le corps sur le siège, puis placèrent les mains sur le volant. Celui qui commandait desserra alors le frein à main.
— Ça y est ! dit-il en refermant la portière. Maintenant, on pousse !
Les trois autres hommes s’arc-boutèrent contre l’arrière du véhicule. Celui-ci s’ébranla et prit de la vitesse sur la route en pente. Il poursuivit sa trajectoire rectiligne, quittant la chaussée au niveau du virage en contrebas ; la vitesse acquise était maintenant trop élevée pour stopper la voiture et même si la malheureuse passagère s’était réveillée à ce moment, il eût été trop tard…
Elle ne se réveilla pas… Heureusement pour elle, si l’on peut dire cela, elle ne se vit pas mourir.
La berline rebondit sur les roches affleurant sous la végétation de bruyère et d’ajoncs, atteignit à un train d’enfer le bord de la falaise, puis bascula dans le vide.
Trente mètres plus bas, la voiture s’écrasa sur les rochers bordant la grève.
Le vacarme de la tôle martyrisée, à peine amorti par la cotonneuse couche de brume, parvint aux oreilles des assassins.
— C’est bon ! dit le chef des tueurs. Le boulot est fini pour cette nuit, mais on a complètement raté notre coup. Faudra qu’on se refasse, et proprement, sinon le patron nous le fera payer cher ! Allez ! Tirons-nous d’ici !
*
Mercredi 21 mai 2014 ; Saint-Malo, cimetière de Rocabey.
C’était un de ces jours pluvieux de la fin de printemps, comme il en arrive parfois en Bretagne ; un vent frais de noroît chargé de pluie balayait le cimetière de Rocabey à Saint-Malo. Un homme encore jeune, grand et robuste, se dirigeait vers la sortie d’un pas lent et incertain. Le visage ruisselant de pluie et de larmes mêlées, il leva la tête et suivit d’un regard noyé de souffrance la course folle des épais nuages noirs venus de la mer. Du fond de sa mémoire, au hasard d’un curieux détour de son esprit en berne, surgirent quelques vers autrefois découverts au gré des études, composés par un être dépressif écrasé sous son fardeau de douleur :
« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l’horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits… »
Les mots empreints de désespoir de Charles Baudelaire résonnaient dans sa tête ; Jo se sentait à l’unisson du poète maudit, son profond mal-être se confondant avec le sien, en ce sinistre jour de funérailles…
Julie, son amour, était morte… morte et maintenant enterrée. Oh, Julie ! Que faisais-tu sur cette route étroite et sinueuse à cette heure de la nuit ?
Elle avait raté un virage, sans doute gênée par une nappe de brouillard ; sa voiture était allée tout droit, avait plongé du haut de la falaise et s’était écrasée sur les rochers en contrebas…
L’accident s’était produit quatre jours plus tôt. Depuis l’instant où le gendarme qui s’était déplacé au petit matin à leur domicile, lui avait appris l’horrible drame en cherchant péniblement ses mots, Jo vivait dans un cauchemar permanent. Il s’était aussitôt rendu chez les parents de Julie, avait sonné et, avec le plus grand ménagement, avait annoncé la funeste nouvelle au père de sa compagne, venu ouvrir. Celui-ci avait blêmi, avait porté une main tremblante à sa bouche, puis avait claqué la porte sans rien dire, laissant Jo au dehors. Jo avait hésité, attendu un peu, puis avait frappé. Sans succès… Il avait sonné à nouveau… Pas de réponse ! Il avait donné un nouveau coup de sonnette… La fenêtre d’une chambre à l’étage s’était alors ouverte et le père de Julie avait paru dans l’encadrement. Il avait dit à Jo d’une voix emplie de colère et de mépris que son épouse et lui-même ne voulaient plus rien avoir à faire avec lui, que sa fille serait encore en vie si elle ne l’avait pas rencontré, que tout était de sa faute… Et il avait refermé la fenêtre sans attendre la réponse de Jo.
Jo était remonté dans sa voiture – celle de Julie en fait – et était reparti, le cœur lourd. Même s’il se savait peu apprécié des parents de sa compagne, il avait espéré qu’eux et lui auraient pu se réconforter mutuellement, se soutenir dans leur malheur commun.
Il n’avait pas été associé à la préparation de la cérémonie de funérailles ; les parents de Julie lui avaient refusé toute participation. Comme ils n’avaient pu éviter que Jo veille le corps au funérarium, ils avaient exigé qu’il ne vienne que lorsqu’eux-mêmes n’y seraient pas et lui avaient donné un papier avec les horaires qu’ils lui avaient impartis. Il était ressorti de la chambre funéraire à temps, juste avant de ne plus pouvoir contrôler sa colère.
Durant quatre jours, le midi et le soir, il avait veillé le corps de celle qu’il aimait…
Les allées du cimetière étaient détrempées par les averses, mais Jo ne se souciait pas des flaques. Ses souliers avaient pris l’eau ; il avait les pieds trempés, mais n’en avait cure… Il ressassait sa rancœur envers les parents de Julie… Et là, soudainement, les souvenirs remontèrent à la surface si nets, si précis qu’il en eut le souffle coupé…
*
Dimanche 20 mai 2012 ; deux ans auparavant.
C’était un beau dimanche de mai, un jour de lumière sur la magnifique baie de Saint-Malo. Jo naviguait seul à bord de son voilier, le “Majic Quiersen”, un First Bénéteau 31,7 qu’il avait acheté d’occasion, quelques années auparavant. Il avait passé la journée à tirer des bords dans la baie, de l’estuaire de la Rance au cap Fréhel, savourant pleinement ce moment de totale liberté.
La fin de la journée approchait et Jo décida de mettre le cap sur l’embouchure de la Rance. Il emprunta le chenal de la Grande Porte, passa devant le phare du Grand Jardin, puis s’engagea dans l’estuaire du fleuve, laissant les fiers remparts de Saint-Malo sur bâbord et la jolie station balnéaire de Dinard sur tribord. Une fois encore, il s’émerveilla de la beauté du site dont jamais il ne se lassait. Il dirigea son embarcation vers l’écluse du barrage de la Rance qu’il lui fallait franchir pour rejoindre le mouillage où il abritait son bateau dans une anse du fleuve. À quelque distance de l’ouvrage, il démarra le moteur et affala ses voiles afin de se préparer à entrer dans l’écluse.
Alors qu’il s’apprêtait à reprendre la barre du Majic Quiersen qu’il avait orienté face au vent puis mis au ralenti pendant la manœuvre, il vit un autre voilier lui foncer droit dessus par le travers arrière. Il cria très fort pour alerter le barreur qui ne l’avait probablement pas vu, reprit la barre pour faire tourner le sien dans le même axe que l’autre, tout en donnant des gaz. L’homme, réagissant enfin, fit ce qu’il pouvait, mais il était trop tard pour éviter la collision. Jo se précipita pour faire glisser un des pare-battages attachés à la filière jusqu’au niveau du point d’impact probable, afin d’amortir le choc entre l’étrave de l’autre bateau et la partie arrière-bâbord du sien. Le pare-battages encaissa bien le choc, préservant la coque. À ce moment, Jo entendit un « plouf ! » retentissant, tandis que l’autre bateau venait s’appuyer puis longer assez rudement le sien mais finalement sans casse.
Une femme d’une cinquantaine d’années, allongée sur le pont de l’autre voilier, s’était levée quand elle avait entendu le cri de Jo. Puis, perdant l’équilibre dans l’embardée causée par le brusque coup de barre puis le choc de l’abordage, elle avait basculé pardessus bord. Jo vit la tête de l’infortunée réapparaître à la surface. Il coupa aussitôt les gaz, mit au point mort, puis enjamba la filière et sauta sur la plateforme, à l’arrière du bateau.
Se penchant au-dessus de l’eau, il réussit à saisir le bras de la naufragée et l’attira vers lui, puis, l’agrippant sous l’aisselle, il la souleva hors de l’eau et la déposa à côté de lui.
La rescapée avait tout du chat mouillé ; elle suffoquait sous l’effet du choc thermique provoqué par l’eau froide, tandis qu’elle remettait de l’ordre dans son maillot de bain qui avait laissé échapper un sein blanc encore ferme.
Et soudain, il entendit un rire de femme : un grand éclat de rire sans retenue, un fou rire incontrôlable, cristallin, magique… Avant même de l’avoir vue, il sentit battre son cœur… Puis une sublime vision surgissant de nulle part lui apparut comme dans un enchantement : le soleil était derrière elle et elle se tenait là devant lui, nimbée d’un halo lumineux, comme une créature née d’un rêve…
Il eut l’étrange sensation que ses yeux bleus rieurs l’absorbaient tout entier ; son visage à l’ovale parfait, ses dents éclatantes, son corps d’une légèreté d’elfe offraient à son regard émerveillé et incrédule l’image éblouissante d’un être évanescent d’une irréelle beauté…
Il était comme pétrifié, les yeux écarquillés, se demandant que croire, quand il entendit sa voix moqueuse :
— Oh ! Monsieur ! Merci beaucoup, mais vous pouvez me rendre ma mère maintenant !
— Oui ! Bien sûr ! avait-il bafouillé bêtement.
La jeune femme s’était rendu compte de l’effet qu’elle produisait sur lui ; elle lui adressa en retour un beau sourire prometteur qui lui fit comprendre qu’il ne lui était pas indifférent.
Reprenant pied dans la réalité, Jo grimpa dans le cockpit, puis invita la mère de la jeune femme à en faire autant, tout en l’aidant à enjamber la filière arrière. La dame le remercia de ses services, puis elle rejoignit son propre bord, aidée par sa fille.
Le père de la jeune femme s’était approché. Il ne serra pas la main de Jo, ne le remercia pas d’avoir aidé sa femme, mais, au contraire, lui reprocha d’avoir effectué une manœuvre irréfléchie juste devant son bateau. Jo, surpris par ces propos injustes, lui répliqua calmement qu’il s’était écarté pour manœuvrer et que c’était à celui qui venait de derrière, de faire attention à ce qu’il y avait devant. La fille de l’homme, gênée par l’attitude de son père, fit savoir sèchement à celui-ci qu’il était de mauvaise foi et plutôt impoli de ne pas montrer un peu de reconnaissance envers le sauveur de sa mère. Le père, étonné du ton de sa fille, remercia finalement Jo du bout des lèvres. Ce dernier lui dit que ce n’était pas un exploit et que, comme il n’y avait pas eu de casse sur les bateaux, c’était bien là l’essentiel.
Avant de redémarrer, la jeune femme lui glissa, à voix suffisamment basse pour ne pas être entendue de ses parents, qu’il était dommage de se quitter comme ça et qu’ils pourraient se retrouver tous deux au Café de la Marine à La Richardais, d’ici deux heures.
Deux heures plus tard, Jo qui attendait depuis une bonne demi-heure, la vit entrer dans le café… Et dans sa vie…
Ce furent les jours heureux… Deux années d’un bonheur parfait, durant lesquelles il emménagea chez elle, dans une jolie maison du bord de mer. Ils vivaient très confortablement, surtout grâce à l’argent qu’elle gagnait.
Elle était diplômée d’une grande école de commerce et avait fondé une start-up spécialisée dans la création et le développement de jeux informatiques. Il était médecin généraliste et avait son cabinet dans un quartier populaire de Saint-Malo.
Son père à elle était président d’une grande compagnie de transports maritimes, héritier d’une grande famille marchande de Saint-Malo, personnage incontournable de la vie économique locale.
Ses parents à lui étaient des gens d’origine modeste qui avaient fait des études primaires et secondaires sérieuses, obtenues leur bac puis exercé des professions fort honorables mais qui n’avaient guère fait d’eux des gens riches ou puissants. Ne pouvant avoir d’enfant, ils l’avaient adopté, lui, l’enfant de l’Assistance publique, et lui avaient donné l’amour d’une famille et l’éducation vertueuse de gens issus des classes populaires qui croyaient aux valeurs du travail, de l’effort et du respect des autres. Ils étaient décédés depuis quelques années et ils lui manquaient encore énormément.
Quelques semaines après leur rencontre, les parents de Julie décidèrent de convier Jo à déjeuner un dimanche, puisqu’il était devenu évident que, malgré leurs réticences, leur fille s’était amourachée de ce bellâtre – c’étaient les mots utilisés lorsqu’ils avaient chargé leur fille de transmettre l’invitation, ce que Jo n’avait appris que bien plus tard. Très vite, malgré la courtoisie et les bonnes manières de ses hôtes, leur désintérêt pour lui suinta dans leurs paroles, puis leur mépris s’afficha clairement quand il évoqua son statut d’enfant adopté. Jo en avait été très affecté et Julie très fâchée contre eux…
Pendant plus d’un an, Julie ne vit pas ses parents, ne répondit pas à leurs appels. Jusqu’au jour où ils vinrent sonner à la porte… Julie n’était pas là ; ce fut Jo qui ouvrit.
Les reconnaissant, Jo eut d’abord envie de leur claquer la porte au nez ; mais ils avaient l’air si mal à l’aise, si malheureux qu’il s’en abstint finalement. Ils s’excusèrent pour leur comportement incorrect envers lui. Jo accepta leurs excuses avec une certaine réticence, en ajoutant que, lui, on lui avait inculqué comme valeur première le droit à la dignité et au respect de chacun, quelles que soient ses origines sociales. Ils baissèrent la tête, non qu’ils se fussent sentis fautifs envers lui, mais pour ravaler leur colère de devoir supporter cette leçon de morale ; mais ils étaient contraints de faire profil bas s’ils voulaient renouer des liens avec leur fille, et donc d’accepter le compagnon qu’elle s’était choisi.
Julie arriva peu après ; elle se montra tout d’abord très froide à leur égard, puis comprenant qu’ils avaient présenté leurs excuses et que Jo avait décidé de faire un effort pour pardonner, elle se dérida peu à peu…
Après cela, une fois par mois environ, ils se retrouvaient pour un déjeuner dominical chez les parents de Julie. Jo prenait sur lui pour participer à la conversation, tout en sachant qu’ici, son avis ne comptait pas ; et par contraste, il songeait avec nostalgie aux discussions d’autrefois chez ses parents à lui, à cette qualité d’écoute qu’il y avait dans leur chaleureux foyer…
Heureusement, Julie ne leur ressemblait pas : Jo se demandait souvent comment des gens tellement austères et imbus d’eux-mêmes pouvaient avoir engendré une fille d’un naturel si enjoué, et aussi attentive, soucieuse des autres. Jo était totalement sous son charme ; il ne comprenait même pas comment avait pu être sa vie avant elle…
*
Mercredi 21 mai 2014 ; Saint-Malo, cimetière de Rocabey.
Jo avait repris sa marche incertaine. Alors qu’il allait franchir la grille du cimetière, il aperçut les parents de Julie qui parlaient avec un groupe de personnes qui les avaient accompagnés et auxquelles il n’avait pas été présenté. Quand il passa à leur hauteur, les paroles se turent et des regards peu amènes le suivirent alors qu’il tournait vers sa gauche.
Il avait garé sa voiture à bonne distance et il continua à marcher dans l’air humide.
Il avait parcouru une distance d’environ trois cents mètres quand, tout à coup, une voiture stoppa à sa hauteur dans un brusque coup de frein. Deux hommes en jaillirent, pistolet au poing, le passager avant et celui de l’arrière. Le premier lui ordonna :
— Monte dans la caisse, vite !
Brutalement interrompu dans ses pensées, Jo réagit aussitôt, sans réfléchir, à l’instinct. Sa jambe droite se détendit ; le coup de pied, porté violemment dans la portière du passager avant, la referma brutalement sur l’homme. L’arme de ce dernier soudainement relevée dans le choc, laissa partir le coup de feu qui se perdit dans les airs. Jo se jeta de tout son poids sur la portière, saisit le pistolet que tenait l’agresseur pour le lui arracher, mais se brûla au contact du canon, puis eut l’index coincé par le chien de l’arme qui s’était rabaissé. Les deux hommes laissèrent échapper l’arme qui tomba par terre. Sa fureur décuplée par la douleur physique, Jo asséna un coup de poing terrible à son adversaire qui s’affaissa, assommé, le nez éclaté.
Pendant ce temps, le passager arrière avait contourné sa portière et pointait son arme sur Jo, prêt à appuyer sur la détente. En une infime fraction de seconde, Jo se dit qu’il allait mourir, que c’était tant mieux, qu’il aurait fini de souffrir… mais, à ce moment, le conducteur qui avait empoigné son acolyte assommé pour le ramener sur le siège passager, hurla :
— Ne tire pas, le patron a dit qu’il nous le fallait vivant !
« Merci du renseignement ! » pensa Jo, de nouveau prêt à l’action. « S’ils me veulent vivant, ils ne peuvent pas me tirer dessus ! »
— Rentre dans la tire ! Vite ! dit l’homme, agitant son pistolet.
Prenant appui des deux mains sur la portière, d’une formidable extension, Jo propulsa ses jambes vers son adversaire qui fut frappé coup sur coup par les deux pieds de Jo, l’un dans la poitrine, pulvérisant une côte dont on entendit le claquement sec, l’autre dans le menton, manquant lui dévisser la tête. L’homme tomba. Jo se précipita, shoota du pied dans l’arme encore tenue par le type et qui alla valdinguer à plusieurs mètres.
On entendit alors la sirène deux-tons d’une voiture de police ; Jo remarqua alors une jeune femme avec une poussette qui tenait un téléphone portable : c’était elle qui avait dû appeler les secours.
— Vite, les flics ! hurla le conducteur à son complice. On se casse ! C’est raté, tant pis ! Monte vite !
Alors que l’homme se relevait péniblement, le chauffeur braqua une arme sur Jo qui plongea derrière la voiture.
Le conducteur n’avait pas l’intention de tirer, suivant les ordres reçus, mais il voulait donner le temps à son complice de monter dans le véhicule. Tant bien que mal, celui-ci y parvint et la voiture démarra en trombe, tandis que le hurlement de la sirène se rapprochait.
Jo respira un grand coup, tout en se demandant ce qui avait bien pu pousser ces types à vouloir le kidnapper…
Il n’eut pas le loisir d’y penser plus longtemps, la voiture de police pila devant lui, des policiers en jaillirent, arme de service en main.
— Levez les mains, vite ! dit l’un d’eux qui le soumit à une fouille en règle.
— Hé ! C’est moi qui ai été attaqué ! se plaignit Jo. Mes agresseurs, eux, se sont enfuis par là en voiture, il y a juste quelques secondes.
— C’est exact, Monsieur l’agent, dit la jeune femme à la poussette, encore toute pâle. C’est moi qui vous ai appelés pour vous signaler cette agression. J’ai tout vu, ils avaient des armes et ont attaqué ce monsieur !
— Bon ! coupa un des policiers. On va prendre vos dépositions au poste ! Vous venez avec nous !
II
Mercredi 21 mai 2014 ; Saint-Malo, commissariat central.
Jo fut conduit directement au commissariat central de Saint-Malo, rue du Calvaire… « Ça ne s’invente pas », pensa Jo. La jeune femme qui avait été témoin de l’agression, avait obtenu l’autorisation de déposer son bébé chez sa mère, avant d’être emmenée au commissariat.
Après un long moment d’attente, Jo fut invité par un planton à entrer dans une pièce où une jeune femme en civil se tenait assise à un bureau couvert de paperasse derrière un ordinateur. Le planton l’annonça :
— Lieutenant, c’est le docteur Fauvel, la personne qui a été agressée en ville tout à l’heure.
— Très bien, merci Fabre ! Vous pouvez prévenir le lieutenant Moreau que la victime de l’agression est dans mon bureau, s’il vous plaît ? demanda-t-elle tout en posant son regard sur Jo.
La jeune policière eut un léger écarquillement des yeux, comme quelqu’un qui ne s’attend pas à ce qu’il voit. En réalité, la première impression qui se dégageait de l’homme qui lui faisait face était son imposante présence, comme si la pièce était soudain devenue trop petite. Il était très grand, large d’épaules, avec un corps athlétique à la fois mince et musclé. Encadré d’épais cheveux bruns, son visage aux traits fermes et réguliers, à la mâchoire et aux pommettes saillantes, aux yeux gris vert bienveillants était empreint d’une profonde tristesse. Ses épaules légèrement affaissées témoignaient également d’un douloureux fardeau… Et cela n’avait rien à voir avec l’agression dont il avait été victime ; elle en était certaine.
Elle se leva et lui tendit la main qu’il serra fermement, mais sans lui écraser les doigts.
— Lieutenant Audrey Tisserand, se présenta la policière. C’est moi qui suis chargée de l’enquête sur votre agression, avec le lieutenant Moreau qui ne devrait pas tarder.
— Bonjour Lieutenant, dit Jo d’une voix neutre.
— Asseyez-vous, je vous en prie ! l’invita-t-elle en lui désignant une des deux chaises se trouvant devant son bureau.
Il prit place en face d’elle. Avant qu’elle ne se rassoie, Jo remarqua qu’elle était d’assez grande taille pour une femme, environ un mètre soixante-quinze, élancée et d’allure sportive, dans la petite trentaine. Elle commença à pianoter sur le clavier de son ordinateur, tandis que Jo la détaillait rapidement. Ses cheveux auburn coupés assez court dégageaient son cou gracieux, orné d’un petit médaillon en pierre et argent. Son fin visage au teint mat était d’une beauté discrète et un peu froide. Ses yeux couleur d’ambre étaient en harmonie avec son teint et la couleur de ses cheveux. L’ensemble était très séduisant.
— Je vais prendre votre déposition, Monsieur… ? commença-t-elle en s’apprêtant à taper à son clavier.
— Fauvel.
— Prénom ?
— Jonathan, mais on m’appelle Jo.
— D’autres prénoms ?
— Simon, c’est tout.
— Date et lieu de naissance ?
— Le 25 mai 1979 à Saint-Malo.
— Taille et poids ?
— Un mètre quatre-vingt-treize ; quatre-vingt-seize kilos.
— Noms de vos parents ?
— A quoi ça sert, ces questions ? dit Jo dans un léger mouvement d’humeur.
— Pour qu’il n’y ait pas de risques de confusion entre des personnes de même nom. Cela arrive, vous savez !
— Bon… Mes parents se nomment Fauvel Jean-Claude et Catherine, répondit Jo qui n’avait nulle envie de signaler qu’ils étaient ses parents adoptifs ; la dernière fois qu’il en avait parlé avec les parents de Julie lui avait suffi.
— Nom de naissance de votre mère ?
— Héry.
— Votre adresse ?
— …Euh !
— Alors ?
— 27 rue du Gué, bâtiment C, troisième étage à Saint-Malo, répondit finalement Jo qui avait donné l’adresse de son appartement dans lequel il ne vivait plus depuis deux ans, puisqu’il s’était installé depuis chez Julie.
— Rue du Gué, mais c’est…
— …au beau milieu des quartiers populaires, oui. C’est là que j’exerce. J’y ai ouvert mon cabinet de médecin généraliste, les gens en difficulté ont aussi droit d’être soignés… et j’ai trouvé plus simple d’habiter sur place.
— Je comprends… fit la jeune policière en tapant l’adresse. Continuons ! Votre situation de famille ?
— …
— Vous ne savez plus si vous êtes célibataire, marié ou divorcé ? demanda la policière avec un soupçon d’ironie dans la voix.
— Je vivais en concubinage. Mais je revenais de son enterrement quand j’ai été agressé. Alors cela fait bizarre d’entendre cette question…
— Oh ! Excusez-moi ! Je… je suis désolée ! bafouilla la policière en pâlissant malgré son teint mat.
— Vous ne pouviez pas savoir !
— Bon, passons à la suite. Des enfants ?
— Non, mais c’était prévu…
À ce moment, la porte de la pièce s’ouvrit et un homme entra. Il referma la porte derrière lui et s’approcha du bureau du lieutenant Tisserand.
— Voici le lieutenant Moreau qui va travailler avec moi sur l’affaire qui vous concerne, dit la policière à Jo qui serrait la main molle du policier.
Puis, se tournant vers son collègue qui s’asseyait sur la chaise libre, elle ajouta en montrant Jo :
— Voici le docteur Jonathan Fauvel qui a été victime d’une agression ce matin, après l’enterrement de sa compagne.
— Toutes mes condoléances, se borna à dire Moreau sans réelle empathie pour Jo.
— Merci, répondit Jo en posant son regard sur lui.
Moreau détourna aussitôt les yeux pour fixer un point sur le mur au-dessus de la tête de sa collègue. Le personnage n’avait pas un abord très sympathique. Son allure générale ne plaidait pas pour lui : c’était un homme dans la petite quarantaine, de taille moyenne, plutôt gras, aux cheveux châtains clairsemés et aux petits yeux fuyants. Son attitude désinvolte renforçait l’impression de laisser-aller que ses vêtements froissés d’une propreté douteuse, son menton mal rasé et ses cheveux gras laissaient paraître au premier regard : il était avachi sur sa chaise, les bras croisés reposant sur sa bedaine, la tête rejetée en arrière, continuant à fixer le mur et affichant ainsi son manque d’intérêt pour l’affaire.
— Bien ! Nous poursuivons ! reprit la policière en lançant un regard désapprobateur à son collègue. Monsieur Fauvel, vos numéros de téléphone, s’il vous plaît…
Jo lui communiqua ses numéros de téléphone fixe et de portable. Puis elle enchaîna :
— Votre profession est donc…
— Médecin généraliste, compléta Jo.
— Votre adresse professionnelle est donc la même… dit la policière en continuant de taper sur son clavier.
— …que celle de mon domicile ; c’est le même palier, indiqua Jo.
— Bien ! Venons-en à l’exposé des faits : expliquez-nous comment tout cela s’est passé. Nous vous écoutons et par ailleurs, j’enregistre votre déclaration que vous signerez tout à l’heure.
Jo relata les circonstances de l’agression qu’il avait subie, sans toutefois entrer dans les détails de la lutte menée contre ses adversaires. Pendant qu’il parlait, la policière continuait à taper sa déposition sur le clavier de son ordinateur, tandis que son collègue semblait parfaitement indifférent à ses dires. Puis elle lui demanda de décrire ses agresseurs. Il répondit qu’il n’avait pas eu vraiment le temps de les détailler et qu’il aurait vraiment des difficultés à en faire un portrait précis, d’autant qu’aucun des deux n’avait un physique particulier, hormis celui qui avait eu le nez éclaté et qui devrait certainement porter un pansement ou une protection quelconque.
— Hum, c’est dommage… Mais nous aurons peut-être d’autres informations quand les techniciens de la police auront effectué les relevés des indices et les auront fait analyser. Maintenant, mon collègue et moi allons vous poser quelques questions pour compléter certains points, annonça la jeune policière. En premier lieu, vous avez pris de gros risques pour résister à des individus vous menaçant avec des armes à feu. Nous conseillons plutôt aux victimes d’obéir aux ordres des agresseurs. Vous auriez pu vous faire tuer !
— Vous savez, répondit Jo, c’est plutôt difficile d’expliquer ma réaction. J’ai agi instinctivement. Ces hommes m’attaquaient, ils voulaient me faire monter dans leur voiture contre ma volonté. J’étais plongé dans mes pensées, j’étais triste, déboussolé… Cette agression m’a… comment dire… révolté, alors j’ai frappé… Après, quand le deuxième type m’a mis en joue et allait tirer, j’ai cru que j’allais mourir et je me suis dit que c’était tant mieux ; mais il n’a finalement pas tiré, car le conducteur de la voiture l’en a empêché…
— Vous vous êtes défendu comme un champion du close-combat, on dirait ! lança le policier d’une voix désagréable. Nous avons entendu avant vous la jeune femme qui a été témoin de la scène. D’après ce qu’elle nous a dit, vous n’avez pas frappé vos adversaires n’importe comment, au hasard, comme un homme affolé qui se défendrait comme il peut. Non, vous avez utilisé des techniques de combat, j’me trompe ?
— Effectivement, j’ai pratiqué des sports de combat quand j’étais jeune, admit Jo.
— Lesquels ? questionna Moreau.
— Judo et karaté.
— Longtemps ?
— Plusieurs années, quand j’avais de onze à dix-huit ans.
— En compétition ? Vous étiez bon ?
— J’ai fait de la compétition, oui. Et j’ai eu quelques bons résultats.
— Quel niveau ? J’veux dire : quelle ceinture ?
— Ceinture noire pour finir, répondit Jo en haussant les épaules. Quelle importance ?
— C’est nous qui posons les questions, rétorqua le policier sèchement, alors que sa collègue le regardait d’un air surpris. Pourquoi vous avez arrêté si tôt ?
— À cause d’un certain ras-le-bol, et puis il y avait les études aussi… répliqua Jo avec un geste évasif.
— Ouais… Donc si j’comprends bien, vous êtes un spécialiste du combat rapproché… énonça le policier sur un ton de plus en plus suspicieux.
— Mais, cela fait très longtemps que je n’ai pas fait de combat ! se défendit Jo. On ne peut pas dire que je sois encore un spécialiste… Et puis, que signifient toutes ces questions ? Ce n’est pas moi, l’agresseur ! Ce sont eux qui m’ont attaqué !
— Ça ne fait absolument aucun doute ! intervint la jeune policière en jetant un regard noir à son collègue. Notre témoin ne dit pas autre chose : elle a confirmé avoir vu cette voiture s’arrêter à votre hauteur et ces hommes vous menacer avec des armes à feu et que vous vous êtes défendu vigoureusement.
— Peut-être bien ! reprit Moreau en s’adressant à sa collègue. N’empêche qu’elle sait pas c’que voulaient ces types à ce monsieur. Lui, il prétend qu’ces mecs voulaient l’emmener ; elle, elle a pas entendu ça ! Si ça se trouve, c’est un règlement de comptes entre eux et lui, et c’est pour ça qu’il a réagi si vite et si violemment.
— Mais c’est complètement faux ce que vous venez d’insinuer ! protesta Jo avec véhémence. Je ne connais pas ces personnes, et je n’ai aucun compte à régler avec personne ! Si cette dame qui a témoigné ne peut pas confirmer que mes agresseurs voulaient me faire monter dans leur voiture, c’est tout simplement parce qu’elle ne les a pas entendus ; ça ne veut pas dire que j’invente le fait qu’ils voulaient m’emmener !
— Pourquoi voulaient-ils vous emmener avec eux, selon vous ? demanda la policière qui essayait d’apaiser la tension qui avait monté d’un cran.
— Je n’en sais absolument rien ! répondit Jo, écartant les bras dans un geste d’ignorance. Je ne vois pas du tout de raison ! S’ils voulaient me kidnapper en échange d’une rançon, ils auraient été déçus : je n’ai pas de fortune personnelle, loin de là !
— Ouais ! Ils voulaient peut-être vous choper pour vous faire parler de quelque chose que vous leur cachez, et c’est pour ça qu’ils voulaient pas vous tirer dessus, pour pas risquer de vous tuer avant de vous avoir fait parler… suggéra sournoisement Moreau, à mi-voix, comme s’il se faisait la réflexion pour lui-même.
— Non mais c’est intolérable cette façon d’agir ; à vos yeux, de victime je deviens suspect ! s’indigna Jo en se tournant vers le policier qui continuait à regarder le mur. Et puis, ayez l’obligeance de me regarder lorsque je vous parle !
— C’est nous qui menons l’enquête. On n’est pas obligés de vous croire sur parole ! rétorqua Moreau en lui jetant un regard oblique qu’il reporta presque aussitôt sur le mur d’en face. On a souvent eu le cas de gens venus déposer une plainte parce qu’ils commençaient à avoir peur de ceux avec lesquels ils trafiquaient et qu’ils avaient essayé de doubler…
— Quoi ? bondit Jo, outré. Vous pensez que je serais un complice de ces truands dans un trafic quelconque et que je les aurais trahis ? Non, mais je rêve !
— Mon collègue n’a pas dit cela de vous ! intervint la policière, mal à l’aise. Il a dit qu’il y a eu des cas de ce genre par le passé, et que cela peut se reproduire. En ce qui me concerne, je vous crois : je pense que vous êtes une personne honnête, que vous ne connaissiez pas vos agresseurs et que vous ne savez pas du tout pourquoi ils voulaient vous emmener. Les hypothèses émises par mon collègue n’engagent que lui-même et ne figurent pas dans ce procès-verbal. Vous allez le lire, puis le signer, si vous le voulez bien.
Elle imprima les feuillets, les tendit à Jo. Il s’en saisit et les lut très attentivement ; il avait été suffisamment échaudé par l’attitude du lieutenant Moreau. Il constata que la policière s’en était scrupuleusement tenue aux faits et aux explications qu’il avait fournis. Il signa donc sa déposition et remplit ensuite le formulaire de dépôt de plainte qu’il signa également.
— Bien ! Maintenant que nous en avons fini avec la paperasserie, enchaîna la jeune policière, je vais vous faire part de la suite de la procédure. Suite à votre plainte pour agression et tentative d’enlèvement – Moreau haussa les sourcils en levant les yeux au plafond – le parquet va diligenter une enquête qui sera menée par nos services. Parallèlement à cela, je vais intercéder auprès du parquet pour que soit posé le problème de votre protection et que soit décidée la mise en place d’un dispositif visant à empêcher une nouvelle agression…
— Vous voulez dire que je vais avoir un… une sorte de garde du corps ? demanda Jo, étonné.
— Oui, probablement. Enfin, là, c’est le juge qui décide ! Voilà, nous en avons fini pour l’instant. Nous vous rappellerons dès que le juge aura pris sa décision. À bientôt, monsieur Fauvel !
Elle tendit la main et il la lui serra en la remerciant. Il jeta un coup d’œil acéré à Moreau, toujours avachi sur sa chaise. Ils ne se serrèrent pas la main…
Jo quitta le commissariat, intrigué par le comportement du policier. Heureusement que sa collègue avait l’air plus sympathique et surtout croyait à ce qu’il disait !
Le lieutenant Audrey Tisserand le rappela sur son portable plus tard dans la journée, pour l’informer des décisions du parquet : le juge chargé du suivi de l’enquête avait d’abord été réticent à accorder son autorisation pour la mise en place d’un dispositif de protection de la victime, en l’occurrence le docteur Jonathan Fauvel, arguant du fait que cela coûtait cher et que cela n’en valait peut-être pas la peine.
La policière lui avait rétorqué qu’il y avait de grandes chances que les agresseurs récidivent et que des policiers en protection permettraient peut-être l’arrestation des malfaiteurs, si ceux-ci se manifestaient. Le juge en avait finalement convenu et accordé son autorisation pour une protection rapprochée : jusqu’à nouvel ordre, un policier suivrait Jo dans ses moindres déplacements, serait en faction à la porte de son appartement quand Jo y serait, et interviendrait immédiatement à la moindre alerte. Le policier de service devait retrouver Jo chez lui, une heure plus tard.
Jo la remercia en ajoutant qu’il était déjà chez lui et qu’il y attendrait l’agent chargé de le protéger.
III
Vendredi 23 mai 2014 ; Saint-Malo, appartement de Jo.
Deux jours plus tard, dans la soirée, Jo avait retrouvé son appartement après sa journée de consultations. Il avait rouvert son cabinet le matin même et s’était replongé dans le travail. C’était le meilleur moyen de surmonter son chagrin. De plus, comme il avait reporté les rendez-vous des cinq derniers jours, il avait eu une grosse journée pour rattraper une partie du retard accumulé. Il avait reçu en priorité les patients pour lesquels c’était le plus urgent.
Il avait croisé le policier chargé de sa protection, assis sur une chaise sur le palier. Ils avaient échangé quelques mots ; Jo lui avait proposé de venir prendre un verre chez lui – pas d’alcool bien sûr – mais le policier avait refusé car, avait-il dit, le service l’exigeait.
Jo lui avait souhaité une bonne nuit, l’homme en avait fait autant, ajoutant que la relève aurait lieu à minuit et qu’il pourrait alors aller se coucher. Jo était rentré dans son appartement.
Maintenant, à peine la porte refermée, il se sentait assailli par une nouvelle vague de tristesse et de solitude. Se retrouver dans cet appartement lugubre qu’il n’avait plus occupé depuis presque deux ans, lui rappelait par contraste tout ce qu’il avait connu avec Julie, tous ces moments de bonheur partagé, et le terrible poids de son absence l’écrasait à nouveau, comprimait sa poitrine, l’empêchant de respirer normalement… Il s’exhorta à penser à sa journée, à ses patients et leurs problèmes de santé, et l’étau qui enserrait sa cage thoracique se relâcha peu à peu…
Soudain, un hurlement se fit entendre provenant du palier où se trouvait le policier en faction. Le cri s’interrompit dans un râle, puis il y eut un choc sourd contre la porte de l’appartement de Jo. Des éclats de bois jaillirent de la porte traversée par une balle qui s’écrasa sur le mur ; Jo n’avait pas entendu de détonation, le tireur avait probablement utilisé une arme équipée d’un silencieux. Dans un stress poussé au maximum, Jo comprit que c’était lui la cible de cette nouvelle attaque, que ses agresseurs n’avaient pas renoncé et qu’ils avaient déjà éliminé l’obstacle du policier de garde. Un coup violent fut porté contre sa porte et il vit le fer d’une sorte de hache d’incendie traverser le battant. Jo se précipita sur son balcon, désespéré, alors que les heurts d’autres coups de hache suivis d’horribles craquements du bois lui parvenaient. Il enjamba la rambarde, mais se rendit compte qu’il ne pouvait pas sauter de si haut – du troisième étage – sans risquer de se blesser, voire pire, de se tuer. Que faire ? Il n’y avait que par le balcon qu’il pouvait fuir : c’était la seule issue possible ! Il réfléchissait à toute vitesse… Ou alors devait-il affronter ses agresseurs ? Non, le risque était trop grand, nul doute que leur première tentative ratée leur avait servi de leçon et qu’ils avaient mieux préparé leur affaire, cette fois-ci. Que faire ? Vite, il fallait trouver une solution : la porte allait céder ! Tourné vers le vide, appuyé contre la rambarde, Jo savait qu’il devait agir rapidement… Jetant un regard vers la rue en contrebas, il aperçut alors un gros camion avec une remorque bâchée, qui y circulait et qui allait passer devant son immeuble. À ce moment, un grand fracas se produisit du côté de la porte d’entrée : ce qui restait du battant déchiqueté s’était ouvert brutalement et avait heurté violemment le mur. Un type cagoulé se précipita à l’intérieur de l’appartement, suivi d’un deuxième portant aussi une cagoule. Apercevant Jo sur le balcon, le premier homme hurla en pointant son pistolet muni d’un silencieux :
— Là ! Dehors ! Sur le balcon !
— Ne tire pas ! Laisse-moi faire ! cria l’autre.
Jo eut juste le temps d’entrevoir ce qui lui sembla être un pistolet à impulsion électrique, cet instrument qui paralyse sa cible, la privant de toute volonté, tout en préservant son intégrité physique, tout au moins en principe. À moins de trois mètres de lui, l’homme, qui franchissait la porte vitrée ouvrant sur le balcon, pressa la détente, projetant les deux filaments terminés chacun par une électrode. Si Jo était atteint par les deux électrodes, le circuit électrique serait alors fermé et la décharge électrique se produirait dans son corps, le paralysant instantanément. N’ayant plus le choix, Jo se jeta vers l’avant et d’une poussée fantastique de sa jambe gauche contre le rebord du balcon, effectua un bond gigantesque. Remarquable sang-froid ou coup de chance incroyable, le timing était parfait : les filaments passèrent largement au-dessus de sa tête et le camion arrivait juste devant l’immeuble, sous le balcon… Enfin presque, il s’en fallait de trois bons mètres d’écart à cause de la largeur du trottoir. Pendant quelques centièmes de seconde, emporté par son impulsion, Jo décrivit dans les airs une trajectoire de chute en avant qui le fit dépasser la largeur du trottoir qu’il voyait sous lui, puis surplomber la bâche de la remorque sur laquelle il atterrit, rebondit. Il manqua de basculer de l’autre côté, se raccrochant in extremis au rebord, puis se rétablit sur le haut du véhicule. Ouf ! Il s’aperçut alors qu’il tremblait de tous ses membres… Le camion continua sa route, alors que les deux agresseurs le regardaient s’éloigner, écumant de rage mais totalement impuissants.
Quelques rues plus loin, Jo descendit du poids lourd qui s’était arrêté à un feu rouge, et il s’éloigna sur le trottoir.
IV
Vendredi 23 mai 2014 ; Saint-Malo, commissariat central.
Jo s’était rendu directement au commissariat central. Il avait expliqué les événements qu’il venait de vivre au policier à l’accueil, en ajoutant que c’était la deuxième agression qu’il subissait en trois jours et que c’était le lieutenant Audrey Tisserand qui s’occupait de l’enquête qui avait été ouverte, ne jugeant pas utile de mentionner le nom du lieutenant Moreau. Le planton avait aussitôt prévenu la jeune policière sur son téléphone portable et elle devait arriver bientôt. Il avait ajouté qu’il avait reçu, trois quarts d’heure auparavant, un appel téléphonique d’un résident passablement affolé de l’immeuble de Jo pour signaler une agression avec arme au troisième étage, un homme inanimé sur le palier et la porte d’un appartement défoncé. Les agresseurs avaient apparemment quitté les lieux quand il avait appelé. Le planton avait demandé en guise de conclusion : « Ça devait être chez vous, non ? » Jo avait hoché la tête sans répondre. Le policier lui avait dit d’aller s’asseoir sur un siège et d’attendre l’arrivée du lieutenant Tisserand.
Il était maintenant vingt et une heures. Jo attendait depuis dix minutes quand la jeune policière fit son entrée dans le hall d’accueil du commissariat. Elle vit aussitôt Jo, vint à lui en arborant une mine grave, lui serra la main et l’invita à la suivre dans son bureau. Après avoir ouvert son ordinateur, elle prit la parole :
— Je dois tout d’abord vous prévenir que j’ai prévenu le lieutenant Moreau de votre présence ici, il ne devrait pas tarder à arriver…
Jo fit une grimace révélatrice de l’estime qu’il avait pour le policier. La jeune femme ne releva pas, mais Jo crut discerner sur ses lèvres un léger sourire. Elle enchaîna :
— Voyons notre affaire ! J’ai été prévenue d’une agression avec arme à votre adresse et j’ai ensuite été informée de l’évolution de la situation. Une équipe d’intervention de nos forces de police s’est rendue immédiatement sur les lieux. Les agresseurs étaient partis. Ils ont trouvé le corps du policier chargé de votre protection…
— Vous voulez dire qu’il est… ?
— Mort… Oui. Ils l’ont tué… D’après les collègues de l’équipe d’intervention, un agresseur a tiré sur lui avec une arme à feu, dès que la porte de l’ascenseur s’est ouverte, alors que l’agent de faction avait sorti son arme de service, à l’arrêt de la cabine à l’étage… mais il n’a pas eu le temps de s’en servir ; la balle lui a traversé la poitrine, le tuant sur le coup, est ressortie derrière lui, est passée à travers la porte pour finir dans votre mur. Ce policier avait une famille, sa compagne et ses deux enfants…
— Oh ! J’en suis profondément désolé… pour lui, pour sa famille. Dire que c’est à cause de moi qu’il a été tué !
— Non, pas à cause de vous ! À cause d’eux ! Ce sont ces tueurs qui l’ont abattu ! Je n’en reviens pas : ils ont tué un flic ! Ces types sont des tueurs professionnels, extrêmement dangereux !
Jo secoua la tête, totalement atterré. Il avait échangé quelques mots avec son garde du corps ; il lui avait dit qu’il finirait son service à minuit et qu’il pourrait aller se coucher… Il pensa à sa malheureuse compagne qui maintenant devait avoir appris sa mort, à ses pauvres enfants à qui elle allait devoir dire qu’ils ne reverraient plus leur père… Jo sentit monter sa rage et sa haine contre ces assassins.
Il en était là de sa réflexion lorsque le lieutenant Moreau entra dans la pièce. Jo lui adressa un bref signe de tête en guise de salut, le policier n’y répondit pas. Les deux hommes ne se serrèrent pas la main.
Sans rien dire, Moreau se laissa tomber sur la chaise qu’il avait déjà occupée la dernière fois. Son apparence négligée avait encore empiré.
La jeune policière reprit la parole, résumant ce qui s’était dit entre elle et Jo avant l’arrivée de Moreau. Puis elle demanda à Jo de relater les événements de cette deuxième agression. Celui-ci raconta ce qui s’était passé, là encore sans insister sur les détails de la dangereuse prouesse qu’il avait réalisée pour réussir à s’échapper.
— Donc, reprit la policière, ce que vous dites à propos de la balle correspond à ce qu’en ont déduit les policiers de l’équipe d’intervention : la balle a été tirée sur le policier de faction, l’a traversé de part en part en le tuant, est passée à travers votre porte en faisant éclater le bois, ce que vous avez observé, pour finir sa course dans votre mur. Ensuite, vos agresseurs se sont attaqués à votre porte à coups de hache et vous en avez vu le fer traverser le battant.
— C’est exactement ça ! confirma Jo.
— Ensuite, quand ces tueurs sont entrés, ils étaient cagoulés, c’est bien ça ?
— C’est ça.
— Il semblerait qu’ils aient décidé de se montrer plus prudents que la première fois ; ils ne veulent plus laisser voir leur visage, supposa la policière. Ensuite, vous avez dit que l’un des deux avait un “pistolet électrique” ; on dit : un pistolet à impulsion électrique, ou plus communément, un “Taser”. Cela veut dire qu’ils ont pris conscience de votre capacité à vous défendre et qu’ils veulent vous immobiliser sans vous blesser.
— Sans doute, approuva Jo, mais alors pourquoi n’ont-ils pas utilisé le… comment vous dites ? le Taser sur le policier de garde ? Ils l’auraient neutralisé sans le tuer…
— Parce que, de leur probable point de vue, ils ont dû agir très rapidement à l’ouverture de la porte de l’ascenseur. Dès que le tueur au pistolet a vu le collègue de faction pointer son arme vers eux, il a tiré un coup de feu par pur réflexe d’assassin entraîné à agir ainsi sans se poser de question. Nul doute que s’ils avaient voulu vous éliminer, vous seriez déjà mort, comme ce pauvre collègue…
— Oui, je le pense aussi, acquiesça Jo en frissonnant.
— Ensuite, vous avez réussi à sauter sur un camion bâché, au risque de vous écraser sur le bitume, trois étages plus bas… Vous êtes complètement inconscient du danger, ma parole !
— Je n’avais pas le choix : soit je sautais soit je prenais une décharge électrique. Dans ce cas-là, on fait le choix qui paraît le moins dangereux. Et puis, s’il n’y avait pas eu ce camion providentiel, je n’aurais pas sauté. J’ai cru en ma chance… et j’ai bien fait, finalement.
— Et moi, j’pense que tout n’est pas clair chez vous ! intervint Moreau d’un ton hargneux. Ces types ont recommencé ; ce qui veut dire qu’ils tiennent vraiment à vous mettre la main dessus et par n’importe quel moyen, y compris en tuant un policier. Alors moi, je me demande ce que vous avez bien pu leur faire ! Vous n’avez pas une petite idée ?
— Non, aucune ! répliqua Jo avec humeur. Je vous l’ai déjà dit ! Si vous attrapez ces criminels, vous leur poserez la question et nous aurons enfin la réponse !
— Eh, dites donc ! Vous êtes mal placé pour nous donner des leçons, parce que vous ne nous avez pas tout dit à votre première déposition, loin de là !
— Quoi ? s’insurgea Jo.
— De quoi parles-tu, Moreau ? questionna la jeune policière, également surprise par l’insinuation de son collègue.
— J’ai consulté le fichier des condamnations à son sujet. Ouais ! J’y ai entré son nom, comme ça, pour voir, et qu’est-ce que j’ai trouvé sur le gentil docteur ? Une condamnation pour coups et blessures à l’encontre de deux jeunes gens, prononcée contre lui en 2002, à l’âge de vingt-trois ans. Il a évité une peine de prison, n’a même pas eu de sursis ; il a seulement eu une amende de 1 500 euros à verser en dommages et intérêts. Il s’en est plutôt pas mal sorti. Hein, tu trouves pas, Tisserand ?
Jo était consterné. Ainsi ce policier retors était allé déterrer cette vieille affaire… Il croisa le regard rempli de reproches de la policière, et cela lui parut tout à coup insupportable. Il éprouva le besoin de se justifier aux yeux de la jeune femme, car il sentait que la confiance qu’elle avait pu avoir en lui était sérieusement ébranlée.
— Si je n’ai été condamné qu’à cette peine relativement faible, eu égard à la gravité de l’accusation de coups et blessures volontaires, expliqua Jo, c’est parce que le juge a compris que j’étais en réalité la victime dans cette histoire…
— Vous êtes toujours la victime, même quand vous êtes condamné ! C’est plutôt commode, non ? ironisa Moreau.
— Vous avez lu les rapports d’enquête sur cette affaire ? demanda Jo. Non, bien sûr. Sinon, vous auriez vite compris que ce n’était pas moi l’agresseur. À quatre contre un, il aurait vraiment fallu que je sois sûr de moi ! Ou complètement inconscient…
— Je lirai ces rapports, coupa la policière. En attendant, donnez-nous votre version des faits !
Jo leva les yeux vers elle et se mit à raconter…
*
Samedi 31 août 2002.
Jo avait travaillé comme magasinier dans une grande surface durant les deux mois d’été. Le salaire qu’il avait gagné lui permettrait de compléter les subsides que ses parents lui versaient pour qu’il puisse poursuivre ses études de médecine. Il allait entamer dans quelques semaines sa cinquième année.
En cette fin du mois d’août, lui et ses copains avaient décidé de se retrouver pour fêter la fin de leur job d’été.
Toute la bande se retrouva dans un des troquets sur le front de mer, en début de soirée ; ils y burent pas mal, mirent pas mal d’ambiance… enfin surtout les autres, car Jo étant d’un naturel discret, restait plus calme, même s’il prenait beaucoup de plaisir à participer à ces joyeux moments. Puis, la soirée s’avançant, ils décidèrent de finir la soirée dans une discothèque voisine.
À l’intérieur, l’ambiance battait son plein. La musique assourdissante empêchait de s’entendre parler. Ils commandèrent à boire, burent leur consommation debout près du bar, car il n’y avait plus une seule table libre. Puis, ils allèrent danser sur la piste, bondissant et chantant sur des airs connus. Une série de slows démarra ; Jo invita une jolie fille brune et ils se mirent à se balancer doucement au gré de la douce mélodie. Quelques instants plus tard, ils s’embrassaient avec ardeur… La série des slows terminée, ils décidèrent de quitter la boîte pour savourer le calme d’une nuit d’été.
Ils se dirigèrent vers la plage toute proche, la fille, qui s’appelait Marie, accrochée à son bras. Il se sentait bien : le sable, la mer toute proche, la jolie fille à ses côtés…
Soudain, quatre silhouettes se matérialisèrent devant eux. Quatre jeunes hommes d’une vingtaine d’années… L’un d’eux parla d’une voix forte ; il avait certainement bu, les autres aussi sans doute.
— Alors, ça baigne, les amoureux ? Hé, mec, tu sais que tu m’as piqué ma nana ? Ça s’fait pas, des trucs comme ça !
— Je ne suis pas ta nana ! répliqua Marie. Tu n’as pas arrêté de m’embêter toute la soirée. Je t’ai dit d’aller voir ailleurs, mais tu as continué…
— Bien sûr que j’ai continué ! Les filles font toutes ça ! Au début, elles veulent pas, et puis après, finalement, elles veulent bien et ça finit au plumard !
— Eh bien, moi, je ne suis pas comme ça ! Je suis avec lui, ajouta la fille, énervée, en désignant Jo, et maintenant, tu nous laisses tranquilles !
— Non mais, oh ! Tu me parles pas sur ce ton, hein !
— Bon ! On est tous un peu énervés, intervint Jo d’un ton dénué d’agressivité. Si on se calmait un peu ?
— Hé, toi ! Tu veux qu’on se calme ? reprit le garçon de plus en plus hargneux. Mais moi, j’veux pas me calmer. Tu m’piques ma nana, et tu voudrais que j’laisse faire ?
Il tourna légèrement la tête vers la droite, puis fit un hochement de tête, manifestement un signe de connivence pour celui qui était sur la gauche de Jo. Mais Jo était sur ses gardes ; il se doutait depuis le début que ces gars voulaient en découdre, surtout celui qui était le meneur… Le coup arriva de la gauche, visant son visage. Jo se contenta d’effectuer un mouvement de retrait du buste vers l’arrière pour esquiver l’impact, puis il enchaîna avec une telle rapidité que les types ne comprirent pas ce qui leur tombait dessus. Saisissant de sa main droite l’avant-bras qu’il voyait passer devant lui, il plaça sa main gauche sous l’aisselle de son adversaire et donna une forte poussée pendant qu’il tirait de son autre main le bras du type. Celui-ci plongea vers l’avant tout en ayant le bras violemment tiré vers l’arrière ; l’articulation de son épaule, prise entre deux mouvements antagonistes, céda, tandis que son crâne allait percuter le visage du meneur du groupe. Tous les deux s’affalèrent par terre dans un concert de cris de douleur. Jo se retourna immédiatement vers le plus proche des deux autres gars, détourna aisément le coup de poing qui lui était destiné et le frappa au plexus solaire de son poing fermé. Le type tomba à genoux dans le sable et se mit à vomir la bière qu’il avait bue. Le quatrième ne demanda pas son reste et s’enfuit en courant. Quant à Marie, elle était déjà loin ; elle avait décampé dès le début de l’échauffourée. Les deux types qui s’étaient étalés dans le sable se relevaient péniblement ; le meneur qui tâtait sa bouche ensanglantée avait perdu plusieurs dents, l’autre qui soutenait son épaule douloureuse ne pouvait plus lever le bras. Les trois garçons jetèrent quelques regards inquiets à Jo, se demandant sans doute si celui-ci n’allait pas profiter de son avantage pour encore les frapper. Comme Jo ne bougeait pas, se contentant de les toiser d’un air farouche, ils s’éloignèrent clopin-clopant en direction du parking.
Jo entendit peu après une voiture qui démarrait, puis s’éloignait… Il retourna à son tour sur le parking, espérant que la fille l’aurait attendu à proximité. Mais elle avait disparu…
*
Vendredi 23 mai 2014 ; Saint-Malo, commissariat central.
Jo regarda tour à tour les deux policiers. Moreau continuait à fixer le mur d’en face, arborant un air renfrogné ; Tisserand le fixait de son profond regard d’ambre, dans lequel Jo crut lire davantage de compréhension qu’avant ses explications.