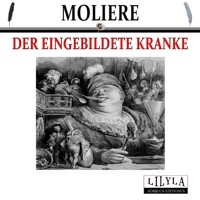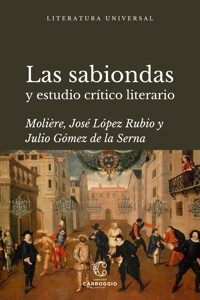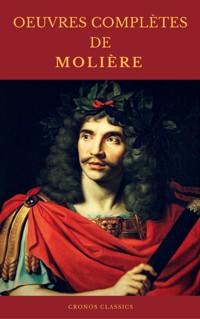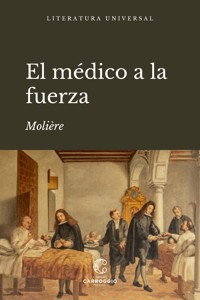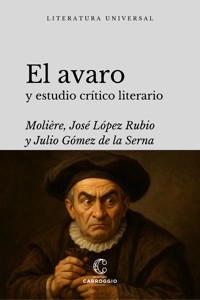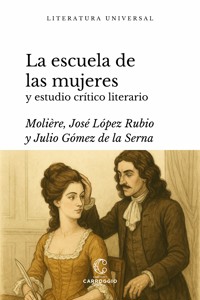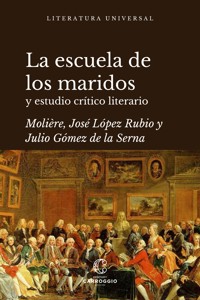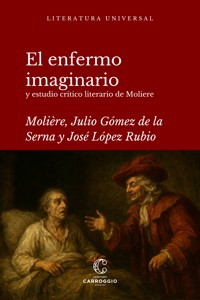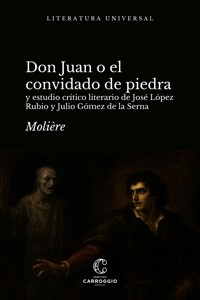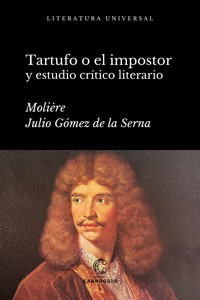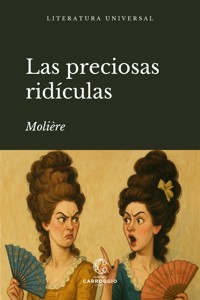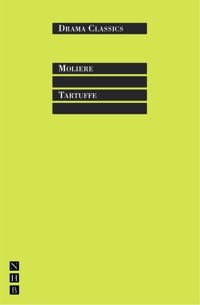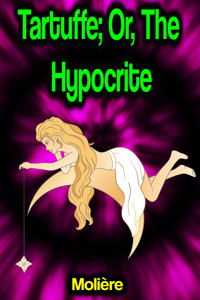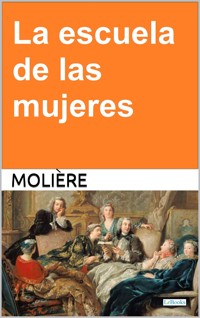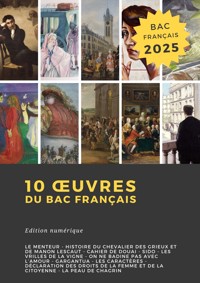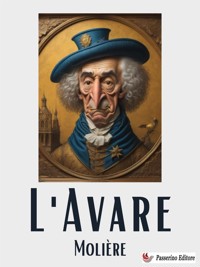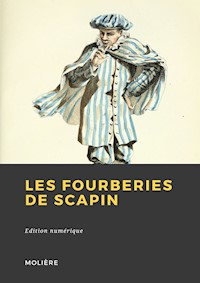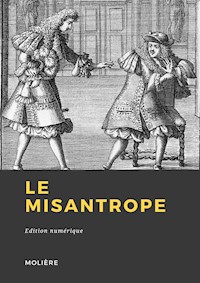Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "MERCURE. Tout beau ! charmante Nuit ; daignez vous arrêter : Il est certain secours que de vous on désire, Et j'ai deux mots à vous dire De la part de Jupiter. LA NUIT. Ah ! ah ! c'est vous, Seigneur Mercure ! Qui vous eût deviné là, dans cette posture ? "
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MONSEIGNEUR,
N’en déplaise à nos beaux esprits, je ne vois rien de plus ennuyeux que les épîtres dédicatoires ; et VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME trouvera bon, s’il lui plaît, que je ne suive point ici le style de ces Messieurs-là, et refuse de me servir de deux ou trois misérables pensées qui ont été tournées et retournées tant de fois, qu’elles sont usées de tous les côtés. Le nom du GRAND CONDÉ est un nom trop glorieux pour le traiter comme on fait tous les autres noms : il ne faut l’appliquer, ce nom illustre, qu’à des emplois qui soient dignes de lui ; et pour dire de belles choses, je voudrais parler de le mettre à la tête d’une armée plutôt qu’à la tête d’un livre ; et je conçois bien mieux ce qu’il est capable de faire en l’opposant aux forces des ennemis de cet État, qu’en l’opposant à la critique des ennemis d’une comédie.
Ce n’est pas, MONSEIGNEUR, que la glorieuse approbation de VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME ne fût une puissante protection pour toutes ces sortes d’ouvrages, et qu’on ne soit persuadé des lumières de votre esprit autant que de l’intrépidité de votre cœur et de la grandeur de votre âme. On sait, par toute la terre, que l’éclat de votre mérite n’est point renfermé dans les bornes de cette valeur indomptable qui se fait des adorateurs chez ceux même qu’elle surmonte ; qu’il s’étend, ce mérite, jusques aux connaissances les plus fines et les plus relevées ; et que les décisions de votre jugement sur tous les ouvrages d’esprit ne manquent point d’être suivies par le sentiment des plus délicats. Mais on sait aussi, MONSEIGNEUR, que toutes ces glorieuses approbations dont nous nous vantons au public ne nous coûtent rien à faire imprimer ; et que ce sont des choses dont nous disposons comme nous voulons ; on sait, dis-je, qu’une épître dédicatoire dit tout ce qu’il lui plaît, et qu’un auteur est en pouvoir d’aller saisir les personnes les plus augustes, et de parer de leurs grands noms les premiers feuillets de son livre ; qu’il a la liberté de s’y donner, autant qu’il veut, l’honneur de leur estime, et de se faire des protecteurs qui n’ont jamais songé à l’être.
Je n’abuserai, MONSEIGNEUR, ni de votre nom, ni de vos bontés, pour combattre les censeurs de l’Amphitryon, et m’attribuer une gloire que je n’ai pas peut-être méritée ; et je ne prends la liberté de vous offrir ma comédie, que pour avoir lieu de vous dire que je regarde incessamment, avec une profonde vénération, les grandes qualités que vous joignez au sang auguste dont vous tenez le jour, et que je suis, MONSEIGNEUR, avec tout le respect possible et tout le zèle imaginable,
DE VOTRE ALTESSE SÉRÉNISSIME
Le très humble, très obéissant et très obligé serviteur,
MOLIÈRE.
Entre le petit acte du Sicilien et l’Amphitryon, représentés pour la première fois, l’un en février 1667, l’autre en janvier 1668, il y eut près d’un an d’intervalle. D’ordinaire, les ouvrages de Molière se succédaient plus rapidement. On pense que, pendant quelque temps, il s’était senti découragé, et que la crainte d’avoir moins à compter sur la protection royale lui avait, plus encore qu’une altération de sa santé, conseillé de s’effacer, de se taire.
L’année 1667 fait époque, on s’en souvient, dans l’histoire du théâtre de Molière. Trois mois après les fêtes de Saint-Germain, Louis XIV était parti de cette même ville pour la campagne de Flandre, qui commença la guerre de la dévolution, et ce fut pendant cette campagne que le Tartuffe, achevé et connu dès 1664, parut sur la scène du Palais-Royal, pour être aussitôt interdit. Cette sévérité, qui trompait tout à coup les espérances données, ne devait pas engager Molière à produire quelque œuvre nouvelle. Il ne s’y décida qu’au commencement de l’année suivante, après qu’il eut été peut-être, comme le pauvre Sosie, rengagé de plus belle par la « faveur d’un coup d’œil caressant. »
L’Amphitryon fut comme une rentrée de l’auteur, qui avait fait relâche, une brillante rentrée. Cette comédie ne semblait pourtant promettre qu’une sorte de traduction ; mais combien, dans le fait, elle montra d’originalité ! Jamais, chez nous, le théâtre comique des anciens n’a eu une si heureuse résurrection, sous une forme toute nouvelle. Un critique a dit que Bayle avait manqué de goût lorsqu’il avait mis l’Amphitryon au nombre des meilleures pièces de Molière, et qu’il n’aurait pas dû oublier combien lui sont supérieures des comédies telles que le Misanthrope, le Tartuffe, l’Avare, les Femmes savantes, l’École des femmes et l’École des maris. La comparaison est difficile entre une comédie mythologique empruntée au théâtre de Plaute et des œuvres toutes modernes, immortelles peintures de nos mœurs ; mais pourquoi ne pas faire une place toute voisine à une charmante fantaisie qui nous fait si bien goûter, en y donnant le tour qui nous convient, ce que l’esprit de la comédie latine a eu de plus vif ? Si Bayle a pensé que, par la verve abondante, par la richesse et la gaieté du style, l’Amphitryon doit être compté parmi les chefs-d’œuvre de notre poète, il ne s’est pas trompé.
Nous devons laisser à d’autres l’histoire des origines théâtrales très anciennes de l’Amphitryon de Plaute : Molière, sans doute, s’est fort peu inquiété de les connaître. Il ne lui importait nullement, et il ne nous importe pas davantage ici, que cette fable fût née dans l’Inde, comme l’a cru Voltaire, qui l’avait trouvée dans un livre du colonel Alexandre Dow, et s’est amusé à la déclarer « encore plus comique et plus ingénieuse » sous cette forme indienne, quand il eût mieux fait de dire qu’elle était seulement beaucoup plus indécente que la légende latine. Il ne fait rien non plus à l’affaire qu’avant Plaute, les Grecs eussent traité ce sujet, peut-être Euripide dans une Alcmène, et Sophocle dans un Amphitryon, tous deux tragiquement sans doute ; et, plus opportuns à citer, Archippe, poète très bouffon de l’ancienne comédie, Eschyle l’Alexandrin, cité par Athénée, et Rhinthon, poète de Tarente, qui écrivit des hilaro-tragédies, au temps de Ptolémée Soter : questions d’érudition auxquelles nous ne nous arrêterons pas. La priorité de ces pièces grecques, celle même d’un Amphitryon de Cécilius, chez les Latins, ne sont pas sans intérêt pour les critiques de la pièce de Plaute ; mais celui-ci a été le seul modèle de Molière ; et les modèles antérieurs, n’ayant laissé qu’un nom et quelques fragments insignifiants, n’ont pas plus compté pour lui que s’ils n’avaient jamais existé. Contentons-nous donc de remarquer, à leur sujet, que Plaute, imitateur lui-même, en a visiblement pris à son aise avec eux et qu’il a, dans bien des passages, habillé à la romaine ses personnages empruntés au théâtre grec, de même que souvent ceux de Molière ont été, sans plus de gêne, habillés par lui à la française. À cette seule condition, une pièce est transportée avec succès d’une scène étrangère sur une scène nationale. Les poètes tragiques, comme les poètes comiques du dix-septième siècle, eurent le sentiment très juste de cette loi de leur art. Ils ne travaillaient pas en archéologues, et ne songeaient pas à un calque scrupuleux.
Pourquoi Molière s’est-il, à ce moment, tourné du côté de Plaute ? Comment lui est venue l’idée d’écrire un Amphitryon ? S’il nous avait dit lui-même le secret de son choix, il nous aurait tirés de quelque peine ; car on a imaginé de cette excursion sur les terres latines une explication très malveillante, et, pour y en substituer une autre, nous ne pouvons chercher que des vraisemblances.
Lorsqu’on fait attention que son Avare, imitation aussi, quoique beaucoup plus éloignée, d’une comédie de Plaute, suivit l’Amphitryon à quelques mois de distance, on est porté à conjecturer que tout simplement il s’était pris, en ce temps-là, d’un goût très vif pour le vieux comique de Rome et qu’il s’était promis de suivre cette veine latine dans quelques ouvrages.
Mais, si facile à comprendre que soit cette pensée, qui eût été mieux qu’une fantaisie, il y a autre chose encore à supposer. Les Sosies de Rotrou, joués par la troupe du Marais, sur un théâtre rival, avaient eu un grand et juste succès. Les comédiens du Palais-Royal n’auraient-ils pas, comme ils avaient fait en 1665 pour le Festin de Pierre, sollicité de Molière une pièce qui fît concurrence ? L’ouvrage de Rotrou était, dira-t-on, bien ancien à cette date. La première représentation en remontait à plus de trente ans, ayant été donnée en 1636 ; mais il est prouvé qu’il a eu la vie dure. Après quatorze ans, en 1650, les Sosies étaient encore représentés, sous le titre de la Naissance d’Hercule, avec cette magnificence de spectacle, ce luxe de machines, qui était le grand attrait du théâtre du Marais. La description du merveilleux appareil scénique déployé en cette occasion se trouve dans un livret in-4°, publié par René Baudry, sous cette date de 1650, et intitulé : Dessein du poème de la grande pièce des machines de LA NAISSANCE D’HERCULE, dernier ouvrage de M. de Rotrou, représentée sur le théâtre du Marais par les comédiens du Roi. Là, on nomme cette pièce « le plus excellent poème qui ait jamais paru, » et « le chef-d’œuvre » de « l’incomparable M. de Rotrou. » Une pantomime qui, pendant le carnaval de 1653, fut exécutée au Petit-Bourbon dans le grand Ballet royal de la Nuit, sous le nom de Comédie muette d’Amphitryon, semble prouver que le sujet, recommandé par le succès des Sosies, n’avait pas alors cessé d’être à la mode et devait tenter toutes les troupes de comédiens.
Nous aurions voulu pouvoir constater que les représentations des Sosies, comédie si goûtée, ne s’arrêtèrent pas en 1650 ; mais ce que nous venons de dire est tout ce que nous connaissons de leur histoire, à moins que nous n’y ajoutions une anecdote de Tallemant des Réaux, qui se rapporte incontestablement à cette pièce. Malheureusement, si elle peut être citée comme plus ou moins piquante, elle n’éclaircit pas la question de la longévité des Sosies. Jodelet, nous apprend l’auteur des Historiettes, vint, au moment où le tonnerre du dénouement avait éclaté, jeter au parterre, dans la langue très crue du temps, une plaisanterie dont le sens était que, si l’on faisait si grand tapage chaque fois qu’à Paris un mari était trompé, tout le long de l’année on n’entendrait pas Dieu tonner. Tallemant n’indique pas la date de cette facétieuse allocution, et ce que nous savons de Jodelet ne nous vient pas en aide. Il avait quitté la troupe du Marais, pour passer à l’Hôtel de Bourgogne, en 1634, par conséquent avant les Sosies. Il revint ensuite à son premier théâtre, mais on ignore à quel moment. On voit seulement qu’en 1642 il y jouait le Cliton du Menteur de Corneille. Il y resta plusieurs années, puis émigra de nouveau à l’Hôtel de Bourgogne ; enfin, en 1659, au Petit-Bourbon. Quoique l’on ne suive qu’imparfaitement les vicissitudes de cette inconstante carrière théâtrale, il s’y trouve plus d’une place, avant 1650, pour l’anecdote de Tallemant ; ce n’est donc pas elle qui nous fera savoir quelles furent les dernières années où l’on joua encore la comédie de Rotrou ; mais nous ne serions pas surpris que ç’ait été à une époque assez voisine de celle de l’Amphitryon, pour que celui-ci soit né d’une pensée de rivalité entre le Palais-Royal et le Marais. La conjecture de cette émulation pourrait paraître confirmée par des vers de Robinet qui seront cités plus loin. Les décorations, les machines volantes y sont célébrées parmi les merveilles de la nouvelle comédie de Molière. Ne semblerait-il pas que l’on eût pensé à lutter avec le spectacle féerique de la Naissance d’Hercule ?
Il n’y a pas pour toutes les comédies de notre poète le même intérêt à connaître pourquoi l’esprit, qui souffle où il veut, avait tel jour soufflé d’un côté plutôt que d’un autre. Si nous avons pris quelque peine à chercher quelle occasion a pu inspirer celle-ci, c’est que d’autres, qui s’en sont inquiétés aussi, ont voulu insinuer qu’un pur caprice était invraisemblable et se sont fondés sur cette invraisemblance pour appuyer une conjecture très fâcheuse, qui ne s’est que trop accréditée. Rœderer l’a, nous le croyons, hasardée le premier ; nous n’en trouvons pas trace chez les contemporains. Il faut citer l’acte d’accusation, afin de n’en pas affaiblir les arguments. On le trouve au chapitre XXII du Mémoire pour servir à l’histoire de la société polie en France.
« Les Mémoires de Mademoiselle de Montpensier, dit Rœderer, nous apprennent… que, dans le commencement de la campagne de Flandre, au mois de mai 1667…, on s’arrêta… dans une ville dont le nom est resté en blanc, et que là s’établit la liaison intime du Roi et de Mme de Montespan…
Ce serait vers le milieu de l’année 1667 que Montespan se serait… laissé aller à la fougue de sa jalousie et aux plus violents outrages envers la duchesse de Montausier, comme complice de la séduction exercée par le Roi sur sa femme.
Il est fâcheux, ce me semble, que l’ordre chronologique amène, à la suite du premier éclat que fit l’intrigue du Roi avec Mme de Montespan et de la colère du mari, la première représentation de la comédie d’Amphitryon… Que l’auteur, après avoir dit qu’il n’avait plus besoin d’étudier son art ailleurs que dans la société, et après avoir produit plusieurs chefs-d’œuvre de cet art ainsi étudié, ait néanmoins eu la fantaisie d’imiter une comédie fort immorale de Plaute, je le veux croire. Mais qu’il n’y ait pas trouvé quelque rapport avec ce qui se passait à la cour ; qu’il n’ait pas vu, pas soupçonné que la situation du marquis de Montespan eût quelque rapport avec celle d’Amphitryon, celle de Louis XIV avec celle de Jupiter ; qu’il n’ait eu aucune intention en disant dans sa pièce :
c’est ce qu’il est difficile de croire d’un homme qui était au courant de toutes les aventures galantes de la cour, et ne négligeait, que dis-je ? ne laissait passer, sans un éclatant tribut de son zèle et de son talent, aucune occasion de divertir et de flatter le Roi, et qui enfin avait cela de particulier que, amant malheureux, mari trompé, il était poète sans pitié pour les victimes d’un désordre qui faisait son tourment. »
Ceux qui croient utile à certaines rancunes d’imprimer une flétrissure au nom de Molière ont avidement saisi l’arme qui leur était fournie par Rœderer, et n’ont eu garde de douter qu’elle ne fût de bonne qualité. Si Rœderer n’avait pas les mêmes raisons qu’eux d’en vouloir à notre poète, il avait pourtant les siennes. La comédie des Précieuses ridicules, quoiqu’il ait affecté de croire qu’elle attaquait seulement les fausses précieuses de province, et même la comédie des Femmes savantes, le blessait, comme il ne l’a guère caché, dans sa partialité pour la société polie de l’hôtel de Rambouillet. Il ne néglige aucune occasion de taxer Molière de complaisance pour la corruption de son temps, parce qu’il veut laisser moins de crédit aux railleries du poète contre des femmes dont les mœurs sévères « l’inquiétaient, dit-il, et offensaient la cour. » On doit donc se défier de ce paladin des précieuses et examiner de près les preuves de son réquisitoire.
Nous pensons que, pour les besoins de sa cause, il a antidaté la connaissance à la cour et dans le public du scandale dont, à l’en croire, Molière se serait fait le héraut et comme l’apologiste sur la scène.
Les Mémoires de Mademoiselle de Montpensier étaient assurément le document à citer comme le seul contemporain et irrécusable sur les commencements de la liaison du Roi et de Mme de Montespan. Ils placent ces commencements au temps de la campagne de 1667. Mais Rœderer a eu tort de parler du mois de mai. La Gazette de 1667 permet de dater jour par jour le récit de Mademoiselle. Quelle est la ville dont le nom, dans ce récit, « est resté en blanc, » et où l’on remarqua le premier indice de la liaison, c’est-à-dire la sentinelle déplacée pour laisser la communication libre entre l’appartement du Roi et celui de Mme de Montespan ? Elle est désignée par cette circonstance que de là on fut couché à Vervins et le lendemain à Notre-Dame-de-Liesse. Évidemment il s’agit d’Avesnes. Ce fut donc seulement entre le 9 et le 14 juin que pour la première fois on put avoir soupçon de la nouvelle intrigue. La veille même de l’arrivée à Avesnes, comme on était en carrosse, Mme de Montespan, blâmant, avec les autres dames, la pauvre la Vallière, disait : « Dieu me garde d’être maîtresse du Roi ! » Pense-t-on que ç’ait été pour afficher le lendemain le démenti donné à ces sages paroles ? Le scandale d’Avesnes ne put donc être encore celui qui éclata aux yeux de tous. Sera-ce celui de Compiègne, pendant le séjour du Roi du 9 au 19 juillet 1667 ? Celui-là sans doute put faire plus de bruit, mais seulement encore parmi les plus initiés. Il est clair que si, dans un cercle très étroit, on s’entretenait de la grande nouvelle, ce n’était qu’à voix basse, même au moment où, par une lettre charitable, la Reine en eut le premier avis, sans y croire. C’était après la prise de Lille, qui est du 27 août.
Il ne faudrait assurément point parler de beaucoup de mystère dans ces temps de la campagne de Flandre, s’il était vrai que la jalousie de M. de Montespan, comme le dit Rœderer, eût dès lors fait esclandre. Mademoiselle de Montpensier a su les extravagances du marquis, les injures dont il accabla sa femme et qui forcèrent le Roi à le faire chercher pour l’envoyer en prison ; mais elle en place certainement le temps fort peu avant celui où M. de Montausier fut nommé gouverneur du Dauphin (18 septembre 1668). Loin que M. de Montespan ait affiché son infortune aussi tôt que le dit Rœderer, on raconte qu’il fut d’abord d’un aveuglement opiniâtre, refusant d’emmener loin de la cour sa femme qui l’en priait.