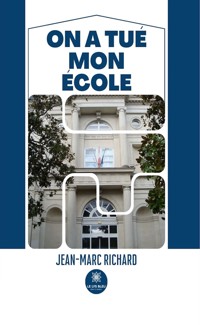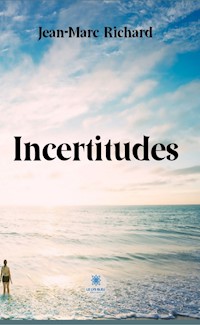Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dans un petit bourg de la France profonde, quelques personnes se rassemblent régulièrement et évoquent souvent les grands problèmes du moment. Progressivement, les choses s’organisent en forme de petite société savante qui débat sur des sujets de toute nature. Mais, peu à peu, l’étrange se manifeste, les questions se multiplient et un suspense s’installe. Cette petite équipe, qui choisit de s’appeler « L’écoute », va faire sérieusement parler d’elle.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean-Marc Richard éprouve un grand intérêt pour la lecture et principalement les livres concernant les faits de société, l’économie mondiale et la géopolitique. Savoir comment des gens simples et de bon sens regardent les immenses problèmes qui se posent aujourd’hui à l’humanité est la problématique qui l’a conduit à la rédaction de ce roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 226
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean-Marc Richard
L’écoute
Roman
© Lys Bleu Éditions – Jean-Marc Richard
ISBN : 979-10-377-4457-9
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé serait parfaitement fortuite.
Préface
Jean-Marc Richard et moi avons depuis que nous nous connaissons, depuis notre adolescence, une passion commune : vouloir refaire le monde. Les chemins que nous avons suivis dans la vie sont différents mais convergents. Comme historien et enseignant, puis chef de grands établissements d’enseignement en métropole et en Nouvelle Calédonie, après une enfance compliquée marquée par son attachement à sa terre natale – l’Algérie – Jean-Marc Richard nous offre avec ce roman un condensé de ses aspirations et de ses inquiétudes pour le monde.
Comme technocrate et planificateur, puis fonctionnaire des Nations Unies chargé de promouvoir un développement qui se veut humain et durable, j’ai servi sur plusieurs continents après avoir, tout jeune, parcouru le monde, comme fils de diplomate puis comme jeune aventurier. Nous avons tous deux jeunes milité politiquement, puis avons tous deux défendu des causes qui se voulaient justes, sans jamais nous départir de cette conviction commune : la nécessité de nous acheminer progressivement, vaille que vaille, vers une sorte de gouvernement mondial. Utopie partagée mais ô combien nécessaire à l’heure ou l’humanité s’affronte de toutes parts à des dangers mortifères et risque à tout moment de disparaître en tant qu’espèce.
Le roman que Jean-Marc Richard nous livre ici se déroule dans le « Vieux pays », un terroir qu’il connaît bien pour l’aimer et y avoir acquis une vieille maison qu’il a rénovée avec ardeur. C’est dans ce décor champêtre, situé non loin de Pau et des Pyrénées, qu’évoluent ses personnages ; des personnages de plus en plus attachants au fur et à mesure que se déroule l’action. Ce sont des citoyens simples, comme vous et moi, désireux de donner un sens à leurs interrogations sur le monde, qui se réunissent périodiquement dans une arrière-salle de café, non pour « refaire le monde » mais pour en comprendre tout, du moins la nature et l’évolution. Cette petite « société savante », comme la qualifie l’auteur, aborde ainsi successivement les questions du dérèglement climatique, de l’énergie et des ressources naturelles, celle des filtres idéologiques, celles du terrorisme et de la démocratie, sans oublier les problèmes financiers internationaux et la fiscalité au niveau mondial. À l’occasion de chaque échange, des solutions techniques sont envisagées, à l’image des réponses que nos sociétés industrielles soi-disant avancées cherchent à donner. Mais ces réponses sont aussi vite invalidées par des facteurs proprement humains : nos comportements, notre vision des choses et notre incapacité à formuler ensemble des réponses cohérentes. C’est ici notamment qu’intervient le concept si pertinent de « filtres idéologiques » : ces filtres qui nous enferment dans nos certitudes et nos modes de pensée, nous interdisant d’écouter les autres (le roman s’intitule L’écoute), de formuler ensemble des réponses judicieuses, tant au niveau individuel que collectif, tant au niveau des sociétés que des États. D’où l’idée sous-jacente d’une impossible gouvernance mondiale, seule capable de nous sortir du pétrin dans lequel s’enfonce l’humanité.
Ce roman dont l’intrigue captivante nous conduit au plein cœur d’évènements mystérieux devrait susciter chez le lecteur attentif nombre d’interrogations : Serons-nous capables en tant qu’espèce humaine de formuler les réponses à même de surmonter les catastrophes qui se dessinent à l’horizon ? Serons-nous capables d’écouter les autres et de concevoir ensemble des projets et des mesures susceptibles de prévenir les désastres que nous avons nous-mêmes engendrés ? Serons-nous en mesure, en tant qu’États et nations de mettre en œuvre des solutions communes, seules capables de résoudre les problèmes communs qu’affronte l’humanité ? Ou devrons-nous attendre que d’hypothétiques extra-terrestres, soucieux de réparer ou de prévenir les dégâts que l’humain inflige à l’univers, le fassent à notre place ? Telle est la question fondamentale sur laquelle débouche ce roman.
Ariel Français,
Ancien représentant des Nations Unies et essayiste
Le vieux pays
Sérignacq est un chef-lieu de canton posé sur le sommet presque plat d’une colline au nord du Béarn.
Ce n’est pas une bastide : le bourg s’ouvre de toutes parts vers des terres agricoles où dominent des vignes de bonne renommée et un maïs quelque peu envahissant.
Pourtant, à l’image des bastides, il dispose, sur la place centrale, de l’inévitable halle abritant quelques étals du marché hebdomadaire qui, lui, occupe totalement l’esplanade.
Autour, les commerces permanents se font rares et les friches commerciales ne trouvent plus preneurs.
De manière étonnante, l’église est assez déportée par rapport au centre du bourg.
Bâtie sur la partie sensiblement la plus élevée de l’agglomération, son clocher devait avoir jadis pour office de guider le voyageur impatient ou le paisible pèlerin.
Dans un passé récent, c’était une petite ville très active, capitale de cette portion de territoire que l’on avait pris pour habitude de dénommer « Le Vieux Pays ».
Signe imparable d’activité et de prospérité, au milieu du siècle dernier, on y comptait presque trente bistrots à disposition des quelque cinq mille habitants du canton. Mais l’exil rural est passé par là et la démographie, à l’inverse de l’âge moyen des électeurs, a fortement chuté.
Il ne reste plus que trois débits de boissons, un restaurant, une petite pizzeria, une boulangerie, une librairie, un bureau de tabac, et quelques activités tertiaires ou artisanales comme assurances, garagistes et coiffeurs, ainsi que l’inévitable commerce destiné principalement aux agriculteurs et dénommé jadis « Maison du paysan ».
Bien évidemment, l’indispensable pharmacie voyait sa prospérité s’élever avec l’âge de la population cantonale.
Là comme ailleurs, le déclin des petits commerces s’est accompagné de l’implantation d’un vaste libre-service polyvalent, consacré essentiellement à l’alimentation, mais devenu assez vite une sorte de « magasin général » après les fermetures successives des petites boutiques.
C’est un endroit où, en général, on ne ménage guère sa peine, où la plupart des artisans fonctionnent « à l’ancienne », ce qui veut dire avec grande conscience professionnelle, tarifs très abordables et délais aléatoires. C’est un lieu où la vie écarte toute trépidation inutile puisque la nature, chaque saison, vient vous donner la part d’elle-même que vous attendez mais qui vous surprend toujours.
C’est là une aire de l’espace moderne où le bon sens est roi.
On y trouve aussi quelques renaissances sous forme de petits îlots de repeuplement : gens de la ville en recyclage rural, Britanniques ou Bataves en transfert méridional, enfants du pays jadis aspirés par le tourbillon des capitales et venus reprendre souffle, avant le terme de leur vie, dans les collines paisibles de leur jeunesse.
Benoit ne rentrait dans aucune de ces catégories de migrants. Il était né là, dans une maison proche du presbytère, voilà plus de soixante ans. Il avait connu ici l’école et le collège, le lycée à Pau, ses études de médecine à Bordeaux et, retour aux sources, il avait installé son cabinet au rez-de-chaussée d’une petite bâtisse qui donne sur la Grand-Place.
Il se souvient de la fierté un peu juvénile avec laquelle il avait observé le maçon Jean-Claude, l’un de ses camarades de classe, installer la plaque du cabinet à droite de la porte : « Docteur Benoit Hourcade, diplômé de la faculté de Bordeaux, ancien chef de clinique ».
Puis, pendant plus de quarante ans, il avait connu à peu près toutes les familles, parcouru la plupart des routes et des chemins du canton, voire au-delà.
Il avait connu la médecine à l’ancienne, avec des réveils intempestifs à des heures impossibles, des colères d’ivrognes, des accouchements tragiques, mais aussi des regards de gratitude qui vous payaient de toutes les peines.
C’est la même plaque qu’il a dévissée lui-même, lors de son départ, voilà bientôt six ans.
Le cuivre, grâce aux efforts de Juliette lorsqu’elle faisait son ménage, avait conservé son éclat, mais la gravure, usée par le temps, avait quelque peu perdu de sa lisibilité.
Lorsqu’il revenait vers ces moments de sa vie, il s’apercevait douloureusement qu’il avait embauché Juliette quand Bernadette l’avait quitté.
Cela signifiait de manière assez claire que sa femme représentait dans son esprit une part de domesticité.
Il en voulait à son épouse pour beaucoup de choses (surtout l’abandon), mais là, c’est à lui qu’il s’en prenait.
Bernadette avait donc rejoint ses racines bordelaises. Cette fille de la grande ville ne pouvait demeurer indéfiniment au « Vieux Pays ».
Les enthousiasmes de la jeunesse furent ainsi dilués dans une interminable routine.
Aujourd’hui, il s’était replié à quelques kilomètres du bourg, dans une ancienne ferme dénommée « Les Garennes » dont l’architecture traditionnelle et vieillissante ne pouvait laisser deviner le confort intérieur.
Il vivait là avec Pompon son chien, épagneul plus léchant que méchant.
C’est toujours Juliette qui, trois fois par semaine, entretenait le logis.
La solitude choisie était mesurée.
C’est pour cela que, chaque mardi, à la tombée du jour, l’hiver, et même lorsque la chaleur pesait parfois encore l’été, il retrouvait quelques amis dans l’un des cafés qui demeuraient.
D’une manière évidente, ils avaient choisi celui qui disposait d’une arrière-salle épargnée par les jurons des beloteurs et des parieurs, ainsi que par le commentaire précipité du journaliste hippique que la télévision transmettait en continu.
Ce n’était pas un endroit vraiment calme, mais les sons y étaient atténués, et l’on pouvait échanger en ménageant ses cordes vocales et ne pas trop constater l’insuffisance de sa propre audition.
Ce lieu disposait de ses habitués. Au début, ils étaient seuls, ou par deux.
Peu à peu, les conversations s’engageaient entre tables. Ces propos, mélanges de banalités ponctuées de bon sens ou remarques inspirées par une culture inattendue en ce lieu, tissaient lentement des liens entre ces personnes d’origines diverses dont la curiosité et la sociabilité trouvaient là une dimension du « Vieux pays » qui leur convenait.
Finalement, on finit par rassembler les chaises autour d’une large table centrale constituée des plus petites regroupées.
Cinq à huit consommateurs s’y retrouvaient régulièrement.
Par la suite, toute personne seule ou non, qui franchissait le seuil, considérant sans doute qu’il s’agissait là d’un regroupement privé, rebroussait chemin pour retourner dans le tourment sonore de la salle principale : les habitués s’étaient ainsi constitué un territoire.
Le niveau de leurs consommations étant commercialement satisfaisant, Germaine, la patronne des lieux, leur avait accordé un jour le privilège de cette privatisation une fois par semaine.
Dès lors, un rite s’était établi.
***
Cette désorganisation conviviale spontanée se mua progressivement vers un soupçon d’ordre.
Pourtant, introduire une forme de logique et d’organisation dans ce groupe incertain regroupant davantage les solitudes que les convictions semblait impossible.
Ce petit rassemblement s’étant à l’évidence constitué autour d’un dénominateur commun banal : le désir de sortir d’un quotidien trop solitaire ou lassant, la suite de cette affaire aurait dû normalement demeurer dans cette banalité.
Nous verrons que ce ne fut pas le cas.
Seule la plus jeune personne du groupe semblait échapper à la pesante routine du quotidien local : elle était étudiante.
Pour les autres, aucune similitude ne semblait émerger, ni des personnes ni de leurs passés, encore moins de leurs compétences supposées et absolument pas de leurs vies antécédentes.
Outre Benoit, on pouvait trouver en effet de manière assez régulière :
Raymond, le libraire, la quarantaine joyeuse, de gauche, bouffeur de curés et féministe convaincu autant que misogyne. Sa fonction de commerçant lui imposait l’amabilité lorsqu’il jouait l’homme-tronc derrière son comptoir, mais, une fois sorti de sa cage professionnelle, il ne mâchait pas ses mots. Il possédait (ou le croyait) des idées arrêtées de manière définitive.
Il y avait aussi Jacqueline, la femme du boulanger, frustrée d’avoir vu ses études interrompues par une grossesse non désirée, qui, volontairement, s’appliquait un rythme quotidien totalement décalé par rapport à celui de son époux : ils vivaient leurs divergences à distance rapprochée. La mort accidentelle de leur fils, à l’âge de dix-huit ans, avait distendu leurs liens à jamais, Jacqueline n’avait jamais pu pardonner à son mari l’achat de cette moto finalement mortelle.
Quant à Simon, le prêtre de la paroisse, originaire du Gabon et soucieux de s’intégrer dans ce petit morceau de France qui, désormais, devenait son royaume pastoral, il se glissait dans ce petit monde par toutes les voies possibles que pouvait lui offrir le Seigneur.
Ce petit groupe de l’arrière-salle pouvait en être une.
Pour Aurélie, venue de Paris quelques années plus tôt, les choses s’avéraient moins évidentes.
D’un indéniable niveau culturel, visiblement issue d’un milieu qui fréquentait ce qu’il est convenu de nommer « la haute bourgeoisie » elle demeurait toujours muette sur l’histoire qui avait pu l’amener ici. Sur le plateau du Sud, elle possédait un gîte rural haut de gamme, loué en toutes saisons, ce qui lui imposait d’employer une deux personnes selon les périodes.
Il y avait aussi Robert, personnage un peu lunaire, installé depuis presque deux ans dans une maison bourgeoise, au centre d’un petit parc, près de l’église. On savait qu’il avait été dans l’informatique et, à ce titre, rendait d’amicaux services aux cinquantenaires et plus, qui s’accrochaient aux nouvelles technologies. Muni de deux ou trois clés USB, il allait chez les uns ou les autres pour nettoyer leur ordinateur ou constater leur défaillance définitive.
Lorsque certains désiraient le dédommager, sa réponse procédait d’une extrême simplicité : « je sais que j’ôte du travail à ceux qui en vivent, mais il m’est impossible de faire payer des amis ».
Il était devenu ainsi l’homme discret, toujours disponible et efficace d’une petite communauté qui voyait en lui un vieux garçon venu combattre un peu sa solitude auprès de personnes avec lesquelles il se sentait bien.
Pour Joseph, artisan menuisier autodidacte, célibataire au milieu d’une énorme bibliothèque, le terme qui pouvait peut-être mieux le définir ressemblait à quelque chose comme « authentique béarnais ».
Il grasseyait et son langage semblait remuer des galets du gave : cela roulait, cela cascadait, cela claquait.
On disait que, animé tardivement par l’envie de savoir, il avait progressivement acquis une invraisemblable quantité de livres.
Le hasard faisant parfois converger des mondes que certains jugeraient à tort divergents, les neurones et l’habileté manuelle du menuisier trouvèrent leur pleine expression dans des rayonnages qui, selon certains témoins, atteignaient la centaine de mètres.
Il avait même pris soin de construire pour cela, de ses propres mains, une annexe à son habitation principale, au cœur du bourg.
Les citoyens informés désignaient le bâtiment aux gens de passage en le désignant comme « La bibliothèque de Joseph »
Fugace personnage de ce petit monde perdu, Corinne, étudiante en sociologie et fierté de son père, viticulteur dans la vallée du sud.
Elle venait parfois distraire de ses provocations, le fil un peu monotone des discours habituels.
Son assiduité toute relative ne choquait personne car elle terminait ses études et envisageait de se lancer dans la rédaction d’une thèse.
Benoit ne pouvait s’empêcher de penser qu’elle avait trouvé là un petit laboratoire pour ses recherches.
C’est en effet peut-être la routine des centres d’intérêt qui rassurait les participants.
Point de surprise : on parlait de soi et de sa vie avec la pudeur minimum qu’imposait un nouveau compagnonnage et surtout, c’était les grands problèmes du monde : le climat, les multinationales informatiques, le surarmement, les guerres locales, l’islamisme, la domination du capital, quelle issue pour l’humanité ? etc.
Bref entre le soi avec retenue et le grand tout dans le désordre, comment caler les sujets intermédiaires ?
Comme il n’avait pas toujours été possible de bien régler les difficultés de sa propre vie, s’enfoncer au cœur de vastes problèmes qui vous dominaient pouvait presque vous enivrer et vous procurer quelque fugace sentiment de puissance.
En fait, on venait là pour apaiser sa solitude, pour mieux palper sa propre existence grâce aux regards et aux mots que les autres vous adressaient.
Benoit finit par avoir pleinement conscience de cela. Il devina d’un coup combien chaque être, ici comme ailleurs, ne pouvait être lui-même qu’avec un lien et des échanges, même conflictuels, avec le monde alentour.
Les mois précédents, les restrictions liées à la pandémie avaient démontré cela de manière trop claire.
C’est ainsi qu’un soir de l’hiver, alors que chacun semblait avoir hâte de retrouver sa solitude, il déclara doucement :
— Nous commençons tous à bien nous connaître. Nos rencontres sont sympathiques, et je dirais même souvent réconfortantes. Pourquoi n’en profiterions-nous pas afin de nous enrichir l’esprit mutuellement au lieu de faire tout cela dans un désordre et parfois une confusion qui n’aide guère à éclaircir les choses et à nous enrichir véritablement ? Nous pourrions par exemple prévoir un thème de réflexion pour chaque réunion, une personne parmi nous pourrait choisir de faire l’exposé initial et ensuite, nous pourrions débattre et voir dans quelle mesure, de simples citoyens sont capables de se mettre d’accord. Cela pourrait être instructif car, si notre très, très petit monde est incapable d’aboutir à un consensus, cela laisse peu d’espoir pour le grand monde réel.
Cette idée lui avait été un peu soufflée par Robert, l’informaticien, dont la rigueur d’esprit semblait mal s’accommoder du désordre des propos tandis qu’il appréciait cependant cette convivialité hebdomadaire.
Aurélie rajouta :
— Et puis nous pourrions peut-être échapper à quelques heures d’informations télévisées qui tournent en boucle avec des choix éditoriaux souvent plus racoleurs que formateurs.
Un murmure d’approbation salua cet avis tranché.
Raymond demanda la parole :
— Puis-je proposer une formule un peu moins traditionnelle que l’exposé oral puis questions-réponse ?
— À quoi pensez-vous ? interrogea Aurélie.
— Faire un peu comme des groupes d’étudiants en fac lorsqu’ils se partagent la bibliographie d’un programme : chacun prend un ouvrage, fait une fiche de lecture pour chacun des autres et ensuite répond aux questions qui lui sont posées après lecture du document par tous.
Quelques secondes de réflexions plus tard, Céline reprit la proposition :
— Oui, c’est une bonne idée, car tout le monde travaille et cherche et nous disposons d’un document écrit de référence. En plus de cela, les contradictions possibles ont le temps de mûrir !
Assise sur sa chaise en peu en retrait de la table, Jacqueline dodelina négativement de la tête.
Un silence général finit par l’entourer. Elle était la seule encore assise car chacun s’apprêtait à quitter les lieux.
Le regard un peu perdu dans le vide, elle semblait accablée de quelque souci lointain qui la ressaisissait d’un coup. Quelque chose du passé l’habitait.
Benoit interrogea :
— Vous n’êtes pas d’accord, madame Denoyer ?
Quelques secondes, et elle répondit :
— Vous savez, les formules classiques, tout le monde connaît. Pourquoi ne pas mettre un peu d’humain, de quotidien, de personnel ? Nous sommes un petit groupe, faisons des lettres aux amis, c’est bien plus romantique et plus intime. C’est quelqu’un qui s’épancherait auprès de ses amis autant de ses découvertes que de ses angoisses ou de ses interrogations, voire de ses convictions. Cela donnerait une forme d’intimité et de complicité qui n’aurait rien à voir avec les formes académiques habituelles.
L’assemblée demeura un moment perplexe.
— Vu de cette manière, je suis d’accord
Aurélie approuva, suivie immédiatement par Joseph.
Les autres se turent.
Ainsi, la formule fut donc adoptée dans une ambiance de démocratie implicite.
Personne n’avait voté, mais l’adhésion de tous ne semblait poser aucun problème.
On décida, par la même occasion, que l’auteur de la « lettre » devait remettre son document écrit à tous les membres au plus tard le vendredi soir qui précédait la séance du mardi. On bénéficiait ainsi du week-end pour éplucher le thème.
Ainsi fut fait. Les choses prirent bonne tournure et cette petite troupe disparate allait prendre l’habitude de préparer ses échanges, de débattre, de s’enrichir des compétences des autres et surtout de trouver des accords apaisés, ce qui ne fut pas toujours le plus facile, comme la simple mise en place de cette infime organisation pourra le démontrer.
Nous retiendrons ici, seulement quelques-unes de ces modestes rencontres qui marquèrent les esprits et conduisirent à une issue assez extraordinaire dont on se souvient encore bien au-delà du Vieux Pays.
ƐΞΘΠΨϢϪ
(Épilogue anticipé)
L’Omni Chams, d’un coup de bec, attrapa le morceau de verdure qui enveloppait le fruit.
En attendant les missionnaires, il conversait avec l’un de ses adjoints, le Sous-Omni Ircour.
— Vois-tu, Ircour, la tâche qui m’incombe devient pesante.
Je pense même qu’elle devient inutile. Souviens-toi, il y a près de trois mille révolutions autour de notre astre, nos ancêtres avaient compté plus de vingt mille sociétés « pensantes » dans notre galaxie.
C’est assez insignifiant pour plus de cent milliards de systèmes planétaires, mais c’était un espoir.
Il n’en resterait plus que quelques centaines.
Tout cela semble maintenant s’affaisser dans les décombres accumulés de ce que l’on appelle peut-être sans véritable raison l’intelligence ou la pensée.
Il apparaît que la nature, tant qu’elle ne se connaît pas elle-même, se contente de survivre. Mais dès qu’elle prend conscience de son existence par l’émergence de la pensée, on a l’impression que, presque partout, le mécanisme de l’autodestruction se met en marche.
Nous avons vécu cela nous-mêmes et voici où nous en sommes : après avoir frôlé la disparition par les armes, nous n’avons plus qu’une planète à peine vivable.
Je comprends très bien que notre histoire tragique ait incité nos sages à vouloir éviter le même sort, voire pire, aux civilisations qui demeurent, mais vois-tu, après tant d’expériences aux quatre coins de la galaxie et tant d’échecs, je me demande si la pensée ne porte pas en elle sa propre mort.
Le phénomène est-il identique dans ces autres galaxies qui nous sont inaccessibles ?
L’Omni se tut un moment. Son ton découragé incita Ircour à faire part d’une expérience qui tombait ce jour à point.
— Il y a peu, environ douze révolutions je suis allé sur la planète où doivent se rendre les missionnaires que nous attendons. Ses habitants l’appellent « Terre ».
Vit là-bas une espèce particulièrement douée pour forger son propre malheur. Une petite description, suivie d’une anecdote suffiront :
Cette planète est l’une les plus bénies de la galaxie. Elle ne connaît pas les dures contraintes de la nôtre. L’espèce n’est pas obligée de vivre sous terre afin d’éviter les rayons mortels de son étoile, le ciel est dégagé de toute fumée toxique et seuls des amas d’humidités dénommés nuages, rarement vraiment menaçants, passent au-dessus de vous.
Mais les habitants sont cependant plutôt insatisfaits.
La planète est divisée en « pays » (il y en aurait plus de deux cents) qui sont autant de sujets de querelle. Les habitants de chacun n’aiment guère ceux des autres tout en étant généralement peu contents de leur propre sort et de leurs dirigeants.
Une histoire légendaire concernant l’un de ces pays illustre assez bien la mentalité générale.
C’est une contrée qui porte le nom de France.
On raconte que Dieu (Celui que nous appelons l’Unique), créant le monde, avait pris soin de donner à ce pays un peu trop d’avantages : une mer chaude, un océan poissonneux, des plaines fertiles, des montagnes magnifiques, un climat idéal, et bien d’autres choses encore. L’assistant de Dieu, nommé Gabriel dit alors à son maître « Seigneur, vous ne croyez pas que vous en faites un peu trop pour ce pays ? »
Dieu aurait alors dit : « Tu as raison Gabriel, je vais y mettre les Français ». Ces derniers, réputés râleurs, querelleurs et jamais contents, ne pourraient ainsi jamais apprécier leurs avantages.
Ircour conclut :
— Eh bien, cette histoire pourrait s’appliquer à l’ensemble de l’espèce pensante de cette planète. Un monde merveilleux habité par des êtres capables du pire et du meilleur mais incapables d’être conscients de ce dont ils bénéficient.
— Je t’en prie Ircour, ne va pas décourager nos missionnaires en racontant cela.
— Je m’en garderais bien, Omni !
Justement, les missionnaires arrivaient.
Ils saluèrent respectueusement l’Omni Chams qui, ainsi que le veut la tradition, avança vers eux de son membre antérieur gauche, le premier plat des mets consacrés.
Chams attendait que les missionnaires aient terminé la première consommation rituelle avant de prendre la parole.
— Fidèles missionnaires de la Sauvegarde, vous allez accomplir une nouvelle action salutaire. Votre dernière intervention sur la planète Usus a été un plein succès et je ne doute pas qu’il en sera de même sur la planète (Chams dût lire sur la table-écran pour retrouver le nom) Terre, ainsi que la nomme son espèce.
Voici le Sous-Omni Ircour qui connaît la planète de votre destination et va vous en dire quelques mots, mais l’essentiel vous sera communiqué pendant votre voyage. Je lui donne la parole.
Avant d’intervenir, Ircour plongea son bec dans le liquide d’une large coupelle commune et but.
Il redressa la tête et parla d’une voix dont les tonalités indiquaient un grand âge.
— Bien entendu, je vous souhaite le même succès que sur Usus, mais il est de mon devoir de vous prévenir que cette mission sera pour vous sans doute plus difficile tant j’ai trouvé là-bas une espèce particulièrement douée pour forger son propre malheur.
C’est une espèce capable de choses merveilleuses ainsi que d’atrocités inimaginables. Si l’on parvient à encourager les côtés positifs, qui sont nombreux, il doit être possible de parvenir à contenir et peut-être à faire reculer le désordre et la haine qui règnent dans beaucoup d’esprits.
Ils ont une confiance démesurée dans leurs capacités scientifiques, mais aucune sagesse pour les dominer. Certains pourront exterminer des populations entières, tandis que d’autres seront prêts à mourir pour défendre les plus faibles. C’est un monde fait de contradictions permanentes. C’est peut-être par-là que vous parviendrez à atteindre vos objectifs.
— Merci Sous-Omni.
L’Omni Chams en revint aux aspects pratiques.
— Bon, nous vous avons préparé la mission et vous aurez pendant le trajet, qui, par les sauts d’espaces, ne durera que quelques-unes de nos journées, toutes les informations nécessaires pendant votre léthargie, par info-intrusion.
Brunr, vous serez de sexe masculin et vous Somp, de sexe féminin puisque, là-bas, l’espèce est sexuée et non hermaphrodite comme la nôtre.
Les derniers mets consacrés terminés, les deux missionnaires regagnèrent l’antichambre pour reprendre leur revêtement et sortir de l’anfractuosité.
Couverts de leur revêtement-carapace pour se protéger des rayons mortels de l’astre, les deux êtres, sortes de tortues dorées ou de scarabées géants, regagnèrent le vaisseau qui les attendait là pour rejoindre l’autre extrémité de la Voie lactée.