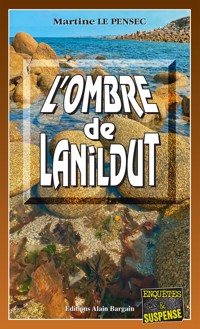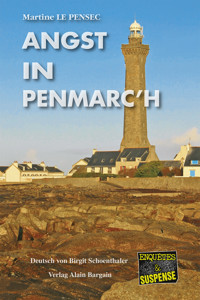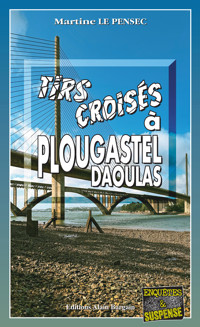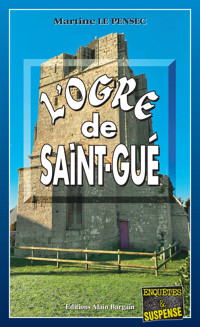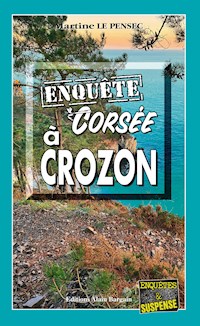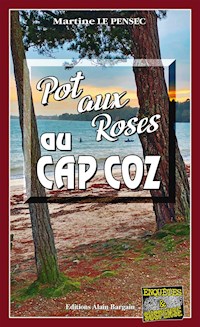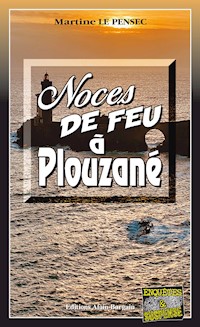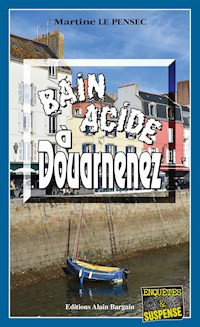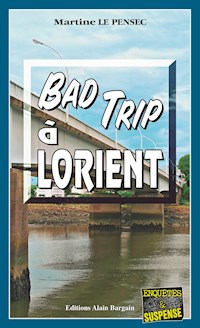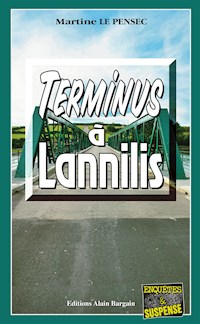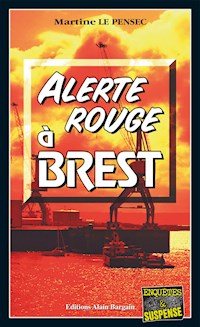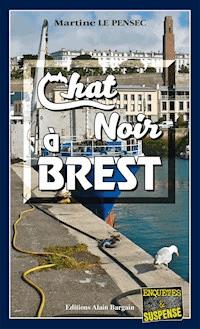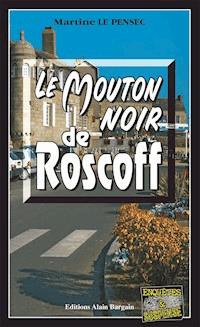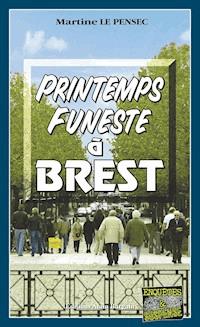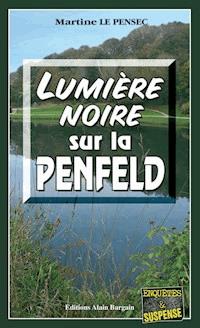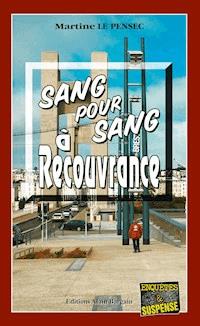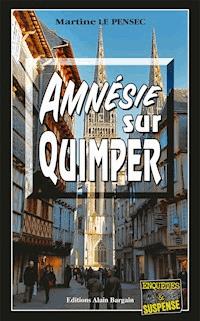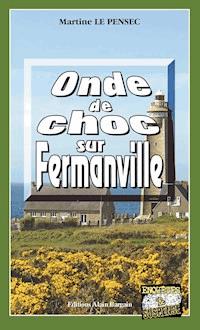Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Léa Mattei, gendarme et détective
- Sprache: Französisch
Que feriez-vous si un mourant vous suppliait du regard ? Accéderiez-vous à sa demande même au péril de votre vie ?
Cette question, Léonie Kerenflec'h, modeste fleuriste quadragénaire de Plogoff, ne se l'était jamais posée. Pourtant un braquage en plein Paris va la précipiter dans une quête insolite à la recherche d'un secret vieux de plus de 450 ans. Revenue à Plogoff, son meilleur ami, un jeune écrivain franco-américain, va l'aider à débrouiller les fils de cette histoire où l'astrologie tient la vedette. Ce sont les éphémérides qui lui permettront de remonter jusqu'à Vera et la seconder dans sa mission écrite au cœur du XVIe siècle. Mais ils ne sont pas les seuls à courir après cette énigme et devront faire preuve de courage et détermination face à des personnages que l'appât du gain et du pouvoir animent.
Une course contre la montre s'engage car le sésame qu'ils recherchent doit être remis en temps voulu entre les mains de celui à qui il revient. Une curieuse enquête pour le tandem de gendarmes Guillerm et Bernier qui s'emploieront à remonter le fil des événements…
Enquête policière et quête ancestrale se mêlent dans ce 2e tome de Léa Mattei, gendarme et détective. Un thriller captivant !
EXTRAIT
Une cliente avait terminé ses opérations et quittait le guichet. Loïc Troël allait prendre sa place quand un brouhaha se fit entendre. Le sang de Léonie se glaça dans ses veines. Un homme cagoulé avait profité de la sortie de la cliente pour forcer le passage et pointait une arme à feu sur eux.
— À terre ! cracha-t-il.
Des cris fusèrent dans l’agence, suivis d’un silence de mort.
Léonie regarda autour d’elle et reçut un coup de crosse dans le flanc qui l’obligea à s’exécuter. Les deux guichetiers, blêmes, ne pipaient mot. Le braqueur fit un signe du bras et, ce faisant, dévoila un étrange tatouage sur son avant-bras. Rouge. Léonie n’eut pas le temps d’identifier ce qu’il représentait. L’homme qui la précédait dans la file avait suivi son regard et Léonie le vit pâlir à son tour. Le braqueur réclama la caisse sans les perdre de vue. Pendant que le guichetier rassemblait les espèces, il se rapprocha encore d’eux. Elle vit que son voisin la regardait d’un air épouvanté, tandis que sa main s’égarait dans ses vêtements. Elle perçut dans un souffle :
—Je vous en supplie, articula-t-il silencieusement.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
Editions Bargain, le succès du polar breton. – Ouest France
À PROPOS DE L’AUTEUR
Née à Cherbourg, Martine Le Pensec vit à Toulon où elle travaille dans le secteur public. Mère de quatre filles, d'origine bretonne et normande, elle puise son inspiration dans l'Ouest et le domaine médical où elle a travaillé plusieurs années. Elle signe, avec L'Enfer de Plogoff, son huitième roman aux Editions Alain Bargain.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." - Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« Je ne suis gentille qu’avec les âmes meurtries. »Jusqu’à ce que la mort nous unisse - Karine GiebelÉditions Fleuve noir
« Never complain and never explain. »(Ne jamais se plaindre et ne jamais se justifier)Benjamin Disraéli(Morley Life of William Ewart Gladstone)
I
Propriano
Elle monta lestement l’escalier qui menait à l’église, observant au passage les cinq ou six chats qui squattaient le jardin de gauche, à mi-pente. « Une portée de l’année », songea-t-elle. Trois noirs et blancs identiques détalèrent, chacun dans un coin du terrain, tandis qu’une chatte tricolore, une “isabelle”, la détaillait craintivement. Un roux et blanc, plus hardi, campait sur l’escalier, sans bouger. Les chats de Propriano. De ceux qui hantent les tombeaux bâtis que l’on trouve dans le sud de la Corse. Ici, la route principale traverse le cimetière marin. Les mausolées rivalisent de taille et, au détour de ces bâtisses d’éternité, il n’est pas rare d’apercevoir un de ces chats efflanqués. En franchissant l’escalier de granit, elle perçut les intonations mêlées des touristes qui arpentaient le quai Napoléon. Accents criards des Italiens et gutturaux des Allemands qui formaient l’essentiel des estivants. Au loin, les notes mélodieuses d’une chanson corse, interprétée par Éric Mattei, lui parvenaient par intermittence. Le libecciu avait soufflé toute la nuit et toute la journée, rafraîchissant de quelques degrés l’atmosphère estivale et formant des creux de deux mètres en mer. Le bruit des rouleaux se brisant à intervalles réguliers sur la plage de Mandricu lui emplissait les oreilles. Un des chats, sorti de son territoire, s’enhardit à frôler sa jambe. Vera se pencha légèrement et caressa, du bout des doigts, le dos tendu de l’animal qui s’échappa d’un bond. Du parvis de l’église, elle dominait Propriano et soupira en caressant furtivement son pendentif en forme de lion, gravé de son prénom. Vera : la foi, en russe. Il lui en fallait en ce moment. La nostalgie d’une autre région la saisit brutalement, faisant monter des larmes à ses yeux. Une bouffée de regrets. Pourtant, la Corse était aussi son pays…
Un gros soupir gonfla sa poitrine. Si seulement maman n’avait pas eu cet accident… Un voile de tristesse tomba sur elle à l’évocation de l’ombre qu’était devenue sa mère. Elle, si pétillante et si vivante, ne vivait plus qu’accrochée aux multiples post-it qui guidaient sa journée. Mémoire morte, avait conclu le médecin qui s’était occupé d’elle. Rupture d’anévrisme dont elle avait réchappé par miracle. L’avertisseur de sa voiture s’était coincé, alertant les riverains qui l’avaient trouvée inanimée, encastrée dans un mur de clôture. Marie avait été évacuée rapidement sur l’hôpital. La rupture d’anévrisme avait-elle été la cause de son accident ou le contraire ? La question était demeurée sans réponse, car Marie était désormais bien incapable d’en donner une. En tous les cas, la vie de Vera avait changé radicalement depuis cet instant. Six mois déjà. Marie était devenue incapable de s’occuper d’elle-même et, à plus forte raison, de sa fille. Dès qu’elle avait été en état de voyager, Mamie avait fait le déplacement sur le continent pour la ramener. « Qui d’autre que sa mère peut s’occuper d’elle ? », avait-elle dit.
C’était la première fois que Vera prenait le ferry. L’énorme paquebot jaune de Corsica Ferries l’avait impressionnée. Le monstre ouvert par l’arrière avait avalé, en quarante minutes, les centaines de voitures et camions qui attendaient, sur cinq files, de pouvoir embarquer dans le port de Toulon. L’antique voiture de Mamie avait pris place à l’intérieur dans le bruit assourdissant des énormes machines. Huit heures de traversée agitée pour rallier Ajaccio et soixante-dix kilomètres, qui en valaient deux cents, tant la route était tortueuse, pour rentrer à Propriano. C’était là que mamie habitait, là où Marie avait grandi. Vera n’était venue que trois fois et elle avait oublié à quoi ressemblait la Corse. Sauf l’odeur qu’elle avait reconnue immédiatement, mélange de myrte et de figuier. Maman avait paru heureuse en revoyant le jardin, même si sa mémoire était éteinte. Depuis, elles vivaient au rythme de ses oublis, la surveillant comme une enfant qu’elle était redevenue. Vera souffrait de lire l’absence dans son regard. Chaque jour, elle devait lui rappeler qu’elle était sa fille. Une souffrance renouvelée pour elle qui avait vécu en osmose avec sa mère jusqu’à cet accident.
Et puis, il y avait Mamie. Serena Paoli. Une nature taillée dans le granit corse. Un petit bout de femme aux nattes blanches et au regard perçant. Sitôt de retour, elle avait troqué ses vêtements de ville pour la tenue qu’elle portait au quotidien pour faire son jardin et ses courses. Une nature, Mamie Serena ! Peu bavarde, mais chaque mot portait. Le silence est une religion en Corse et Vera l’apprenait chaque jour un peu plus.
Elle aidait sa grand-mère à entretenir le potager situé dans le vieux Propriano, au bas de l’escalier menant à l’église. Elle aimait les odeurs de plantes aromatiques et les tomates gorgées de soleil. Les poivrons et les aubergines y poussaient aussi au milieu d’un fouillis d’herbes folles. C’est que Mamie n’était plus toute jeune… Elle avait eu soixante-dix ans au printemps.
— Vera, Vera, rentre, il est l’heure !
L’appel de Mamie monta jusqu’à elle, avec son accent corse bien particulier. Un ton légèrement traînant qui lui faisait avaler la fin des mots et poser l’accent tonique sur l’avant-dernière syllabe.
— J’arrive, Mamie ! répondit-elle en dégringolant l’escalier.
II
Paris
Pressée, Léonie Kerenflec’h marchait d’un bon pas dans le quinzième arrondissement de Paris. Avec un peu de chance, elle arriverait avant la fermeture de la banque. Elle regarda nerveusement sa montre. Allons, elle avait encore quinze minutes devant elle ! Elle se détendit un peu et huma l’air parisien. Cela faisait deux jours qu’elle était ici pour un concours floral. Non pas un, LE concours floral de l’année, l’Amsterdam Cup, organisé par les plus grands semenciers hollandais. Trois épreuves en trois jours, dotés de dix mille euros de prix pour le vainqueur et une coupe en vermeil et cinq mille euros pour le deuxième. Léonie avait été primée plusieurs fois, dans d’autres concours, et celui-ci lui tenait à cœur, autant pour son prestige que pour la somme allouée. Gagner ce concours lui permettrait de rénover son magasin de fleurs, “Violettes Impériales”, situé en Bretagne, à Plogoff, le village du bout de la terre, à une encablure de la Pointe du Raz. Au détour de la rue, elle vit l’agence bancaire et pressa le pas. Soulagée d’être parvenue à temps elle passa avec succès le tourniquet qui sécurisait l’accès. Une personne à la fois. Deux guichets étaient ouverts et occupés. Un homme attendait devant elle et une femme rentra sur ses talons. Les opérations des clients s’éternisaient et Léonie consulta sa montre avec un peu d’impatience. L’homme qui la précédait se retourna et elle sentit son regard la détailler. « Belle prestance », songea-t-elle. Elle entrevit dans son encolure un triskèle en pendentif. Un Breton. La cinquantaine, grand et bien bâti. Des cheveux poivre et sel qui surmontaient un regard magnétique d’un bleu très clair. Maladroite, elle fit tomber son sac qui se répandit sur le sol avec un bruit de ferraille, engendrant le regard réprobateur de la plus proche guichetière. Confuse, Léonie se pencha pour ramasser son contenu, mais l’homme l’avait précédée et lui rendit son trousseau de clefs qui avait glissé loin d’elle. Un sourire éclaira son visage lorsqu’il fit jouer les clefs entre ses doigts et remarqua le triskèle qui ornait le porte-clefs.
— Vous aussi ? dit-il en pointant le doigt vers son propre pendentif.
Léonie acquiesça tout en refermant son sac à main.
— Où qu’on aille, on trouve toujours des Bretons ! Et particulièrement à Paris ! Sans être indiscret, puis-je vous demander de quelle région de Bretagne vous venez ?
— Plogoff ! Enfin, je ne sais pas si vous connaissez ? Le bout de la terre, la Pointe du Raz !
— Si, je connais, s’esclaffa-t-il, je suis originaire de Douarnenez ! Il y a longtemps que vous êtes à Paris ?
— Juste de passage, jusqu’à demain. Je suis fleuriste à Plogoff et je suis montée à Paris pour l’Amsterdam Cup, un concours floral.
— Ah, les fleurs… quel joli domaine ! Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté, Loïc Troël, dit-il en lui tendant la main. Hélas, je travaille ici et je n’ai pas la chance de retourner en Bretagne aussi rapidement que vous !
— Léonie Kerenflec’h, répondit-elle en serrant la main tendue. Mais on m’appelle Léo !
Une cliente avait terminé ses opérations et quittait le guichet. Loïc Troël allait prendre sa place quand un brouhaha se fit entendre. Le sang de Léonie se glaça dans ses veines. Un homme cagoulé avait profité de la sortie de la cliente pour forcer le passage et pointait une arme à feu sur eux.
— À terre ! cracha-t-il.
Des cris fusèrent dans l’agence, suivis d’un silence de mort.
Léonie regarda autour d’elle et reçut un coup de crosse dans le flanc qui l’obligea à s’exécuter. Les deux guichetiers, blêmes, ne pipaient mot. Le braqueur fit un signe du bras et, ce faisant, dévoila un étrange tatouage sur son avant-bras. Rouge. Léonie n’eut pas le temps d’identifier ce qu’il représentait. L’homme qui la précédait dans la file avait suivi son regard et Léonie le vit pâlir à son tour. Le braqueur réclama la caisse sans les perdre de vue. Pendant que le guichetier rassemblait les espèces, il se rapprocha encore d’eux. Elle vit que son voisin la regardait d’un air épouvanté, tandis que sa main s’égarait dans ses vêtements. Elle perçut dans un souffle :
— Je vous en supplie, articula-t-il silencieusement.
Léonie retint la question qui était montée à ses lèvres, sentant peser le regard aigu du braqueur. Il arracha d’un coup le pendentif de l’homme qui étouffa un gémissement de douleur, puis fouilla ses poches et lui ôta sa pochette en cuir. Léonie était tétanisée. Tout se passa ensuite très vite. Un coup de feu tiré en l’air éclata, puis l’ordre de rester tranquilles. Le bruit assourdissant de la balle qui se ficha dans le plâtre du plafond résonna dans la tête de Léonie comme un gong, mais, avant qu’elle eût pu réaliser, un deuxième coup éclata, suivi d’un bruit mouillé. L’homme détala et elle constata subitement l’ampleur des dégâts. Le Breton la fixait d’un regard qui se ternissait à grande vitesse et un filet de sang s’écoulait de la commissure de ses lèvres. Stupéfaite, Léonie vit qu’une balle avait perforé son poumon droit. Elle se pencha vers lui et entendit une nouvelle fois :
— Je vous en supplie, trouvez à qui remettre… Il faut lui remettre…
Et tandis qu’une bulle sanglante éclatait sur ses lèvres :
— Trouvez… l’implora le Breton.
Cette dernière bulle mourut sur ses lèvres, laissant Léonie désemparée. Une autre agitation se faisait autour d’elle. La sirène d’une voiture de police, suivie par celle des pompiers, éclata dans ses oreilles. Un brancard surgit à côté d’elle tandis qu’elle reprenait pied dans la réalité. Elle lâcha la main inerte de Loïc Troël, après un dernier regard à cet inconnu qui avait échangé les dernières paroles de sa vie avec elle. On lui glissa une couverture sur le dos et elle suivit docilement le policier qui l’entraînait.
III
La lumière éblouit Léonie en ressortant des locaux obscurs de la PJ. Elle et les autres clients de l’agence bancaire avaient dû patienter avant d’être interrogés et de faire leur déposition. La tête lui tournait un peu et elle réalisa qu’elle n’avait rien avalé depuis le matin, à part l’insipide lavasse servie par un policier compatissant, en guise de café. Toutes ses pensées étaient tournées vers cet homme dont elle avait partagé les dernières minutes. Le scénario du braquage revenait sans cesse dans son esprit, sans parvenir à apaiser le malaise de Léonie. Elle revoyait les dernières secondes, le regard suppliant de Loïc Troël et celui, insondable, du braqueur, dirigé vers lui. Pourquoi lui ? Avait-il reçu une balle perdue dans l’affolement ? Léonie avait porté ses mains à son visage au premier coup de feu, réflexe de protection et n’avait pas vu les circonstances du suivant. Pourtant, son instinct lui soufflait que quelque chose de bizarre s’était joué là. Pourquoi le Breton avait-il été le seul à être dépouillé ? Sa raison lui disait que le braqueur n’avait pas eu le temps de le faire pour les autres clients et que, dans l’affolement du premier coup de feu, il avait dû détaler. Oui, mais une petite voix contredisait cette hypothèse au fond d’elle. Était-ce la peur de mourir qui avait poussé la victime à la supplier tout bas ? Était-ce autre chose ? Elle se souvenait de sa main qui s’était dirigée vers elle. Insinuée, même, dans ses vêtements. Léonie portait un ample imper de ville vert foncé. Prise d’un doute, elle passa ses mains dans ses poches et ne sentit rien d’autre que son paquet de kleenex. « Allons, se dit-elle en secouant la tête, tu te fais des idées, ma pauvre Léo ! Après un choc pareil, rien d’étonnant. » Tout de même, le sort funeste de Loïc Troël avait entamé sa belle humeur et le regard bleu, glacé, de l’homme ne cessait de la hanter. Elle jeta un coup d’œil à sa montre et son cœur s’affola. Elle avait juste le temps de rallier la porte de Versailles pour la dernière épreuve du concours. Elle aurait bien voulu passer un coup de fil à Angel pour lui raconter ses péripéties, mais il lui fallait choisir entre ça et manger un sandwich avant l’épreuve. Elle choisit de se restaurer pour ne pas subir de “coup de pompe” pendant l’épreuve. Pas le moment de flancher ! Elle choisit rapidement un sandwich au saumon fumé et se posa dans un coin pour l’avaler. La pensée du jeune homme avait adouci ses pensées moroses. C’était un personnage que le jeune écrivain, spécialiste des romans historiques. À vingt-huit ans, Angel Klyne était devenu un ami précieux de Léonie qu’il appelait Léo avec son accent inimitable, depuis qu’il s’était installé à Plogoff, trois ans plus tôt. D’abord client régulier de Violettes Impériales, il avait su capter l’attention de la fleuriste puis son amitié. Angel était américain par son père et français par sa mère. Élevé aux États-Unis après la séparation de ses parents, il n’avait quasiment pas connu celle-ci. Lorsqu’il était revenu en France la retrouver, Angel était arrivé trop tard. Sa mère venait de mourir. Demeurer à Plogoff, près de ses racines bretonnes, était, pour le jeune homme, une façon de restaurer le passé. En dehors de ça, c’était un beau garçon, blond aux yeux gris, qui plaisait aux filles mais qui cachait sa blessure derrière une particularité et pas des moindres. Angel était hypocondriaque, sa peur maladive des microbes leur valait des échanges épiques quelquefois ! Progressivement, Angel était devenu pour Léonie un proche, comme le fils qu’elle n’avait pas eu. À quarante-sept ans, la fleuriste était ce qu’on appelait communément une vieille fille. Moderne quand même. Et dynamique. Mais elle n’avait connu que des histoires de passage et jamais envisagé de vivre avec quiconque. Il faut dire que Léonie s’était occupée de ses parents jusqu’à trente-neuf ans, en même temps que du magasin créé par son père, et que ceci avait considérablement handicapé sa vie sentimentale. Qui aurait souhaité vivre avec Catherine Kerenflec’h ? Une main de fer dans un gant de fer… Léonie devait en convenir. Heureusement, elle avait eu les fleurs, sa passion, pour lui tenir compagnie et, depuis quelques années, le jeune écrivain qui passait tous les jours la voir. Ça en faisait bien jaser quelques-unes dans le village, mais Léonie s’en fichait ! Elle jeta un coup d’œil dans la devanture la plus proche et s’observa sans aménité. Pas trop mal pour son âge… La pratique de la marche au bord de mer et du vélo lui faisait une silhouette musclée. Décharger ses arrivages de fleurs tonifiait ses bras à un âge où le relâchement se fait sentir habituellement. Toujours en jean et en pull, Léonie ne faisait guère de frais de toilette, mais ses cheveux bruns mêlés de fils argentés surmontaient deux yeux noisette au regard pétillant. Elle termina son sandwich, but quelques gorgées d’eau gazeuse et se dirigea résolument vers le métro en espérant que ces péripéties n’allaient pas gâcher ses chances au concours. Elle avait déjà passé l’épreuve du bouquet rond et celle de la composition en triangle, aujourd’hui, elle terminait par l’ikebana. Léonie prit une grande respiration et descendit dans les entrailles du métro.
IV
Il l’identifia immédiatement. C’était elle. Il l’avait repérée avant qu’elle ne pénètre dans les locaux du concours floral et patienté jusqu’à ce qu’elle en ressorte. Ses talents de physionomiste lui avaient souvent permis d’être embauché par le passé. Il la vit lever la tête au ciel et sonder les nuages qui s’étaient amoncelés sur Paris. Un orage de fin d’été. Elle resserra son imper et se massa les tempes quelques secondes avant de porter son sac à l’épaule. « Fatiguée », se dit-il. Ça l’arrangeait. Elle serait ainsi moins attentive à lui. Il fallait qu’il rattrape la bévue de midi. Le commanditaire n’était pas content. Il grinça des dents et jura à voix basse. Pourtant, il était sûr de son plan. Qu’était devenu ce qu’il recherchait ? À part…
Elle s’était décidée à bouger et téléphonait tout en marchant. Tout à sa conversation, elle ignorait la foule de la Porte de Versailles qui se dispersait dans les bouches du métro. Il allongea le pas souplement et le calqua sur le sien. Léonie décompressait après son passage devant le jury de fleuristes et de professionnels. Comme chaque fois qu’elle passait une épreuve, elle s’était immergée dans l’essence des fleurs. L’esprit de l’ikebana l’avait habitée durant trois heures et elle n’avait pas vu le temps passer. Toutes les épreuves étaient terminées et il ne restait plus que la délibération du jury. Demain serait le grand jour du résultat final. Léonie raconta par le menu ses aventures parisiennes à Angel et le braquage sanglant, ce qui arracha des exclamations au jeune homme. Il s’était installé chez elle le temps de son absence pour veiller sur Iris et Sam, ses deux chats, et elle visualisait parfaitement l’écrivain se lavant les mains trente-six fois par jour et passant de l’eau de javel sur le plan de travail, inquiet à l’idée d’être contaminé par les deux félins. Phobie quand tu nous tiens ! Mais au fond, au-delà de sa manie, elle savait qu’il les aimait bien tout de même et avait totale confiance en lui.
— Merci Angel de m’avoir permis de participer à ce concours. Tu sais quelle importance il revêt à mes yeux. Et je n’aurais pas pu laisser mes chats tout seuls pendant cinq jours…
Sa réponse se perdit dans le brouhaha de l’avenue. Elle ajouta :
— En tous les cas, je me souviendrai de cette journée ! Je crois que le regard de cet homme me poursuivra toute ma vie…
Un bip inquiétant lui répondit, suivi d’une coupure de la communication. Léonie regarda son téléphone avec un froncement de sourcils et réalisa soudain. « Quelle idiote je suis, se dit-elle, j’ai reçu un SMS m’avertissant de la fin de mon crédit ! Tant pis, je le rechargerai à l’hôtel avec ma carte bleue ! » Elle descendit résolument l’escalier et perçut le grondement sourd du métro entrant en gare. Avec ses multiples salons, la Porte de Versailles est un lieu animé à longueur d’année et sa station de métro, très fréquentée. Elle se fondit dans la foule. « Enfin, se dit-elle, juste une station avant Vaugirard et l’hôtel ! » Elle monta dans la rame et s’accrocha à la barre centrale. Léonie n’aimait guère s’asseoir à moins d’avoir une dizaine de stations à passer. Perdue dans ses pensées, elle se laissa bercer par les trépidations de la rame. Elle était enserrée de toutes parts et sa main touchait légèrement celle d’un Japonais. Elle la descendit légèrement. Un mouvement imperceptible se fit sur sa droite et elle tourna un peu la tête. Quelque chose l’alerta. Léonie entendit un son de cloche lointain et insistant. C’était vague et dangereux à la fois. Ses sens en alerte, elle se concentra sur ses sensations. Un effet du choc subi quelques heures plus tôt ? Une appréhension soudaine. Léonie se força à respirer l’air vicié du wagon et releva la tête. Elle croisa un regard et capta un détail. Son estomac se serra. Elle avait déjà vu cet éclair de violence briller dans ces yeux-là et le dessin rouge qui sortait de la manche de l’homme n’était pas sans lui rappeler celui entrevu sur le bras du braqueur. Elle se força à détailler le dessin et identifia une petite salamandre rouge, tatouée sur la peau offerte aux regards. L’image forte de l’assassin de Loïc Troël la prit à la gorge. Quelque chose lui souffla que c’était lui. La probabilité pour qu’elle croise deux hommes, dans la même journée, tatoués de ce même emblème, au même endroit, était quasi nulle. Elle sentit la racine de ses cheveux se hérisser dans sa nuque et son souffle se raccourcir. Détournant le regard, elle bougea lentement, se coulant dans la masse compacte des voyageurs. Elle quitta la barre centrale pour se tenir aux dossiers des premiers sièges, puis aux suivants. Elle voulait arriver à l’autre porte pour ne pas se heurter à lui. Elle progressait à pas de loup, la nuque raide, et se repassait en boucle la supplication silencieuse de la victime : « Je vous en supplie… ». Bloquée par un rugbyman à la carrure imposante, elle s’arrêta et osa jeter un coup d’œil derrière elle. Son sang se glaça. Lui aussi avait bougé et se trouvait à moins de deux mètres d’elle. Elle discerna un éclat froid entre ses paupières mi-closes. Vaugirard arrivait. Léonie hésita une seconde. Sortir ? Elle visualisa la station, le petit square sur lequel elle débouchait, la plupart du temps désert, et la rue Blomet où se trouvait son hôtel. Si son instinct ne la trompait pas, il descendrait derrière elle et… que se passerait-il ? Elle ferma les yeux en entendant le signal de départ et vit s’éloigner sa station et la quiétude de son hôtel. Son destin s’engouffrait à grande vitesse dans un tunnel obscur, songea-t-elle, effrayée. Il avait encore avancé vers elle. Maintenant, elle percevait sa présence, comme une aura maléfique, et il dégageait une odeur métallique qui l’incommodait. « Au secours, Angel ! » pria-t-elle. Le rugbyman sortit à la station suivante et elle put reprendre sa progression. Son esprit était un volcan en ébullition, elle essayait désespérément de trouver une solution. Elle songea à crier mais se retint. Était-il armé comme ce midi ? Tirerait-il pour se couvrir, s’il se sentait découvert ? Elle jeta un coup d’œil au-dessus de la fenêtre et compta mentalement. Dans huit stations, elle serait à Concorde et pourrait essayer de le semer. L’endroit comportait de nombreux embranchements et de multiples couloirs. Elle se concentra sur le rythme des arrêts et des départs, tout en continuant à s’éloigner de lui. À chaque fois qu’elle vérifiait, il avait avancé aussi, raccourcissant la distance entre eux. À l’Assemblée Nationale, il se colla à elle. Il lui sembla que la pointe d’un couteau appuyait dangereusement sur son flanc droit. Le cœur de Léonie battait la chamade. L’homme fouillait méthodiquement, tâtant ses poches, et elle sentit qu’il essayait de la délester de son sac. L’arrêt Concorde était là. Les portes s’ouvrirent. Elle prit son élan et le surprit en jaillissant sur le quai bondé. Les gens qui montaient en force gênèrent sa sortie, faisant gagner à Léonie de précieuses secondes. Elle courut sans se retourner, enfilant le couloir au pas de course. Ce n’était pas un simple voleur à la tire, elle en était désormais convaincue, mais l’homme qui avait abattu le client de l’agence bancaire. Il l’avait suivie. Pourquoi ? Comment ? Elle l’ignorait mais commençait à comprendre que cela avait un rapport avec la peur de Loïc Troël. Léonie était intimement convaincue que le Breton s’était senti menacé personnellement. Pourquoi elle maintenant ? L’homme était venu chercher quelque chose en dévalisant sa victime. Quelque chose qu’il n’avait pas obtenu. De là à penser que le Breton le lui avait confié, il n’y avait qu’un pas que le braqueur avait pu sauter. La sueur coulait sur le front de Léonie et piquait ses yeux. Elle percevait le bruit précipité de ses pas et il lui semblait qu’ils se répercutaient dans le couloir emprunté par une foule anonyme et pressée. Concorde était une station majeure qui desservait trois lignes. Tout en courant, Léonie calculait. Elle avait la ligne un, huit ou douze pour s’enfuir de là. À moins qu’elle ne remonte en surface et tente sa chance à l’air libre ? Ses pieds devenaient plus lourds et elle sentit soudain une main saisir son vêtement dans le dos. La terreur lui donna des ailes. Elle défit la ceinture qui retenait l’imper qui flotta autour d’elle et vit le reflet de sa peur dans les yeux des personnes croisées furtivement. Une seconde d’étonnement avant qu’elles ne poursuivent leur chemin dans l’anonymat des couloirs blafards. L’homme ne relâchait pas sa prise et Léonie abandonna le vêtement, le laissant entre les mains de l’homme. Son sac serré contre elle, elle puisa dans ses forces pour accélérer l’allure. Au passage, elle heurta de l’épaule un couple qui s’arrêta pour l’invectiver, gênant au passage son poursuivant. Léonie en profita pour se fondre dans la foule qui se dirigeait vers le métro douze. Elle s’y glissa, priant pour ne pas être repérée et monta dans le premier compartiment ouvert en se faisant toute petite. La sonnerie retentit et les portes se refermèrent sur la station aux carreaux de céramique brillants, affichant la déclaration des Droits de l’homme. À cet instant précis, l’autre surgit sur le quai, trop tard pour attraper la rame, et Léonie vit l’éclair de rage, mêlé de surprise, dans ses yeux…
V
Tétanisée, Léonie s’était posée sur un strapontin pour laisser défiler les stations en reprenant son souffle, consciente des regards furtifs des voyageurs sur elle. Le hasard de sa fuite l’avait remise sur la ligne douze dans la direction de son hôtel. Ira ? Ira pas ? Elle était assise dans le wagon de queue et ses yeux ne quittaient pas les allées et venues des personnes en amont. Un soulagement de courte durée l’avait envahie. Elle l’avait semé. Pour combien de temps ? Léonie calcula qu’il y avait trois minutes d’intervalle entre chaque rame. Il lui faudrait courir jusqu’à son hôtel, en admettant qu’il sache à quelle station elle descendrait. Mais savait-il où elle logeait ? L’incertitude la rongeait. Il l’avait suivie depuis sa sortie du concours floral et elle s’y était rendue directement à sa sortie de la Police Judiciaire. Avait-elle été attendue et suivie en quittant ces locaux ? Si c’était le cas, il ne connaissait pas son nom ni son lieu d’habitation. Peut-être même ignorait-il qu’elle n’était que de passage… Elle chercha, à tâtons, son téléphone dans son sac fourre-tout et se rappela qu’elle n’avait plus de crédit. Au lieu de son portable, ses doigts rencontrèrent un objet qu’elle remonta au jour, intriguée. C’était une petite boîte noire joliment travaillée. « De l’ébène », se dit-elle. Avec un couvercle en marqueterie. Léonie la regarda avec appréhension, tout en la tournant entre ses doigts. La boîte ciselée était un bijou en elle-même. Son cœur battait sourdement au point d’envahir ses oreilles et d’annihiler tout ce qui l’entourait. Léonie était comme hypnotisée par cette boîte, visiblement ancienne, qui ne lui appartenait pas. Elle retardait le moment de l’ouvrir, par crainte de ce qu’elle allait y découvrir. Son intuition lui soufflait que, telle la boîte de Pandore, son ouverture serait source d’ennuis. Avec répugnance, elle s’y décida et dut s’y reprendre à plusieurs fois pour déclencher un mécanisme invisible. Elle sentit un petit déclic et le couvercle se souleva. Ébahis, les yeux de Léonie découvrirent deux clefs sur un lit de velours cramoisi. La plus grande des deux était noire et brillante. Léonie la prit entre ses doigts et reconnut le toucher doux de l’obsidienne. L’autre, plus petite, était taillée dans ce qui lui parut être un saphir. Émue et perturbée, elle referma l’écrin et l’enfouit au plus profond de son sac, en vérifiant qu’elle n’avait pas suscité de convoitise autour d’elle. Les deux objets, serrés dans leur berceau de velours, lui semblaient porteurs d’une menace sourde et indéfinie. D’où venaient-ils ? Pourquoi étaient-ils en sa possession ? Léonie se dit qu’elle ne tarderait pas à le savoir.
VI
Il jeta un coup d’œil à l’adresse que lui avait remis l’officier de police, l’Institut Médico-légal, l’IML, dans le jargon policier. Une ombre passa dans son beau regard clair, le même que celui de son père, à l’idée de ce qui l’y attendait. Une balle dans le poumon, fatale, pendant un hold-up. Meven avait du mal à imaginer son père mort. Loïc était une nature, une présence. Comment était-ce possible ? Il serra ses poings dans ses poches et fit signe à un taxi.
Meven Troël sortit de la PJ et passa sa main sur son visage fatigué. La nouvelle l’avait cueilli à froid tandis qu’il s’apprêtait à convoyer un sloop en Irlande. La mort de son père lui paraissait encore irréelle. Avec la vie de bohème qu’il menait, un jour dans un port, un jour dans un autre, cela faisait plus de huit mois qu’ils ne s’étaient pas revus. Le jeune homme fronça les sourcils pour rassembler ses souvenirs. Juste avant la nouvelle année. Le trente ou le trente et un décembre… Il partait à Nice avant de convoyer un yacht en Corse et avait vu son père entre deux gares. Une visite d’une heure, le temps d’échanger leurs vœux. Il avait trouvé Loïc un peu fatigué. Cinquante-huit ans et toujours aussi fringant mais quelque chose d’usé dans la posture. Le contraire de lui qui traînait en vareuse et pull marin en permanence. À vingt-neuf ans, Meven avait choisi la mer et une vie sans attaches. Peut-être en réaction à ce père trop embourgeoisé à son goût. Loïc Troël avait évolué dans son domaine professionnel. Cadre dans une société de crédit, il avait dû quitter la Bretagne après une promotion, douze ans plus tôt. Une belle ascension qui lui avait coûté sa femme. La mère de Meven n’avait pas supporté la capitale et demandé le divorce trois ans après. Quant à lui, à dix-sept ans, il avait exigé de rester dans sa région natale. Un an d’internat à Brest. À dix-huit ans, bac en poche, il avait choisi sa vie. Convoyer des bateaux était ce qui lui convenait le mieux. Il voyait Loïc de loin en loin. Une ou deux fois par an. Quelques heures. La dernière rencontre avec son père s’était soldée par un désaccord. Loïc avait encore remis sur le tapis cette vieille histoire, celle qu’il racontait depuis son enfance. Mais là, loin de la Bretagne, et de voir son père éloigné de ses attaches, si différent de celui qu’il était à Douarnenez, cela l’avait irrité. Meven regrettait maintenant de l’avoir rembarré. Après tout, s’il aimait croire à ces vieilles légendes…
VII
Léonie s’était faite toute petite pour traverser le square du quinzième arrondissement et elle avait refermé avec soulagement la porte de sa chambre au cinquième étage de l’hôtel. Tout s’était passé si vite que son esprit avait encore du mal à intégrer ce qui s’était passé durant cette journée. Elle posa la boîte d’ébène sur le bureau de la chambre et passa longuement sous la douche pour dénouer toutes les tensions qui la crispaient. L’eau tiède sur son visage lui fit du bien. Enfin, elle sortit de la salle d’eau et se posa sur le lit. Son regard était irrésistiblement attiré par l’objet. Elle sortit son téléphone et entreprit d’en recharger le crédit avec sa carte bleue. Quand elle eut reçu le SMS de confirmation, elle appela Angel.
— Ouiii…
À l’intonation mourante, elle comprit que le jeune homme était en proie à une nouvelle crise d’angoisse. De quoi s’agissait-il aujourd’hui ? Cancer, tuberculose, ulcère à l’estomac… ou pire ?
— Ah, Léo, tu tombes à pic ! Figure-toi que j’ai une plaque qui est sortie sur le côté gauche…
— Pitié, Angel ! Pas ce soir !
— Mais…
— Non ! Écoute-moi, j’ai des choses à te raconter.
Léonie se lança dans le récit de l’heure passée, ce qui eut pour effet de distraire Angel de ses préoccupations morbides.
— Et tu te trouves où, exactement ? lui demanda-t-il.
— Dans ma chambre d’hôtel.
— Tu es certaine qu’il ne t’a pas suivie ?
— Certaine… pas à cent pour cent, mais je ne l’ai plus vu après être montée dans mon dernier métro. Il ne pouvait pas prendre la même rame que moi, je me suis jetée dans le dernier wagon ! Et je t’assure que je n’ai pas traîné dans la rue en ressortant du métro !
— …Hum… quant à cette… boîte, tu ne l’avais jamais vue avant aujourd’hui ?
— Angel, voyons ! Tu imagines que je pourrais oublier posséder une boîte ancienne contenant deux clefs qui ressemblent à des bijoux !
— Oui, tu as raison, convint son interlocuteur. Mais alors…
— Alors, je ne l’avais pas ce matin. Tu connais ma maladresse légendaire et, du fait de la dernière épreuve du concours à passer, j’étais stressée et j’ai renversé mon sac dans la chambre. J’ai dû me mettre à quatre pattes pour récupérer mes affaires, alors je connais le contenu de mon sac !
— Que comptes-tu faire, Léo ?
— Je ne sais pas…
— Préviens la police ! Il suffit d’appeler. Ils viendront à l’hôtel prendre ta déposition.
— …Oui… mais…
— Mais ?
— D’abord, je n’ai pas du tout envie que ce type me localise. Je crains que le remue-ménage occasionné par la venue de la police me dénonce, s’il est en train de me chercher dans le secteur…
— Ils s’occuperont de toi, tu seras protégée !
— Tu crois ? L’agression s’est passée dans la foule sans que personne ne s’en rende vraiment compte. Je n’ai ni preuve ni témoin. Je risque fort de rester ensuite toute seule, à sa merci. Et puis…
— Oui ?
— Le regard de cet homme me poursuit. Plus les heures passent et plus je suis persuadée qu’il a voulu me faire passer un message et qu’il m’a confié cette boîte. Elle n’est pas venue seule dans mon sac et je sens encore sa main auprès de moi, s’agitant sans que je comprenne pourquoi. Il a voulu cacher ces clefs. Pourquoi moi ? J’étais la plus proche de lui, mais nous venions juste de sympathiser, ayant la Bretagne pour point commun. Je t’ai dit qu’il était de Douarnenez ?
Léonie relata à nouveau les circonstances de sa rencontre éphémère avec la victime du casse.
— J’ai envie de comprendre ce que ça voulait dire, conclut-elle. Il était mourant, mais je sais qu’il m’a demandé de trouver quelqu’un qu’il n’a pas eu le temps de nommer et de lui remettre quelque chose. Et avec la découverte de cette boîte dans mon sac, je commence furieusement à penser que ce pourrait être ces deux clefs !
— Comment comptes-tu t’y prendre sans aucun indice ?
— Je n’en sais rien, à vrai dire, et… je compte un peu sur toi pour m’éclairer ! Tu as l’habitude d’investiguer pour tes romans historiques ! Et puis, je n’ai pas encore examiné la boîte, elle me révélera peut-être des détails…
— Et dans l’hypothèse où tu n’en trouverais pas, que feras-tu de cette boîte et de son contenu ? Il semble avoir de la valeur ?
Angel observa un silence prudent. Il savait son amie dotée d’un caractère bien trempé et il évita de se confronter à elle à distance. Elle était encore sous le choc et à l’abri dans sa chambre d’hôtel. Demain, elle verrait peut-être les choses différemment…
— Je n’ai pas envie de laisser la dernière demande de cet homme sans réponse. Si je ne trouve rien, je me rapprocherai de ses héritiers. Il en a bien au moins un !
VIII
Vera déposa une assiette pleine devant sa mère. Son beau regard s’assombrit en voyant que Marie ne réagissait pas.
— Maman… Maman… dit-elle en lui plaçant la cuillère dans la main.
Le regard vide de sa mère lui serra le cœur et, en même temps, fit monter une bouffée de colère en elle.
— C’est l’heure de manger. Regarde la soupe de Mamie, respire comme elle sent bon !
L’inertie de sa mère l’énerva.
— Regarde-moi ! Tu te rappelles qui je suis ?
Un vague sourire éclaira le visage de Marie en forme d’excuse. Elle oubliait régulièrement sa fille qui devait lui rappeler qui elle était à chaque moment de la journée.
— VERA ! Je suis VERA ! lui dit-elle en articulant posément. Je suis ta fille. Tu es ma mère.
La femme hocha la tête et prit une cuillère de potage. Chaque jour, pour elle, était un éternel recommencement. L’aube de sa vie. Une page vierge qu’il fallait imprimer mais sur laquelle rien ne restait.
Les journées de Marie s’écrivaient à l’encre sympathique qui s’effaçait au fur et à mesure des heures qui passaient. Vera enrageait contre le coup du sort qui avait ruiné leurs vies. Avec l’ardeur de sa jeunesse, elle échafaudait des solutions pour rendre à sa mère un semblant de vie normale, à défaut de lui rendre sa mémoire. Elle passait beaucoup de temps à recueillir des odeurs et à les lui faire sentir. Vera avait lu un article sur Internet qui parlait de la mémoire olfactive. La plus tenace. Celle qui reste quand tout s’est effacé et qui est capable de réveiller d’autres secteurs endormis du cerveau. Elle courait la campagne de Propriano à la recherche de l’odeur miraculeuse qui réveillerait sa mère, un peu comme la Belle au Bois Dormant s’éveillant d’un long sommeil. À défaut, elle lui avait concocté un carnet pour noter tous les événements de ses journées et en garder ainsi la trace et un système de post-it de différentes couleurs.
Le fil rouge de ses journées. Un travail de fourmi.
Mamie lisait une lettre reçue au courrier du jour et semblait contrariée.
— Elle est de qui cette lettre, Mamie ?
La vieille femme pinça les lèvres et reposa ses lunettes sur la table.
— Ta tante, répondit-elle sombrement.
Visiblement, ce courrier ne l’enchantait pas.
— Ah… dit Vera, soudain intimidée. Tu veux dire…
— Carmela, grommela-t-elle.
Pour des raisons qui échappaient à Vera, l’entente entre Serena Paoli et sa plus jeune fille Carmela n’était pas au beau fixe.
— Les nouvelles sont bonnes ? demanda-t-elle prudemment.
— Elle veut s’occuper de vous. Elle prétend que je suis trop âgée pour supporter la charge de Marie et que tu pourras plus facilement suivre tes études sur le continent. Elle… elle dit qu’elle aurait une place pour ta mère dans une communauté religieuse…
— Mais comment ? On ne va pas vivre au couvent, Mamie !
— Ne blasphème pas, ma fille !
Comme toute bonne Corse, Serena était pieuse.
— Et puis ta tante n’est pas religieuse, Vera ! Elle a rompu ses vœux après son noviciat. Maintenant, elle est expert-comptable et a son propre cabinet.
La nouvelle stupéfia la jeune fille. Elle gardait le souvenir vague d’une religieuse qui dégageait une odeur de cire et d’encens. Vague, car elle ne la voyait pas souvent. Maman allait la voir autrefois toute seule dans une sorte de parloir. Comptable ! C’était une surprise !
— Elle écrit que son ancienne communauté pourrait s’occuper de Marie. Ils ont l’habitude de recevoir des laïques pour des séjours. Elle ne craindrait rien dans ce milieu fermé. Pas de risque qu’elle se perde. Il y aurait toujours quelqu’un pour veiller sur elle. Quant à toi, Carmela propose de te prendre avec elle et de t’inscrire comme interne à Brest. Tu passerais les week-ends avec elle et ta mère.
Vera garda le silence, tant la nouvelle était surprenante. Elle venait juste de s’acclimater à la Corse et de s’habituer aux manières rudes de Mamie. Carmela était une quasi inconnue pour elle.
— Et toi, Mamie, qu’en penses-tu ?
La vieille femme pinça les lèvres.
— Ta mère, c’est ma fille et tu es mon sang. C’est mon devoir de m’occuper de vous.
— Je sais mamie, je sais ce que tu fais pour nous !
Vera s’était jetée spontanément au cou de la vieille dame.
— Mais je ne sais pas comment sera l’avenir. Combien de temps pourrais-je m’occuper de Marie ? Le médecin dit que mon cœur n’est plus très bon… et puis, je ne vais pas pouvoir te garder à Propriano, auprès de nous. Il faudrait que tu sois interne à Ajaccio à la rentrée. Ta tante a peut-être raison… Là-bas, tu suivras tes études. Carmela n’a que trente-cinq ans et elle pourra veiller sur toi et ta mère. Elle a encore la jeunesse ! S’il m’arrivait quelque chose, que deviendriez-vous toutes les deux ici ?
Vera vit qu’il en coûtait à Serena de faire ce constat et elle se tourna vers Marie qui avait terminé sa soupe. Elle avait gardé sa cuillère et Vera la reposa. Leur échange sur Carmela n’avait pas éveillé d’intérêt chez sa mère. Se souvenait-elle de sa jeune sœur ? Vera en doutait.
Mamie conclut :
— Carmela propose d’arriver dans huit jours. Il faudra avoir pris une décision à ce moment-là.
La dernière phrase de sa grand-mère retentit longuement dans l’esprit de Vera, partagée entre le désir de veiller sur sa mère et celui, plus intime, de retrouver la vie d’une jeune fille de son âge, loin des soucis quotidiens générés par le handicap de Marie.
La fin de l’été lui apporterait la réponse.