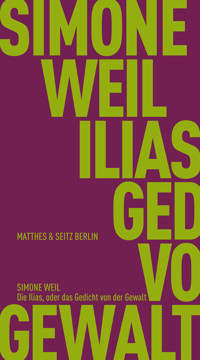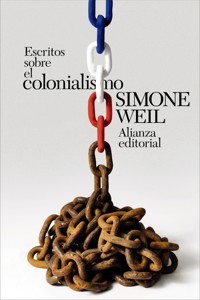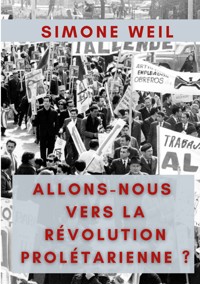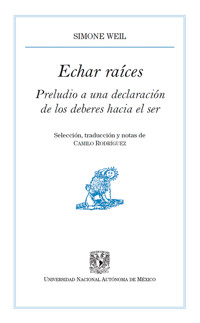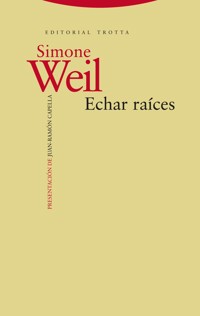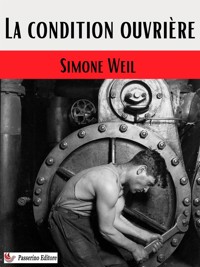
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Passerino
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
La Condition ouvrière est un ouvrage de la philosophe française
Simone Weil, paru en 1951 aux éditions Gallimard, dans la collection « Espoir » dirigée par Albert Camus.
Le livre est composé de textes divers – des lettres, un journal et des articles – écrits entre 1934 et 1942, dont quelques-uns seulement sont parus en revues du vivant de l’auteure. Ces textes concernent l'expérience ouvrière vécue par les travailleurs salariés dans les années 1930 et forment, dans leur ensemble, une tentative pour en comprendre les enjeux politiques, sociaux et économiques.
L'intérêt de l'ouvrage est à la fois historique et philosophique : il constitue, d'une part, une source de renseignements sur la situation des ouvriers à cette époque et, d'autre part, un exposé des idées de Weil sur les thèmes du travail, des machines, du temps, du malheur, de l'attention, de la joie, de l'obéissance et de la nécessité. Le texte le plus long, le Journal d'usine, est le récit du quotidien vécu par Weil lorsqu'elle travaille comme ouvrière en 1935.
Simone Weil (1909-1943) était une philosophe, militante sociale et mystique française. Elle est connue pour ses profondes réflexions dans divers domaines, tels que la philosophie, la politique, la religion et la justice sociale. La pensée de Weil est souvent caractérisée par sa combinaison unique de spiritualité, de conscience sociale et de rigueur philosophique.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Simone Weil
La condition ouvrière
The sky is the limit
table des matières
Avant-propos
Trois lettres À Mme Albertine Thévenon (1934-1935)
Lettre à une élève (1934)
Lettre à Boris Souvarine (1935)
Fragment de lettre à X (1933-1934 ?)
Journal d'usine
Première semaine
Deuxième semaine
Troisième semaine
Quatrième semaine
Cinquième semaine
Sixième semaine
Septième semaine
Treizième semaine (Sem. de 40 h : sortie à 4 h 1/2, repos le s.).
Quatorzième semaine
Quinzième semaine
Seizième semaine
Le mystère de l'usine
I. Le mystère de la machine.
II. Le mystère de la fabrication.
III. Le mystère du « tour de main ».
Transformations souhaitables.
Organisation de l'usine.
À la recherche de l’embauche
Dimanche de Pâques
Deuxième boîte, du jeudi 11 avril au mardi 7 mai, Carnaud, Forges de Basse-Indre, rue du Vieux-Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt
Pour la 2e fois, à la recherche du boulot
Renault
Incidents notables
Incidents
Fragments
Usines de R. (Monsieur B)
Lettres à un ingénieur Directeur d'usine
Un appel aux ouvriers de R.
Fragment de lettre
La vie et la grève des ouvrières métallos (sur le tas)
Lettre ouverte à un syndiqué
Lettres à Auguste Detœuf
a) Lettre de Simone Weil
b) Réponse de A. Detœuf
Remarques sur les enseignements à tirer des conflits du Nord
Principes d'un projet pour un régime intérieur nouveau dans les entreprises industrielles
La rationalisation (23 février 1937)
La condition ouvrière
Expérience de la vie d'usine (Marseille, 1941-1942)
Condition première d'un travail non servile
Avant-propos
Le hasard n'est pour rien dans le fait que le petit groupe des syndicalistes-révolutionnaires de la Loire connut Simone Weil en 1932. De bonne heure, ainsi qu'elle le raconte elle-même, elle avait été émue par les injustices sociales et son instinct l'avait portée du côté des déshérités. La permanence de ce choix donne à sa vie son unité.
Très tôt elle fut attirée par les révolutionnaires. La révolution russe, porteuse à l'origine d'un immense espoir, avait dévié, et les prolétaires y étaient maintenus en état de servage par la bureaucratie, nouvelle caste de privilégiés, confondant volontairement industrialisation et socialisme. Simone avait trop l'amour et le respect de l'individu pour être attirée par le stalinisme qui avait créé un régime dont elle devait dire en 1933 : « À vrai dire, ce régime ressemble au régime que croyait instaurer Lénine dans la mesure où il exclut presque entièrement la propriété capitaliste ; pour tout le reste il en est très exactement le contre-pied. »
Ayant ainsi éliminé du monde révolutionnaire des staliniens, elle se rapprocha des autres groupes : anarchistes, syndicalistes-révolutionnaires, trotskystes. Elle était trop indépendante pour qu'il soit possible de la classer dans un de ces groupes ; cependant celui pour lequel elle eut le plus de sympathie à l'époque où nous l'avons connue était symbolisé par la Révolution prolétarienne.
Fondée en 1925, cette revue qui portait au début en sous-titre « Revue syndicaliste-communiste » rassemblait autour d'elle des syndicalistes qui, emportés par leur enthousiasme pour la révolution d'Octobre, avaient adhéré au parti communiste et en avaient été exclus ou l'avaient volontairement quitté en constatant que peu à peu la bureaucratie se substituait à la démocratie ouvrière du début. Les deux figures les plus marquantes en étaient et en sont encore Monatte et Louzon, tous les deux syndicalistes-révolutionnaires et de formation libertaire.
Simone entra en contact avec plusieurs des hommes qui animaient cette revue, et lorsqu'en automne 1931 elle tut nommée professeur au lycée du Puy ce fut à eux qu'elle demanda de la mettre en rapport avec des militants de cette région. C'est ainsi qu'un soir d'octobre elle vint chez nous pour y rencontrer Thévenon, alors membre du conseil d'administration de la Bourse du Travail à Saint-Étienne, secrétaire adjoint de l'Union départementale confédérée de la Loire, qui s'efforçait de regrouper la minorité syndicaliste et de ramener à la C. G. T. la Fédération régionale des mineurs, alors minoritaire dans la C. G. T. U. et dont le secrétaire Pierre Arnaud venait d'être chassé du parti communiste.
Par Thévenon, Simone se trouva du même coup plongée en plein milieu ouvrier et en pleine bagarre syndicale. Elle ne demandait que cela. Chaque semaine, elle fit au moins une fois le voyage du Puy à Saint-Étienne et deux ans après de Roanne à Saint-Étienne, pour participer à un cercle d'études organisé à la Bourse du Travail, assister à des réunions ou à des manifestations.
*
Son extraordinaire intelligence et sa culture philosophique lui permirent une connaissance rapide et approfondie des grands théoriciens socialistes, en particulier de Marx. Mais cette connaissance théorique de l'exploitation capitaliste et de la condition ouvrière ne la satisfaisait pas. Elle croyait utile de pénétrer dans la vie de tous les jours des travailleurs.
Au syndicat des mineurs, Pierre Arnaud représentait un beau type de prolétaire. Bien que permanent, il avait gardé toutes ses habitudes de mineur : son langage, ses vêtements et surtout sa conscience de classe. Il était un mineur et ne cherchait pas à passer pour rien d'autre. Simone l'estima, appréciant sa fierté, sa droiture et son désintéressement. Autour de lui gravitaient des hommes habitués à se heurter durement à la vie, dont quelques-uns avaient servi dans les bataillons disciplinaires. Simone essaya de s'intégrer à eux. Ce n'était pas facile. Elle les fréquenta, s'installant avec eux à la table d'un bistrot pour y casser la croûte ou jouer à la belote, les suivit au cinéma, dans les fêtes populaires, leur demanda de l'emmener chez eux à l'improviste, sans que leurs femmes fussent prévenues. Ils étaient un peu surpris par l'attitude de cette jeune fille si instruite qui s'habillait plus simplement que leurs femmes et dont les préoccupations leur semblaient extraordinaires. Cependant elle leur était sympathique, et c'est toujours avec amitié qu'ils revoyaient « la Ponote[1] » . Ils ne l'ont pas oubliée. L'un d'entre eux, homme simple s'il en fut, lui garde une fidèle affection ; un autre, rencontré il y a peu de temps, exprima ainsi ses regrets en apprenant sa mort : « Elle ne pouvait pas vivre, elle était trop instruite et elle ne mangeait pas. » Cette double constatation caractérise bien Simone. D'une part une activité cérébrale intense et continue et d'autre part la négligence à peu près totale de la vie matérielle. Déséquilibre ne pouvant aboutir qu'à une mort prématurée [2].
*
Quelle fut sa participation au mouvement syndical à cette époque ? Non seulement elle participa au cercle d'études de Saint-Étienne, mais elle l'aida à vivre en employant à l'achat de livres sa prime d'agrégation qu'elle considérait comme un privilège intolérable. Elle renforça la caisse de solidarité des mineurs, car elle avait décidé de vivre avec cinq francs par jour, prime allouée aux chômeurs du Puy. Elle milita dans le syndicat des instituteurs de la Haute-Loire, où elle se rapprochait du groupe de l' « École émancipée ». Au Puy, elle se mêla à une délégation de chômeurs, ce qui lui valut une belle campagne de presse et des ennuis avec son administration. Et, pardessus tout, elle mit au point, après maintes discussions avec des militants, ses réflexions sur l'évolution de la société dans un article paru dans la Révolution prolétarienne d'août 1933, sous le titre général de « Perspectives ». Cette étude – portant en sous-titre « Allons-nous vers une révolution prolétarienne » – donne une idée précise de ce que Simone entendait par socialisme qui est la « souveraineté économique des travailleurs et non pas celle de la machine bureaucratique et militaire de l'État ». Le problème est de savoir si, l'organisation du travail étant ce qu'elle est, les travailleurs vont vers cette souveraineté. Contrairement à une espèce de credo révolutionnaire qui veut que la classe ouvrière soit la remplaçante du capitalisme, Simone voit poindre une nouvelle forme d'oppression, « l'oppression au nom de la fonction » . « On ne voit pas, écrit-elle, comment un mode de production fondé sur la subordination de ceux qui exécutent à ceux qui coordonnent pourrait ne pas produire automatiquement une structure sociale définie par la dictature d'une caste bureaucratique. » Le danger de cette dictature bureaucratique s'est précisé depuis, ainsi qu'en témoigne Burnham dans son livre sur les managers. Ces constatations d'une clairvoyance si pessimiste qu'elle craint qu'on les taxe de défaitisme sont-elles une raison de désespérer et d'abandonner la lutte ? Pour elle, il n'en est pas question. « ... Étant donné qu'une défaite risquerait d'anéantir, pour une période indéfinie, tout ce qui fait à nos yeux la valeur de la vie humaine, il est clair que nous devons lutter par tous les moyens qui nous semblent avoir une chance quelconque d'être efficaces. » Nul langage ne saurait être plus courageux.
Enfin c'est également dans le temps qu'elle fut des nôtres qu'elle se rendit en Allemagne où les nazis commençaient à faire parler d'eux et de leurs horribles méthodes. Je la revois essayant de persuader un de nos jeunes camarades de l'accompagner. Pour elle, c'était simple : des hommes se battaient pour défendre leur liberté, ils avaient droit à l'aide de tous. Je la revois à son retour, ulcérée jusqu'au fond du cœur par ce qu'elle avait vu là-bas et s'effondrant sur un coin de table, les nerfs à bout, au souvenir des cruautés subies par les Allemands anti-nazis. Avec une grande lucidité elle analysa la situation allemande dans un article paru dans la Révolution prolétarienne du 25 octobre 1932 et annonça la victoire de Hitler. Elle avait, hélas ! vu juste.
*
Fréquenter les mineurs, vivre avec la paie d'un chômeur, réfléchir et écrire sur le mouvement ouvrier ne pouvait lui suffire. Ce qui paraissait essentiel à la fois à son intelligence et à sa sensibilité – deux forces à peu près égales en elle – c'était de pénétrer intimement les rapports du travail et des travailleurs. Elle ne pensait pas qu'on pût parvenir à cette connaissance autrement qu'en se faisant travailleur soi-même ; aussi décida-t-elle de devenir ouvrière. Ce fut un gros point de friction entre nous deux. Je pensais et je pense encore que l'état de prolétaire est un état de fait et non de choix, surtout en ce qui concerne la mentalité, c'est-à-dire la manière d'appréhender la vie. Je n'ai aucune sympathie pour les expériences genre « roi charbon » où le fils du patron vient travailler incognito dans les mines de son père pour retourner, son expérience faite, reprendre sa vie de patron. Je pensais et je pense encore que les réactions élémentaires d'une ouvrière ne sauraient être celles d'une agrégée de philosophie issue d'un milieu bourgeois. Ces idées étaient aussi celles des trois ou quatre copains qui formaient le petit groupe des amis de Simone à Saint-Étienne. Nous les lui exprimâmes crûment, et peut-être même brutalement, car nos rapports – affectueux – étaient exempts de mondanités. D'autres raisons nous poussaient à la dissuader de mettre son projet à exécution : son manque d'habileté manuelle et son état de santé. Elle souffrait de maux de tête terribles dont elle m'écrivit par la suite « qu'ils n'avaient pas eu l'obligeance de la quitter » .
Si nous avions raison en général, nous nous sommes trompés en ce qui concerne Simone. D'abord, elle mena son expérience à fond et avec la plus grande honnêteté, s'isolant de sa famille, vivant dans les mêmes conditions matérielles que ses compagnes d'atelier. Les lettres qu'elle m'écrivit alors et l'article qu'elle publia à la suite des grèves de 1936 dans la Révolution prolétarienne prouvent que sa possibilité d'adaptation et son pouvoir d'« attention » , pour employer une de ses expressions, lui ont permis de saisir avec acuité le caractère inhumain du sort fait aux travailleurs, surtout les non-qualifiés, « tous ces êtres maniés comme du rebut » dont elle se sentait la sœur, ce qui chez elle n'était pas littérature. « J'ai oublié que je suis un professeur agrégé en vadrouille dans la classe ouvrière » , écrivait-elle. De cette expérience elle resta marquée jusqu'à la fin de sa vie.
*
Elle quitta la Loire en 1934 et je ne devais plus la revoir. Je reçus d'elle encore une carte alors qu'elle était milicienne en Espagne chez les Rouges. Thévenon la revit à un congrès en 1938, à Paris. Puis ce fut la guerre. Et à la fin de la guerre, l'annonce de sa mort.
*
Peut-être un jour un militant ouvrier averti qui la connut aussi bien que nous éprouvera-t-il le besoin de tirer les enseignements de ses diverses expériences sociales. Pour moi – qui ai toujours vécu à l'intérieur du mouvement syndical sans y militer – je voudrais simplement porter témoignage du souvenir que Simone Weil a tissé aux quelques copains avec lesquels elle vécut en confiance dans une atmosphère de chaude camaraderie. Plusieurs ont été des militants ou le sont encore. Tous se souviennent des discussions qu'ils eurent avec elle, de son exigence, de la rigueur impitoyable avec laquelle elle obligeait à penser, et plus d'une fois leur pensée se tourne encore vers cette Simone toujours insatisfaite.
Je voudrais dire aussi la chance qu'ont eue ceux qui la connurent et l'apprécièrent ; comme il faisait bon près d'elle quand on avait sa confiance. Un de ses amis m'écrivait il y a peu de temps qu'elle fut « plus poète dans sa vie que dans ses œuvres ». C'est vrai. Elle était simple, et bien que sa culture générale fût tellement supérieure à la nôtre nous avions avec elle de longues conversations sur un ton fraternel, nous la plaisantions, elle riait avec nous, nous demandait de chanter (et pas toujours des choses très orthodoxes). Elle-même, assise au pied d'un petit lit de fer dans une chambre sans beauté qui ne comportait pas d'autres meubles, nous récitait parfois des vers grecs auxquels nous ne comprenions rien, mais qui nous réjouissaient quand même à cause du plaisir qu'elle y prenait. Enfin, un sourire, un coup d'œil faisaient de nous ses complices dans certaines situations cocasses. Ce côté de son caractère qui n'apparaissait pas souvent à cause du sérieux avec lequel elle envisageait d'ordinaire toutes choses avait un charme inoubliable.
Non moins séduisante était son absence de conformisme, et le souffle de liberté qu'elle portait avec elle. Encore fallait-il l'apprécier. Toutes ces manifestations qui nous la rendaient chère lui valurent d'irréductibles hostilités. Aussi est-ce une joie profonde pour nous de l'avoir aimée quand il en était temps.
Car enfin, s'il est relativement facile de l'admirer et de comprendre sa grandeur lorsque, dans la solitude d'un cabinet de travail, un livre ouvert devant soi, plus rien ne cache sa pensée profonde, il faut bien reconnaître que bon nombre de ceux qui sont passés près d'elle n'ont même pas soupçonné l'être exceptionnel qu'elle fut. Pourtant, à ceux qui l'ont bien connue et aimée alors qu'elle était incroyante, puis l'ont retrouvée si profondément religieuse, sa vie apparaît avec une unité parfaite, malgré son changement apparent. Le mouvement qui la poussait à se considérer et à se traiter comme le plus déshérité des déshérités est contraire à l'aspiration normale d'un être humain ordinaire. Il procède à la fois du désir de connaître le malheur – ce qui est gratuit –, de le traduire –, ce qui peut être efficace – et du sentiment de justice absolue : je n’ai droit à rien, puisque tant d'autres êtres n'ont droit à rien. Or, cette tendance était très nette et facilement décelable. C'est elle qui la faisait vivre avec l'allocation d'un chômeur en 1933, et qui la fit mourir de privations et de maladie, seule, sur un lit d'hôpital à Londres en 1943. Si cruelle qu'elle soit pour nous, cette mort est la conclusion logique de la vie que Simone avait choisie. Comme le dit Albert Camus, c'est une voie solitaire : la voie de Simone Weil.
Lorsqu'il m'est arrivé de parler de Simone Weil à mes amis, deux réflexions ont presque toujours été faites : « C'était une sainte » ou bien alors : « À quoi sert une vie comme la sienne ? » En vérité, je ne sais si elle était une sainte, mais beaucoup de révolutionnaires – parmi les meilleurs – ont ce détachement des biens matériels et ce désir de faire corps avec les plus malheureux. On devient révolutionnaire par le cœur d'abord. Chez Simone, cet état d'esprit se haussait au niveau d'un principe rigoureux. Quant à savoir « à quoi a servi sa vie » , c'est la question essentielle. Pour mon compte, je me suis souvent insurgée contre les privations qu'elle s'infligeait, contre la vie dure qu'elle s'imposait, et encore aujourd'hui je m'insurge en pensant qu'elle a disparu si tôt en grande partie à cause des souffrances qu'elle a délibérément endurées. Mais n'est-ce pas à toutes ces souffrances gratuites qu'elle doit son extraordinaire « pouvoir d'attention » , attention qui lui a permis de retrouver dans la poussière de la vie quotidienne le grain de pureté qui s'y trouvait ? N'est-ce pas ces souffrances gratuites qui ont fait d'elle un témoin dont la pureté et la sincérité ne peuvent jamais être mises en doute ? N'est-ce pas elles enfin qui lui ont donné cette admirable compassion qui la rendait perméable à toute misère humaine ? Le grand mérite de Simone est d'avoir mis une harmonie totale entre son besoin de perfection et sa vie, cela antérieurement à toute influence religieuse. Ce besoin de perfection était tel d'ailleurs qu'il l'a empêchée d'entrer dans l'Église qui, étant l'œuvre des hommes, porte les stigmates de l'imperfection, tout comme les mouvements révolutionnaires auxquels elle est restée attachée par tant de liens visibles.
Les raisons qui nous avaient fait l'apprécier et l'aimer restent entières. Aussi, même si nous l'abandonnons au seuil de sa vie mystique qui nous est étrangère, lui gardons-nous une affection intacte et un souvenir fidèle.
Albertine Thévenon.
Roche-la-Molière, décembre 1950.
Trois lettres À Mme Albertine Thévenon (1934-1935)
Chère Albertine,
Je profite des loisirs forcés que m'impose une légère maladie (début d'otite – ça n'est rien) pour causer un peu avec toi. Sans ça, les semaines de travail, chaque effort en plus de ceux qui me sont imposés me coûte. Mais ce n'est pas seulement ça qui me retient : c'est la multitude des choses à dire et l'impossibilité d'exprimer l'essentiel. Peut-être, plus tard, les mots justes me viendront-ils : maintenant, il me semble qu'il me faudrait pour traduire ce qui importe un autre langage. Cette expérience, qui correspond par bien des côtés à ce que j'attendais, en diffère quand même par un abîme : c'est la réalité, non plus l'imagination. Elle a changé pour moi non pas telle ou telle de mes idées (beaucoup ont été au contraire confirmées), mais infiniment plus, toute ma perspective sur les choses, le sentiment même que j'ai de la vie. Je connaîtrai encore la joie, mais il y a une certaine légèreté de cœur qui me restera, il me semble, toujours impossible. Mais assez là-dessus : on dégrade l'inexprimable à vouloir l'exprimer.
En ce qui concerne les choses exprimables, j'ai pas mal appris sur l'organisation d'une entreprise. C'est inhumain : travail parcellaire – à la tâche – organisation purement bureaucratique des rapports entre les divers éléments de l'entreprise, les différentes opérations du travail. L'attention, privée d'objets dignes d'elle, est par contre contrainte à se concentrer seconde par seconde sur un problème mesquin, toujours le même, avec des variantes : faire 50 pièces en 5 minutes au lieu de 6, ou quoi que ce soit de cet ordre. Grâce au ciel, il y a des tours de main à acquérir, ce qui donne de temps à autre de l'intérêt à cette recherche de la vitesse. Mais ce que je me demande, c'est comment tout cela peut devenir humain : car si le travail parcellaire n'était pas à la tâche, l'ennui qui s'en dégage annihilerait l'attention, occasionnerait une lenteur considérable et des tas de loupés. Et si le travail n'était pas parcellaire... Mais je n'ai pas le temps de développer tout cela par lettre. Seulement, quand je pense que les grands chefs bolcheviks prétendaient créer une classe ouvrière libre et qu'aucun d'eux – Trotsky sûrement pas, Lénine je ne crois pas non plus – n'avait sans doute mis le pied dans une usine et par suite n'avait la plus faible idée des conditions réelles qui déterminent la servitude ou la liberté pour les ouvriers – la politique m'apparaît comme une sinistre rigolade.
Je dois dire que tout cela concerne le travail non qualifié. Sur le travail qualifié, j'ai encore à peu près tout à apprendre. Ça va venir, j'espère.
Pour moi, cette vie est assez dure, à parler franchement. D'autant que les maux de tête n'ont pas eu la complaisance de me quitter pour faciliter l'expérience – et travailler à des machines avec des maux de tête, c'est pénible. C'est seulement le samedi après-midi et le dimanche que je respire, me retrouve moi-même, réacquiers la faculté de rouler dans mon esprit des morceaux d'idées. D'une manière générale, la tentation la plus difficile à repousser, dans une pareille vie, c'est celle de renoncer tout à fait à penser : on sent si bien que c'est l'unique moyen de ne plus souffrir ! D'abord de ne plus souffrir moralement. Car la situation même efface automatiquement les sentiments de révolte : faire son travail avec irritation, ce serait le faire mal, et se condamner à crever de faim ; et on n'a personne à qui s'attaquer en dehors du travail lui-même. Les chefs, on ne peut pas se permettre d'être insolent avec eux, et d'ailleurs bien souvent ils n'y donnent même pas lieu. Ainsi il ne reste pas d'autre sentiment possible à l'égard de son propre sort que la tristesse. Alors on est tenté de perdre purement et simplement conscience de tout ce qui n'est pas le train-train vulgaire et quotidien de la vie. Physiquement aussi, sombrer, en dehors des heures de travail, dans une demi-somnolence est une grande tentation. J'ai le plus grand respect pour les ouvriers qui arrivent à se donner une culture. Ils sont le plus souvent costauds, c'est vrai. Quand même, il faut qu'ils aient quelque chose dans le ventre. Aussi est-ce de plus en plus rare, avec les progrès de la rationalisation. Je me demande si cela se voit chez des manœuvres spécialisés.
Je tiens le coup, quand même. Et je ne regrette pas une minute de m'être lancée dans cette expérience. Bien au contraire, je m'en félicite infiniment toutes les fois que j'y pense. Mais, chose bizarre, j'y pense rarement. J'ai une faculté d'adaptation presque illimitée, qui me permet d'oublier que je suis un « professeur agrégé » en vadrouille dans la classe ouvrière, de vivre ma vie actuelle comme si j'y étais destinée depuis toujours (et, en un sens, c'est bien vrai) et que cela devait toujours durer, comme si elle m'était imposée par une nécessité inéluctable et non par mon libre choix.
Je te promets pourtant que quand je ne tiendrai plus le coup j'irai me reposer quelque part – peut-être chez vous.
………………………………………………………………………………..
Je m'aperçois que je n'ai rien dit des compagnons de travail. Ça sera pour une autre fois. Mais ça aussi, c'est difficile à exprimer... On est gentil, très gentil. Mais de vraie fraternité, je n'en ai presque pas senti. Une exception : le magasinier du magasin des outils, ouvrier qualifié, excellent ouvrier, et que j'appelle à mon secours toutes les fois que je suis réduite au désespoir par un travail que je n'arrive pas à bien faire, parce qu'il est cent fois plus gentil et plus intelligent que les régleurs (lesquels ne sont que des manœuvres spécialisés). Il y a pas mal de jalousie parmi les ouvrières, qui se font en fait concurrence, du fait de l'organisation de l'usine. Je n'en connais que 3 ou 4 pleinement sympathiques. Quant aux ouvriers, quelques-uns semblent très chics. Mais il y en a peu là où je suis, en dehors des régleurs, qui ne sont pas des vrais copains. J'espère changer d'atelier dans quelque temps, pour élargir mon champ d'expérience.
………………………………………………………………………………..
Allons, au revoir. Réponds-moi bientôt.
S. W.
*
Ma chère Albertine,
Je crois sentir que tu as mal interprété mon silence. Tu crois, semble-t-il, que je suis embarrassée pour m'exprimer franchement. Non, nullement ; c'est l'effort d'écrire, simplement, qui était trop lourd. Ce que ta grande lettre a remué en moi, c'est l'envie de te dire que je suis profondément avec toi, que c'est de ton côté que me porte tout mon instinct de fidélité à l'amitié.
………………………………………………………………………………..
Mais avec tout ça je comprends des choses que peut-être tu ne comprends pas, parce que tu es trop différente. Vois-tu, tu vis tellement dans l'instant – et je t'aime pour ça – que tu ne te représentes pas peut-être ce que c'est que de concevoir toute sa vie devant soi, et de prendre la résolution ferme et constante d'en faire quelque chose, de l'orienter d'un bout à l'autre par la volonté et le travail dans un sens déterminé. Quand on est comme ça – moi, je suis comme ça, alors je sais ce que c'est – ce qu'un être humain peut vous faire de pire au monde, c'est de vous infliger des souffrances qui brisent la vitalité et par conséquent la capacité de travail.
………………………………………………………………………………..
Je ne sais que trop (à cause de mes maux de tête) ce que c'est que de savourer ainsi la mort tout vivant ; de voir des années s'étendre devant soi, d'avoir mille fois de quoi les remplir, et de penser que la faiblesse physique forcera à les laisser vides, que les franchir simplement jour par jour sera une tâche écrasante.
………………………………………………………………………………..
J'aurais voulu te parler un peu de moi, je n'en ai plus le temps. J'ai beaucoup souffert de ces mois d'esclavage, mais je ne voudrais pour rien au monde ne pas les avoir traversés. Ils m'ont permis de m'éprouver moi-même et de toucher du doigt tout ce que je n'avais pu qu'imaginer. J'en suis sortie bien différente de ce que j'étais quand j'y suis entrée – physiquement épuisée, mais moralement endurcie (tu comprendras en quel sens je dis ça).
Écris-moi à Paris. Je suis nommée à Bourges. C'est loin. On n'aura guère la possibilité de se voir.
………………………………………………………………………………..
Je t'embrasse.
SIMONE.
*
Chère Albertine,
Ça me fait du bien de recevoir un mot de toi. Il y a des choses, il me semble, pour lesquelles on ne se comprend que toi et moi. Tu vis encore ; ça, tu ne peux pas savoir comme j'en suis heureuse…………. Tu méritais bien de te libérer. La vie les vend cher, les progrès qu'elle fait faire. Presque toujours au prix de douleurs intolérables.
………………………………………………………………………………..
Tu sais, j'ai une idée qui me vient juste à l'instant.
Je nous vois toutes les deux, pendant les vacances, avec quelques sous en poche, marchant le long des routes, des chemins et des champs, sac au dos. On coucherait des fois dans les granges. Des fois on donnerait un coup de main pour la moisson, en échange de la nourriture………………………….Qu'en dis-tu ?….………...
………………………………………………………………………………..
Ce que tu écris de l'usine m'est allé droit au cœur. C'est ça que je sentais, moi, depuis mon enfance. C'est pour ça qu'il a fallu que je finisse par y aller, et ça me faisait de la peine, avant, que tu ne comprennes pas. Mais une fois dedans, comme c'est autre chose ! Maintenant, c'est comme ceci que je sens la question sociale : une usine, cela doit être ce que tu as senti ce jour-là à Saint-Chamond, ce que j'ai senti si souvent, un endroit où on se heurte durement, douloureusement, mais quand même joyeusement à la vraie vie. Pas cet endroit morne où on ne fait qu'obéir, briser sous la contrainte tout ce qu'on a d'humain, se courber, se laisser abaisser au-dessous de la machine.
Une fois j'ai senti pleinement, dans l'usine, ce que j'avais pressenti, comme toi, du dehors. À ma première boîte. Imagine-moi, devant un grand four, qui crache au-dehors des flammes et des souffles embrasés que je reçois en plein visage. Le feu sort de cinq ou six trous qui sont dans le bas du four. Je me mets en plein devant pour enfourner une trentaine de grosses bobines de cuivre qu'une ouvrière italienne, au visage courageux et ouvert, fabrique à côté de moi ; c'est pour les trams et les métros, ces bobines. Je dois faire bien attention qu'aucune des bobines ne tombe dans un des trous, car elle y fondrait ; et pour ça, il faut que je me mette en plein en face du four, et que jamais la douleur des souffles enflammés sur mon visage et du feu sur mes bras (j'en porte encore la marque) ne me fasse faire un faux mouvement. Je baisse le tablier du four ; j'attends quelques minutes ; je relève le tablier et avec un crochet je retire les bobines passées au rouge, en les attirant à moi très vite (sans quoi les dernières retirées commenceraient à fondre), et en faisant bien plus attention encore qu'à aucun moment un faux mouvement n'en envoie une dans un des trous. Et puis ça recommence. En face de moi un soudeur, assis, avec des lunettes bleues et un visage grave, travaille minutieusement ; chaque fois que la douleur me contracte le visage, il m'envoie un sourire triste, plein de sympathie fraternelle, qui me fait un bien indicible. De l'autre côté, une équipe de chaudronniers travaille autour de grandes tables ; travail accompli en équipe, fraternellement, avec soin et sans hâte ; travail très qualifié, où il faut savoir calculer, lire des dessins très compliqués, appliquer des notions de géométrie descriptive. Plus loin, un gars costaud frappe avec une masse sur les barres de fer en faisant un bruit à fendre le crâne. Tout ça, dans un coin tout au bout de l'atelier, où on se sent chez soi, où le chef d'équipe et le chef d'atelier ne viennent pour ainsi dire jamais. J'ai passé là 2 ou 3 heures à 4 reprises (je m'y faisais de 7 à 8 F l'heure – et ça compte, ça, tu sais !). La première fois, au bout d'une heure et demie, la chaleur, la fatigue, la douleur m'ont fait perdre le contrôle de mes mouvements ; je ne pouvais plus descendre le tablier du four. Voyant ça, tout de suite un des chaudronniers (tous de chics types) s'est précipité pour le faire à ma place. J'y retournerais tout de suite, dans ce petit coin d'atelier, si je pouvais (ou du moins dès que j'aurais retrouvé des forces). Ces soirs-là, je sentais la joie de manger un pain qu'on a gagné.
Mais ça a été unique dans mon expérience de la vie d'usine. Pour moi, moi personnellement, voici ce que ça a voulu dire, travailler en usine. Ça a voulu dire que toutes les raisons extérieures (je les avais crues intérieures, auparavant) sur lesquelles s'appuyaient pour moi le sentiment de ma dignité, le respect de moi-même ont été en deux ou trois semaines radicalement brisées sous le coup d'une contrainte brutale et quotidienne. Et ne crois pas qu'il en soit résulté en moi des mouvements de révolte. Non, mais au contraire la chose au monde que j'attendais le moins de moi-même – la docilité. Une docilité de bête de somme résignée. Il me semblait que j'étais née pour attendre, pour recevoir, pour exécuter des ordres – que je n'avais jamais fait que ça – que je ne ferais jamais que ça. Je ne suis pas fière d'avouer ça. C'est le genre de souffrances dont aucun ouvrier ne parle : ça fait trop mal même d'y penser. Quand la maladie m'a contrainte à m'arrêter, j'ai pris pleinement conscience de l'abaissement où je tombais, je me suis juré de subir cette existence jusqu'au jour où je parviendrais, en dépit d'elle, à me ressaisir. Je me suis tenu parole. Lentement, dans la souffrance, j'ai reconquis à travers l'esclavage le sentiment de ma dignité d'être humain, un sentiment qui ne s'appuyait sur rien d'extérieur cette fois, et toujours accompagné de la conscience que je n'avais aucun droit à rien, que chaque instant libre de souffrances et d'humiliations devait être reçu comme une grâce, comme le simple effet de hasards favorables.
Il y a deux facteurs, dans cet esclavage : la vitesse et les ordres. La vitesse : pour « y arriver » il faut répéter mouvement après mouvement à une cadence qui, étant plus rapide que la pensée, interdit de laisser cours non seulement à la réflexion, mais même à la rêverie. Il faut, en se mettant devant sa machine, tuer son âme pour 8 heures par jour, sa pensée, ses sentiments, tout. Est-on irrité, triste ou dégoûté, il faut ravaler, refouler tout au fond de soi, irritation, tristesse ou dégoût : ils ralentiraient la cadence. Et la joie de même. Les ordres : depuis qu'on pointe en entrant jusqu'à ce qu'on pointe en sortant, on peut à chaque moment recevoir n'importe quel ordre. Et toujours il faut se taire et obéir. L'ordre peut être pénible ou dangereux à exécuter, ou même inexécutable ; ou bien deux chefs donner des ordres contradictoires ; ça ne fait rien : se taire et plier. Adresser la parole à un chef – même pour une chose indispensable – c'est toujours, même si c'est un brave type (même les braves types ont des moments d'humeur) s'exposer à se faire rabrouer ; et quand ça arrive, il faut encore se taire. Quant à ses propres accès d'énervement et de mauvaise humeur, il faut les ravaler ; ils ne peuvent se traduire ni en paroles ni en gestes, car les gestes sont à chaque instant déterminés par le travail. Cette situation fait que la pensée se recroqueville, se rétracte, comme la chair se rétracte devant un bistouri. On ne peut pas être « conscient ».
Tout ça, c'est pour le travail non qualifié, bien entendu. (Surtout celui des femmes.)
Et à travers tout ça un sourire, une parole de bonté, un instant de contact humain ont plus de valeur que les amitiés les plus dévouées parmi les privilégiés grands ou petits. Là seulement on sait ce que c'est que la fraternité humaine. Mais il y en a peu, très peu. Le plus souvent, les rapports même entre camarades reflètent la dureté qui domine tout là-dedans.
Allons, assez bavardé. J'écrirais des volumes sur tout ça.
S. W.
Je voulais te dire aussi : le passage de cette vie si dure à ma vie actuelle, je sens que ça me corrompt. Je comprends ce que c'est qu'un ouvrier qui devient « permanent », maintenant. Je réagis tant que je peux. Si je me laissais aller, j'oublierais tout, je m'installerais dans mes privilèges sans vouloir penser que ce sont des privilèges. Sois tranquille, je ne me laisse pas aller. À part ça, j'y ai laissé ma gaieté, dans cette existence ; j'en garde au cœur une amertume ineffaçable. Et quand même, je suis heureuse d'avoir vécu ça.
Garde cette lettre – je te la redemanderai peut-être si, un jour, je veux rassembler tous mes souvenirs de cette vie d'ouvrière. Pas pour publier quelque chose là-dessus (du moins je ne pense pas), mais pour me défendre moi-même de l'oubli. C'est difficile de ne pas oublier, quand on change si radicalement de manière, de vivre.
Lettre à une élève (1934)
Chère petite,
Il y a longtemps que je veux vous écrire, mais le travail d'usine n'incite guère à la correspondance. Comment avez-vous su ce que je faisais ? Par les sœurs Dérieu, sans doute ? Peu importe, d'ailleurs, car je voulais vous le dire. Vous, du moins, n'en parlez pas, même pas à Marinette, si ce n'est déjà fait. C'est ça le « contact avec la vie réelle » dont je vous parlais. Je n'y suis arrivée que par faveur ; un de mes meilleurs copains connaît l'administrateur délégué de la Compagnie, et lui a expliqué mon désir ; l'autre a compris, ce qui dénote une largeur d'esprit tout à fait exceptionnelle chez cette espèce de gens. De nos jours, il est presque impossible d'entrer dans une usine sans certificat de travail – surtout quand on est, comme moi, lent, maladroit et pas très costaud.
Je vous dis tout de suite – pour le cas où vous auriez l'idée d'orienter votre vie dans une direction semblable – que, quel que soit mon bonheur d'être arrivée à travailler en usine, je ne suis pas moins heureuse de n'être pas enchaînée à ce travail. J'ai simplement pris une année de congé « pour études personnelles ». Un homme, s'il est très adroit, très intelligent et très costaud, peut à la rigueur espérer, dans l'état actuel de l'industrie française, arriver dans l'usine à un poste où il lui soit permis de travailler d'une manière intéressante et humaine ; et encore les possibilités de cet ordre diminuent de jour en jour avec les progrès de la rationalisation. Les femmes, elles, sont parquées dans un travail tout à fait machinal, où on ne demande que de la rapidité. Quand je dis machinal, ne croyez pas qu'on puisse rêver à autre chose en le faisant, encore moins réfléchir. Non, le tragique de cette situation, c'est que le travail est trop machinal pour offrir matière à la pensée, et que néanmoins il interdit toute autre pensée. Penser, c'est aller moins vite ; or il y a des normes de vitesse, établies par des bureaucrates impitoyables, et qu'il faut réaliser, à la fois pour ne pas être renvoyé et pour gagner suffisamment (le salaire étant aux pièces). Moi, je n'arrive pas encore à les réaliser, pour bien des raisons : le manque d'habitude, ma maladresse naturelle, qui est considérable, une certaine lenteur naturelle dans les mouvements, les maux de tête, et une certaine manie de penser dont je n'arrive pas à me débarrasser... Aussi je crois qu'on me mettrait à la porte sans une protection d'en haut. Quant aux heures de loisir, théoriquement on en a pas mal, avec la journée de 8 heures ; pratiquement elles sont absorbées par une fatigue qui va souvent jusqu'à l'abrutissement. Ajoutez, pour compléter le tableau, qu'on vit à l'usine dans une subordination perpétuelle et humiliante, toujours aux ordres des chefs. Bien entendu, tout cela fait plus ou moins souffrir, selon le caractère, la force physique, etc. ; il faudrait des nuances ; mais enfin, en gros, c'est ça.
Ça n'empêche pas que – tout en souffrant de tout cela – je suis plus heureuse que je ne puis dire d'être là où je suis. Je le désirais depuis je ne sais combien d'années, mais je ne regrette pas de n'y être arrivée que maintenant, parce que c'est maintenant seulement que je suis en état de tirer de cette expérience tout le profit qu'elle comporte pour moi. J'ai le sentiment, surtout, de m'être échappée d'un monde d'abstractions et de me trouver parmi des hommes réels – bons ou mauvais, mais d'une bonté ou d'une méchanceté véritable. La bonté surtout, dans une usine, est quelque chose de réel quand elle existe ; car le moindre acte de bienveillance, depuis un simple sourire jusqu'à un service rendu, exige qu'on triomphe de la fatigue, de l'obsession du salaire, de tout ce qui accable et incite à se replier sur soi. De même la pensée demande un effort presque miraculeux pour s'élever au-dessus des conditions dans lesquelles on vit. Car ce n'est pas là comme à l'université, où on est payé pour penser ou du moins pour faire semblant ; là, la tendance serait plutôt de payer pour ne pas penser ; alors, quand on aperçoit un éclair d'intelligence, on est sûr qu'il ne trompe pas. En dehors de tout cela, les machines par elles-mêmes m'attirent et m'intéressent vivement. J'ajoute que je suis en usine principalement pour me renseigner sur un certain nombre de questions fort précises qui me préoccupent, et que je ne puis vous énumérer.
Assez parlé de moi. Parlons de vous. Votre lettre m'a effrayée. Si vous persistez à avoir pour principal objectif de connaître toutes les sensations possibles – car, comme état d'esprit passager, c'est normal à votre âge -vous n'irez pas loin. J'aimais bien mieux quand vous disiez aspirer à prendre contact avec la vie réelle. Vous croyez peut-être que c'est la même chose ; en fait, c'est juste le contraire. Il y a des gens qui n'ont vécu que de sensations et pour les sensations ; André Gide en est un exemple. Ils sont en réalité les dupes de la vie, et, comme ils le sentent confusément, ils tombent toujours dans une profonde tristesse où il ne leur reste d'autre ressource que de s'étourdir en se mentant misérablement à eux-mêmes. Car la réalité de la vie, ce n'est pas la sensation, c'est l'activité – j'entends l'activité et dans la pensée et dans l'action. Ceux qui vivent de sensations ne sont, matériellement et moralement, que des parasites par rapport aux hommes travailleurs et créateurs, qui seuls sont des hommes. J'ajoute que ces derniers, qui ne recherchent pas les sensations, en reçoivent néanmoins de bien plus vives, plus profondes, moins artificielles et plus vraies que ceux qui les recherchent. Enfin la recherche de la sensation implique un égoïsme qui me fait horreur, en ce qui me concerne. Elle n'empêche évidemment pas d'aimer, mais elle amène à considérer les êtres aimés comme de simples occasions de jouir ou de souffrir, et à oublier complètement qu'ils existent par eux-mêmes. On vit au milieu de fantômes. On rêve au lieu de vivre.
En ce qui concerne l'amour, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais au moins des avertissements. L'amour est quelque chose de grave où l'on risque souvent d'engager à jamais et sa propre vie et celle d'un autre être humain. On le risque même toujours, à moins que l'un des deux ne fasse de l'autre son jouet ; mais en ce dernier cas, qui est fort fréquent, l'amour est quelque chose d'odieux. Voyez-vous, l'essentiel de l'amour, cela consiste en somme en ceci qu'un être humain se trouve avoir un besoin vital d'un autre être – besoin réciproque ou non, durable ou non, selon les cas. Dès lors le problème est de concilier un pareil besoin avec la liberté, et les hommes se sont débattus dans ce problème depuis des temps immémoriaux. C'est pourquoi l'idée de rechercher l'amour pour voir ce que c'est, pour mettre un peu d'animation dans une vie trop morne, etc., me paraît dangereuse et surtout puérile. Je peux vous dire que quand j'avais votre âge, et plus tard aussi, et que la tentation de chercher à connaître l'amour m'est venue, je l'ai écartée en me disant qu'il valait mieux pour moi ne pas risquer d'engager toute ma vie dans un sens impossible à prévoir avant d'avoir atteint un degré de maturité qui me permette de savoir au juste ce que je demande en général à la vie, ce que j'attends d'elle. Je ne vous donne pas cela comme un exemple ; chaque vie se déroule selon ses propres lois. Mais vous pouvez y trouver matière à réflexion. J'ajoute que l'amour me paraît comporter un risque plus effrayant encore que celui d'engager aveuglément sa propre existence ; c'est le risque de devenir l'arbitre d'une autre existence humaine, au cas où on est profondément aimé. Ma conclusion (que je vous donne seulement à titre d'indication) n'est pas qu'il faut fuir l'amour, mais qu'il ne faut pas le rechercher, et surtout quand on est très jeune. Il vaut bien mieux alors ne pas le rencontrer, je crois.
Il me semble que vous devriez pouvoir réagir contre l'ambiance. Vous avez le royaume illimité des livres ; c'est loin d'être tout, mais c'est beaucoup, surtout à titre de préparation à une vie plus concrète. Je voudrais aussi vous voir vous intéresser à votre travail de classe, où vous pouvez apprendre beaucoup plus que vous ne croyez. D'abord à travailler : tant qu'on est incapable de travail suivi, on n'est bon à rien dans aucun domaine. Et puis vous former l'esprit. Je ne vous recommence pas l'éloge de la géométrie. Quant à la physique, vous ai-je suggéré l'exercice suivant ? C'est de faire la critique de votre manuel et de votre cours en essayant de discerner ce qui est bien raisonné de ce qui ne l'est pas. Vous trouverez ainsi une quantité surprenante de faux raisonnements. Tout en s'amusant à ce jeu, extrêmement instructif, la leçon se fixe souvent dans la mémoire sans qu'on y pense. Pour l'histoire et la géographie, vous n'avez guère à ce sujet que des choses fausses à force d'être schématiques; mais si vous les apprenez bien, vous vous donnerez une base solide pour acquérir ensuite par vous-même des notions réelles sur la société humaine dans le temps et dans l'espace, chose indispensable à quiconque se préoccupe de la question sociale. Je ne vous parle pas du français, je suis sûre que votre style se forme.
J'ai été très heureuse quand vous m'avez dit que vous étiez décidée à préparer l'école normale ; cela m'a libérée d'une préoccupation angoissante. Je regrette d'autant plus vivement que cela semble être sorti de votre esprit..
Je crois que vous avez un caractère qui vous condamne à souffrir beaucoup toute votre vie. J'en suis même sûre. Vous avez trop d'ardeur et trop d'impétuosité pour pouvoir jamais vous adapter à la vie sociale de notre époque. Vous n'êtes pas seule ainsi. Mais souffrir, cela n'a pas d'importance, d'autant que vous éprouverez aussi de vives joies. Ce qui importe, c'est de ne pas rater sa vie. Or, pour ça, il faut se discipliner.
Je regrette beaucoup que vous ne puissiez pas faire de sport : c'est cela qu'il vous faudrait. Faites encore effort pour persuader vos parents. J'espère, au moins, que les vagabondages joyeux à travers les montagnes ne vous sont pas interdits. Saluez vos montagnes pour moi.
Je me suis aperçue, à l'usine, combien il est paralysant et humiliant de manquer de vigueur, d'adresse, de sûreté dans le coup d'œil. À cet égard, rien ne peut suppléer, malheureusement pour moi, à ce qu'on n'a pas acquis avant 20 ans. Je ne saurais trop vous recommander d'exercer le plus que vous pouvez vos muscles, vos mains, vos yeux. Sans un pareil exercice, on se sent singulièrement incomplet.
Écrivez-moi, mais n'attendez de réponse que de loin en loin. Écrire me coûte un effort excessivement pénible. Écrivez-moi 228, rue Lecourbe, Paris, XV e. J'ai pris une petite chambre tout près de mon usine.
Jouissez du printemps, humez l'air et le soleil (s'il y en a), lisez de belles choses.
[i] (en grec dans le texte)
S. WEIL.
Lettre à Boris Souvarine (1935)
Vendredi.
Cher Boris, je me contrains à vous écrire quelques lignes, parce que sans cela je n'aurais pas le courage de laisser une trace écrite des premières impressions de ma nouvelle expérience. La soi-disant petite boîte sympathique s'est avérée être, au contact, d'abord une assez grande boîte, et puis surtout une sale, une très sale boîte. Dans cette sale boîte, il y a un atelier particulièrement dégoûtant : c'est le mien. Je me hâte de vous dire, pour vous rassurer, que j'en ai été tirée à la fin de la matinée, et mise dans un petit coin tranquille où j'ai des chances de rester toute la semaine prochaine, et où je ne suis pas sur une machine.
Hier, j'ai fait le même boulot toute la journée (emboutissage à une presse). Jusqu'à 4 h j'ai travaillé au rythme de 400 pièces à l'heure (j'étais à l'heure, remarquez, avec salaire de 3 F), avec le sentiment que je travaillais dur. À 4 h, le contremaître est venu me dire que si je n'en faisais pas 800 il me renverrait : « Si, à partir de maintenant vous en faites 800, je consentirai peut-être à vous garder. » Vous comprenez, on nous fait une grâce en nous permettant de nous crever, et il faut dire merci. J'ai tendu toutes mes forces, et suis arrivée à 600 à l'heure. On m'a quand même laissée revenir ce matin (ils manquent d'ouvrières, parce que la boîte est trop mauvaise pour que le personnel y soit stable, et qu'il y a des commandes urgentes pour les armements). J'ai fait ce boulot 1 h encore, en me tendant encore un peu plus, et ai fait un peu plus de 650. On m'a fait faire diverses autres choses, toujours avec la même consigne, à savoir y aller à toute allure. Pendant 9 h par jour (car on rentre à 1 h, non 1 h 1/4 comme je vous l'avais dit) les ouvrières travaillent ainsi, littéralement sans une minute de répit. Si on change de boulot, si on cherche une boîte, etc., c'est toujours en courant. Il y a une chaîne (c'est la première fois que j'en vois une, et cela m'a fait mal) où on a, m'a dit une ouvrière, doublé le rythme depuis 4 ans ; et aujourd'hui encore le contremaître a remplacé une ouvrière de la chaîne à sa machine et a travaillé 10 mn à toute allure (ce qui est bien facile quand on se repose après) pour lui prouver qu'elle devait aller encore plus vite. Hier soir, en sortant, j'étais dans un état que vous pouvez imaginer (heureusement les maux de tête du moins me laissaient du répit) ; au vestiaire, j'ai été étonnée de voir que les ouvrières étaient encore capables de babiller, et ne semblaient pas avoir au cœur la rage concentrée qui m'avait envahie. Quelques-unes pourtant (2 ou 3) m'ont exprimé des sentiments de cet ordre. Ce sont celles qui sont malades, et ne peuvent pas se reposer. Vous savez que le pédalage exigé par les presses est quelque chose de très mauvais pour les femmes ; une ouvrière m'a dit qu'ayant eu une salpingite, elle n'a pas pu obtenir d'être mise ailleurs que sur les presses. Maintenant, elle est enfin ailleurs qu'aux machines, mais la santé définitivement démolie.
En revanche, une ouvrière qui est à la chaîne, et avec qui je suis rentrée en tram, m'a dit qu'au bout de quelques années, ou même d'un an, on arrive à ne plus souffrir, bien qu'on continue à se sentir abrutie. C'est à ce qu'il me semble le dernier degré de l'avilissement. Elle m'a expliqué comment elle et ses camarades étaient arrivées à se laisser réduire à cet esclavage (je le savais bien, d'ailleurs). Il y a 5 ou 6 ans, m'a-t-elle dit, on se faisait 70 F par jour, et « pour 70 F on aurait accepté n'importe quoi, on se serait crevé ». Maintenant encore certaines qui n'en ont pas absolument besoin sont heureuses d'avoir, à la chaîne, 4 F l'heure et des primes. Qui donc, dans le mouvement ouvrier ou soi-disant tel, a eu le courage de penser et de dire, pendant la période des hauts salaires, qu'on était en train d'avilir et de corrompre la classe ouvrière ? Il est certain que les ouvriers ont mérité leur sort : seulement la responsabilité est collective, et la souffrance est individuelle. Un être qui a le cœur bien placé doit pleurer des larmes de sang s'il se trouve pris dans cet engrenage.
Quant à moi, vous devez vous demander ce qui me permet de résister à la tentation de m'évader, puisque aucune nécessité ne me soumet à ces souffrances. Je vais vous l'expliquer : c'est que même aux moments où véritablement je n'en peux plus, je n'éprouve à peu près pas de pareille tentation. Car ces souffrances, je ne les ressens pas comme miennes, je les ressens en tant que souffrances des ouvriers, et que moi, personnellement, je les subisse ou non, cela m'apparaît comme un détail presque indifférent. Ainsi le désir de connaître et de comprendre n'a pas de peine à l'emporter.
Cependant, je n'aurais peut-être pas tenu le coup si on m'avait laissé dans cet atelier infernal. Dans le coin où je suis maintenant, je suis avec des ouvriers qui ne s'en font pas. Je n'aurais jamais cru que d'un coin à l'autre d'une même boîte il puisse y avoir de pareilles différences.
Allons, assez pour aujourd'hui. Je regrette presque de vous avoir écrit. Vous êtes assez malheureux sans que j'aille encore vous entretenir de choses tristes.
Affectueusement.
S. W.
Fragment de lettre à X (1933-1934 ?)
Monsieur,
J'ai tardé à vous répondre, parce que le rendez-vous s'arrange mal. Je ne pourrais être à Moulins qu'assez tard dans l'après-midi du lundi (vers 4 h), et je repartirais à 9 h. Si vos occupations là-bas vous permettent de me consacrer quelques heures dans cet intervalle, je viendrai. Vous n'auriez qu'à me fixer en ce cas un rendez-vous précis en tenant compte que je ne connais pas Moulins. J'espère que cela s'arrangera. Je crois que nous aurons avantage à causer plutôt qu'à écrire.
C'est pourquoi je préfère réserver pour notre prochaine rencontre ce qui m'est venu à l'esprit à la lecture de vos lettres. Je veux seulement signaler une incertitude qui m'avait déjà inquiétée en écoutant votre conférence.
Vous dites : Tout homme est opérateur de séries et animateur de suites.
Tout d'abord il faudrait, ce me semble, distinguer diverses espèces de rapports entre l'homme et les suites qui interviennent dans son existence, selon qu'il joue un rôle plus ou moins actif à leur égard. Un homme peut créer des suites (inventer... ) – il peut en recréer par la pensée – il peut en exécuter sans les penser – il peut servir d'occasion à des suites pensées, exécutées par d'autres – etc. Mais c'est là quelque chose d'évident.
Voici ce qui m'inquiète un peu. Quand vous dites que, par exemple, le manœuvre spécialisé, une fois sorti de l'usine, cesse d'être emprisonné dans le domaine de la série, vous avez évidemment raison. Mais qu'en concluez-vous ? Si vous en concluez que tout homme, si opprimé soit-il, conserve encore quotidiennement l'occasion de faire acte d'homme, et donc ne dépouille jamais tout à fait sa qualité d'homme, très bien. Mais si vous en concluez que la vie d'un manœuvre spécialisé de chez Renault ou Citroën est une vie acceptable pour un homme désireux de conserver la dignité humaine, je ne puis vous suivre. Je ne crois d'ailleurs pas que ce soit là votre pensée – je suis même convaincue du contraire – mais j'aimerais le maximum de précision sur ce point.
« La quantité se change en qualité », disent les marxistes après Hegel. Les séries et les suites ont place dans chaque vie humaine, c'est entendu, mais il y a une question de proportion, et on peut dire en gros qu'il y a une limite à la place que peut tenir la série dans une vie d'homme sans le dégrader.
Au reste je pense que nous sommes d'accord là-dessus.
……………………………………………………………...
(en grec dans le texte) [1]