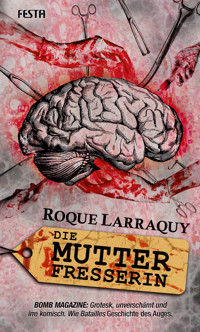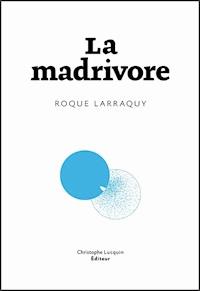
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Christophe Lucquin Éditeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un roman à l’écriture acérée.
Que faire des cadavres, des restes du passé ? C'est une question que pose ce roman, et à laquelle il répond se donnant pour titre le nom de cette effroyable plante imaginaire : la madrivore.
Le roman se divise en deux récits qui se déroulent chacun à une période différente. Le premier a lieu au début du XXe siècle, plus exactement en 1907, dans la clinique de Temperley, dans la banlieue de Buenos Aires. Plusieurs personnages interviennent, des médecins et des infirmières. Toute cette équipe évolue sous les ordres d’un directeur de clinique plutôt barré, Mr Allomby. Ce dernier souhaite mener à terme une expérience exceptionnelle et absolument poétique à ses yeux, mais qui nous semble plutôt folle et cruelle. Le docteur Quintana nous fait le récit des événements (par la même occasion, il confesse sa folle attirance pour l’infirmière en chef, Menéndez) et l’escalade de ce que l’on pourrait qualifier d’horreur, l’expérience : une série de décapitations à la guillotine avec pour but de relever par écrit les dernières paroles prononcées par les têtes coupées au cours des neuf secondes de conscience qui suivent la décapitation. Mais pour cela, il faut trouver des cobayes humains.
Roman sur la frénésie d’expérimentation de la science du début du XXe siècle.
EXTRAIT
Il existe, semble-t-il, une relation directe entre la tristesse et la décalcification, que la plupart des enfants ignore et qui, petit à petit, les laisse la bouche vide s’ils se laissent gagner par l’obscurité. Les dents se déchaussent, les gencives cèdent, jusqu’au jour où l’on en perd une en mordant doucement dans une pêche. Alors on arrête de sourire et la tristesse se fait plus grande, le calcium diminue, et le reste s’effondre. Mes dents de lait tombent toutes en même temps et les définitives mettent des années à sortir. On me fait manger en conséquence. De la bouillie. Mes os deviennent fragiles : si quelqu’un me touche, il me pulvérise. J’oublie ce qu’est un sandwich. Exister, c’est pouvoir mastiquer ; tandis que j’attends mon tour pour exister, on m’envoie étudier le piano, mais je suis bien médiocre. Peut-être que j’utilise la mauvaise moitié de moi.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
- « Un roman bicéphale étayé par deux récits siamois, autonomes mais interconnectés par de subtils filaments nerveux... »
(Les Inrockuptibles)
- «
La madrivore de Roque Larraquy : un sens de l'absurde à perdre la tête. » (Anaïs Heluin, Politis)
A PROPOS DE L’AUTEUR
Roque Larraquy est né à Buenos Aires en 1975. Il est scénariste pour la télévision et le cinéma et professeur à l’université. La madrivore (publié en 2010 aux éditions Entropía, Buenos Aires) est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La madrivore
Que faire des cadavres, des restes du passé ? C'est une question que pose ce roman, et à laquelle il répond se donnant pour titre le nom de cette effroyable plante imaginaire : la madrivore.La madrivore
Roque Larraquy
Christophe Lucquin Editeur
1907
1
Temperley, province de Buenos Aires, 1907
Il y en a qui n’existent pas, ou presque pas, comme mademoiselle Menéndez. L’infirmière en chef. Elle incarne parfaitement ces mots. Les femmes placées sous ses ordres ont toutes la même odeur, les mêmes vêtements, et nous appellent docteur. Si l’état de santé d’un patient se dégrade à cause d’un oubli ou d’une piqûre de trop, elles deviennent soudainement très présentes : elles existent dans l’erreur. En revanche, Menéndez ne fait jamais de faux pas, c’est pour ça que c’est la chef.
Dès que je peux, je la regarde pour trouver en elle un geste familier, un secret, une imperfection.
J’ai trouvé. Ce sont les cinq minutes de Menéndez. Elle s’appuie sur la rambarde et allume une cigarette. Comme elle ne lève jamais les yeux, elle ne se rend pas compte que je l’observe. À son visage, on dirait qu’elle ne pense à rien, elle a l’air d’une bouteille vide. Elle fume pendant cinq minutes. Ce laps de temps ne lui suffit pas pour finir sa cigarette et elle en laisse la moitié. Son caprice, son luxe personnel, c’est de l’éteindre avec le doigt mouillé de salive et de la jeter à la poubelle. Elle ne fume que de nouvelles cigarettes. C’est ainsi qu’elle apparaît au monde tous les jours, à la même heure, et cela me suffit pour tomber amoureux d’elle.
Mes collègues sont nombreux et je n’arrive pas encore à tous les identifier. Il y a un type robuste avec un grain de beauté sur le menton qui me salue tout le temps. Ce grain de beauté est le seul détail qui me permet de le reconnaître. Je ne sais ni comment il s’appelle, ni quelle est sa spécialité. Une partie de son visage est plus tombante que l’autre et, chaque fois qu’il parle, je ne sais pas bien de quoi, il plisse les yeux comme s’il était ébloui.
Chaque mot prononcé par Silvia est une mouche qui sort de sa bouche. Elle devrait la fermer pour de ne pas en augmenter le nombre. Je la plonge dans l’eau glacée. Quand je retire ma main, elle sort la tête de l’eau, reprend son souffle et demande à nouveau : « Vous ne voyez pas que les mouches sortent de moi ? ». Que je ne les voie pas l’ennuie bien plus que le froid. Je ne comprends toujours pas pourquoi on me l’a confiée. Je ne suis pas psychiatre. Je suis sûr que l’eau glacée n’a d’autre effet que de l’exposer à une pneumonie. Mais ce qui importe dans ce genre de cas, c’est de constater la persistance du délire qui, avec le froid, devrait s’apaiser. Je lui promets un lit tiède. Il faut prendre note du moindre changement : si elle préfère rester silencieuse, si elle réclame sa famille (elle n’en a pas, mais ce serait un délire plus salutaire), s’il n’y a plus de mouches. Elle les voit se dissoudre sur le plafond.
Tu ne penses pas à des choses d’infirmière. Pendant tes cinq minutes de cigarette, avec cet air vide, comme si tu n’étais pas une femme mais ton métier de femme, tu penses à autre chose qu’à des cathéters et des sérums, à des choses qui n’ont pas de forme.
La voilà. Elle traîne une nuée d’infirmières qui lui demandent de l’aide, un conseil, des dossiers médicaux, des produits de nettoyage.
J’ai les cheveux gominés. J’approche. Faire fuir la nuée est chose aisée. Elles s’écartent pour ne pas violer mon espace intime. Nous les docteurs, nous jouissons de ce droit corporel que les infirmières, assignées aux lavements et aux thermomètres, ne respectent quasiment jamais.
— Menéndez !
— Oui, docteur Quintana ?
C’est beau de l’entendre dire mon nom. Je lui donne quelques instructions.
La clinique se trouve dans la banlieue de Temperley, à quelques kilomètres de Buenos Aires. Le pic d’activité est atteint en journée avec une trentaine de patients en moyenne. Le service de nuit, désolant, est placé sous ma responsabilité depuis un an. Mes patients sont des hommes qui jouent du couteau dans un foyer tout proche et apprécient notre discrétion devant la loi. Les infirmières les craignent. Elles empruntent, avant la tombée de la nuit, le chemin qui traverse le parc. Je ne me souviens pas avoir vu sortir Menéndez. Elle est toujours là. Habite-t-elle la clinique ? Je note : poser la question.
La nuit tombe et il n’y a rien à faire. Si ce n’est arpenter les couloirs, chercher à bavarder ou à jouer aux cartes, réussir à faire un carré dans la soirée. Une infirmière est adossée contre le mur, les mains dans les poches. Sa collègue fixe le sol.
Le docteur Papini se dirige vers moi en trottinant, l’index sur la bouche pour réclamer mon silence. Il a des tâches de rousseur et l’habitude de tripoter les seins des vielles dames évanouies. Parfois, il me raconte quelques indiscrétions sur sa vie ; son manque de pudeur, intentionnel, me dégoûte un peu. Il me conduit vers une petite salle.
— Vous savez ce qu’il y a dans la morgue, Quintana ?
— Le vin rouge que vous avez caché mardi.
— Non, il n’y en a plus. Nous avons donné quel-ques bouteilles à la femme de ménage pour qu’elle la ferme. Venez avec moi.
Papini ouvre un tiroir. Il en sort un instrument anthropométrique qu’il a acheté il y a un mois sur le Paseo de Julio et qu’il n’a jamais pu utiliser dans l’enceinte de la clinique, ordre de Ledesma. Il est en sueur, exophtalmique et sent le citron. Cela montre qu’il est heureux, ou qu’il croit être heureux. Sa personnalité se fonde sur ce genre de choses.
— Il se passe des choses bizarres, Quintana. Les femmes s’enferment dans la salle de bains et se servent du bidet des heures durant. Quand elles sortent de là, elles ne pipent pas mot. Je vous assure que ce rituel n’a rien à voir avec l’hygiène ou la masturbation. J’ai moi-même écarté les jambes de mon épouse, je l’ai reniflée, et rien. Elle m’a dit qu’elle s’était lavé les dents. Mais je l’ai entendue, moi ! Le bruit de l’eau du bidet ne prête pas à confusion ! Je ne suis pas capable de grand-chose, mon ami, et encore moins de tuer mon épouse. Mais certains peuvent passer à l’acte, comprenez-vous, obliger leur femme à avouer, parce que ce rituel d’eau et de faïence représente une menace pour l’homme. Les femmes se maquillent pour effacer leur visage, elles se boudinent dans un corset et ont beaucoup d’orgasmes, vous savez ? Une quantité à nous couper le souffle. Elles sont différentes. Elles descendent d’un singe en particulier, qui était jadis une loutre, qui avant fut un amphibien bleuté, ou une chose avec des branchies. La forme de leur tête est différente aussi. Elles s’enferment pour se servir du bidet et penser à des choses humides adaptées aux courbures de leur crâne. La menace. Moi je suis un homme gentil, je n’ai pas le cran d’empêcher la menace. Mais d’autres en sont capables. Ils les attrapent par les cheveux et leur demandent des explications quant à ces heures passées au bidet. Et si elles ne coopèrent pas, ils les découpent au couteau. Ces hommes sont aussi différents de nous que d’elles. Ils descendent d’un singe encore à part, d’un rang qui, bien qu’inférieur au nôtre, reste sain et persistant. Il y en a un à la morgue. Allons le mesurer. Je vais vous prouver que son crâne répond aux critères d’un atavique, d’un assassin-né. Il faut le faire maintenant parce que, demain, ils l’emmènent. Vous, vous êtes intelligent, mais un peu têtu. Je vais vous remplir la tête de preuves.
— Le type a tué sa femme, parce qu’elle ne lui a pas dit ce qu’elle faisait avec le bidet ?
— C’est une métaphore, Quintana.
Alors que nous sortons dans le couloir, il me vient à l’esprit qu’il n’y a pas de bidet dans les salles de bains de la clinique : Menéndez ne peut rien me cacher. Pas ce genre de pensées dégoulinantes. Elle ne peut pas non plus m’exposer à la menace. Papini parle de plus en plus vite, il se dirige vers la morgue en laissant son odeur de citron derrière lui.
— Le fameux écart qualitatif, Quintana. Nous bâtissons des projets ambitieux qui, s’ils étaient menés à terme, transformeraient totalement notre vie. Mais ces projets tombent à l’eau le jour venu et l’on redevient l’être médiocre qui se gâche la vie obstinément. Ça ne vous arrive jamais ? Ces hommes sont différents. Pourquoi pensez-vous qu’ils continuent d’exister s’ils sont inférieurs à nous ? C’est une question d’adaptation : eux font. Ce qu’ils projettent la nuit, ils l’exécutent le lendemain. Ils sont vicieux, aussi. Ils abusent du gel, empestent le tabac, transpirent de la bile, se masturbent beaucoup et n’ont pas de morale, mais ils ont une éthique, que ni vous ni moi ne pouvons comprendre, qui est en lien avec notre anéantissement. Vous comprenez ?
— Comment savoir s’ils se mettent trop de gel ?
— Vous prenez mes paroles beaucoup trop au pied de la lettre, Quintana.
Nous entrons dans la morgue, l’endroit le mieux éclairé de la clinique. Avec ses tâches de rousseur, Papini ressemble à un pubère un peu entamé. Si les hommes qu’il vient de me décrire existent, lui en est un. Le corps est sur la table funéraire. Menéndez ne doit jamais me voir sous cette lumière.
— Ses compagnons de cellule l’ont pendu. Vous ne voyez pas l’expression de ses yeux et leur couleur ? Et voici la trace violacée sur son cou. Regardez ce front comme il est étroit. Crâne asymétrique, plus petit que la moyenne caucasienne, présentant une convexité dans la région tempo-pariétale droite. Ses idées devaient être bien étriquées. Quelle énergie faciale faut-il pour bouger une mâchoire pareille ? Comparez donc, Quintana. Vous, vous n’êtes pas ce que l’on appelle un bel homme, mais vous avez les traits à leur place. Les couilles je ne sais pas, mais vous devez le savoir non ? Chacun fait ce qu’il veut avec ses couilles. Regardez-le, lui : il a l’œil gauche trois ou quatre millimètres en dessous du droit, des oreilles énormes, des canines inférieures plus développées que les supérieures. Il ne mâchait pas, il déchirait la viande. Tenez son pied, Quintana, pliez-lui le genou. Vous voyez ? Pied préhensile. Un homme avec une petite tête pour ne pas se compliquer les choses, poilu, doté d’une dentition capable de vous casser le fémur d’une seule morsure... Vous vous rendez compte ? Dans quelques années nous allons pouvoir identifier ces animaux tout juste sortis du ventre de leurs mères, et leur vider les burnes, si ce sont des hommes, ou leur retirer l’utérus, si ce sont des femmes.
— Pourquoi ne pas les tuer directement ?
— Vous ne me prenez pas au sérieux, Quintana.
— Je ne voudrais pas vous offenser, Papini. Cet homme est un cas isolé.
— Alors on vous mesure, vous et votre tête dure. Ou on trouve quelqu’un d’autre pour comparer.
— Mesurons mademoiselle Menéndez.
Elle entre dans mon bureau, accompagnée de Papini. Elle sait que cette entrevue ne rentre pas dans ses obligations de service. On le lit sur son visage, qui n’est pas celui qu’on lui connaît, et sur son corps, tout en retenue.
Les explications sont ténues, imprécises. Elle comprend que sa tête est en jeu, mais ignore que Papini espère en faire une criminelle (ou non, n’importe quel résultat fera l’affaire) et moi une épouse. Elle s’assoit sur une chaise et se laisse mesurer. Elle a la peau très blanche, les yeux clairs et une légère inclinaison du nez. Sa réaction face à la douleur (Papini est en train de lui pincer un doigt) est modérée.
Je n’ose pas lui parler. Quel singe gît au fond de mademoiselle Menéndez ? Aucun, selon moi. Je suis disposé à croire qu’elle a eu un passé amphibie, mais rien d’autre.
Je regarde par la fenêtre. Une file de fourmis sort d’une fissure du mur. Elles avancent en dessinant un grand cercle. Les premières restent au bord, et les autres comblent les espaces vides du cercle jusqu’à ce qu’il n’y ait plus sur le mur ni fissure ni fourmis, seulement une tâche chitineuse, craquante de pattes. Je suppose que cette circularité est leur vision du monde.
Je trouve Silvia assise sur le lit. Elle me demande d’ouvrir la fenêtre et m’interroge sur le temps qu’il fait. Il fait froid. La nouvelle la réjouit : les mouches fuient le froid. Elle continue à parler des mouches. Je pense, entre parenthèses, à Menéndez. Les deux lignes courbes se referment dans ma tête. Et voilà Menéndez enfermée dans ma tête et ma tête dans la parenthèse...
Devrais-je me laisser aller à ces intrusions, à ces fantaisies ? Est-ce salutaire ? Je ne connais même pas son surnom. Pourquoi est-ce que je rougis ? N’ai-je pas honte ?
Il faut faire comme l’autre singe. Concrétiser le jour ce que l’on a projeté la nuit.
— Tu es déjà tombée amoureuse, Silvia ?
Elle parle de se couvrir de mouches, mais accepte facilement de changer de sujet de conversation.
— Oui, je suis tombée amoureuse.
— De qui ?
— Je préfère ne pas vous le dire, docteur.
— C’était un amour réciproque ?
— Oui.
— Et comment s’y est pris cet homme pour te déclarer sa flamme ?
— Il m’a dit : « Silvia, je pense à vous. »
— Il t’a menti.
Où est-elle ? Il faut que ce soit maintenant. Avant que je ne sache plus quoi lui dire. Ce n’est pas que je le sache déjà, mais j’ai l’élan pour le faire. Le médecin au grain de beauté me dit que Menéndez se trouve dans la clinique, mais qu’il ne sait pas où, et que, si elle est dans sa chambre, mieux vaut ne pas la déranger.
Comment peut-elle vivre dans une clinique ?
Je la vois entrer dans le bureau de Ledesma et marche dans sa direction comme un aimant, mais l’un des goujats qui est à l’intérieur, ou elle-même, me claque la porte au nez.
On me rappelle qu’il y a une réunion exceptionnelle. Nous nous entassons près de la porte du bureau de Ledesma. Je dois patienter comme les autres. Mes collègues s’agrappent. Le docteur Gigena est un enthousiaste, il porte des lunettes et on dit qu’il est le médecin le plus apprécié des patients parce qu’il leur raconte des blagues pendant les injections. Les docteurs Gurian et Sisman pensent que l’obstination de Gigena à se comporter comme le gentil tonton des malades entache son professionnalisme. Papini blague sur le sujet.
D’autres médecins arrivent. Nos ventres commencent à se frôler, nos boutons à s’accrocher, nos moustaches à se dresser électriquement. Nous continuerions bien ainsi, à nous tripoter discrètement pour faire passer le temps, mais l’arrivée de Mister Allomby, duquel dépend notre salaire, nous met au garde-à-vous. Il n’est pas fréquent de le voir à la clinique. La réunion devrait être plus importante que prévu. La queue entre les jambes, il nous faudra préparer la potence.
Quelqu’un le salue en anglais. Avec une très mauvaise prononciation. Craignant de salir son aura, nous fronçons le nombril et nous entassons encore plus. Mais cette fois de manière désordonnée, si bien qu’un clampin trébuche et tombe contre la porte du bureau. La porte cède.
Nous voyons Ledesma à quatre pattes sous son bureau. Certains d’entre nous estiment que se retrouver à quatre pattes dans un hall de gare est blâmable, mais seul dans son propre bureau, cela ne porte pas préjudice à un homme de bien. D’autres, en revanche, envisagent la possibilité de lui trouver un surnom, de désobéir à ses ordres, et de réclamer sa démission pour conduite inappropriée. Cette divergence d’opinions face à la scène nous met mal à l’aise. Nous retenons notre respiration jusqu’à ce que Ledesma se sente observé. Il tourne la tête et nous regarde.
— Pas l’heure encore, dit Mr. Allomby en fermant la porte.
Ledesma et Mr. Allomby sont assis au bureau face à nous. Les plus serviles se placent tout près de ce foyer d’autorité, le corps incliné en quête d’aval et de protection. Nous, les plus hardis, nous prenons place plus loin, le torse bombé et la panse fière.
— Vous avez pu l’attraper, Menéndez ? demande Ledesma à voix haute.
Menéndez entre dans le bureau, un canard braillant dans les mains. Son apparition fait son effet. Nombre de mes collègues la regardent pour la première fois, longuement. Elle existe sur le moment grâce aux ordres du directeur.
— Laissez-le sur cette petite table, dit Ledesma.
Le canard glisse sur la surface vitrée. Lorsqu’il retrouve l’équilibre, il revient à la neutralité caractéristique de son espèce. Il y a à côté de lui une caisse en bois de taille moyenne. Le couvercle, qui s’ouvre en deux volets, présente en son centre un large orifice circulaire, entouré du mot ergo gravé en caractères latins. En dessous, un couperet se déclenche à l’horizontale avec la force et la rapidité d’une arbalète. Sur les côtés apparaissent en relief les bustes de Louis XVI et Marie-Antoinette. On y lit respectivement cogito et sum. Il est clair que les mots et les figures ont un but allégorique, ce qui gâche la beauté de l’ensemble.
— Notre pauvre canard cartésien, dit Ledesma, souriant.
Ledesma introduit le canard dans la guillotine par une trappe dérobée située sur la partie inférieure, encastrant sa tête dans l’orifice. Sans plus attendre, il active le dispositif. Le couperet tombe à une telle vitesse qu’aucune goutte de sang ne se répand. La tête du canard cartésien reste sur ergo. Il semble n’avoir rien senti. Il nous regarde. Ou il pense à des choses de canard. Il demeure ainsi quelques secondes, cancanant occasionnellement, jusqu’à ce que ses yeux se ferment et son incursion au monde s’achève.
Je n’arrive pas à voir si Menéndez observe la scène attentivement ou si elle préfère détourner le regard, mais, dans tous les cas, c’est elle qui retire le corps et l’enveloppe dans un linge propre avant de sortir de la pièce.
— Qu’il reste juteux, je vous prie, réclame Ledesma.
— Nous attendons une explication.
— Prenez-le comme un exemple, dit Ledesma.
— Que voulez-vous dire ? Vous cherchez un canard boiteux ? Vous pensez réduire le personnel ? Vous allez couper des têtes, c’est ça ?
— Non, Papini, dit Ledesma. La raison de cette introduction qui, je l’espère, vous a semblé poétique et singulière, se trouve dans ces documents que je vous lis :
Avant la guillotine, la peine capitale était un spectacle public avec des personnages bien définis : un bourreau, un condamné et la populace. Le dénouement immuable de la représentation, à la fois cathartique et didactique, ne calmait pas pour autant la foule.
L’invention de la guillotine transforme la peine capitale en une technique. La figure du bourreau se réduit à sa plus simple expression, celle d’opérateur de machine. La fonctionnalité stricte de cette nouvelle méthode ne laisse aucune place au style.
Les bourreaux, cependant, se refusent à abandonner leur geste rituel caractéristique, celui de brandir la tête du décapité et la montrer à la populace une fois la tâche accomplie.
a) Le bourreau apporte une preuve concrète du travail bien fait, pas par fierté personnelle, mais pour cumuler les mérites et être récompensé.
b) La populace professe sa dévotion pour les oraisons simples et catégoriques. La tête équivaut à un point final qui laisse tout le monde satisfait. Le bourreau comme aphoriste.
« a » et « b » semblent anéantir les explications possibles de l’acte. Mais le bourreau connaît l’abécédaire de la mort du début à la fin. Les points suivants révèlent des raisons plus personnelles qui impliquent une faveur, ou une concession, envers le condamné. C’est sur cela que repose la rébellion secrète du bourreau.
Ceux qui ne pratiquent pas ce métier ignorent que la tête séparée du tronc demeure consciente et possède le plein usage de ses facultés pendant encore neuf secondes. En brandissant la tête de sa victime, le bourreau lui offre une vision du monde, finale et évanescente. De cette façon, il ne contredit pas seulement l’idée même du châtiment, mais fait également du public un spectacle.
Pour que le décapité reste lucide, une série de normes doit être respectée.
a) Il doit être éveillé lors de sa décapitation. L’accomplissement du a) est le reflet direct de son courage.
b) Il doit regarder vers le fil du couperet, c’est-à-dire vers le ciel. Il ne s’agit pas d’une métaphore de ses retrouvailles avec la foi, mais plutôt d’une disposition d’ordre pratique. Ceux qui reçoivent le couperet sur la nuque s’évanouissent sous l’effet du coup.
c) Endroit de coupe. Chez les hommes, en-dessous de la pomme d’Adam. Chez les femmes, au-dessus de la marque du rosaire. Éviter les coupes obliques.
d) Un public animé est préférable pour exciter les sens du décapité.
Ces règles et d’autres de nature plus subtiles (s’il s’agit d’une femme, orienter son regard dans la direction opposée à la foule) sont transmises par les bourreaux à leurs enfants comme autant de savoir-faire pour accomplir la tâche à venir. Ce secret partagé renforce leur tendre complicité et se transmet de génération en génération, comme l’habit noir.
Le canard et la lecture nous laissent silencieux. Ledesma explique qu’il s’agit d’une étude réalisée en France par un illustre légiste, traduite en espagnol à partir d’une traduction en anglais que Mr. Allomby a lui-même réalisée à partir de l’original en français. Menéndez nous distribue une copie dactylographiée avec notre nom inscrit dans la marge. Mon nom de famille est mal orthographié : Qintana, sans u.
— Je dois avouer que quand je l’ai eue entre les mains, poursuit Ledesma, je l’ai lue à contrecœur. En la portant à ma connaissance, Mr. Allomby voulait savoir si l’hypothèse pouvait être corroborée par des méthodes scientifiques.