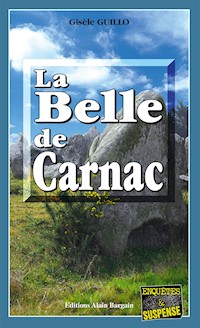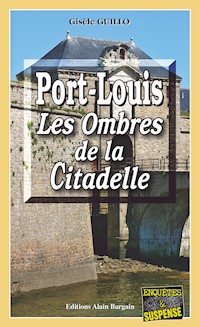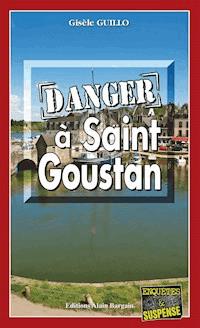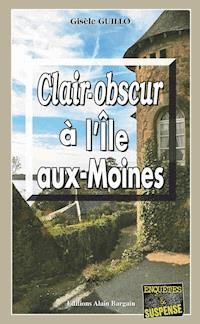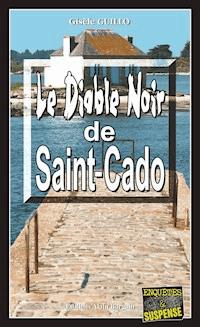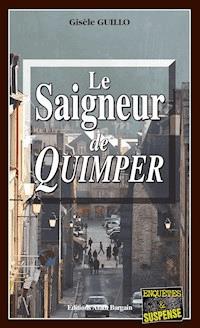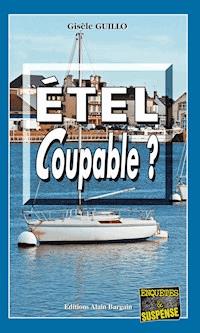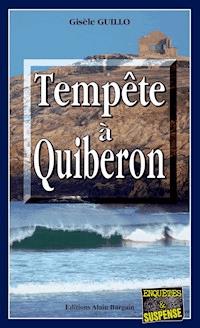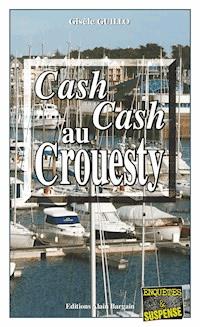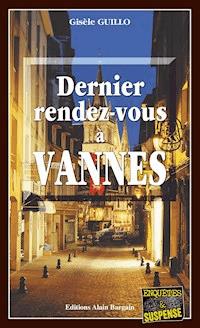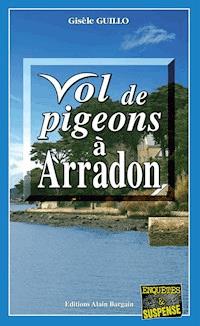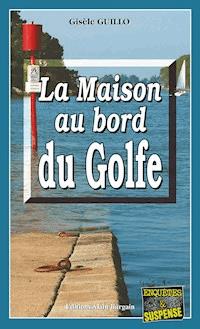
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Un étrange jeu d'influences...
C'est la maison-refuge, votre havre, votre jardin secret. Que diriez-vous si, arrivant à l'improviste, vous découvriez qu'un inconnu s'y est installé ?
C'est ainsi que commence une cohabitation insolite entre un vagabond aux abois et une bourgeoise bohème, un brin loufoque. Au dehors, c'est le ciel changeant du Golfe du Morbihan, le cri des mouettes surfant sur les souffles de la marée montante et celui qu'on n'attendait pas. À l'intérieur, se joue une drôle de partie, ce jeu cruel du chat et de la souris. Mais qui est le chat ? Qui est la souris ? Et qui va gagner ?
L'intrigue passionnante de ce roman policier prend place au cœur du Golfe du Morbihan !
EXTRAIT
Stéfan frappa, et frappa de nouveau de toutes ses forces. Il leva le bras pour frapper encore. Le geste s’arrêta en chemin. Ce n’était plus la peine. À ses pieds, l’homme gisait, face contre terre. Stéfan resta immobile, à fixer la main gantée, la sienne, qui brandissait la statuette ensanglantée. Comme hébété, il regarda les deux filets de sang qui couraient à travers la chevelure blanche et commençaient à se noyer dans les dessins du tapis. Soudain, il crut percevoir un bruit léger et se retourna d’un bloc. À trois pas derrière lui, la femme, recroquevillée entre les pieds de la table, gémissait faiblement. Stéfan se releva, s’approcha. Elle bougeait encore. Il allait falloir l’achever. Dans quelques instants. Pas tout de suite. Pour le moment, il lui était impossible de maîtriser le tremblement qui l’agitait de la tête aux pieds, qui le faisait claquer des dents. Il avait posé la statuette sur le tapis. Machinalement, il l’examina. Cela représentait un homme assis sur un tronc d’arbre, avec une espèce de couronne de feuilles sur la tête. Un athlète ou alors un dieu. En tous les cas, c’était du beau, du solide, du lourd, du bronze peut-être.
Il regarda autour de lui. Sur les meubles – de l’ancien, jugea-t-il – il y avait des bibelots, des vases, des trucs en argent. En d’autres temps, il n’aurait pas raté l’occasion. Il aurait tout raflé ; parce que ça se revend bien, ces choses-là. Mais aujourd’hui, l’urgence c’était de ficher le camp, de quitter les lieux avant qu’un voisin, une femme de ménage, n’importe qui, entre et découvre les corps. Les corps… Il fit deux pas en direction de la femme.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gisèle Guillo fait partie des Bretons de Paris : carrière parisienne mais fidélité à ses racines bretonnes, notamment à Arradon où elle fait de fréquents séjours. Agrégée de Lettres modernes, elle a enseigné la littérature comparée et la linguistique, a publié des ouvrages scolaires et universitaires. Elle finit par succomber à sa passion pour la littérature policière et a signé plusieurs polars.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
I
Stéfan frappa, et frappa de nouveau de toutes ses forces. Il leva le bras pour frapper encore. Le geste s’arrêta en chemin. Ce n’était plus la peine. À ses pieds, l’homme gisait, face contre terre. Stéfan resta immobile, à fixer la main gantée, la sienne, qui brandissait la statuette ensanglantée. Comme hébété, il regarda les deux filets de sang qui couraient à travers la chevelure blanche et commençaient à se noyer dans les dessins du tapis. Soudain, il crut percevoir un bruit léger et se retourna d’un bloc. À trois pas derrière lui, la femme, recroquevillée entre les pieds de la table, gémissait faiblement. Stéfan se releva, s’approcha. Elle bougeait encore. Il allait falloir l’achever. Dans quelques instants. Pas tout de suite. Pour le moment, il lui était impossible de maîtriser le tremblement qui l’agitait de la tête aux pieds, qui le faisait claquer des dents. Il avait posé la statuette sur le tapis. Machinalement, il l’examina. Cela représentait un homme assis sur un tronc d’arbre, avec une espèce de couronne de feuilles sur la tête. Un athlète ou alors un dieu. En tous les cas, c’était du beau, du solide, du lourd, du bronze peut-être.
Il regarda autour de lui. Sur les meubles – de l’ancien, jugea-t-il – il y avait des bibelots, des vases, des trucs en argent. En d’autres temps, il n’aurait pas raté l’occasion. Il aurait tout raflé ; parce que ça se revend bien, ces choses-là. Mais aujourd’hui, l’urgence c’était de ficher le camp, de quitter les lieux avant qu’un voisin, une femme de ménage, n’importe qui, entre et découvre les corps. Les corps… Il fit deux pas en direction de la femme. Pas de doute, elle avait bougé. Il fallait en finir. Il fit un effort pour respirer, pour se donner du courage, reprit la statuette, ajusta son coup et, tournant légèrement la tête pour ne pas voir, il frappa de toutes ses forces. Il s’obligea à regarder. Il eut un haut-le-cœur. Ce n’était pas beau à voir. « Elle a son compte », se dit-il.
Maintenant, il fallait faire vite. De sa main, toujours gantée, il reposa la statuette sur le sol. La sacoche grande ouverte était près du corps ; le vieux ne l’avait lâchée que lorsqu’il était tombé. Stéfan la saisit, en sortit la liasse de billets. Six billets de cinquante euros ; le reste, des petites coupures. De loin, pendant qu’il surveillait le distributeur, il avait espéré mieux. Au moment de prendre la carte de crédit, il hésita. Tenter de s’en servir c’était comme jouer au Petit Poucet, semer des petits cailloux pour qu’on le suive à la trace. Il laissa tomber la carte sur le tapis, près du corps. Dommage. Mais quand on est en cavale, on ne peut se permettre le moindre risque. À présent, il fallait sortir. La porte d’entrée ? Non, même dans ce hameau perdu, à l’écart du centre, il pouvait tomber sur un voisin, un jardinier. Pour éviter toute rencontre, le mieux était de partir par où il était entré, le garage. C’était de là qu’il avait surgi devant le couple ébahi.
— Qui êtes-vous ? avait balbutié l’homme. Par où êtes-vous entré ?
Le vieux ne s’était aperçu de rien. Ni qu’il avait été épié pendant qu’il faisait son retrait au distributeur d’une banque, dans une ruelle à Auray, ni qu’il avait été suivi jusqu’au parking, désert à cette heure-là, où, après avoir déverrouillé la portière, il s’était brusquement ravisé et avait traversé la place pour entrer dans le bureau-tabac, en face. Il était revenu, cigarette au bec, en sifflotant, sans se douter qu’il allait transporter lui-même son agresseur dans le coffre de sa voiture. La proie idéale. Cela aurait été presque trop facile si le vieux s’était montré raisonnable, s’il n’avait pas commencé par résister, si sa femme n’était pas venue à sa rescousse, s’il ne s’était pas débattu. Mais, par malheur, il s’était débattu…
Stéfan jeta un dernier regard sur la pièce. Il fallait maintenant quitter les lieux, au plus vite, sans emporter la moindre trace de sang à la semelle de ses chaussures. Il enjamba les taches qui s’élargissaient sur le tapis, passa dans la cuisine. Sur la table, traînait un sac en plastique, un sac de supermarché, d’où dépassaient un pain et des paquets. Il s’en empara. La cuisine donnait sur une courette. Le garage était en face.
Quand il sortit, la lumière du soleil qui dardait presque à l’horizontale, l’aveugla. Ses jambes tremblaient encore un peu et il ressentait le besoin de reprendre ses esprits, de décider de ce qu’il allait faire. Un tronc d’arbre fraîchement abattu barrait un bout de pelouse pelée.
Il s’assit et regarda autour de lui. Il se trouvait dans un grand jardin, une sorte d’enclos, bordé de quelques arbres dont les feuilles jaunissaient à peine, avec des plates-bandes irrégulières où quelques fleurs haussaient des corolles jaunes et blanches au milieu d’herbes folles. Un jardin négligé, un peu sauvage, comme il aurait aimé en avoir un, s’il avait été du genre à avoir un jardin. L’air était tiède, presque chaud.
— C’est vrai qu’on est en septembre, se dit-il.
Il avait oublié que l’été déclinait. Et même qu’il y avait des étés. Il faut dire qu’en taule, on ne s’occupe guère des saisons, on ne les voit pas passer.
Il arracha un brin d’herbe, l’écrasa entre ses doigts, le huma. Des souvenirs remontaient… Une petite ferme près d’Alençon, quand son grand-père l’emmenait faire paître les vaches dans le pré qu’il louait à l’année. Une dizaine de vaches ; elles étaient mortes en quelques jours de la fièvre aphteuse. Ça lui avait fichu un coup au grand-père ; il ne s’en était jamais remis.
C’était loin tout ça, comme si cela était arrivé dans une autre vie, dans un autre monde.
Un vol de passereaux traversa la lumière, vint s’ébattre autour d’une assiette emplie d’eau au pied du perron et, dans un concert de piaillements, alla se perdre dans les frondaisons d’un chêne rabougri. Ce fut à cet instant que Stéfan reprit conscience, qu’il réalisa ce qu’il venait de faire. Tout au long de ce que l’on pouvait appeler sa carrière de truand – c’étaient les mots employés par le juge d’instruction, avant son dernier procès – il avait toujours pris garde de ne pas commettre l’irréparable. Des petits larcins d’adolescent, puis des cambriolages et, pour finir, deux braquages. Pour le dernier, “en bande organisée” mais avec des armes factices. L’addition avait été salée. Mais, cette fois, il avait franchi le pas. Deux morts sur les bras. Aux assises, ça ne pardonne pas. Il fallait lever le camp et tout de suite.
Il ouvrit le portail, le referma, jeta un dernier coup d’œil à la maison. Avec ses volets ouverts, son pot d’herbe à chat au pied d’une fenêtre entrouverte, elle avait l’air si paisible qu’avec un peu de chance, il s’écoulerait un jour ou deux, plus peut-être, avant qu’on découvre ce qui s’était passé à l’intérieur. Cela donnait du temps. Le temps d’attendre qu’Alberto se pointe au rendez-vous. Il suffisait de retourner à l’endroit fixé, sans se faire remarquer, deux fois par jour, comme c’était convenu.
Car il viendrait. Il viendrait sûrement. Alberto était un type de parole.
Il avait oublié les gants. L’un portait un mince filet sanguinolent. Il les enleva, les fourra dans le sac de plastique en attendant de trouver un endroit où s’en débarrasser. Il enroula l’anse du sac autour de son poignet et il s’élança sur la route.
II
Stéfan repoussa légèrement le battant de la porte et risqua un œil à l’extérieur. La place se vidait. C’était la fin du marché. Les derniers clients se dispersaient tandis que les commerçants s’interpellaient tout en rangeant leurs étals. On commençait à charger les cageots dans les camionnettes en stationnement à l’arrière de la place. C’était peut-être le moment…
Il y avait deux jours qu’il se nourrissait exclusivement de ce que contenait le sac emporté en quittant la maison des vieux. Du pain bis et du fromage, rien d’autre. Deux jours qu’il ne buvait que l’eau de la fontaine dans le coin de la place, tard dans la nuit, quand il était sûr que personne ne pouvait le voir. Deux nuits qu’il dormait, roulé en boule dans ce fond de couloir humide. Et encore, la chance l’avait servi : tomber sur cette maison dont la façade décrépite portait un écriteau « À vendre. » Quand il était arrivé, vers deux heures du matin, épuisé par des heures de marche sur des routes, des chemins, à travers champs, il avait poussé la porte, machinalement. Miracle, elle s’était ouverte. Un agent immobilier avait dû oublier de la refermer après une visite. Grâce à quoi, il avait trouvé un abri. C’était un répit en attendant de retourner au lieu du rendez-vous.
On s’activait du côté des camionnettes. Des senteurs de légumes frais, de pommes parvinrent jusqu’à lui. Il salivait… Il tâta le billet préparé au fond de sa poche. Il pouvait faire vite, éviter de se faire remarquer, jouer au client pressé qui arrive en retard. Alors qu’il était prêt à s’aventurer hors de son couloir, il aperçut trois hommes en uniforme en train de bavarder avec l’un des commerçants. Il savait qu’on les recherchait, Alberto et lui. Sans doute les journaux avaient-ils signalé leur évasion, peut-être même avaient-ils publié leurs photos… Depuis qu’ils avaient pris la fuite, c’était sa hantise : être reconnu. Il se renfonça à l’intérieur du couloir. Les trois hommes s’éloignèrent assez lentement pour que Stéfan ait le temps de déchiffrer l’inscription en blanc sur leurs blousons bleus : « Police municipale ». La municipale, cela semblait inoffensif. Mais on ne sait jamais. Entre flics, on s’entraide…
Résigné, il sortit le quignon de pain et en cassa un bout qu’il se mit à ronger. Soudain, il sursauta. La porte venait de s’ouvrir.
Une silhouette de femme venait d’apparaître, en contre-jour, sur le pas de la porte.
— Le cinq, c’est ici ?
— Le cinq ? répéta Stéfan, la bouche pleine.
— Le numéro cinq ; c’est tellement sale, on ne peut même pas lire le chiffre… Je cherche le cabinet du vétérinaire, monsieur Labotte, vous ne le connaîtriez pas, par hasard ?
— Non, balbutia Stéfan.
La femme n’insista pas.
— Tant pis. Merci quand même.
Elle disparut et Stéfan poussa un soupir. « Cela devait arriver », pensa-t-il.
Elle ne lui avait rien demandé, elle n’avait pas semblé s’étonner de trouver un inconnu en train de mordre à même un morceau de pain dans le couloir d’une maison à vendre.
— Elle a dû me prendre pour un clochard. N’empêche qu’elle m’a vu et si on l’interroge…
Il ne pouvait plus rester là. Bouger, se déplacer constamment. Quand on se cache, c’est une règle élémentaire. On l’apprend tout de suite, en prison. De toute façon, il devait retourner à l’endroit du rendez-vous. À l’heure dite. Il attendit, écouta sonner la demie de treize heures et se glissa à l’extérieur.
*
« Tu te repères d’après la gare, avait dit Alberto. Tu laisses Hennebont derrière toi et tu continues. Au bout de deux kilomètres, la route passe sous la voie de chemin de fer. Ça fait comme un pont. Et cent mètres plus loin, il y a un abribus. C’est une ligne qui va vers Vannes. C’est à cet endroit précis qu’on se retrouvera. Rendez-vous tous les jours entre seize et dix-sept heures. Il y a un horaire affiché à l’intérieur de l’abribus. Le premier qui y arrive fait un tag sur l’horaire, « Zag », en gros, au crayon-feutre. Ça voudra dire que le lendemain, on se retrouve sur le banc de l’abribus. Tu te rappelleras ? »
Bien sûr qu’il se rappelait.
Ils avaient longuement préparé le rendez-vous, Alberto et lui, avant de se faire la belle. Tout était parfaitement organisé. Alberto avait des contacts à l’extérieur. Il ne lui faudrait que quelques heures pour se pointer au rendez-vous avec du fric et des armes. Ensuite, on se mettrait quelque temps à l’abri ; Alberto avait un copain qui leur avait aménagé une planque à toute épreuve.
— Tu en es sûr de ton copain ?
— Comme de moi-même.
La suite était encore plus simple. On réglait les préparatifs.
— Là, on prend son temps. Tu comprends, il s’agit de tout prévoir.
Et on attendait le moment favorable pour l’attaque du fourgon. C’était un coup en or, le dernier, celui qui allait leur assurer de quoi couler une retraite dorée, hors des frontières.
Stéfan se leva, s’approcha et, une fois de plus, parcourut chaque ligne de l’horaire – il en était au point qu’il le connaissait par cœur. La feuille était vierge de toute inscription. Quatre jours qu’il venait là, à la même heure. Quatre jours à grelotter toute la nuit derrière des rouleaux de foin repérés dans un champ voisin. Quatre jours à fréquenter les toilettes publiques pour essayer de garder une apparence convenable et ne pas attirer l’attention lorsque, poussé par la faim, il se risquait à acheter de quoi manger, en variant les endroits, distributeur automatique de confiseries, buffet de la gare, et même – mais c’était sans doute une imprudence qu’il ne faudrait pas renouveler – le supermarché d’un centre commercial. Il en était sorti avec deux sacs pleins de victuailles qu’il avait dévorées goulûment.
Quatre jours de galère, d’inquiétude aussi. Parce que, malgré lui, la dernière phrase d’Alberto lui revenait :
— Si, au bout de quarante-huit heures, je ne me suis pas pointé, c’est que quelque chose a foiré. Alors, tu ne m’attends pas.
— Qu’est-ce que tu veux dire ?
— Eh bien, à des types comme nous, des gens dans notre situation, il peut arriver n’importe quoi. Alors, pas la peine de se faire prendre à deux. Dans ce cas-là, chacun pour soi.
Chacun pour soi… Il avait un drôle d’air, Alberto quand il avait dit ça.
Pourtant, l’évasion, c’était grâce à lui, Stéfan, qu’elle avait réussi. Dissimuler le matériel, berner les gardiens, bluffer l’assistante sociale, c’était lui. Et faire le mur, sans lui, Stéfan, Alberto, qui avait une jambe malade, n’aurait même pas pu y songer. Non, Alberto ne pouvait pas l’avoir trompé. Pourtant, depuis quelques heures, Stéfan n’était plus tout à fait sûr que l’affaire était aussi simple qu’il avait pensé. Et si le rendez-vous n’était pas un vrai rendez-vous ? Si Alberto avait manigancé de le larguer aussitôt après avoir recouvré la liberté ? Et si, dès le début, il s’était tout simplement fait rouler comme un débutant ? Il consulta sa montre : dans une dizaine de minutes, le bus passerait pour la dernière fois. Deux jeunes femmes arrivèrent en riant et en poursuivant une conversation animée. Stéfan se leva pour leur céder la place sur le banc. Elles remercièrent d’un signe de tête sans cesser de bavarder. Les autres fois, à l’approche de l’autobus, il s’éloignait car on aurait pu s’étonner de voir ce voyageur attendre et rester là lorsque le bus arrivait. Cette fois, Stéfan ne bougea pas. Debout, il regardait la route. L’autobus arrivait. Avec un dernier coup d’œil autour de lui, il monta.
III
Stéfan s’arrêta pour souffler un peu. L’espace d’une seconde, il se sentit mieux, un peu moins mal. Ses jambes ne le portaient plus et la tête lui tournait. La faim, la fatigue surtout, après ces kilomètres à cheminer à travers champs lorsque c’était possible, à éviter les routes qui, toutes, menaient quelque part, à des endroits où il ne devait pas arriver, des villages, des bourgs inconnus où le danger guettait à chaque coin de rue.
Il s’arrêta.
— Je suis déjà passé par là.
Il reconnaissait l’endroit. Ce carrefour, une heure plus tôt, l’autobus l’avait traversé. Machinalement, Stéfan avait noté l’enseigne du restaurant, essayé de lire les écriteaux, de se repérer ; tout cela sans tourner la tête, en évitant de se faire voir des autres voyageurs. Quand le premier autobus l’avait débarqué à Vannes, il en avait pris un autre, aussitôt, pour Baden. Pourquoi Baden ? Pourquoi pas…
À Baden, dans le bourg, il s’était aventuré tout près d’une Maison de la Presse, hésitant à entrer et à acheter un journal local. Depuis qu’il avait fui du hameau de Saint-Hélig, il vivait dans l’angoisse. Avait-on découvert les corps ? Si oui, une surveillance particulière avait dû être mise en place dans les environs. S’il existait une chance de passer entre les mailles du filet, c’était au prix de continuelles précautions : s’efforcer de rester invisible, transparent, ne rien faire qui pût attirer l’attention. C’est pourquoi, au moment de franchir le seuil de la boutique, il avait jugé plus prudent de tourner les talons.
Il déchiffra les noms sur les écriteaux. En face, c’était Baden, il en venait. Par-derrière, on retournait à Vannes. À droite et à gauche, des noms qui ne lui disaient rien. Il prit à droite, au hasard.
Il marchait malgré la douleur. Une ampoule au pied droit avait crevé, s’était transformée en une plaie qui faisait de chaque pas un supplice. Mais ce n’était pas le moment de flancher. Il fallait avancer ; vers où ? Il ne savait pas. Il marcha encore. Au bout d’un quart d’heure, il arriva à un embranchement. Sur la droite, partait une petite route qui, d’après l’écriteau, menait à Toulindac, une base nautique, un endroit qui devait être désert à cette époque de l’année. Et, dans une base nautique, il y a des hangars à bateaux. Peut-être y trouverait-il un abri jusqu’au lendemain… Il se sentait à bout de forces mais il n’avait aucune envie d’entamer les sandwiches et le chocolat achetés dans une boulangerie de Baden. Trouver un endroit où dormir, c’était urgent. Le jour baissait et les nuits se faisaient de plus en plus froides.
Il prit la route, dépassa un hameau aux maisons closes, descendit un chemin piétonnier, déboucha sur un terre-plein. Et, tout d’un coup, ce fut la mer. Étonné, il regarda. Devant lui, le golfe s’étendait dans la lumière argentée du soir tombant. Il aspira une grande bouffée d’air.
— Ça sent bon, se dit-il.
Il fallait descendre quelques marches pour arriver au bord de l’eau. Lorsqu’il déboucha sur la grève, sa déception fut grande. Pas le moindre hangar à bateaux. Les embarcations, des genres de “Vauriens”, enchaînées les unes aux autres, étaient alignées à même le sable. Il remonta. Sur la droite du terre-plein, se dressait une bicoque qui devait servir à entreposer les rames et les voiles. Il en fit le tour sans trouver d’autre ouverture qu’une porte de fer qu’il essaya vainement de forcer. Il revint sur ses pas. Le sentier longeait le jardin d’une villa. Sauter par-dessus la haie d’arbustes était un jeu d’enfants. À travers le bosquet de pins, il observa. Tout était clos ; manifestement, la maison était vide. Il en fit le tour, essaya de faire jouer une persienne, puis une porte, sans succès. Il battit en retraite lorsqu’il aperçut le panonceau indiquant le numéro d’une société de surveillance.
De retour sur la route, il hésita. Poursuivre dans la même direction ? Celle-là ou une autre… puisque, de toute manière, il n’allait nulle part. Sur la droite, il dépassa un parking totalement vide et, ensuite, un autre chemin qui, lui aussi, descendait vers la mer en longeant le jardin d’une autre maison dont on ne distinguait que le toit. Il se sentait épuisé, incapable de faire un pas de plus. La nuit tombait. Et il commençait à pleuvoir. Avec ce qui lui restait de force, il escalada la clôture.
C’était une belle maison, vaste. Faisant face à la mer, il y avait un corps de logis à deux étages auquel on avait ajouté une aile qui se prolongeait en véranda. Il entreprit d’en faire le tour et, méthodiquement, de la main et du pied, éprouva la résistance des portes et des fenêtres aux volets hermétiquement clos. Il revint à la véranda, essaya de faire jouer la poignée ; elle était légère mais elle tenait bon. Casser un carreau ? C’était signaler une intrusion. Même dans ce coin perdu, c’était trop risqué. Un vol d’oiseaux passa à travers les pins. « Des hirondelles », se dit-il.
Mais lorsque les oiseaux revinrent près de lui, jusqu’à le frôler, il s’aperçut que c’étaient des chauves-souris. C’est alors qu’il avisa, près d’un fauteuil de jardin, un barbecue, oublié lui aussi. Sur la grille, on avait laissé traîner des brochettes. Il en prit une et, dans les dernières lueurs du jour, tâtonna pour trouver le trou de la serrure. Par bonheur, la brochette était encore graisseuse, elle tournait facilement dans la serrure. Il ne fallut que quelques instants pour faire jouer le pêne. La poignée s’abaissa et, dans un grincement léger, la porte s’ouvrit.
Stéfan entra avec un immense soulagement. Pour la première fois depuis quatre jours, il allait passer la nuit sous un toit.
IV
Stéfan étira un à un ses membres douloureux. Les jointures de ses genoux craquèrent lorsque, après deux tentatives, il parvint à se mettre debout. De la nuque aux talons, il avait la sensation de n’être qu’une seule courbature.
Car la nuit, même à l’abri, avait été rude. Lorsque, la veille, il avait pénétré dans la maison, profitant des dernières lueurs du jour, il avait jeté un coup d’œil dans les pièces du rez-de-chaussée manifestement inoccupé depuis un certain temps, si l’on en jugeait par la profusion de publicités et d’enveloppes non décachetées, glissées sous la porte d’entrée. Mais il avait jugé prudent de dormir au sous-sol. Vers trois heures du matin, il s’était réveillé transi. Des bouffées d’humidité pénétraient dans la cave par un soupirail mal fermé. À la lueur de sa lampe de poche, il avait fini par dénicher un bout de tapis de faux gazon qu’il avait déroulé et posé à même le sol en ciment. C’est là que, luttant contre le froid, recroquevillé, tant bien que mal, il avait réussi à dormir.
Stéfan regarda sa montre : presque neuf heures du matin. Son pied blessé le faisait souffrir. Il avait faim et soif. Rien ne lui restait du pain et du chocolat engloutis la veille. Peut-être, s’il se risquait hors de la cave, trouverait-il quelque chose à se mettre sous la dent… Qui sait ? Il s’engagea dans l’escalier de ciment, monta les marches une à une, s’efforçant de ne faire aucun bruit. À l’extérieur, comme à l’intérieur, tout était silencieux. Tout en haut de l’escalier, il y avait la porte d’accès au rez-de-chaussée. Lentement, dans la pénombre, Stéfan trouva la poignée. La porte s’ouvrit avec un grincement si aigu qu’il semblait résonner jusqu’au bout du jardin. Il tendit l’oreille, mais rien ne bougeait dans la maison endormie. Il poussa la porte et se trouva dans le vestibule.
La cuisine était à l’arrière, donnant sur une courette qui précédait le jardin. Pas de volets. La lumière du petit matin arrivait par deux fenêtres tout en longueur, garnies de barreaux. Stéfan se mit à explorer les placards. Au fond d’une étagère, il dénicha des paquets de gâteaux secs, des galettes “pur beurre de Bretagne” mentionnait l’étiquette. Du nourrissant. Exactement ce qu’il lui fallait.
Il fit jouer ses doigts engourdis et, à l’aide d’un couteau, déchira l’emballage. Il mangea lentement, en essayant de faire durer chaque bouchée, tout en prenant soin de ne pas faire de miettes sur le sol. Lorsqu’il eut fini le deuxième paquet, il alla à l’évier. Par chance, l’eau n’était pas coupée ; il but goulûment à même le robinet. Le gros orteil de son pied droit envoyait des élancements de plus en plus douloureux mais, puisqu’il avait de l’eau à sa disposition, il allait essayer de nettoyer la blessure. Pour l’instant, il avait à satisfaire un besoin plus pressant.