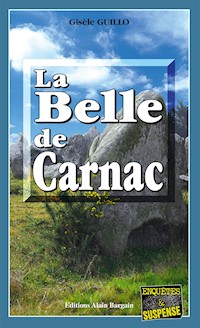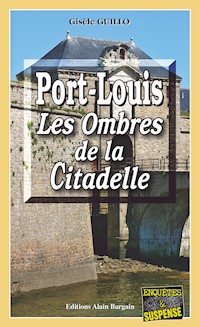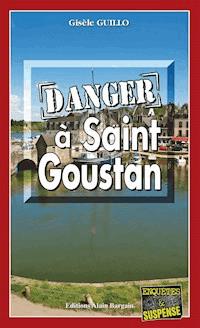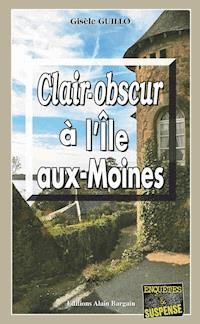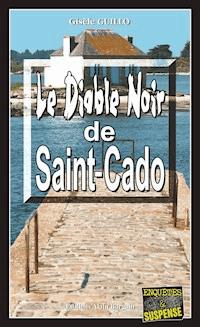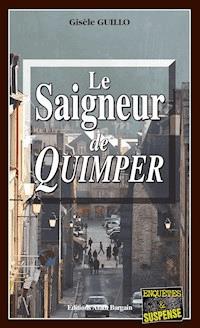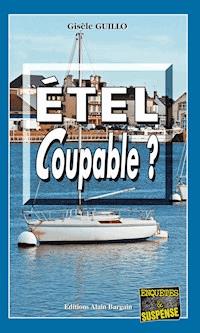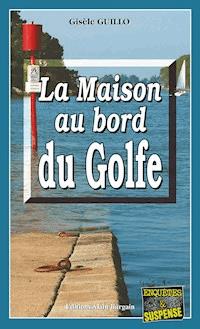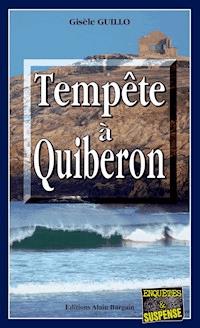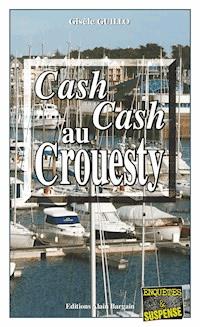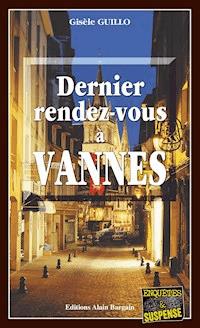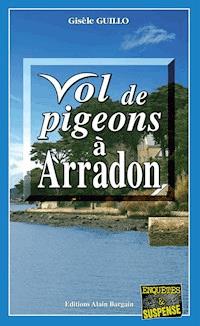
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Il ne faut pas se fier aux apparences...
Il y a Luciano et Joseph, Timothée et Jean-Maurice. Et aussi Charlie, dit "Le Poussin". Rosalie mène sa petite troupe avec autorité et élégance : main de fer dans un gant de velours.
Ils sont tous serviables, amicaux, ingénieux et pleins d'entrain.
Pourtant, ne vous y trompez pas, ces gens-là sont tout sauf des enfants de chœur. Leurs activités sont lucratives, discrètes et tout à fait immorales.
Mais on ne saurait tout prévoir… Même dans le trafic le mieux rôdé, il suffit parfois d'un grain de sable pour que la machine s'emballe et que tout bascule dans la tragédie…
Savourez ce roman policier humoristique au suspense haletant !
EXTRAIT
— Et voilà, dit l’homme. Trois colis, le compte y est. Ils sont marqués, comme d’habitude. C’est pour vous.
— J’espère que personne ne vous a vu… dit Rosalie.
— Personne. A part la petite brune bien roulée qui astique la porte de la rue.
Rosalie et Charlie échangèrent un regard consterné. Madame Gonzalès, chargée de l’entretien, était connue dans tout l’immeuble autant pour son zèle au travail que pour son insatiable curiosité. Avant la fin de la matinée, elle trouverait un prétexte pour venir sonner, histoire de savoir ce qu’on avait bien pu livrer de si volumineux au cinquième étage.
Rosalie attendait.
— Et le reste ?
— Vous voulez dire ce que vous livrez à ces individus qui…
— Je ne livre pas, coupa Rosalie. Ces individus, comme vous dites, viennent eux-mêmes à la boutique.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Les péripéties se succèdent, servies par une narration fluide et des dialogues qui sonnent juste. Cette intrigue ne manque ni de suspense, ni d'humour. -
Claude Le Nocher, Action-Suspense
Editions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gisèle Guillo fait partie des Bretons de Paris : carrière parisienne mais fidèle à ses racines bretonnes, notamment à Arradon où elle fait de fréquents séjours. Agrégée de Lettres Modernes, elle a enseigné la littérature comparée et la linguistique, a publié des ouvrages scolaires et universitaires. Elle finit par succomber à sa passion pour la littérature policière et signe ici son sixième polar.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 193
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
Merci à Daniel, Robert et Laurent,marins de cœur et d’expérience qui m’ontaidée à conduire mes personnages versles sables mouvants où ils devaient se perdre.
I
— Charlie, cria Rosalie, tu m’entends ? Où es-tu ?
— Ici.
— Écoute ça : « Étudiant vingt-huit ans désire rencontrer dame généreuse pour moments chauds et virils. Bien membré, sans tabou. Hygiène et discrétion garanties. Écrire sous chiffre 22YP38. » Qu’en penses-tu, mon Poussin ?
Le Poussin extirpa précautionneusement son mètre soixante-quinze de l’alcôve dont il garnissait le plafond de papier peint. Il prit le temps de poser la brosse à encoller sur le bord du seau et de renfiler ses baskets, un imposant quarante-trois depuis qu’il avait adopté les semelles “auto-massantes”.
— Alors, qu’est-ce que tu en penses ? insista Rosalie.
— Je te l’ai déjà dit ; tu aurais beaucoup plus de choix sur Internet.
Rosalie secoua la tête.
— J’aime mieux les petites annonces. Je trouve ça plus discret ; et, à mon âge, c’est plus distingué.
— Ça se discute, dit Charlie ; mais, comme de toute façon, tu n’en feras qu’à ta tête…
Dans un short délavé, le cheveu en bataille, torse nu, il s’étira sous le regard de Rosalie plein d’une maternelle vigilance.
— Tu es trop bronzé. Je suis sûre que tu abuses des UV…
— Mais non, coupa Charlie, juste ce qu’il faut. Tiens, montre-la-moi cette annonce.
Il s’empara du journal.
— Attention ! Tu as bien lu ? « Dame généreuse… », c’est clair. Tu as intérêt à être moins radin que la dernière fois. Rappelle-toi, le garçon n’était pas content.
— Moi non plus, riposta Rosalie, je n’étais pas contente ! Une vraie mauviette… Toujours fatigué…
Charlie lorgna sa mère, mi-agacé, mi-amusé : inutile de discuter. Elle était comme ça Rosalie, toujours à l’affût du meilleur rapport qualité-prix. Partout. Dans tous les domaines…
Cheveux argentés soigneusement noués dans un catogan de velours noir, drapée dans son kimono fleuri, regard pétillant, elle était prête à conquérir le monde. Comme tous les matins.
— On étouffe ici, dit-elle ; et cette odeur de colle… c’est pénible. Tu en as encore pour longtemps ?
— J’aurai fini ce soir, dit Charlie.
Il alla ouvrir les deux fenêtres et le grondement de la circulation envahit la pièce. Le boulevard Suffren était tout proche. Une rue bruyante, dans un quartier chic : en se penchant un peu, par les fenêtres du salon, on apercevait les frondaisons du Champ de Mars.
C’est important d’avoir une bonne adresse. Charlie et Rosalie y tenaient beaucoup.
Rosalie épousseta du doigt une effilochure de papier sur le marbre de la table tulipe :
— Tu as de la salade toute prête et du rôti froid au réfrigérateur ; et il reste des framboises au kirsch.
— Tu ne rentres pas déjeuner ? s’enquit Charlie.
— Aujourd’hui, pas question de quitter la boutique. Quelqu’un passera me donner des nouvelles de la livraison.
— Un nouveau ?
— Je crois, oui.
— Et ce sera pour quand ?
Rosalie fit un geste d’ignorance.
— Dans quatre ou cinq jours ; peut-être plus tôt. Comme d’habitude, je serai prévenue à la dernière minute.
Charlie s’était rembruni.
— Est-ce qu’on a vraiment besoin d’y aller ?
— Sois raisonnable, mon Poussin. Un aller-retour à Vannes, ce n’est quand même pas la mer à boire.
— La mer, parlons-en ! Si, au moins, c’était la Méditerranée ! Mais le golfe du Morbihan… on grelotte.
— Tu exagères, mon Poussin.
— Moi, il me faut l’eau à vingt-quatre degrés, au-dessous, je ne peux pas me baigner !
— Charlie, tu sais bien qu’on n’y va pas pour se baigner…
— Est-ce que, pour une fois, ils ne pourraient pas se débrouiller autrement ? Décharger un camion, transporter quelques cartons, c’est plus risqué dans une bicoque isolée que dans une rue de Paris. Sérieusement, ce serait tellement plus simple de se faire livrer ici ou à la boutique. On se ferait aider ; on trouve des gens pour ce genre de petit boulot… on peut passer une annonce…
— Et pourquoi pas convoquer les policiers pour qu’ils donnent un coup de main… Tu perds la tête ! Non. Discrétion, sécurité. La méthode a fait ses preuves. Allez, je suis en retard. Je m’habille et je file.
Resté seul, Charlie déploya le drap avec lequel il protégeait la moquette et se remit à sa besogne. Il travaillait avec soin, égouttant le pinceau pour prendre juste ce qu’il fallait pour encoller le papier, tapotant délicatement pour le faire adhérer malgré les irrégularités de la paroi. Il en était au deuxième lai lorsque le téléphone sonna.
— Pas moyen d’avoir cinq minutes tranquilles, ronchonna-t-il.
Il alla décrocher.
— Allô ? Oui… Madame Delaroque… Oui, c’est ici… Non… Je ne sais pas… Il faut que j’aille voir si elle…
Rosalie venait de réapparaître, habillée de pied en cap, prête à partir.
— Qui est-ce ?
— Je n’en sais rien, chuchota Charlie. Et tout haut : c’est de la part de qui ?
Un silence. Charlie écoutait. Il se tourna vers Rosalie, la main sur le micro.
— Il veut te parler à toi, en personne.
Des lèvres et de la main, Rosalie multipliait les dénégations et mimait un départ immédiat. Charlie reprit l’appareil.
— C’est que… n… non… elle vient de partir. Mais vous pouvez laisser un message ; c’est à quel sujet ?
Charlie écoutait, sourcils froncés.
— C’est au sujet de la livraison, dit-il tout bas.
Rosalie claqua la porte qu’elle venait d’ouvrir. Elle fonça vers le téléphone :
— Dis-lui de raccrocher immédiatement. Il ne doit pas appeler ici. Sauf en cas d’urgence.
— Justement, chuchota Charlie, il dit qu’il y a urgence.
II
Les deux cartons emplissaient l’espace du minuscule ascenseur. L’un après l’autre, le camionneur les porta à l’intérieur du vestibule. C’était un vrai camionneur, comme on en voit au cinéma, avec le physique de l’emploi. Un grand costaud avec des épaules impressionnantes, couvertes de tatouages. Charlie se demanda si les tatouages étaient des vrais, indélébiles, comme il les aimait… Au troisième carton, les portes de l’ascenseur, libérées, claquèrent violemment.
Du palier où elle surveillait les opérations, Rosalie intervint, mécontente :
— Faites donc attention ! L’ascenseur n’est pas tout neuf.
— Ça, je m’en suis aperçu, ricana l’homme. On a dû vous le bricoler dans les années soixante. Il reste trois autres cartons en bas, les plus gros. Si vous préférez y aller vous-même…
Charlie jugea qu’il était temps de mettre un peu d’huile dans les rouages.
— Vous n’avez pas eu trop de mal à vous garer ? demanda-t-il aimablement.
— Me garer ! Vous rigolez. Vous me voyez avec mon trois tonnes en train de chercher une place devant chez vous ? Sûr que je ne serais pas passé inaperçu. Non, j’ai planqué mon bahut à proximité du périph et j’ai réussi à trouver un taxi qui a bien voulu me prendre avec mon chargement. Pas facile. Au fait, il va falloir me le rembourser. Ce n’était pas prévu dans mes frais de route.
Il disparut dans l’ascenseur. Charlie souleva le coin d’un carton, le reposa et, finalement, le poussa du pied jusque dans le salon.
— C’est lourd ? demanda Rosalie.
— Non. Plutôt moins que d’habitude.
L’ascenseur remontait avec des couinements poussifs.
— Et voilà, dit l’homme. Trois colis, le compte y est. Ils sont marqués, comme d’habitude. C’est pour vous.
— J’espère que personne ne vous a vu… dit Rosalie.
— Personne. A part la petite brune bien roulée qui astique la porte de la rue.
Rosalie et Charlie échangèrent un regard consterné. Madame Gonzalès, chargée de l’entretien, était connue dans tout l’immeuble autant pour son zèle au travail que pour son insatiable curiosité. Avant la fin de la matinée, elle trouverait un prétexte pour venir sonner, histoire de savoir ce qu’on avait bien pu livrer de si volumineux au cinquième étage.
Rosalie attendait.
— Et le reste ?
— Vous voulez dire ce que vous livrez à ces individus qui…
— Je ne livre pas, coupa Rosalie. Ces individus, comme vous dites, viennent eux-mêmes à la boutique.
— Drôles de clients ! fit le camionneur, goguenard. Plutôt “rastas” à ce qu’on m’a dit…
— Des gens discrets, dit Rosalie sèchement. Ils viennent, ils prennent leurs colis. Ils s’en vont. Je n’ai pas besoin d’en savoir plus.
— Bien, bien. Ne vous fâchez pas. Le reste vous attend dans le patelin habituel. D’ailleurs, quand je dis habituel… On va tous être obligés de les changer un peu, les habitudes.
— Entrez, dit Rosalie.
— J’ai pas le temps.
— Juste un instant. J’ai quand même le droit de savoir ce qui s’est passé.
Le camionneur obtempéra. Rosalie le fit entrer, non sans s’être assurée d’un coup d’œil dans la cage d’escalier, que madame Gonzalès n’y était pas postée. Charlie avança un siège que l’homme refusa :
— Je préfère me dérouiller les jambes. J’ai passé toute la nuit au volant.
Sur la table d’angle du coin salle à manger, trônait un bol fumant. Charlie avait été interrompu dans son petit déjeuner.
— C’est de l’Ovomaltine, dit-il. Ça requinque. Une petite tasse ?
— Non. Mais si vous aviez une bière…
— Racontez, dit Rosalie. Comment se fait-il que vous soyez là ?
Le camionneur ne se pressa pas de répondre. Sans aucune discrétion, il regardait autour de lui.
— C’est chouette chez vous… c’est pas souvent que je vois des trucs comme ça…
— Alors, fit Rosalie ? Que s’est-il passé au juste ?
— En fait, pas grand-chose. Normalement, vous n’êtes pas dans mon circuit. Moi, je livre autre chose, en Belgique ou ailleurs ; dans le Nord quoi. Mais Gabin veut qu’on change un peu de temps en temps ; il dit que ça évite de se faire repérer.
Donc, j’avais vos colis en plus de ma cargaison. Hier, dans la soirée, j’arrive à Vintimille, je m’arrête pour faire le plein. Sur les plates-formes, tout le monde parle du contrôle d’un nouveau genre que les douanes sont en train de tester. J’étais déjà sur une des voies d’accès au poste-frontière. Trop tard pour faire demi-tour : il y a des caméras partout. Je me serais fait repérer. Je sais qu’ils arrêtent un camion sur huit ou dix. Je tente ma chance.
Charlie était revenu avec un verre et une canette de bière que l’homme décapsula d’un coup de dents.
— Manque de pot, dit-il, c’est tombé sur moi.
— Ils ont fouillé le camion ?
L’homme éclata d’un rire énorme.
— Même pas. Une veine de…
— De pendu, dit Charlie qui riait aussi.
— Disons de cocu, dit le camionneur ; on s’en sort mieux. La nouveauté, c’est qu’en plus des papiers, il leur faut une batterie de renseignements, le chargement, le point de départ, la destination exacte. Il y en a un qui pose les questions, l’autre entre les réponses dans un ordinateur. Il paraît qu’ils ont un logiciel diabolique ; en fonction de la distance, des conditions de circulation, de la vitesse autorisée, des temps de repos obligatoire, ils calculent vos heures de passage aux frontières, votre heure d’arrivée etc. Tout ça à la demi-heure près.
— Ça leur sert à quoi ? demanda Rosalie.
—A vérifier que la cargaison arrive bien là où on l’a déclaré et pas ailleurs, qu’on n’a pas fait d’arrêt ou de détour suspect etc… Tous les douaniers du territoire, y compris les brigades volantes, ont accès aux données. On est suivi à la trace.
— C’est pas bête leur truc, dit Charlie, songeur.
— Pas bête du tout. Il paraît qu’ils ont déjà réussi quelques jolis coups de filet.
Le camionneur s’interrompit pour boire une gorgée de bière. Il buvait au goulot. Proprement. En jetant des coups d’œil étonnés en direction de Charlie qui trempait des biscuits dans son bol avant de les croquer avec délicatesse.
— Moi, poursuivit-il, ma destination c’est Rotterdam. D’après leurs calculs, je devrais être en train de passer la frontière belge. J’ai déjà pris du retard en faisant le détour par Paris. Mais le Morbihan, Vannes, pas question. D’ailleurs, ça n’est pas même pas dans la ville, on décharge un peu plus loin…
— Oui, dit Charlie, une crique au fond du golfe, à Arradon.
— Comment dites-vous ?
— Arradon, répéta Charlie.
— Oui, dit le camionneur, c’est bien ça. J’ai déjà livré là-bas, deux ou trois fois mais je ne me rappelle jamais le nom… D’ailleurs, là aussi, il va y avoir du changement. D’après Gabin, il se pourrait que les prochaines livraisons aient lieu en mer.
Devant l’air ahuri de Rosalie, il se remit à rire.
— Il va falloir penser à acheter un bateau.
Il s’essuya les lèvres d’un revers de main et posa sa bouteille sur la tablette du secrétaire en érable. Rosalie se précipita pour l’enlever et la déposer sur un coin de la table où Charlie finissait son Ovomaltine.
— Faut que j’y aille, dit le camionneur ; j’ai pas envie d’avoir des emmerdements. Le taxi, c’était trente-cinq euros. Si vous voulez bien, vous doublez… pour le retour.
— Attendez, dit Rosalie.
Elle fouilla dans son sac à main et sortit des tickets de métro. Une grimace de Charlie l’arrêta.
— On pourrait ajouter dix euros, dit-il, Monsieur a sans doute donné un pourboire ?
— Exact, dit l’homme.
Rosalie s’exécuta, de mauvaise grâce. Elle sortit son porte-monnaie, compta un à un les billets que le camionneur empocha.
— Salut, dit-il, et merci pour la bière.
Charlie s’approcha pour lui ouvrir la porte. De près, l’homme dégageait une puissante odeur, mélange d’eau de toilette et de transpiration. Une odeur virile que Charlie huma, tout émoustillé :
— Je vous raccompagne jusqu’à la rue, dit-il aimablement.
III
Lorsque Charlie remonta, Rosalie était toujours là, debout, dans le salon.
Elle avait ôté sa veste et elle triturait nerveusement son collier de fausses perles :
— Donc, il faut se préparer à partir pour Arradon. Quel contretemps ! Moi qui viens de convoquer l’étudiant !
— Quoi ? Celui de l’annonce ?
— Eh bien, oui, celui de l’annonce. J’ai répondu aussitôt.
— Par retour de courrier, ricana Charlie. Là aussi, il devait y avoir urgence…
— Charles, je t’en prie ! Un peu de respect pour ta mère !
Quand Rosalie l’appelait Charles, le Poussin savait qu’il fallait filer doux. Il piqua du nez vers son bol, but une dernière gorgée, tiédasse, et se leva pour emporter le plateau à la cuisine.
Quand il revint, Rosalie commençait à déballer le premier carton.
— Encore des porte-cierges, dit-elle, tu auras de quoi t’occuper avec les abat-jour.
La vente des luminaires, tout prêts ou à la commande, constituait la vitrine honorable du magasin que tenait Rosalie à proximité du Village Suisse*. Le reste, ce que l’on vendait dans l’arrière-boutique, était réservé à une clientèle triée sur le volet, par le bouche à oreille : étrangers de passage, personnel des ambassades, nombreuses dans le quartier, tous gens qui avaient la dépense facile et qui se souciaient peu de l’origine de ce qu’on leur proposait.
Rosalie avait sa tête des mauvais jours et déversait sa hargne contre le camionneur :
— Quel rustaud ! On a du mal à se retrouver dans ce qu’il raconte. Il n’a pas l’air très intelligent.
— Tu sais, dit Charlie, on n’a pas besoin de sortir de Centrale pour conduire un camion…
— Mais ça n’empêche pas le savoir-vivre… Pour un peu, avec sa canette, il me faisait un rond sur le palissandre de la table ; et quel mufle ! Tu as vu comme il me passait devant, sans un mot d’excuse… Et profiteur avec ça ! Le coup du taxi, j’ai trouvé cela un peu fort, alors que la station École Militaire est à deux pas…
— Moi, dit Charlie, je le trouve plutôt brave type, ce Luciano…
— Qui est-ce Luciano ?
— Le camionneur.
— Comment sais-tu son prénom ?
— Il me l’a donné en bas en me disant au revoir. En plus, il m’a donné des conseils.
— Je n’en ai que faire de ses conseils !
— Tu as tort. Il voulait nous mettre en garde parce que, d’après ce qu’on lui a dit, ça commence à sentir le roussi dans le golfe.
Rosalie lâcha une paire de chandeliers pour regarder son fils.
Pas mécontent d’avoir repris l’avantage, Charlie distillait ses informations une à une, sans se presser :
— D’après Luciano, ils ont peur que la maison soit repérée.
— Qui ça “ils” ?
— Les autres, enfin Gabin… surtout Gabin…
Gabin… Rosalie ne savait rien du mystérieux personnage qui se cachait derrière ce nom – ou ce prénom – sinon que les ordres venaient de lui.
— Et tu n’as pas eu l’air de le croire, continua Charlie, mais c’était sérieux ; la prochaine fois, on sera livré par bateau.
Rosalie n’était plus incrédule. Elle était accablée.
— Quelle tuile ! fit-elle.
Silence… Rosalie digérait l’information. Elle finit par couler un regard interrogateur en direction de Charlie.
— Il nous faudrait quelqu’un qui nous prête un bateau…
— Et les manœuvres, tu y as pensé aux manœuvres ? Je n’ai jamais touché un bateau, toi non plus…
— Quelqu’un qui nous prêterait un bateau et qui se chargerait lui-même du transport. Sans rien savoir de ce qu’il transporte, évidemment…
Rosalie, le regard vague suivait le va-et-vient des baskets de Charlie qui se balançait sur son siège préféré, le rocking-chair “style Kennedy”.
— On pourrait présenter cela comme de la navigation de plaisance…
— Je vois, dit Charlie. Quelqu’un qui aurait un bateau, qui ferait le boulot à notre place, sans s’étonner de rien, sans poser de questions… L’imbécile parfait, quoi… J’ai pas ça en stock.
Il regarda sa mère qui s’était mise à caresser pensivement ses fausses perles.
— Moi, dit Rosalie, j’ai peut-être quelqu’un.
* Quartier des antiquaires donnant dans l’avenue de Suffren.
IV
Le journal de Timothée.
Tout a commencé le 21 mai, le jour de l’assemblée générale des actionnaires de la COTALDIS. Je possède des actions d’un certain nombre de sociétés. Il y a le portefeuille que m’ont légué mes parents et il y a toutes celles que j’ai achetées, au cours des années. Comme je n’ai pas de goûts de luxe et que je n’arrive pas à dépenser ce que je gagne, j’achète des actions. Je n’en vends jamais. C’est comme une tirelire. Chaque année, à la même période, je prends des jours de congé pour assister aux assemblées. J’aime bien cela. C’est un peu comme une fête, il y a de l’animation, de la foule, on finit par revoir des têtes connues, on échange quelques mots avec les uns et les autres, je me sens moins seul…
L’une de mes assemblées favorites, c’est celle de la COTALDIS. Le PDG a du talent. Il sait éluder les questions dérangeantes et il n’a pas son pareil pour nous convaincre que “notre groupe”, comme il dit, a des perspectives brillantes même si le cours a baissé. Je ne comprends pas tout mais ça rassure. A la fin, on reçoit un cadeau. Pas toujours utile, le cadeau – j’ai un tiroir plein de porte-clefs et un autre de calculatrices – mais cela fait plaisir. Et puis, il y a le cocktail. Très important le cocktail. Et c’est amusant, si on sait s’y prendre. Moi, je suis rodé. Il faut quitter sa place avant la fin du vote des résolutions, se placer le plus près possible de la porte de la salle de réception et, dès que la porte s’ouvre, s’engouffrer vers le buffet central. Avec un peu de chance, on s’empare d’une assiette bien garnie. Il ne reste plus qu’à se trouver un coin tranquille en prenant garde de ne pas se faire arracher ses boutons de veston.
Hier, je dégustais mes canapés en sirotant ma deuxième coupe de champagne – c’est plus facile pour le champagne que pour les canapés – j’avais serré quelques mains. Nous attendions les petits fours en bavardant. Elle s’est approchée de nous. C’est une habituée, elle est connue pour être une vraie terreur autour du buffet. Les mauvaises langues prétendent qu’elle fourre des canapés, en douce, dans son sac à main. Ça ne l’empêche pas de regarder les gens de haut. Avec cela beaucoup d’allure, un port de reine. Rares sont eux à qui elle adresse la parole. Hier, elle nous a dit quelques mots, en passant… quelque chose comme « il y a toujours autant de monde »… avec un sourire aimable. J’ai même eu l’impression que c’est à moi qu’elle souriait. Elle s’est un peu éloignée et j’ai demandé à mon voisin s’il savait son nom.
— Mais voyons c’est la mère Delaroque. Elle fait toutes les assemblées. Trois buffets par jour, ça ne lui fait pas peur.
Quand les petits fours sont arrivés, elle est revenue vers moi et m’a entraîné vers le buffet. Il faut la voir jouer des coudes… Nous avons été servis dans les premiers. Ensuite, elle est restée à me parler, de tout et de rien, de la mondialisation, de la situation internationale. Elle me demandait mon avis, m’écoutait et, à plusieurs reprises, elle m’a dit qu’elle partageait mes points de vue. Cela m’a fait plaisir parce que, généralement, on ne me prête aucune attention. Nous avons bavardé un bon moment et, à la fin, nous avons échangé nos adresses.
V
— Charlie, il y a une heure que tu monopolises la salle de bains. Il est dix heures passées. Je l’attends pour le déjeuner.
— Qui ça l’imbécile ?
— Charlie, à partir de maintenant, tu l’appelles par son nom, Timothée Lepic.
— Timothée ! Quand on a été affublé d’un nom pareil, on ne doit pas s’en remettre. Comment est-il ?
— Très gentil, pas malin malin…
— C’est ce qu’il nous faut. Quel âge ?
— Cinquante-cinq… soixante… plutôt cinquante-cinq.
— Et physiquement ?
— Pas spécialement beau…
— Moche ?
— Non plus. Ni bien, ni mal. Totalement insignifiant. Rien à signaler.
— Eh bien, soupira Charlie, le voyage promet d’être folichon !
Rosalie ramassa le peignoir éponge qui traînait sur le carrelage ruisselant.
— Sois raisonnable, mon Poussin, c’est l’affaire de quelques jours. Après tout, c’est notre gagne-pain et je te promets qu’on passera l’été sur la Côte. En attendant, dépêche-toi. J’ai une journée chargée, j’ai convoqué l’étudiant en fin de soirée.
— Ici ?
— Eh bien oui, ici.
Charlie vivait sa libido dans le quartier du Marais, Rosalie à domicile. Question de génération.
Midi un quart : long tablier de toile cirée autour des reins, Charlie mettait la dernière main au perdreau sur canapé, un de ses triomphes. Il ne broncha pas au coup de sonnette venu de l’entrée, il fignolait la présentation : épaisse couche de foie gras étalée sur la brioche à peine dorée sur laquelle il posait les suprêmes de volaille décorés de copeaux de truffe, délicate architecture qui réclamait toute son attention. Au deuxième coup de sonnette, Rosalie parut, en collant de dentelle noire, un tube de rouge à lèvres à la main :
— Vas-y. Je ne suis pas prête.
En plein travail, Charlie protesta :
— Madame Gonzalès…
— Déjà partie, coupa Rosalie, cinq minutes avant l’heure, comme d’habitude. Vas-y, c’est le pâtissier qui apporte le millefeuille.
Ce n’était pas le pâtissier. L’étudiant pénétra dans le salon, l’air emprunté :
— C’est pour l’annonce…
Rosalie réapparut. Elle avait enfilé ses escarpins et ajustait sa deuxième boucle d’oreille. Il y eut un silence. Rosalie gratifia l’arrivant d’un regard dépourvu d’indulgence. Il tombait mal. Et pour le physique ?
Sans prendre le temps de le faire asseoir, elle jaugea. Assez grand. Bon, pour la taille cela pouvait aller. Mais blond. Dommage… Visage poupin, déjà empâté et teint blafard ; c’est le risque avec les blonds… Au premier coup d’œil, elle avait repéré l’anneau à une oreille, les bagues aux cinq doigts de la main gauche. Le silence se prolongeait.
— Je suis peut-être en avance, murmura l’étudiant.
— Exact. Je vous attendais à cinq heures.
— Vous m’aviez dit vers midi trente.
— Mais je vous ai laissé un deuxième message pour changer l’heure…