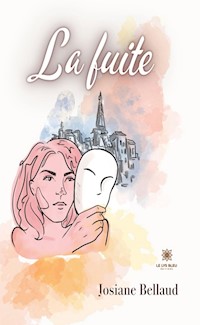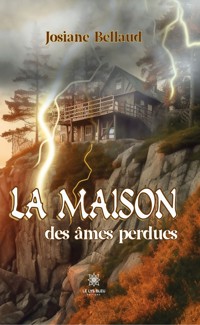
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Maryline, en quête d’identité et de sécurité, fera la découverte d’une maison située en bord de mer sur l’île de Ré. Cette demeure, qui oscille entre bienveillance et danger, est enveloppée d’un mystère séduisant qui laissera une empreinte indélébile sur notre protagoniste. Sur les traces du passé de ce lieu idyllique, Maryline se retrouvera jusqu’à New York, de l’autre côté de l’océan. Les secrets qui se cachent derrière le destin entrelacé de cette portion de l’île et de la jeune fille se révèlent entre les lignes de cette histoire captivante.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Josiane Bellaud voue une passion à l’écriture. Sillonnant le monde, elle passe des carnets de voyage aux nouvelles puis aux romans. Une fois de plus, elle s’autorise à partager et à franchir le pas de l’édition.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Josiane Bellaud
La maison des âmes perdues
Roman
© Lys Bleu Éditions – Josiane Bellaud
ISBN :979-10-422-0978-0
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Je voudrais dédicacer ce livre à Marie Thérèse,
ma tante qui à 98 ans est ma plus fidèle lectrice
Chapitre 1
Je m’appelle Maryline Mai. Née en 1960, je n’ai connu ni mon père ni ma mère. En mai de cette année-là, une main anonyme m’a déposée devant l’orphelinat du couvent. Je n’avais que quelques heures.
Ma vie ne commençait pas sous les meilleurs auspices.
C’est ce mois-là qui a inspiré mon nom de famille et ce jour précis devint ma date anniversaire. J’étais, m’a-t-on dit, un minuscule bébé hurlant devant la porte jusqu’à ce que mes cris de fureur alertent une nonne qui passait. Je manifestais déjà un intense désir de vivre, semblait-il.
J’ai passé ces premières années dans cet orphelinat à Quimper parmi une trentaine d’autres petites filles. Mes premiers souvenirs d’enfant ne sont ni des visages bienveillants ni des sourires penchés sur moi, mais des cornettes, une multitude de cornettes surmontant des visages pâles et inexpressifs. Les sœurs ne faisaient jamais preuve de méchanceté vis-à-vis de nous, mais elles se révélaient simplement indifférentes, sans amour, sans compassion. Elles pratiquaient une charité aseptisée comme l’air que nous respirions. Elles nous prêchaient l’amour du prochain, la générosité, mais elles ignoraient elles-mêmes le sens de ces mots. Ce n’était que prêchi-prêcha, un discours bien rodé et répété à l’infini.
Nos journées étaient programmées heure par heure et jamais rien ne venait troubler notre routine. Chaque dimanche, nous sortions de l’orphelinat pour assister à la messe dans la cathédrale Saint-Corentin à Quimper.
Pour l’occasion, nous revêtions des uniformes propres et bien repassés, les apparences étant primordiales. Nous marchions par deux dans la rue, les plus petites devant et les plus grandes fermaient la marche. Les nonnes encadraient cet étrange cortège. Les passants souriaient et murmuraient à notre passage, leurs regards parfois remplis de pitié, mais surtout de curiosité.
Je me souviens de cette magnifique église de style gothique avec ses deux flèches qui s’élevaient très haut dans le ciel et, entre les deux, comme figé dans sa course, la statue équestre du légendaire roi Gradlon.
Cette sortie restait l’unique distraction de la semaine et notre seule ouverture sur le monde extérieur. Une foule de femmes se serraient sur les bancs de l’église. Les hommes, pour leur part, attendaient le plus souvent assis au café d’en face, évoquant la vie au quotidien et ses aléas, le temps d’une pause devant un pastis ou un lambig, l’alcool de pomme local.
Le temps passait au ralenti, les journées se déroulaient selon un rite bien rodé entre prières, repas et éducation.
L’école se situait à l’intérieur du couvent et les cours étaient dispensés par les sœurs elles-mêmes. Comme je le découvris plus tard, leur savoir était fort limité. J’ai longtemps cru que les étoiles filantes étaient les âmes des morts qui s’envolaient vers le paradis et que l’orage symbolisait la colère de Dieu quand une fillette avait démérité. C’était dire la qualité de l’enseignement !
Parfois, l’une d’entre nous trouvait des parents, des couples venus spécialement pour adopter. D’autres partaient en famille d’accueil. Certaines revenaient quelques mois ou quelques années plus tard, sans aucune explication.
Le temps ne comptait pas, chaque jour s’écoulait, semblable au précédent.
Pour les enfants abandonnés, le sujet de prédilection, le thème de tous les fantasmes, ce sont les parents. Aucune d’entre nous ne pouvait accepter l’idée de la mort ou de l’abandon volontaire et définitif, alors nous inventions de belles histoires.
Au cœur de toute la grisaille ambiante, ce qui nous permettait de survivre, c’était la part de rêve, la petite flamme qui sommeillait en nous. Nous imaginions des scénarios improbables justifiant l’absence de parents qui bien sûr allaient réapparaître un jour pour nous emmener loin d’ici. Alors nous attendions, suspendues au temps et à notre espoir.
Un matin comme les autres, survint pourtant un événement qui s’avéra pour moi exceptionnel : la mère supérieure me convoqua dans son bureau pour m’annoncer qu’elle m’avait trouvé une famille d’accueil. Il s’agissait d’un couple qui désirait accueillir des enfants de l’Assistance publique.
C’était une pratique assez courante dans les familles de pêcheurs. Ceux-ci, en général, avaient du mal à « joindre les deux bouts » comme on disait là-bas, aussi, l’allocation versée par la DDASS pour les mineurs à charge permettait de vivre un peu mieux. De plus, ces enfants étaient de la main-d’œuvre facile et gratuite. Certaines familles en abusaient et il n’y avait aucun contrôle.
Si la rencontre se passait bien, ils viendraient me chercher dès la fin de la semaine.
J’avais 9 ans. À la pensée de quitter ces lieux, je ressentais une grande excitation, mais en même temps, j’étais terrorisée par l’inconnu et celui-ci commençait derrière la porte du couvent.
L’orphelinat était mon seul univers réel, mon seul repère, pas un foyer bien sûr, ni un endroit où accrocher mes racines, mais un lieu dans lequel je bénéficiais d’une protection contre la faim et la violence. J’ignorais ce qui se passait à l’extérieur. La porte d’entrée franchie, ce serait un autre univers où le temps et la vie auraient un rythme différent.
Je craignais que la rencontre ne me soit pas favorable, qu’ils ne me jugent pas assez intéressante pour m’accueillir chez eux. J’étais une enfant timide et ne possédais guère de confiance en moi. Le grand jour arriva et la rencontre eut lieu. Elle ne se passa ni bien ni mal, elle se passa, tout simplement, sans émotion ni promesse.
J’étais un peu inquiète à l’idée de quitter l’orphelinat. Je pensais à ma mère, que se passerait-il si elle se présentait au couvent pour me récupérer ?
Cependant, le fait de rester dans la région me réconfortait, elle me retrouverait facilement.
Dès la fin de la semaine, un homme vint me chercher devant la porte du couvent. Il prit la valise remplie de mes maigres possessions et la mit dans le coffre de son taxi.
Sortis de Quimper et après quelques kilomètres, nous traversâmes un petit village aux maisons basses dans lequel poules et cochons circulaient librement. C’était amusant ! La voiture s’arrêta devant une vieille bâtisse isolée.
Ma famille d’accueil était là, m’attendant. La femme me souriait, son visage un peu rond semblait très sympathique. Lui avait l’air d’un géant auprès d’elle, il ne souriait pas et m’observait d’un air sévère. Je me sentis anxieuse devant cet homme impressionnant.
Ils me précédèrent à l’intérieur. La maison était petite, mais très propre et chaleureuse. Je n’avais jamais vu autant de bibelots, les meubles en étaient recouverts. Sur le manteau de la cheminée cohabitaient boules à neige, petits objets en cuivre, lampes, pigeons et même un bouquet de fleurs artificielles. Le tout reposait sur des napperons blanc immaculé de toutes les tailles.
Tout brillait, il n’y avait pas un seul grain de poussière.
Dans une vitrine du buffet rustique à deux corps se tenait une collection de petites poupées bretonnes avec des coiffes magnifiques. Je restais bouche bée à les observer.
Le couple n’avait pas d’enfant. J’allais partager ma chambre avec une autre orpheline, juste un peu plus âgée, arrivée dans la famille depuis quelques mois déjà.
Elle se prénommait Annie. Elle était à l’école et je ne la rencontrerais que dans la soirée.
Je m’installais dans ma chambre. C’était une grande pièce très claire et à ma grande satisfaction, j’avais même un bureau pour faire mes devoirs. Elle était sobrement décorée, mais me parut superbe comparée au dortoir de l’orphelinat.
Le soir arriva et Annie rentra de l’école. Elle était exactement mon opposé.
Elle possédait de longs cheveux bruns bouclés et de beaux yeux verts expressifs. Sa peau couleur caramel lui donnait un petit air exotique qui me fascina. C’était une très jolie fillette, elle ressemblait à une petite princesse venue d’une île lointaine.
Moi, avec mon allure de garçon manqué, mes cheveux d’un châtain terne, coupés très courts et mes yeux marron, je me voyais plutôt en pirate sillonnant les mers du globe à bord d’un navire de flibustiers comme ceux des livres d’images.
Nous nous sentions si seules que nous n’eûmes aucune difficulté à établir un lien d’amitié très fort au fil des jours.
La maison se situait dans un village près de la côte bretonne.
L’accès à la mer nous était interdit. Pour l’atteindre, il fallait traverser la lande et les rochers escarpés qui bordaient le rivage étaient dangereux.
Ma nouvelle famille était toujours en mouvement. Lui, il partait quotidiennement en mer avec la marée haute. Parfois, il restait plusieurs jours au large sur un chalutier quand les bancs de poissons s’étaient éloignés des côtes. La pêche était son gagne-pain et il ne fallait pas compter ses heures si on voulait rapporter au port de quoi faire vivre les familles. C’était un homme taciturne et droit, il avait le sens des responsabilités. Son regard ne s’adoucissait que quand il regardait sa femme. Il y avait beaucoup d’amour et une grande complicité entre eux.
Au fil des jours en le découvrant, j’appris à l’apprécier, car sous ses airs distants et froids il faisait preuve de gentillesse et de bienveillance.
Quant à Marguerite, c’était ainsi qu’elle nous avait demandé de l’appeler, elle se levait chaque matin à l’aube. Alors, commençait une activité intense et quotidienne : cuisine, ménage, lessive, repassage et couture, sans souffler une seule minute.
Ici, tout respirait l’ordre et la propreté.
L’horaire décalé des marées basses était la seule digression de la journée, le seul élément qui ne se soumettait pas à sa volonté. L’océan a ses propres règles et n’obéit à personne, pas même à une vieille femme têtue. Elle suivait la mer quand elle se retirait et ramassait des palourdes et des coques. Elle pêchait crabes et étrilles dans le creux des rochers. Lorsque nous n’avions pas classe, nous adorions l’accompagner. Nous attendions toujours ces moments avec beaucoup d’impatience. Nous ramassions les coquillages échoués sur la plage. Nous courions sur le sable, accompagnées par les cris des cormorans et des mouettes, sans jamais ressentir de fatigue. Nous y faisions le plein d’énergie, comme si l’air marin nous rendait invulnérables.
Les jours se suivaient, entre la maison et l’école, entre l’école et la maison.
Nous rentrions à l’heure du déjeuner et après la classe, nous participions aux tâches domestiques, épluchages des légumes, mise en place de la table pour le dîner et autres gestes du quotidien.
L’école occupait un bâtiment préfabriqué à la sortie du village. L’institutrice était douce et chaleureuse et cet endroit était devenu pour moi un havre de paix autant qu’un lieu d’étude.
J’avais pris du retard à l’orphelinat. J’étais avec des élèves plus jeunes, mais je voulais être la meilleure, non pas pour attirer l’attention, mais parce que je pressentais là, une façon de sortir du rang. La notion d’ascenseur social m’était alors inconnue, toutefois mon intuition me soufflait qu’étudier élargirait le champ des possibilités.
Les enfants seuls n’ont pas le choix. D’instinct, je savais ma sécurité aléatoire, je devrais me débrouiller pour survivre.
Trois ans passèrent. Je garde de cette période de très bons souvenirs. Grâce à l’argent de l’Assistance publique, nous ne manquions de rien.
Annie était devenue comme une sœur pour moi et nous partagions tout.
Chapitre 2
Puis un jour, tout bascula.
Un ouragan éclata par une étrange soirée d’avril. Le ciel devint sombre, la lumière fut comme passée à travers un étrange prisme violet. Pendant un long moment, tout sembla suspendu, comme si la nature retenait son souffle. Tous les chiens du village se mirent à hurler en même temps, un son plaintif et effrayant. Les oiseaux s’envolaient vers les terres emportant avec eux leurs chants joyeux.
Les nuages s’amoncelèrent dans un ciel qui peu à peu s’obscurcissait. Et soudain la tempête arriva. Le vent transportait des rafales de pluie et de grêle mêlées et soufflait si fort qu’il aurait pu nous emporter.
On entendait des cris dans la rue, tous se précipitaient vers l’intérieur des maisons, y transportant ce qui pouvait encore être sauvé. C’était la panique chez les gens comme chez les animaux domestiques.
Les bateaux qui n’étaient pas très éloignés du port s’empressèrent de rentrer, parfois avec difficulté. Marguerite guetta le retour de son homme, inquiète au fur et à mesure que le temps passait et que le vent furieux arrachait les branches des arbres tout autour de nous.
Elle pria, son chapelet enroulé entre ses doigts, mais la tempête dura plusieurs heures et le soir tombé, après des heures d’angoisse, il n’y avait toujours aucun bateau à l’horizon.
Chaque matin, elle parcourait la jetée pour voir entrer les chalutiers dans le port et, telle une ombre, rentrait un peu plus voûtée au fur et à mesure que défilaient les heures et les jours.
Il ne revint jamais.
La cérémonie funèbre eut lieu plusieurs semaines après la catastrophe, sans que l’on n’eût jamais retrouvé les corps des marins disparus. La mer les garderait à tout jamais dans la profondeur de ses entrailles.
À partir de ce moment-là, tout se mit à changer. Marguerite marchait des nuits entières dans la maison, parlait toute seule et pleurait beaucoup.
L’Assistance publique, reprit Annie. Je ne la revis plus.
Je compris par la suite qu’après le décès de son mari les services sociaux ne jugeaient pas Marguerite en condition d’élever 2 jeunes enfants. Je me souviens encore la tristesse et la résignation dans les grands yeux d’Annie quand une dame à l’air sévère l’emmena loin de nous. Elle fit face, courageusement, comme si elle savait déjà que ces quelques années heureuses n’étaient qu’un passage dans une succession de mauvaises fortunes.
Je fus la seule à pleurer.
J’avais perdu ma compagne de jeu, ma grande sœur, et pour moi ce fut un déchirement. Pourquoi elle et pas moi ? Cette question me perturba jour et nuit pendant longtemps. Je ressentais une grande culpabilité à être celle qui était restée.
La peur de repartir à l’orphelinat s’infiltrait aussi au plus profond de moi, alors je me faisais toute petite pour me faire oublier.
Ce fut une période très triste et très stressante. Marguerite était devenue folle de douleur et passait des journées entières sans dire un mot. Parfois elle éclatait en sanglots et se renfermait dans sa chambre. L’atmosphère était devenue très lourde dans la maison et je me sentais impuissante. Je tentais d’aider en prenant en charge certaines tâches, mais rien ne semblait la faire sortir de son état léthargique.
Elle avait repris contact avec sa famille pour les informer de sa situation et elle reçut de nombreuses lettres et des témoignages de soutien qu’elle lisait en pleurant.
Ils vivaient tous sur la côte ouest autour de La Rochelle. Ils essayaient de la convaincre de se rapprocher d’eux.
Elle avait vécu là-bas toute son enfance ainsi qu’une partie de sa jeunesse. Bien qu’étant fille unique, elle avait de nombreux cousins avec qui, autrefois, elle partageait jeux d’enfants et escapades mémorables. Quand ses parents étaient décédés, elle avait hérité d’une vieille maison à Rivedoux-en-Ré qui à ce jour restait inhabitée. Très jeune, elle avait choisi de s’exiler pour suivre son époux et se sentait bretonne dorénavant après toutes ces années passées sur la lande.
Elle n’avait jamais pensé revenir en Charente, sa vie semblait définitivement établie ici et tournait autour de son mari. Maintenant, elle se sentait seule et dépassée. Elle avait de nombreuses connaissances, mais pas d’amis sur place.
Après de multiples tergiversations et quand elle eut accepté son veuvage, elle céda à la famille et décida de rentrer au pays afin de s’éloigner de ce qu’elle appelait « son grand malheur ».
Elle m’annonça la nouvelle en même temps que sa décision de m’emmener. J’en fus heureuse et soulagée.
Pourtant en m’éloignant, je coupais définitivement le lien avec ma mère. La raison me soufflait que si pendant ces 12 années elle ne s’était pas intéressée à moi, quelle chance y aurait-il qu’elle se manifeste maintenant… Mais quelque part au fond de moi restait une petite lueur d’espoir qui peinait à s’éteindre.
Un changement ne pourrait qu’être profitable, car la situation ne pouvait plus durer, la tristesse et le deuil dominaient notre quotidien. Alors pourquoi pas un nouveau départ ? Je devais regarder droit devant moi et renoncer aux chimères enfantines.
Nous commençâmes donc à remplir de nombreux cartons avec ce qui représentait toute la vie de Marguerite. Les déménageurs viendraient les chercher ultérieurement et les achemineraient à notre nouvelle adresse. Nous ne prendrions qu’une valise chacune avec l’essentiel de nos vêtements et quelques objets de valeur sentimentale.
Début juin, notre départ se fit dans la plus grande discrétion.
Marguerite ferma les volets et remit la clé à son beau-frère, car la maison appartenait à la famille de son mari.
Seules quelques femmes de pêcheurs étaient venues saluer notre départ. Elles présentèrent de nouveau leurs condoléances à Marguerite et lui souhaitèrent bonne chance dans sa nouvelle vie.
Puis elles s’éparpillèrent vers leurs maisons sans s’attarder, car c’était un fait avéré là-bas en pays celtique, que le malheur était contagieux.
Un voisin nous conduisit à la gare avec nos minces bagages.
Les mois écoulés et le départ d’Annie avaient réveillé en moi un sentiment d’insécurité qui dominait tout le reste. J’étais donc angoissée par ce changement à venir. Un dernier regard à notre maisonnette, aux paysages de landes et aux rochers abrupts et je tournais le dos à regret à ces années insouciantes.
Chapitre 3
Je n’ai de ce déplacement que des souvenirs très fugaces. Pourtant c’était mon premier voyage lointain.
Je ne garde au fond de ma mémoire qu’une succession d’images qui disparaissaient aussitôt perçues comme dans un film.
Le train serpentait à travers des paysages de roches désertiques bordés par quelques forêts et quelques petites villes qu’il traversait en sifflant quand il ne s’y arrêtait pas. Nous eûmes un premier changement facile à Rennes, car les wagons étaient de part et d’autre du quai et il nous suffît de descendre pour remonter juste en face.
Presque immédiatement, dès la sortie de la ville, l’environnement changea. De vastes étendues de blé, de maïs et de tournesols, petits soleils tournés en permanence vers leur symbole éclatant, s’étendaient à l’horizon. La campagne était verdoyante après les pluies printanières. Nous traversions villes et villages et je m’émerveillai de la diversité des paysages.
À l’arrivée à Poitiers j’admirai les abords escarpés de la ville et les rives du Clain.
Là, nous avions un dernier changement et suivîmes une horde de voyageurs vers la sortie, repérant les indications qui nous aideraient à trouver la bonne voie pour La Rochelle, notre destination finale.
L’attente fut brève et une locomotive vert kaki s’arrêta devant nous, sifflant d’une façon stridente et assourdissante. Il n’y avait pas beaucoup de wagons et ils semblaient un peu vieillots. Nous franchîmes le marchepied en silence, la locomotive se remit à siffler et le train s’ébranla dans un bruit cacophonique de vieille machine à bout de souffle.
J’étais épuisée par cette journée hors du commun et m’endormis pour le reste du trajet.
Marguerite me réveilla quand le train s’engagea dans les faubourgs de La Rochelle et je me souviens assez clairement de notre arrivée par une belle soirée d’été.
La gare se trouvait dans un bâtiment élégant, surmonté d’un très haut campanile qui semblait sculpté en dentelle de pierre. En sortant, je ressentis quelque chose de particulier, une impression de sérénité, et dans l’air flottait un léger parfum floral.
Une voiture nous attendait et nous conduisit au port de La Pallice où un bac faisait la navette entre le continent et l’île de Ré.
Des centaines de voitures attendaient pour s’engouffrer dans les cales du navire. Je n’avais jamais vu de bateau aussi grand. Il avait l’air d’un monstre et sa gueule grande ouverte avalait goulûment tout ce qui en approchait. Les piétons avançaient en file indienne et, les bras chargés de bagages. Au milieu de la foule, nous nous dirigeâmes vers le pont.
J’étais éblouie par tout ce que je voyais. Aucune vague n’effleurait la surface de l’eau, la mer était si belle, si calme ! Quelle différence avec la côte bretonne où les vents soufflaient en rafales et où l’océan jetait son écume avec violence sur les rochers.
Je passais la traversée appuyée à la rambarde du pont fixant tour à tour les profondeurs océanes et la ligne d’arrivée de l’île qui se profilait devant nous.
Quand le bateau accosta, le soleil commençait à baisser, mais le ciel restait bleu jusqu’au bout de l’horizon où commençaient à apparaître des dégradés d’orange.
Nous reprîmes nos bagages afin de terminer à pied notre périple, car la demeure où nous allions vivre, affirma Marguerite, était proche du débarcadère. Nous étions à Rivedoux.
En passant, je vis les maisons toutes blanches avec leurs volets verts et partout, les fleurs mélangeaient leurs corolles dans une féerie de couleurs. Cette île ressemblait à l’idée que je me faisais du paradis. Après les rochers et les criques inaccessibles de Bretagne, la plage de Sablanceaux m’émerveilla. Cette immense étendue de sable blond était une invite irrésistible à plonger les pieds dans une eau couleur de jade.
La famille de Marguerite l’attendait et elle pleura beaucoup en les embrassant.
Dans l’émotion des retrouvailles, personne ne s’intéressait à moi et je pus observer à loisir tous les gens qui m’entouraient. Ils parlaient d’une façon un peu étrange et je ne comprenais pas tout ce qu’ils disaient. Mais ils semblaient chaleureux et contents de nous accueillir.
Quand l’un d’entre eux prit enfin conscience de ma présence, Marguerite me présenta. Je réalisai seulement à ce moment-là que ces gens bavards et sympathiques allaient faire partie de ma vie.
C’était beaucoup trop d’émotion pour un seul jour, j’étais épuisée.
On nous conduisit à la maison qui avait été aérée et nettoyée sommairement pour l’occasion. Elle faisait face à la plage et il n’y avait que la route à traverser pour avoir les pieds dans le sable. Elle n’était pas très grande, mais possédait 2 chambres, une cuisine et un salon ce qui était parfait pour nous. Nos meubles n’étaient encore arrivés, mais il y avait 2 lits de fortune et nous allions nous en contenter pendant quelques jours.
La maison était restée inhabitée depuis longtemps et il y aurait beaucoup de travail pour remettre tout en état. Marguerite serait occupée un moment et peut-être en oublierait-elle peu à peu son chagrin.
Chapitre 4
Les jours suivants, les voisins nous firent bon accueil, chacun proposant son aide. L’efficacité de tous accomplit rapidement des miracles. Chaque cm² était examiné par une Marguerite attentive qui surveillait tout le monde et donnait ses instructions. En la voyant ainsi reprendre vie et donner le meilleur d’elle-même, je me dis que finalement la corvée de ménage pouvait s’avérer une activité positive.
La maison devenait habitable. Quand Marguerite se déclara satisfaite du résultat, un artisan local vint chauler les murs pièce par pièce apportant ainsi la touche finale.
L’arrivée des déménageurs fut un soulagement et après la mobilisation de tous les voisins et parents pour transporter meubles et cartons, la maison devint enfin fonctionnelle.
Marguerite avait confirmé tout son talent devant l’ampleur du travail à effectuer. Au programme, nettoyage, nettoyage et encore nettoyage… Depuis notre arrivée, cette dernière retrouvait sa vivacité. Je l’aidais du mieux que je pouvais en effectuant de petits travaux. Le résultat fut spectaculaire et nous pûmes nous installer confortablement et nous reposer de toute cette agitation.
Je découvris peu à peu mon nouvel environnement, m’aventurant un peu plus loin chaque jour.
C’était la période des vacances d’été. Chaque matin je participais aux activités de la maison, et l’après-midi, je goûtais à la liberté de flâner le long de l’océan, la seule condition imposée par Marguerite étant de rentrer avant le dîner.
J’observais les touristes qui arrivaient par vagues successives et envahissaient la plage, serviettes étendues à touche-touche. La promiscuité ne semblait pas les déranger et chacun envahissait allègrement l’espace de l’autre. Les enfants caracolaient entre les différents groupes en riant et hurlant, des ballons se perdaient dans la foule et tous profitaient des conversations de chacun. Toute cette agitation me dérangeait et je ne pouvais m’empêcher de penser au jour béni où toute cette foultitude partirait, m’abandonnant la plage.
Ce fut à l’occasion d’une de ces promenades en solitaire, m’éloignant de cette promiscuité et après avoir marché les pieds dans l’eau jusqu’à l’endroit où l’étendue de sable s’amenuisait et où la côte devenait plus escarpée, que je l’aperçus pour la première fois. Elle dominait le paysage, bâtie en haut de la falaise et posée sur un rocher, elle était spectaculaire.
C’était une maison carrée. Ce qui me frappa d’emblée, ce fut cette forme étrange, elle ressemblait à un gros cube abandonné là par accident et que la roche autour aurait amalgamé. À son extrémité, j’observais une tour, carrée elle aussi, à peine plus haute que la maison et qui semblait s’y accrocher désespérément. Elle avait dû autrefois donner du cachet à la propriété, mais aujourd’hui les murs se lézardaient et l’ensemble paraissait bringuebalant.
Face à la mer, majestueuse, la maison ressemblait à un repaire de pirates abandonné depuis la fin de l’épopée corsaire.
Je fus immédiatement inondée par un sentiment étrange, comme si cette maison n’était là que pour moi et m’envoyait des signaux que seule, je pouvais décrypter.
Je montai un petit escalier creusé dans le sable afin de l’approcher.
Les murs qui prenaient appui sur le rocher semblaient immuables, mais tout autour du jardin, les murets étaient décrépits et affaissés. Seuls les arbustes qui les avaient parasités leur permettaient de tenir encore debout. La végétation avait tout envahi, comme si cette terre n’avait été foulée par aucun être humain depuis des siècles.
La maison respirait la tristesse et l’abandon. Je l’aimais instantanément.
La roche ne semblait là que pour servir de socle à cette demeure étrange et fascinante.
J’étais devant la vieille grille en fer forgé toute rouillée et une sensation étrange m’enveloppa. Je me sentis bienvenue, communiant avec l’âme de ce lieu. J’avais l’impression d’être arrivée chez moi après des années d’errance.
Je n’oublierai jamais cette rencontre, j’en ai encore aujourd’hui le souvenir précis, je la revois telle qu’elle m’apparut ce jour-là, inaccessible et belle, autant que négligée et délabrée. Je sus à cet instant précis qu’on pouvait tomber en amour avec une maison.
À partir de ce jour naquit mon obsession pour cette vieille bâtisse qui hanta mes jours et mes nuits.
J’avais beaucoup de temps libre, Marguerite était très occupée et renouait petit à petit les liens avec ses anciens amis. Je me rendais donc quotidiennement dans mon refuge secret, loin des flux de vacanciers et je contemplais la mer à mes pieds.
J’appartenais à la maison et son ombre m’entourait d’un halo de protection. Rien ne pouvait m’arriver, ici j’étais à l’abri.
C’est là qu’au fil des semaines, se révéla ma passion pour le dessin.
Au départ, je souhaitais simplement peindre la maison et transportais dans un sac, crayons, peintures et papier à dessin. Mais dès le premier essai, les formes et les couleurs naquirent spontanément sous mes doigts et les paysages apparurent sur le papier comme si c’était naturel. J’avais un vrai don et bercée par des récits de héros qui possédaient des pouvoirs particuliers, j’étais convaincue que la maison me transmettait celui-ci.
Je ne parlais à personne de ces vieilles pierres. Je savais intuitivement que je ne devais révéler ni ma hantise ni mes rêves. Cela romprait cette magie qui nous liait.
Parfois je voyais s’animer un rideau et j’entendais aboyer un chien. Il y avait donc quelqu’un qui habitait là et pourtant je n’y avais jamais rencontré âme qui vive.
Chapitre 5
À Rivedoux, nous vivions de la petite pension que versaient pour moi les services sociaux et du montant de l’assurance que Louise avait reçu à la suite du décès de son mari. Les fruits de mer que nous allions recueillir sur la plage à marée basse : huîtres, moules et coques nous aidaient aussi à « faire bouillir la marmite », selon l’expression consacrée de Marguerite.
Avec septembre arriva la rentrée des classes, c’était ma dernière année à l’école primaire et il me fallait travailler dur, car l’année suivante je solliciterai une bourse pour entrer au lycée de La Rochelle. Cette bourse était liée à mon statut d’orpheline, mais aussi à mes résultats.
L’automne fut froid et pluvieux et mes visites à la maison carrée s’espacèrent avec l’arrivée de l’hiver.
L’été, l’île était surpeuplée surtout en juillet et août, mais l’hiver, elle était complètement désertée et retrouvait une authenticité et un calme proche de l’ennui.
L’année scolaire me sembla longue et difficile, je regrettais mon institutrice bretonne douce et patiente. Ici l’instituteur était rude et gérait sa classe comme un général son régiment. Je le soupçonnais d’avoir un passé militaire quand il nous menaçait de sa baguette. Mais j’étais une bonne élève et après des premiers mois difficiles, je m’adaptai et retrouvai ma position de première de la classe. Ceci me valut quelques facilitations de la part du maître, mais aussi de la jalousie de la part de mes compagnes pour lesquelles j’étais la fille qui n’avait même pas de parents.
Le monde de l’enfance peut être brutal et j’en avais déjà fait l’expérience.
La solitude était ma compagne depuis longtemps et quand Annie était sortie de ma vie je n’avais pas voulu me faire d’amis. Les séparations étaient trop cruelles.
Ma grande sœur d’adoption me manquait toujours et j’évitais de penser à elle, car cela me donnait envie de pleurer.
Je ne faisais aucun cas des remarques et commentaires mesquins des autres enfants.
J’imaginais qu’un jour, je deviendrais quelqu’un d’important, plus rien ne pourrait m’atteindre et ce serait ma revanche.
L’année passa rapidement et en juillet un courrier arriva annonçant que j’avais obtenu la bourse. J’étais heureuse de cette nouvelle, mais aussi angoissée par ce qu’elle impliquait. Il me faudrait quitter cette île que j’aimais déjà tant.
À La Rochelle je serais pensionnaire, car faire le trajet chaque jour avec le bateau était impensable. Un grand bouleversement s’annonçait et j’en étais consciente.
Je profitais de ce dernier été en vivant pleinement chaque jour. Il me fallait engranger des souvenirs pour l’année à venir et pour les suivantes aussi.
Mon arrivée au lycée en septembre, contrairement à mes craintes, fut plutôt une bonne expérience.
Le bâtiment s’avéra immense, il y avait de nombreux élèves, beaucoup de bruit et d’agitation. Les espaces de travail semblaient bien organisés et les professeurs étaient très abordables.
Nous changions de salle pour chaque cours ce qui rompait la monotonie des journées bien remplies. Semaine après semaine, le cycle se reproduisait et je m’habituais à ce rythme.
La vie au lycée me plaisait et je découvrais de nouvelles matières. L’anglais par exemple me rebuta un peu au départ, mais la professeure était jeune et dynamique, alors je fis de nombreux efforts pour lui plaire.
J’aimais les cours de français et les livres que nous conseillait un vieux professeur à lunettes qui faisait régner l’ordre dans sa classe par son autorité naturelle.
En mathématiques, j’avais plus de mal à fixer mon attention, car cette matière m’ennuyait un peu… Devant tous ces chiffres, mon attention avait du mal à se fixer et je m’évadais dans des rêves qui n’avaient rien à voir avec les triangles de toutes sortes ou les fractions rébarbatives.
Ma matière préférée était évidemment le dessin.
Alors que les autres élèves le considéraient comme une matière ennuyeuse et inutile, j’en appréciais chaque minute. J’eus tout de suite les meilleures notes sous l’œil bienveillant de la professeure. Très rapidement, elle me proposa des cours particuliers afin de m’inculquer quelques bases. Elle m’encourageait à continuer, assurant que j’avais du talent et je progressais rapidement.
À l’internat, j’appréciais l’ambiance des chuchotements le soir dans le dortoir quand la surveillante était entrée dans sa chambre. J’aimais nos rires et notre complicité face aux professeurs et aux surveillants.
Les semaines passaient très vite et je commençais à apprécier mes camarades de classe et de dortoir. J’allais finalement me plaire ici. Je me fis des amies pour la première fois de ma vie. Je n’étais plus la pauvre petite orpheline qu’on laissait à l’écart, je devenais l’égale de toutes les autres élèves et personne ne connaissait mon histoire.
Chaque vendredi à la fin des cours, un bus raccompagnait les élèves vivant sur l’île jusqu’au port de La Pallice et il nous attendait le lundi, à la sortie du bateau de 8 heures, pour nous ramener au pensionnat.
Marguerite guettait toujours mon arrivée avec impatience et voulait tout savoir de ma semaine.
Pendant l’hiver, elle eut du mal à marcher, à cause de ses rhumatismes, disait-elle. Cependant sa maison restait toujours impeccablement tenue.
Notre lien s’était resserré depuis notre arrivée sur l’île. Elle se comportait davantage comme une grand-mère attentive. Quand je repartais le lundi, elle me prodiguait conseils et recommandations.
Les années se succédèrent, toutes au même rythme, j’avais enfin la vie d’une adolescente presque normale. Je travaillais beaucoup afin de conserver ma bourse et de passer le cap du lycée ayant en perspective ensuite de m’inscrire dans une école d’Art. Je continuais à peindre pour mon plaisir, mais cela ne me suffisait pas et j’aspirais à bien davantage. Je voulais faire de ma passion un métier, mais le chemin pour y parvenir serait long et parsemé d’embûches.
Dans l’immédiat, j’attendais les vacances scolaires avec impatience comme le font tous les enfants depuis que l’école existe.
Chapitre 6
J’avais 14 ans quand je rencontrai pour la première fois la propriétaire de la maison carrée.
Avec l’été et l’apparition du soleil, je reprenais mes habitudes, marchant pieds nus dans l’écume des vagues jusqu’à la maison qui hantait mes rêves. Je passais une partie de mes journées à dessiner les vieux murs lézardés et les roses trémières dont les pieds jaillissaient de partout et envahissaient l’espace autour de la vieille demeure.
Les mois et les années passaient, mais l’attraction ressentie pour cette maison restait indemne. J’éprouvais toujours la même sensation d’euphorie et de bien-être dès que je m’approchais de la grille rustique.
Les autres filles recherchaient la compagnie de leurs amis, allaient sur la plage ou au cinéma, mais tout cela ne m’intéressait pas. C’était mon côté atypique.
Ce jour-là, comme tant d’autres, j’avais passé l’après-midi à dessiner et peindre devant la maison. Le soir tombait, il n’y avait pas un souffle d’air, la journée avait été magnifique et assise sur un petit bloc de granit devant la grille, j’étais plutôt satisfaite de mon tableau. Après avoir déposé sur la toile quelques petites touches de couleurs supplémentaires pour raviver les pétales des roses trémières, je me préparai à rentrer. Je rangeais mon matériel quand un taxi s’arrêta devant la grille.
La porte arrière de la voiture s’ouvrit et le chauffeur se précipita pour aider une vieille dame à sortir. Celle-ci s’expulsa du véhicule avec difficulté, ignorant la main tendue de l’homme. Elle accepta cependant la canne qu’il lui tendit et se redressa. S’appuyant dessus, elle avança vers la grille suivie d’un petit caniche blanc frétillant.
Cette femme me fascina dès l’instant où je la vis.
Je pensai qu’elle devait pour le moins être centenaire tant elle paraissait âgée. Elle était vêtue de noir de la tête aux pieds, seules quelques mèches blanches décoiffées s’échappaient d’un foulard noué à la va-vite sous son menton et tranchaient sur l’ensemble de son apparence. Son visage était ridé, tel une vieille pomme, et ses orbites creusées autour de petits yeux noirs et vifs. Ses gestes étaient saccadés et son pas pressé.
Elle avançait, courbée comme si elle portait sur son dos, le poids de toute la misère du monde. Elle se dirigea à petits pas vers la grille, en m’ignorant totalement.
Le chien courut vers moi et aboya gaiement comme pour me faire comprendre qu’il voulait jouer. Je le caressai doucement derrière les oreilles et il semblait apprécier, mais un grognement quasi imperceptible de sa maîtresse l’éloigna très vite.
En s’ouvrant, la grille tourna sur ses gonds émettant un grincement lugubre qui me donna des frissons.
Le regard de la vieille femme croisa enfin le mien quand elle se retourna pour fermer la grille et je lus dans ses yeux de la défiance, mais aussi de la peur. Elle fit un geste qui rappelait vaguement un signe de croix en murmurant des mots inaudibles.
J’en fus troublée ! Ce regard me hanta pendant longtemps.
Je ne l’avais jamais rencontrée auparavant, mais je savais qu’à travers les persiennes, quelqu’un m’épiait. J’avais senti très souvent son attention peser sur moi. Il est vrai que ma présence régulière pouvait lui sembler incongrue. Moi même parfois j’avais l’impression de me comporter bizarrement s’agissant de cette maison.
Mais sa réaction face à moi avait été étrange, c’était comme si elle avait vu un fantôme, une créature qu’elle aurait voulu faire disparaître par miracle avec un signe de croix. Elle paraissait vraiment bouleversée.
La situation devenait de plus en plus étrange, mais la fascination exercée par cet endroit fut encore plus forte et je me posais mille questions sur son occupante.
Avait-elle toujours vécu ici ? Pourquoi ne sortait-elle jamais ?
Je lui inventais des vies toutes plus abracadabrantes les unes que les autres.
Elle ressemblait à une sorcière, il ne lui manquait que le balai pour s’envoler.
Elle m’avait jeté un sort pour m’attirer et j’étais en grand danger…
La maison pourrait-elle me protéger ? Ou bien cette dernière m’appelait-elle pour l’aider à se débarrasser des sorcières qui avaient envahi les lieux ?
Mon imagination était sans limite.
Je sentais toujours une présence à l’intérieur et voyais parfois un mouvement à une fenêtre. Comment pouvait-elle vivre sans mettre le nez dehors ? Elle devait bien se nourrir, faire des courses… C’était un grand mystère.
Je m’attendais à une nouvelle rencontre à n’importe quel moment et ne savais pas vraiment si je la souhaitais ou la redoutais. Cependant, les mois et les années passèrent sans que je ne revoie la vieille dame de Sablanceaux.
Chapitre 7
Ce ne fut que trois ans plus tard, lors des vacances d’été, que j’eus l’opportunité de la rencontrer à nouveau, à son initiative cette fois.
Je m’étais installée face à la grille en amont de la plage pour peaufiner mes croquis et par un après-midi ensoleillé de juillet, soudain, tel un mirage, elle apparut toujours aussi frêle, mais l’air résolu. Elle ouvrit la grille et resta quelque seconde à m’observer, se balançant d’un pied sur l’autre.
Semblant soudain se décider, elle me fit signe de la suivre. J’hésitais quelques secondes à m’exécuter, mais surprise et curieuse, le chien sautillant autour de moi, je franchis la porte.
Un frisson étrange me parcourut, j’eus la chair de poule en pénétrant à l’intérieur de cette maison. Ce fut comme un courant d’air glacial qui me parcourut de la tête aux pieds.
Dès l’entrée, déçue, je ne vis que la saleté qui régnait ici du sol au plafond. Tout était gris, du papier peint jusqu’aux tomettes encrassées. Je ne pus m’empêcher de penser à Marguerite et à sa hantise de la propreté. Le couloir débouchait sur un salon très froid malgré la lumière qui envahissait l’espace à travers deux grandes baies vitrées.
La vue sur l’océan était époustouflante.
Une onde d’angoisse incontrôlable me parcourut. Je me sentis soudain menacée d’une façon inexplicable. La maison maintenant ne me semblait plus si hospitalière.
La vieille dame me fit signe de m’asseoir. Sans dire un seul mot, elle s’installa sur le fauteuil opposé me fixant comme si elle faisait face à son pire cauchemar.
Après de longues minutes :
S’ensuivit une logorrhée de mots sans aucun sens.
Figée dans mon fauteuil, je la regardais avec horreur, me rendant compte que la femme en face de moi « branlait du chapeau » comme aurait dit Marguerite. La peur me paralysait complètement. J’étais chez elle, à sa merci.
Elle pourrait m’agresser, me frapper… ma raison me disait qu’elle était vieille et faible et qu’en cas d’attaque, j’aurais le dessus, mais je ne songeais qu’à m’enfuir.
J’essayai de rompre cette ambiance délétère en m’adressant à elle :
Je vis chez Mme Guilvinec à Rivedoux. Je suis ici depuis quatre ans. Avant nous vivions en Bretagne.
Le visage de mon interlocutrice affichait une totale incompréhension. Elle sembla réfléchir à mes paroles. Elle se prit la tête entre les mains en soupirant.
Elle se leva, hurlant des mots sans suite et affolé, je m’extrayai du fauteuil et me dirigerai à toute allure vers la sortie. Je franchis la grille et courus sans m’arrêter jusqu’à la maison de Marguerite.
Je n’avais plus aucun doute, cette vieille femme n’avait pas toute sa raison.
Malgré la panique qui m’avait saisie, j’étais éberluée par cette aventure. Je voulais vraiment comprendre qui était cette femme et pourquoi elle se comportait d’une manière aussi étrange. Mais l’été passait et j’avais de nombreuses activités, alors peu à peu le souvenir de cette journée s’estompa.
Cependant, mes nuits étaient régulièrement peuplées de rêves récurrents dans lesquels une troupe de vieilles dames me poursuivaient en criant :
Au petit jour, je m’empressais d’oublier ces cauchemars ridicules.
Pourtant la maison me manquait et j’avais l’impression que de loin elle me reprochait de l’avoir abandonnée.
Chapitre 8
En avril, pendant les vacances de Pâques, je croisai André, un vieil ami de Marguerite, venu lui rendre visite. Il était mytiliculteur sur l’île.
Ils se connaissaient depuis toujours et avaient fréquenté la même école. Après des années de séparation, ils s’étaient retrouvés avec plaisir et avaient toujours beaucoup de souvenirs à évoquer. Il n’avait jamais quitté l’île sauf pour aller à Rochefort faire son service militaire. Pour lui le monde se limitait à son coin de terre et de mer et il en sortait peu, prétendant qu’ici il avait tout ce qui lui était nécessaire ; alors, pourquoi aller voir ailleurs ?
Il avait succédé à son père à la tête de l’exploitation familiale qui se transmettait ainsi depuis plusieurs générations.
Ses parcs étaient proches d’ici et il passait régulièrement nous apporter une bourriche pleine de moules. Selon un rite précis, deux ou trois fois par semaine, il arrivait avant le déjeuner et Marguerite lui offrait un pineau local. Tous les deux, assis autour de la table de la cuisine, évoquaient leur enfance sur l’île, leurs amis d’autrefois et les différents événements dont ils se souvenaient.
La semaine passée un de leur camarade d’école avait succombé à une longue maladie. Il avait combattu les Allemands dans le maquis pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet évènement était ce jour-là au cœur des discussions. André retraçait le discours du curé qui avait fait référence à son passé glorieux et commentait la cérémonie.
Je ne prêtais pas vraiment attention à ce qui pour moi, à l’époque, s’apparentait à des souvenirs de vieillards.
Cependant, leur pratique du patois local m’enchantait, j’en aimais les mots imagés et l’intonation spécifique des phrases. Marguerite ne parlait pas ce langage au quotidien, même si les sonorités en avaient bercé son enfance. Pourtant de temps en temps quelques expressions imagées lui échappaient et en présence d’André c’était encore plus évident, comme si l’utilisation de ce jargon quasi incompréhensif était contagieuse.
Au fil de leur conversation, une idée commença à germer dans ma tête.
Je me tournai vers eux et posai la question :
L’homme me regarda surpris et s’adressant à Marguerite, murmura :
Pas étonnant, dans quémaisan !
Puis, se tournant vers moi, il expliqua :