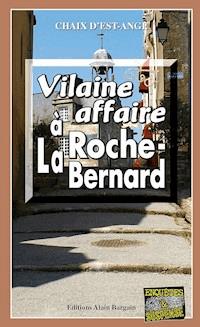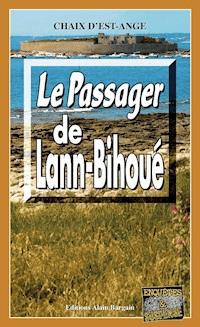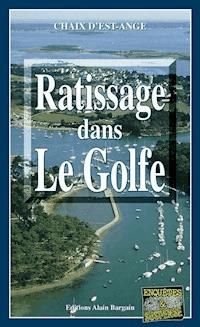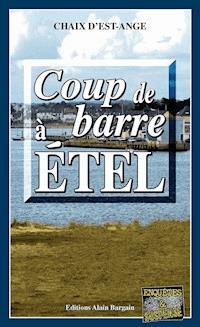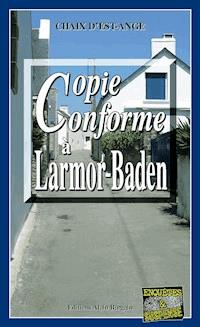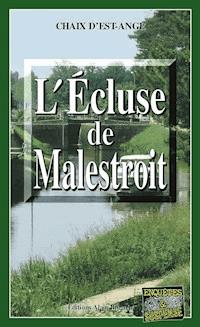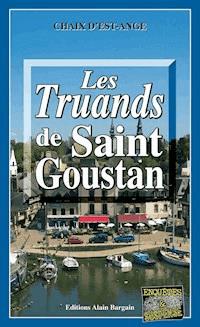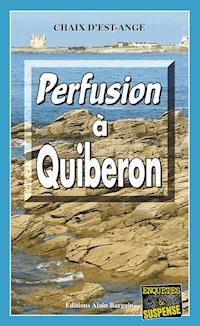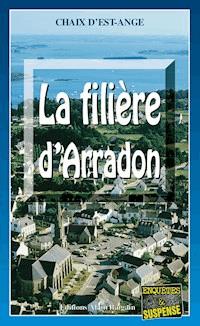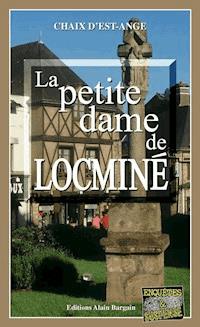
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Marie Lafitte
- Sprache: Französisch
Le lieutenant Alban plongé dans l'univers très particulier des chercheurs en sciences humaines : intranet, Internet et... un cadavre.
Le lieutenant Alban et le commissaire divisionnaire Cazaubon se souviendront longtemps de leur première rencontre avec cette toupie de Marie Lafitte. C’était en 1996, au moment où le vénérable Institut des Sciences Mérovéennes de Vannes équipait ses chercheurs d’un réseau de communication par ordinateurs. Intranet, Internet et... un cadavre. Comme par hasard, celui du directeur du Laboratoire d’Informatique. C’est Marie qui l’avait découvert. Pour trouver le coupable, le lieutenant Alban et le divisionnaire
Cazaubon avaient plongé dans l’univers très particulier des chercheurs en sciences humaines. Des gens comme vous et moi, avait dit Alban. Le lecteur jugera lui-même.
Retrouvez le lieutenant Alban, le commissaire Cazaubon et Marie Lafitte dans le second volet de leurs enquêtes haletantes au cœur de la Bretagne ! Qui a assassiné le directeur du Laboratoire d'Informatique ?
EXTRAIT
On sonna encore à la porte.
C’était le commissaire. Il avait l’air tout guilleret.
Après avoir salué Marie, il s’excusa auprès d’elle et me prit à part dans un coin du salon.
—Le juge d’instruction est d’accord, pour la garde à vue de Martin, me dit-il à voix basse. Il pense comme moi que ça va provoquer des réactions intéressantes.
— Quelles réactions ?
— Figure-toi que Chabot, l’un des opérateurs, a demandé à me voir pour me dire que Martin est innocent et que nous ferions bien de chercher chez les maris trompés.
—Ils sont tous mariés, au labo, sauf Thompson de Machin, qui est divorcé !
—Mais qui a des vues sur Lucie Jouanno, laquelle était en butte aux assiduités de Garnier…
Quand nous avons demandé à Marie Lafitte si elle pensait avoir des ennemis au Laboratoire d’Informatique, elle balbutia :
—Il y a bien eu ce message sur mon ordinateur… Ça m’a fait un choc… Je croyais… Mais Jean-Edmond s’est tellement moqué de moi que je n’en ai parlé à personne. Il est physicien. A Rennes, les chercheurs se servent tout le temps de la messagerie électronique
pour se faire des blagues…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Après une carrière d'ingénieur de recherche au CNRS à Paris,
Chaix d'Est-Ange se consacre aujourd'hui à l'écriture de romans policiers. Le Pays de Vannes est, depuis de nombreuses années, son lieu favori de détente, l'hiver. C'est aussi le cadre choisi pour ce deuxième roman. Elle est décédée en 2011.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Charles et Solange
REMERCIEMENTS :
– À Jean-Marie pour le travail d’analyse et de reconstruction qu’il a effectué pour rendre cette histoire plus digne d’être lue.
– À Michèle et André, qui m’ont aidée, critiquée, encouragée.
PROLOGUE
Nous nous promenions à Arradon. C’était presque le printemps. Je tenais Sarah par la main.
Elle avait voulu voir l’exposition d’aquarelles de Guenaël Le Coq, à la chapelle Saint-Jean. Ça ne m’avait pas déplu. Le dessin est ferme, les couleurs légères.
Nous avons ensuite marché dans le bourg.
Arradon, pour les citadins de Vannes, c’est la porte du paradis, le chemin où l’on traîne, admirant les belles propriétés qui descendent vers la mer, en route vers les petites plages du Golfe du Morbihan, contournées, secrètes, poissonneuses, un rien vaseuses. Les pères y emmènent leurs enfants, le dimanche en fin de matinée, près de la Tour Vincent. A marée basse, ils mettent à l’eau une coque en plastique, y installent les bébés, chacun avec son gilet de sauvetage. Pieds nus, pantalon retroussé, ils les traînent au large vers les troupeaux d’oiseaux de mer, leur montrent les échassiers blancs au bec jaune, les canards à peine sauvages, les contours de l’Ile d’Arz, de l’Ile aux Moines. Ils leur apprennent qu’on peut regarder de loin la terre et ses maisons, la désirer quand le clapotis devient trop fort, quand le cri des mouettes se fait strident.
A Kérat, Sarah me dit brusquement :
— C’est bien là que nous avons rencontré Marie Lafitte avec ce gros chien ?* C’était en novembre dernier, n’est-ce pas ?
— Oui. Mais je préfère ne pas parler de cette toupie. Elle me fout le bourdon.
— Ah ! Bon !… Tu veux qu’on cherche un coin abrité, pour le pique-nique ?
Après le pique-nique face à la mer – une « casquette » du boulanger d’Arradon, des rillettes et des mandarines –, nous sommes restés assis au soleil. J’étais si bien que le temps s’est arrêté. Je crois que je me suis endormi un moment, le dos appuyé contre une barque renversée. Je sentais que Sarah me calait la tête avec quelque chose de doux. Son écharpe en peau de zibi, peut-être… J’ai même dû prononcer ce mot ridicule, parce que j’ai entendu un rire.
Et puis, d’un coup, tout m’est remonté à la mémoire, les images se succédaient, je voyais Marie Lafitte, et l’Institut, à Vannes, où le commissaire et moi avions fait connaissance avec la Science, en 1996, au cours de cette fameuse affaire Garnier.
Enfin, la Science… Je veux dire la horde des scientifiques de l’Institut. Des gens plutôt attachants, quoique souvent discoureurs et vaniteux. Tout aussi vaniteux, envieux, gourmands, négligents, distraits et vulnérables que vous et moi. Intéressés aussi, pour certains. Méchamment intéressés…
Dites-vous bien que ce n’est pas parce qu’on est, comme eux, obnubilé par l’histoire, l’archéologie, la sociologie, la linguistique, la logique, la mathématique, la sémiologie, la philosophie – j’en passe et des meilleures – qu’on est un pur esprit.
Par exemple, on peut être sémiologue et amoureux. Ou bien sémioticien et pêcheur de moules. Si ! Si !
Certains d’entre vous n’en seront même pas étonnés, pour la bonne raison qu’ils ne fréquentent ni sémiologues, ni sémioticiens. Eh bien…, ces gens disent qu’ils étudient la signification. Allez savoir comment, où, pourquoi… Il ne faut pas m’en demander trop.
C’est Marie Lafitte qui m’est apparue la première dans mon sommeil. A cette époque-là, elle habitait encore la maison de Locminé, avec son mari Jean-Edmond, un physicien de la Fac de Rennes. C’est elle qui a trouvé le cadavre sous la table de l’ordinateur.
Un témoin, rien de plus. Elle a pourtant ensorcelé notre divisionnaire, le commissaire Cazaubon. Enfin, c’est ce que je crois…
Elle ne faisait pas partie de l’Institut, mais elle y travaillait fréquemment et s’y était approprié un rôle étonnant, voire dangereux. Elle critiquait méthodiquement le travail de ses collègues. Son truc, c’était de mettre en pièces leurs méthodes surannées, de démonter leurs hypothèses ou leurs préjugés, d’exposer les failles de leur discours.
Pour enfoncer le clou, elle se servait d’un ordinateur, chargé par elle de simuler les raisonnements scientifiques humains et de produire des conclusions. Elle m’avait expliqué un jour que ce qui sort d’un ordinateur est plus neutre et moins offensant que ce qui sort de la plume, ou de la bouche, d’un être humain. « Je peux donc y aller carrément », avait-elle ajouté d’un air innocent.
Je la vois assise, en train d’écrire avec application, entourée de ses cheveux. Longs, épais et bouclés comme vous n’avez pas idée… Chaque mèche a sa vie propre et ondule de façon indépendante. Façon Botticelli, dit Sarah.
Je vois Maud Evenou, son amie et collègue, installée à la table toute proche. Une grande femme rousse, aussi imposante que Marie est minuscule. Elles travaillaient ensemble, et enseignaient leurs méthodes subversives à la jeune génération qui fréquentait l’Institut. Bref, à elles deux, elles foutaient le bordel dans la communauté scientifique. Intellectuellement parlant, j’entends.
Voilà Isabelle Delaporte. Elle entre dans la pièce, une lettre à la main. C’est la secrétaire du Laboratoire d’Informatique où le drame a eu lieu. Un petit bijou aux cheveux cendrés, aux yeux bleus.
J’avoue avoir eu un faible pour elle. Je ne connaissais pas encore Sarah. Ma petite amie du moment s’appelait Arlette. Une beauté, blonde et sculpturale. Nous ne nous entendions déjà plus.
Vous êtes si jolies, mais la barque s’éloigne…**
Qu’est-ce ça vient faire là ? Et puis, zut ! Je n’ai pas à me justifier quand je dors.
Ensuite, c’est Bob Garrett, un géant aux cheveux ras, genre Schwarzenegger, qui arrive dans le bureau. Il tient un transparent écrit à la main. Il dit : « Maud, c’est bien à vous ? J’ai reconnu votre écriture ».
Maud Evenou répond : « Bob, soyez gentil, prêtez-moi votre pull ! ».
Les rêves sont parfois un peu décousus, n’est-ce pas ?
Paul Thompson de La Ferrière entre alors, vêtu d’une élégante veste en tweed, il se dirige vers le tableau noir et commence aussi sec une conférence sur la logique des requêtes dans une base de données relationnelle. Si ! Je vous assure que c’était ça, j’ai une mémoire d’éléphant…
Tout le monde écoute religieusement, en silence, même Maud Evenou qui, d’ordinaire, a le clapet affûté. Marie Lafitte et Bob Garrett prennent des notes.
Je commence à m’ennuyer quand Lucie Jouanno fait son apparition, le teint doré, vêtue de voiles soyeux. Elle me rappelle une indienne que j’avais vue aux environs de New Delhi, lavant son buffle dans une mare. Une princesse des mille et une nuits en sari turquoise au milieu de la boue. Lucie est bretonne pourtant. Elle a passé un DEUG d’informatique à la Fac de Rennes. Je ne l’ai jamais vu porter un imperméable ou un manteau. C’est le genre à passer entre les gouttes. Au Laboratoire d’Informatique, elle range les livres, tape une lettre de temps en temps.
Son arrivée coupe le sifflet à Paul. Plus question de logique des requêtes, modale, approximative, floue ou autre. Il se précipite vers la déesse, lui prend la main en disant : « Je ne veux pas que vous restiez seule le soir au labo. C’est trop dangereux ».
Pendant ce temps-là, Alain Kit-Wah, un ingénieur informaticien, dit le Chinetoque, qui a surgi d’on ne sait où, s’est assis à côté de Marie Lafitte et lui montre des liasses de sorties machine. Ils travaillent tranquillement, au milieu d’un brouhaha de conversations.
Le bureau est pourtant petit, mais je les vois tous aussi clairement que je vous vois et quand les quatre techniciens, Martin, François, Chabot et Courtois, frappent à la porte, Maud Evenou s’arrange pour les caser.
Martin a apporté de la bière et des photos de la longère en ruines qu’il retape dans le Golfe. D’ailleurs, il porte un pantalon couvert de plâtre.
François, un soixante-huitard attardé qui ressemble à un druide, tend à Maud une poignée d’algues brunes et visqueuses, et dit : « C’est pour votre terrine de lotte ». Maud remercie et fourre ces horreurs dans un grand sac en tapisserie qui déborde déjà d’écharpes, de magazines et de tickets de bus. Personne n’a l’air étonné.
Chabot, timide, fripé, s’assied dans un coin sans mot dire à côté de Courtois. Tous les deux, je les vois à peine. Ils sont transparents. Seul le blouson en cuir noir de Courtois se détache sur le mur.
« Est-ce que Jeanne a fini de pleurer ? » demande Maud à Bob Garrett.
Jeanne Régnier, je me la rappelle bien, parce qu’elle a réussi à faire perdre patience au commissaire. C’est la secrétaire de la revue Sinapse de Bob Garrett. Elle fait irruption dans la pièce, et dit d’un ton furieux : « Je vous déteste tous. Je lui dirai, au commissaire Cazaubon, où vous étiez lundi soir ! ». « Jeanne ! » répond Maud tranquillement. « Vous n’êtes pas laide. Vous en trouverez, un autre bonhomme ! Quelqu’un de Vannes, cette fois-ci, hein ? ».
Je n’ai pas entendu la réponse de Jeanne. Le gardien, monsieur Pleven, un homme trapu et silencieux, nous a fait signe que c’était l’heure. Sarah me secouait. Il commençait à pleuvoir.
— Tu pourras continuer l’histoire à la maison, me dit-elle. Je t’aiderai à l’écrire. On va commencer par le premier jour de ta rencontre avec Marie Lafitte.
* Voir La filière d’Arradon, même éditeur, 1999.
** Apollinaire, Alcools, Mai.
I
Pourquoi Marie Lafitte s’était-elle rendue au deuxième étage de l’Institut, ce mardi matin ?
J’ai pensé très vite qu’elle s’était prescrit un petit tour dans l’ascenseur, pour s’aguerrir, à l’abri des témoins, dans le bâtiment encore désert. C’est son genre.
— Tu extrapoles, Alban, me fait souvent remarquer le commissaire divisionnaire. L’extrapolation est une variété inférieure de raisonnement. Nous ne pouvons pas nous permettre ça à tous les coins de rue.
Une fois, pour le faire enrager, je lui ai demandé si le juge d’instruction savait comment il avait obtenu ses conclusions dans l’affaire des frères Lagrange.
— En raisonnant par analogie avec le cas des Cortone, je ne le lui ai pas caché, a-t-il répondu. Les faits m’ont donné raison.
J’ai dit perfidement :
— Vous avez eu de la chance. L’analogie, c’est pas vraiment la fleur des pois. Mon chat raisonne par analogie.
— J’ai une haute opinion de Bogart, Alban. Ce chat est exceptionnel. Tu ne le mérites pas, a-t-il répondu.
— Il m’a choisi, chef, ai-je dit, histoire d’avoir le dernier mot.
Pour en revenir à Marie Lafitte, le commissaire et moi avons su, après coup, qu’elle avait une trouille bleue des ascenseurs. C’est Maud Evenou, sa collègue et amie, qui a cafté. Marie est aussi claustrophobe, a-t-elle ajouté en s’esclaffant. Mais vous ne la ferez pas avouer, commissaire.
Quand elle est arrivée au Laboratoire d’Informatique, au rez-de-chaussée de l’Institut, il était 8 heures. Il n’y avait pas un chat. Elle a posé ses petites affaires sur une chaise dans le bureau de Maud Evenou et décidé, après bien des hésitations, d’aller chercher un café au sixième étage, où il y a un distributeur de boissons tout neuf, qui rend la monnaie.
Au retour, son gobelet encore à demi-plein à la main, elle a cru que l’ascenseur faisait un léger bruit, comme s’il frottait contre une paroi. Son cœur s’est mis à battre… Et voilà-t’y-pas que l’ascenseur s’arrête plusieurs fois. Avec un hoquet. Entre les étages.
Lorsque le voyant du deuxième étage s’est allumé et que la porte s’est ouverte, elle a bondi dehors aveuglément, renversant du café sur sa jupe blanche.
Elle s’est retrouvée sur le palier, honteuse de sa frayeur, et contrariée par l’énorme tache qui ornait le devant de sa jupe.
Il était maintenant 8 heures 30. Elle devait se dépêcher, elle devait se reprendre, elle devait nettoyer cette tache avant de rencontrer qui que ce soit.
Elle a pris le couloir des historiens. Elle savait où étaient les toilettes. Quand le commissaire lui a fait remarquer que les toilettes étaient disposées exactement de la même façon à tous les étages de l’Institut, elle a murmuré qu’elle montait souvent voir le chercheur américain aveugle du deuxième étage. Il a un gros chien beige, a-t-elle ajouté d’un air de défi.
C’est-y une réponse logique, ça ? La spécialité de Marie Lafitte est pourtant l’étude du raisonnement, et même, tenez-vous bien, sa simulation sur ordinateur, si vous voyez ce que je veux dire. Le nombre de ses publications sur ce sujet, en collaboration avec Maud Evenou, est impressionnant. Ce qui prouve bien qu’il reste encore quelques cordonniers mal chaussés, en dépit des statistiques officielles.
Au milieu du couloir, elle s’est aperçue que la porte de la salle de conférences était entrouverte. Etrange ! Normalement, toutes les portes étaient bouclées chaque soir, à cause des vols fréquents de matériel. Il devait être plus tard qu’elle ne croyait.
Elle a passé le nez dans l’entrebâillement de la porte, se disant qu’elle verrait peut-être Bill l’Amerloque et sa Totote beige. Ils étaient très matinaux habituellement. Ne voyant personne, elle s’est avancée dans la pièce.
Pourquoi ? Elle n’a pas pu s’expliquer clairement. Elle avait toujours sa tache de café, mais…
— Mais quoi ? a dit le commissaire rudement.
Il avait pris une grosse voix, mais j’avais le sentiment qu’il se marrait.
Marie Lafitte, à mon grand étonnement, est devenue toute blanche :
— J’ai eu… une sorte de… pressentiment. C’était… mal rangé. Alain Kit-Wah est méticuleux. C’est souvent lui qui part le dernier, le soir.
Il y avait une chaise renversée près de l’un des ordinateurs et une liasse de sorties d’imprimante était déroulée par terre. Elle s’est approchée : des câbles neufs, probablement pour le branchement au réseau informatique, sortaient du mur. Ils ressemblaient un peu à des serpents, jaunes et noirs, formant des anneaux lâches sur la moquette. Il faut refaire toute l’installation, se dit-elle, quel gâchis…
Puis il lui sembla que son cœur s’arrêtait. Derrière le dernier ordinateur, l’un des fils, plus long que les autres, ne faisait pas d’anneaux. Il semblait tendu vers le sol.
Comme fascinée, elle s’est encore avancée. Un homme très grand était couché par terre, la tête sous la table de l’ordinateur. Il ne bougeait pas.
Luttant contre l’envie de s’enfuir, elle a regardé sous la table. Un câble était enroulé autour du cou de l’homme. Elle voyait son visage violet. Les yeux étaient grands ouverts, tournés vers le haut. La bouche…
Elle pensa que c’était Jacques Garnier, le directeur du Laboratoire d’Informatique.
— Vous l’avez reconnu ? demanda le commissaire. Pourtant…
— Pas vraiment. J’ai juste pensé que ça devait être lui. À cause de tous ces ennuis dans le labo. J’ai eu beau me dire que ça n’arrive jamais, chez des gens comme nous…
— Des gens comme vous ?
— Commissaire, il n’y a que des chercheurs en sciences humaines qui viennent travailler dans ce laboratoire d’informatique. Des historiens, des sociologues, des ethnologues…
— Et alors ?
— Mais ces gens-là… n’ont pas d’action sur le réel. Ils parlent des événements, ils inventent et échafaudent des concepts. Leur domaine, c’est le discours.
— Et le personnel technique du laboratoire ? Les électroniciens, les informaticiens ?
— Je ne sais pas, commissaire.
Après, il y avait eu comme un brouillard. Elle n’avait même pas senti qu’elle tombait. Le coin de la table lui avait heurté la tête. Une traînée rouge s’était formée sur la moquette. Avant de sombrer, elle s’était demandée d’où ça venait.
Bill l’Amerloque, un historien, nous a raconté la suite. Totote et lui étaient arrivés au deuxième étage sur les talons de Marie Lafitte. Totote a mené directement son maître à la salle de conférences, ignorant le bureau de Bill.
Bill, un peu étonné, le suivit sans discussion. Le chien savait toujours ce qu’il faisait. Il devait y avoir un ami à lui déjà installé dans la salle. Totote avait tellement d’amis… Mais une fois dans la salle de conférences, tiré par le chien jusqu’au fond de la salle vers le cinquième ordinateur, Bill comprit que quelque chose de grave s’était passé. Totote s’était assis et poussait de petits cris. Bill se pencha et sentit que quelqu’un était couché par terre. Il s’accroupit et passa ses doigts sur un visage.
Il connaissait plusieurs longues chevelures. Mais frisée comme ça… Le parfum léger, à base de jasmin, lui était familier. Il se releva lestement et, traînant Totote, revint aussi vite qu’il put dans le couloir.
La secrétaire du département d’histoire, une forte femme, était déjà là. Elle revint avec lui dans la salle, poussa un hurlement puis essaya de ranimer Marie Lafitte, tout en criant à Bill de téléphoner à l’infirmerie et à l’administrateur.
*
Quand nous sommes arrivés du commissariat boulevard Nominoé, le commissaire et moi, le couloir du deuxième étage était envahi. L’administrateur essayait comme il pouvait de repousser les historiens dans leurs bureaux respectifs. On aurait dit qu’il chassait des mouches.
L’arrivée du commissaire fit merveille. Comme par enchantement, ils se dispersèrent, retournant sans protester à leurs échafaudages de concepts.
L’infirmière avait prestement réveillé Marie Lafitte de son état comateux. Dès son arrivée, le docteur Régis Armagnac, notre médecin légiste, un ami d’enfance du commissaire Cazaubon, a pansé la plaie de sa tête. Il nous a recommandé de la laisser se reposer. Elle avait perdu pas mal de sang.
Elle murmura :
— Je voulais seulement du café…
Comme elle commençait à gigoter, l’administrateur l’a portée comme un paquet à l’infirmerie.
L’Institut est un grand bâtiment des années 70 qui donne sur le boulevard de la Paix, à l’angle de la rue du Général-Thiébeauld. Il appartient à l’Agence Nationale de la Recherche, et abrite, outre le Laboratoire d’Informatique, et un laboratoire de mathématiques appliquées, une trentaine d’équipes de recherche en sciences humaines aux spécialités diverses telles que l’histoire, la sociologie, la linguistique, la sémiologie, la logique, la philosophie.
Les gens au parfum appellent l’Institut « ISM », pour « Institut des Sciences Mérovéennes ». Intellectuellement parlant, le père fondateur de cet Institut serait en effet l’historien Mérovée, un Vannetais pur beurre, mort en 1900, lequel aurait été un champion avant l’heure du concept moderne d’interdisciplinarité. Marie Lafitte prétend cependant que l’administrateur l’a autorisée à farfouiller dans les archives de la maison et qu’elle a eu là la preuve formelle que « ISM » veut dire Institut des Sciences Molles. Mais nous avons appris à connaître cette nana. Quand elle prend un air aussi sérieux, on ne sait jamais si c’est du lard ou du cochon. Dans le doute, on laissera tomber la question.
Nous nous sommes vite aperçus que notre travail d’enquête serait difficile. Allez donc mener une enquête dans un hall de gare ! Vous verriez ce va-et-vient ! Les chercheurs, les profs, les étudiants stationnent dans l’entrée, prennent les nombreux ascenseurs, vont bavarder à la cafétéria, becqueter à la cantine, travailler à la bibliothèque, parler ou dormir dans les salles de séminaires, discuter dans les bureaux.
Dans la journée, l’entrée est libre. Des gens du quartier, des chômeurs, des clochards participent au bordel ambiant. Impossible de les distinguer de l’élite intellectuelle proprement dite.
Heureusement, il n’y a que deux entrées : celle du parking souterrain, dans la rue du Général-Thiébeauld, et l’entrée principale, sur le boulevard de la Paix.
On y a immédiatement posté des hommes, chargés d’empêcher les gens de sortir et de retenir les arrivants. La rude tâche de relever l’identité de toutes les personnes présentes a été confiée aux hommes de mon collègue Le Fichant.
Le Laboratoire d’Informatique est un long rectangle qui occupe l’aile gauche du bâtiment, au rez-de-chaussée.
Du côté éclairé, donnant sur le boulevard de la Paix, sont installés le directeur, les ingénieurs et chercheurs en informatique, ainsi que quelques salles de réunion. Du côté obscur, où se trouvent les escaliers, l’ascenseur, les toilettes et divers placards, on trouve des salles d’informatique, des salles de cours, et les trous à rats qui servent de bureaux aux techniciens.
Nous nous sommes établis dans le bureau de Garnier, aidés par Isabelle Delaporte, la secrétaire, une petite femme élégante, aux cheveux cendrés.
— Voulez-vous du café ? demanda-t-elle en souriant, après avoir répondu calmement à nos questions, et nous avoir apporté un tas impressionnant de dossiers.
La mort de son patron n’avait pas l’air de l’avoir troublée outre mesure.
— Il ne faut pas vous déranger, dit le commissaire.
— Ne vous inquiétez pas. Il y a une machine à café au bout du couloir. Avec du sucre et du lait ?
— Volontiers, merci, dit le commissaire.
Pendant que nous sirotions le café, il examinait des feuilles posées sur son bureau.
— Alban, regarde le plan qu’elle nous a donné, et la liste du personnel. A l’entrée du couloir, il y a le bureau de madame Evenou. C’est pas avec elle que travaille madame Lafitte ?
— Madame Lafitte ?
— C’est elle qui a trouvé le corps, tu sais bien. Elle est archéologue. Elle s’occupe de méthodes informatiques appliquées à l’archéologie.
— Ah ! Oui ! La nana minuscule, qui a des cheveux incroyables. Et alors ?
— Qu’est-ce qu’elle est allée faire au deuxième étage vers 8 heures si elle devait travailler ici avec Maud Evenou ? Si elle voulait du café, elle n’avait pas loin à aller. J’ai vérifié, il n’y a pas de machine à café au deuxième étage.
Il connaissait déjà par cœur l’organisation du Laboratoire d’Informatique, le nom de chacun de ses membres ! Pas étonnant ! Il lui suffit d’un coup d’œil pour mémoriser une page, à cet homme-là ! Mais moi… En soupirant, je potassai les documents que la secrétaire avait apportés.
Le Laboratoire d’Informatique se compose de douze membres, si l’on compte Garnier, son défunt directeur.
A l’entrée se trouve le bureau de Maud Evenou, informaticienne, et de Marie Lafitte, puis celui de Garnier. A la suite, on trouve le secrétariat où règne Isabelle Delaporte, et le bureau de Paul Thompson de La Ferrière. J’ai su par la suite que ce mathématicien égaré dans l’informatique est un descendant des ducs de La Ferrière. Un Breton dont la mère était anglaise, ce qui explique son nom à coucher dehors.
Vient ensuite la pièce de Bob Garrett, un statisticien qui donne dans la linguistique formelle, la traduction automatique, la fabrication de résumés sur ordinateur, que sais-je encore. Jeanne Régnier, qui travaille à la revue Sinapse dirigée par Bob Garrett, a son bureau à côté du sien. Après, il y a une sorte de renfoncement où trônent la photocopieuse et la machine à café, puis deux salles de réunion.
En face des bureaux de ces chercheurs, de l’autre côté du couloir, le Laboratoire d’Informatique abrite une salle de micro-ordinateurs, une salle de mini-ordinateurs SUN, une salle de cours, et les bureaux des techniciens. Des trous à rats, ces bureaux, ai-je dit. Je n’ai pas exagéré. Entre l’escalier, les toilettes et l’ascenseur, on a casé six cubicles étroits. Quatre techniciens – François, Courtois, Chabot et Martin – végètent dans les premiers. Lucie Jouanno, une brune langoureuse et plantureuse, aux humbles fonctions de documentaliste-maison et de femme à tout faire, se morfond au bout du couloir, près de l’ascenseur. Alain Kit-Wah, que j’ai entendu appeler le Chinetoque, a son bureau au fond.
Côté techniciens, l’ambiance n’a pas l’air vraiment gaie. Au cours de l’enquête, j’ai nettement perçu une tension qui semblait se cristalliser autour d’Alain Kit-Wah. « Pourquoi cette hargne contre lui ? », ai-je demandé une fois à Marie Lafitte. « Alain a fait une école d’ingénieur, contrairement aux autres, mais ce n’est pas ça la vraie raison. Son père était vietnamien, on le considère comme un étranger », a-t-elle répondu d’un air embarrassé, comme si elle avait honte pour les autres.
Vers 10 heures, on commença à interroger les quatre techniciens. Ils nous expliquèrent qu’ils avaient tous travaillé tard, la veille, à l’installation de nouveaux câbles pour le réseau informatique. Ils ne s’étaient pratiquement pas quittés. Martin s’était rendu dans la salle de conférences du deuxième étage vers 21 heures 30.
François, le plus ancien, à la barbe fleurie, marmonna d’un air sentencieux :
— L’Ankou a frappé.
— Quand avez-vous vu monsieur Garnier pour la dernière fois ? demanda le commissaire, comme s’il n’avait pas entendu.
— Heu… C’était hier soir… vers… 21 heures 30. Il se dirigeait vers le bureau de Lucie Jouanno.
— Vous lui avez parlé ?
— Il avait autre chose à faire.
— Quoi ? Il était là pour surveiller les travaux, non ?
François eut un rire caverneux :
— Ah ! C’est ce que vous croyez… Lucie Jouanno pourra vous raconter ce qu’il voulait.
— Qu’est-ce qu’il voulait ?
— Je n’ai rien d’autre à dire.
— A quelle heure avez-vous quitté l’Institut ?
— Vers minuit, avec Martin, Courtois et Chabot. Courtois et Chabot avaient leur voiture au parking. Chabot nous a déposés en ville, Martin et moi.
— Et les autres, vous les avez vus partir ?
— Le Chinetoque est sorti du parking derrière nous. Ah ! Il se serait bien gardé de nous proposer une place dans sa voiture… C’est pas que j’aurais accepté…
Il réfléchit un moment puis ajouta :
— Lucie et Thompson de La Ferrière… Il me semble qu’ils ont plié bagage plus tôt. Vers 22 heures… Ils avaient leurs raisons, c’est sûr…
— Quelles raisons ?
— Moi, je ne suis pas du genre à écouter aux portes, monsieur le commissaire.
Courtois portait un superbe blouson en cuir noir avec un blue-jean troué, et des santiags râpées. Chabot, qui n’avait guère que 25 ans, était vêtu d’un vieux costume foncé tout froissé. Ils avaient l’air terrorisé. Ils déclarèrent avoir eu la visite de Garnier la veille vers 21 heures 30, qu’il les avait engueulés parce qu’ils mangeaient leur sandwiches à la table où Martin avait empilé les cartes-modems.
Interrogés sur Lucie Jouanno, ils échangèrent des regards furtifs. Ah ! Lucie ! Ils ne l’avaient pas vue de la soirée, elle s’occupait du téléphone depuis son bureau, puisque les appels extérieurs avaient été transférés du secrétariat sur son poste. Thompson de La Ferrière pourrait mieux qu’eux nous en parler…
Martin, un petit homme, trapu, moustachu, qui portait un pull gris troué, tendu sur un estomac confortable et un pantalon sale, avait eu Garnier sur le dos presque toute la soirée du lundi. « Il n’arrêtait pas de m’emmerder, commissaire », dit-il comme s’il voulait se justifier de je ne sais quoi. « Jusqu’à quelle heure, la persécution ? », demanda le commissaire. « Bof… Jusque vers… 22 heures. C’est qu’il est venu me poursuivre jusque dans la salle de conférences du deuxième étage où j’étais avec Kit-Wah. Il fallait bien que j’aille là-haut, quand même, si je voulais m’entendre avec lui, pour les essais d’envoi de fichiers. Ce n’est pas lui qui serait descendu… Ah ! Non ! Monsieur ne se dérangerait pas… Monsieur est ingénieur, vous comprenez… ».
Ce fut bien différent avec Maud Evenou.
Grande et très forte, elle était vêtue d’un ensemble vert soyeux qui mettait en relief des cheveux roux superbes. Son visage était rond et souriant. Je fus frappé par le bijou moderne qu’elle portait sur son vaste sein. C’était quelque chose comme un bouclier rond associé à une lance, qui me parut très pointue. Attention les yeux !
Elle prit la parole sans attendre :
— Alors, commissaire, vous n’allez pas faire de misères à Marie, j’espère. Nous travaillons ensemble depuis longtemps, vous savez…
— Pouvez-vous me dire à quelle heure vous êtes arrivée ce matin ?
— A 9 heures, comme d’habitude.
— Si j’ai bien compris, vous habitez Locminé comme Marie Lafitte et vous deviez travailler ensemble ici toute la journée. Vous ne venez jamais en voiture ensemble ?
— Presque jamais. Je préfère prendre le bus. Et puis, Marie va souvent travailler l’après-midi avec ses archéologues. Elle appartient à une équipe qui n’est pas logée à l’Institut, mais près de la gare de Vannes. Elle rentre chez elle très tard.
— A quelle heure avez-vous quitté votre bureau hier soir ?
— A 17 heures 30. Vous pouvez vérifier parce que j’ai bavardé un moment avec l’hôtesse dans le hall d’entrée.
— Où avez-vous passé la soirée ?
— Je suis d’abord allée voir une vieille amie à Auray. Nous avons dîné tôt et sommes allées ensuite à un concert au Centre Athéna.
— Vous étiez en voiture ?
— Oui, j’ai fait une exception parce que c’était un trajet compliqué, par le bus.
— Vous m’avez dit être sortie par le hall de l’Institut. Votre voiture n’était donc pas au parking en sous-sol ?
— J’avais passé ma clé à Alain Kit-Wah, qui, exceptionnellement, avait pris sa voiture hier. Il devait travailler tard. J’ai garé la mienne dans la rue.
— Il vous a rendu votre clé ?
— Oui. La voici.
— J’aimerais que vous me parliez de Garnier. Quels étaient vos rapports avec lui ?
— Pas meilleurs que ceux de mes collègues. Quand il est arrivé ici, il a voulu que je l’aide à monter le réseau de télécommunications et à en assurer la publicité. Ça ne m’intéressait pas et j’ai refusé. Depuis, c’était la guerre entre nous. Il disait partout que nos recherches, avec Marie, n’étaient pas de niveau international.
Le commissaire sourit :
— Le sont-elles, à votre avis ?
— Il n’a jamais lu aucun de nos papiers ! Plusieurs de nos articles ont été acceptés dans des revues internationales, en tout cas ! Et Marie a déjà été invitée aux Etats-Unis, au Canada, pour parler de nos travaux. En Europe, c’est moi qui…
— Qu’est-ce qui s’est passé dans la journée d’hier ?
— Le matin, il y a eu une réunion du personnel.
— Est-ce que Garnier y assistait ?
— Vous plaisantez, commissaire ! A 9 heures, j’ai rassemblé en catastrophe tous ceux qui étaient déjà arrivés. Le lundi, Garnier arrivait un peu plus tard car il habite Grenoble.
— De quoi a-t-il été question ?
— De la lettre du directeur de l’Institut à Garnier. Isabelle Delaporte, la secrétaire, l’a reçue vendredi après-midi après le départ de Garnier, et elle m’en a aussitôt apporté une photocopie. Le directeur se plaignait du mauvais fonctionnement du réseau informatique. Pour se défendre, Garnier était capable de mettre en cause les informaticiens et les électroniciens du labo.
— Qui était présent à cette réunion ?
— Tous les techniciens. Lucie aussi, avec Paul Thompson de La Ferrière. Bob Garrett aurait dû être là, en tant que représentant du personnel, mais je n’y pouvais rien.
— J’ai vu Paul… heu… Thompson de La Ferrière. Je suis donc au courant des accusations de vol que Garnier a portées contre lui. A la suite de ces accusations, monsieur de La Ferrière a intenté – et gagné – un procès en diffamation contre Garnier, si j’ai bien compris. Pouvez-vous me donner votre version des faits ?