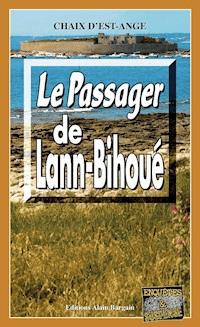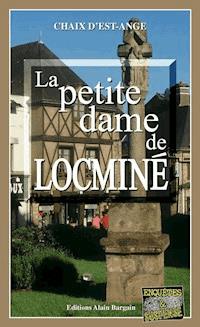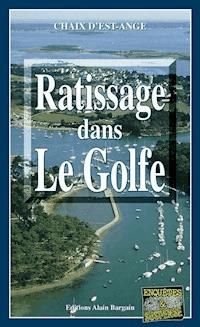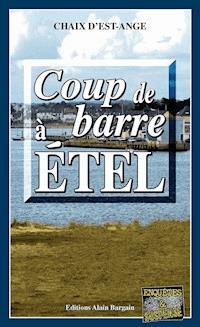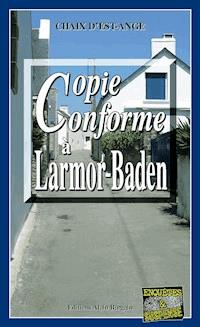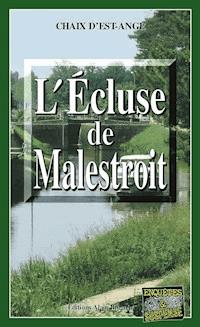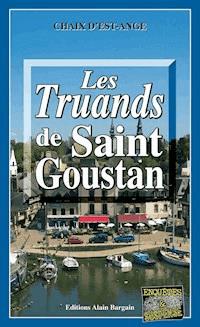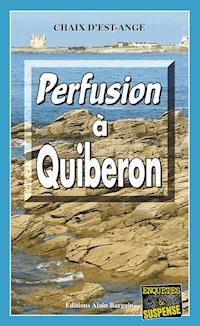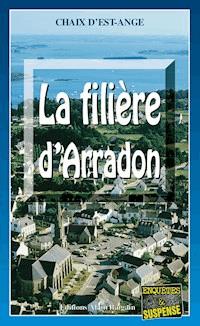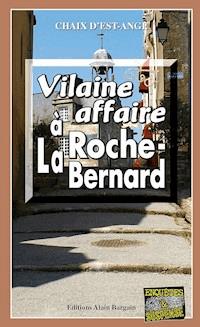
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Marie Lafitte
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Mystères dans la ville de La Roche-Bernard...
Bern-Hart, «Fort comme un ours», était le nom de ce chef viking qui remonta jadis l’estuaire de la Vilaine. Le Rocher lui tapa dans l’œil. Il y bâtit un village fortifié. C’est ainsi qu’est née la ville actuelle de La Roche-Bernard. Son histoire a été cruelle et mouvementée. Moi, capitaine Alban, de la Brigade Criminelle de Vannes, en ai écrit pour vous un épisode, minuscule, mais dramatique. Il était une fois une petite dame qui tenait une librairie dans cette ville pour dépanner une amie. C’est une lourde tâche pour quelqu’un qui ne connaît rien au commerce. Un jour, elle se reposait dans le jardin public de la promenade Ruicard, lisant des poèmes en mangeant son sandwich, quand un gros pivert qui sautillait dans l’herbe l’a distraite. Elle l’a suivi jusqu’à ce qu’il s’envole devant une statue blafarde… Était-ce bien une statue? La tête était penchée sur le côté, un foulard rose serré autour du cou…
Quel mystère entoure cette statue ? À qui appartient ce foulard ? Découvrez sans plus attendre le 8e tome des enquêtes bretonnes de Marie Lafitte, suivez-la sur les traces d’événements insignifiants aux conséquences dramatiques !
EXTRAIT
Après avoir fait sa caisse, rangé les rayons, passé l’aspirateur partout, mis des housses sur les étalages de livres, bouclé le magasin, Marie partit en voiture, passa devant la banque déposer la recette et s’en fut à la gendarmerie sans enthousiasme.
Là, ô miracle, elle fut reçue avec des sourires par les deux jeunes gendarmes qu’elle connaissait, les sergents Jeanne Kéravec et Yvon Le Roch. Ils lui expliquèrent que le capitaine était à Vannes pour étudier deux cas de meurtres de jeunes femmes qui semblaient avoir quelques ressemblances avec celui de Saint-Julien-Le-Haut. C’était en 2002 et en 2004. Ces affaires n’étaient pas résolues.
— C’est votre mari qui nous a soufflé cette idée hier ! dit le sergent Le Roch. On ne l’a pas dit au chef pour qu’il ne prenne pas la mouche ! Quand on lui en a parlé, il n’a pas pu refuser d’y aller, en tout cas.
— Pourquoi aurait-il refusé ? demanda-t-elle.
— Il est bizarre depuis qu’on a découvert le cadavre de la jeune femme à Saint-Julien-Le-Haut.
— Il a quelques ennuis familiaux, dit Jeanne Kéravec, qui semblait née pour apaiser les esprits.
Quand Marie eut répété son témoignage sur l’incident de l’hôpital et signé sa déposition, Yvon Le Roch lui apprit que Luc était hors de danger, même s’il était très faible, mais qu’il fallait absolument laisser croire qu’il était dans un coma irréversible. On craignait en effet une nouvelle attaque contre sa vie.
— Entendu, dit-elle. Qu’est-ce qui s’est passé dans la chambre ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Après une carrière d'ingénieur de recherche au CNRS à Paris,
Chaix d'Est-Ange se consacre aujourd'hui à l'écriture de romans policiers. Le Pays de Vannes est, depuis de nombreuses années, son lieu favori de détente, l'hiver. C'est aussi le cadre choisi pour ce huitième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Sylvie, bibliophile toujours prête à donner un coup de main à sa sœur et qui aurait certainement tenu avec brio la librairie Calvez.
REMERCIEMENTS
- À Jean-Marie.
- À Ghislaine et Lionel Mellerin.
- À Yannick Moreau,
imprimeur à La Roche-Bernard.
PROLOGUE
Moi, capitaine Alban, de la Brigade Criminelle de Vannes, je n’ai jamais été aussi stupéfait que lorsque j’ai lu la lettre du notaire.
C’était il y a un an, un samedi matin.
Je n’étais pas encore très réveillé, ayant assuré la permanence au commissariat une partie de la nuit. Incapable de lire le journal, en tout cas.
Par dessus ma tasse de café, je contemplais Sarah, ses cheveux noirs, son teint doré et ça me suffisait.
Le courrier était passé. Après avoir examiné le timbre d’une lettre, elle l’avait ouverte avec des gestes précis, se servant d’un coupe-papier – pas comme moi, du couteau à beurre ou d’un doigt. Le respect du papier…
Elle me dit ensuite :
— Minouchat ! Excuse-moi ! Ça a l’air important.
C’était une longue lettre. De ma place, je voyais qu’elle avait été imprimée avec des caractères vaguement chichiteux, un peu comme certains faire-part de mariage surannés.
Elle a commencé à lire, s’interrompant de temps en temps pour boire une gorgée de café et pour caresser Bogart, installé sur ses genoux.
Caresser un chat calme les anxiétés, c’est bien connu. Je me demandais si la lettre contenait de mauvaises nouvelles quand elle leva la tête et me tendit la lettre.
— À toi ! dit-elle avec son sourire à fossettes.
Je lus moi aussi. C’était une lettre d’un notaire de Nivillac. Il avisait Sarah que sa grand-tante, Léonie Calvez, célibataire sans enfant, récemment décédée, lui avait légué une ancienne mercerie rue Tour de L’Isle, dans le centre historique de La Roche-Bernard, avec un logement au-dessus, ainsi qu’une maison “paysanne” entourée de trois hectares de terrain, sise à Saint-Julien-Le-Haut, sur la route de La Grée, à 3 kilomètres de la ville. Une somme d’argent était mentionnée aussi, laquelle, disait le notaire, couvrait les droits de succession. Si Sarah désirait vendre ces biens, il se faisait fort de trouver un acquéreur à un bon prix… Je m’interrompis :
— Tu savais que ta tante était morte ?
— Oui, Minouchat, je le sais depuis deux jours !
— Pourquoi ne m’as-tu rien dit ? Tu l’aimais bien !
— Oh ! Je voulais t’en parler ! Et puis tu as été si occupé…
— Mais on n’est pas allés à l’enterrement !
— Je n’ai pas été prévenue à temps. À part Maman et mon frère, ma famille ne voulait plus me voir.
— Parce que tu es divorcée et que tu vis avec moi ? C’est ça ?
Elle hocha la tête et dit :
— Je ne voulais pas laisser tomber tante Léonie, je t’assure. Elle, elle me comprenait. Mais, comme tu sais, elle a quitté sa maison de retraite de Saint-Julien-Le-Haut pour aller vivre chez sa sœur et son beau-frère à Quimper. Je ne te l’ai jamais dit, mais la dernière fois que je suis allée la voir là-bas, ils m’ont fermé la porte au nez. Ça m’a fait de la peine. Je suppose qu’étant si âgée, elle n’avait plus son mot à dire. Ces derniers temps, elle ne répondait plus à mes lettres.
Je vis une petite larme glisser discrètement sur sa joue. Je me levai et la pris dans mes bras.
— Elle t’aimait ! C’est sûr ! Elle t’a légué tout ce qu’elle avait !
*
C’était donc il y a un an. Après bien des hésitations, d’un commun accord, nous avons décidé de garder l’héritage.
Sarah travaille dans une grande librairie à Vannes et a toujours rêvé d’un magasin bien à elle.
Nous avons donc décidé de transformer l’ancienne mercerie en un paradis pour amateurs de livres.
— Je vendrai des livres anciens ou rares. Des livres étrangers aussi, dit-elle, tout excitée. Il y a beaucoup de touristes à La Roche-Bernard. Comme je parle allemand et un peu anglais…
Ça n’a pas été de la tarte. Comme nous étions dans le centre historique de la ville, il a fallu demander toutes sortes d’autorisations pour agrandir la devanture du magasin et modifier une fenêtre au premier étage. On ne peut pas faire n’importe quoi dans la rue Tour de L’Isle ! Même moi qui suis plutôt ignare en architecture, je reconnais que le coin est superbe. Ainsi, tout à côté, j’ai admiré une maison ancienne à pignon pointu recouvert de bois, à étages en encorbellement sur la rue. En face, de beaux bâtiments en granit avec des petits jardins muraillés… Sans parler de “La Crêperie Sarrasine”, devenue notre annexe pendant la durée du chantier… C’est une demeure fort ancienne. Si vous voyiez les deux salles avec leurs poutres ! Une baie a été aménagée vers l’arrière, elle s’ouvre sur un jardinet d’où les clients peuvent contempler l’à-pic sur la vallée du Rhodoir.
Nous n’avions pas un sou devant nous pour faire faire les travaux nécessaires dans le magasin et dans le petit appartement au-dessus. Pour le gros œuvre, nous avons donc emprunté. Pour les finitions et la décoration, tout le monde à la Brigade Criminelle a participé, selon ses talents, à ses heures perdues. C’est pour ça que ça a duré si longtemps.
Enfin, tout a été prêt. L’inauguration du magasin, prévue pour le 1er juin, a été annoncée à son de trompe. Les journaux du Morbihan ne parlaient que de ça. Des invitations ont été lancées, un pot royal organisé.
Et puis il y a eu ce coup de fil… Sarah est partie en catastrophe au chevet de sa mère malade.
Qui a dû inaugurer la librairie ? Bibi, évidemment. Mais j’étais bien entouré. Le commissaire Cazaubon, notre divisionnaire, qui avait entièrement refait l’installation électrique, présidait la fête ; sa femme, Marie Lafitte, recevait les arrivants, parlant aux visiteurs étrangers dans toutes les langues ou presque ; mes collègues Tournebise et Guillou servaient à boire…
Les festivités se sont donc bien passées, même si l’ouverture proprement dite du magasin a été retardée pendant une semaine.
C’est après que ça s’est méchamment gâté, pendant ces quelques jours où Marie, en vacances, a tenu la librairie à la place de sa propriétaire qui était toujours auprès de sa mère à Quimper.
Suis-je en train de suggérer que la toupie a porté la poisse à l’entreprise ?
Vous me connaissez, je suis incapable d’une pareille mauvaise foi. D’ailleurs, certains pourraient dire qu’elle a sauvé la vie de Sarah. Eh oui !
Et si vous vous faisiez votre propre opinion ? Puisque je prends la peine de vous raconter cette histoire, allez, chaussez vos lunettes, lisez.
I
Il était midi, ce mercredi ensoleillé de juin.
Ayant l’un et l’autre quelques jours de vacances, Marie et le commissaire étaient arrivés à Saint-Julien-Le-Haut, quelques jours auparavant, et avaient trouvé la maison telle que l’avait décrite Sarah.
C’était une ancienne bergerie, aménagée de façon fruste, où sa tante avait habité dans un passé lointain. Quatre murs et un toit, certes, avec une porte, des fenêtres, une cheminée, l’électricité, mais pas grand-chose d’autre, à part la grange, passablement délabrée. Et c’était tellement sale et encombré de gravats et de meubles cassés qu’ils n’avaient pu se résoudre à s’installer à l’intérieur. Comme le temps était chaud et sec, ils avaient dormi sous la tente à côté de la maison.
Dans la journée, ils passaient une partie du temps à nettoyer le plafond, les murs, le sol, à réparer, à colmater. À d’autres moments, ils allaient se promener avec Mathilde, la petite chienne, lisaient, se reposaient, allaient au restaurant dans les environs. Ça leur convenait parfaitement.
La plus gros problème, c’était l’eau potable. L’eau de pluie, recueillie dans une citerne derrière la maison, pouvait aller pour la toilette, heureusement. Mais il fallait la faire bouillir pour la vaisselle.
Le terrain paraissait immense à Marie. C’était un ensemble de prés, laissé à l’abandon depuis cinq ou six ans, comme les murs, depuis que la tante de Sarah s’était installée dans sa maison de retraite, puis dans le Finistère auprès de sa sœur. Quelques beaux arbres, des ronces, des ajoncs, des rochers moussus, des prairies hirsutes…
Le commissaire et Alban prétendaient qu’il y avait une source quelque part. Ils se faisaient fort de la trouver en attendant de demander l’eau de la ville. À les entendre, l’installation de canalisations par la Compagnie des Eaux, dans ce coin éloigné de toute habitation, coûterait la peau des fesses et Sarah s’était déjà endettée pour rénover la librairie, malgré l’aide de presque toute la Brigade Criminelle de Vannes.
Le commissaire disait que, pour la maison, il ne fallait pas se presser. Puisque Sarah et Alban étaient convenablement logés à Vannes, il fallait prendre le temps d’y installer le confort.
Alban avait pris un air dubitatif. Marie pensait qu’il ne tenait pas à venir habiter ce trou à la campagne et qu’il ne croyait pas qu’on puisse restaurer une maison aussi délabrée. Mais le commissaire avait dit d’un ton péremptoire :
— Tu verras, Alban, quand tu auras des enfants ! Il faut voir grand, je t’assure !
Le confort… Quand il y a tout à faire…
Un jeune architecte qui fréquentait les séminaires de Marie à l’Institut* avait gracieusement offert ses services pour le projet de restauration et d’agrandissement. Il était passé voir la maison avec Marie, quelques semaines auparavant.
Il était resté des heures sur le chantier à hocher la tête d’un air dubitatif, tâtant les poutres, enlevant quelques pierres descellées. Il s’était ensuite assis sur l’une des chaises les moins branlantes. Il avait posé sur ses genoux son carton à dessin et esquissé une vue cavalière, totalement improbable, des bâtiments tels qu’il les imaginait une fois restaurés.
Sur son croquis, les humbles fenêtres à petits carreaux, ainsi que la porte vitrée de la cuisine avaient fait place à d’immenses baies qui mangeaient les murs du sol jusqu’à la couverture. La pente du vieux toit à deux pans avait été modifiée. C’était devenu un toit pointu, où les tuiles brunies venues du Lot étaient remplacées par de fines plaques d’ardoise. Le pot de cheminée avait disparu. La porte de la grange, qui était en chêne, sous une arcade en anse de panier, était remplacée par un hideux panneau coulissant en verre dépoli. Le jeune homme avait ensuite esquissé l’intérieur de la maison.
— L’ensemble, disait-il en crayonnant à grands traits, doit s’articuler autour d’une problématique de la lumière, ou, si vous préférez, de l’absence d’enfermement. Le regard doit pouvoir cheminer librement d’un espace à l’autre. Je conseille aussi beaucoup de couleur. Comme vous le savez, la couleur agit sur la perception des volumes…
— Vous avez oublié la cheminée ! coupa Marie, qui s’énervait un peu. Et dans la grange, il faut une porte à chaque chambre et à la salle de bains. Je veux de vraies portes, pas des portières en bambou. Mais ça prend de la place. Est-ce qu’il ne faut pas supprimer une des chambres ? Pour faire un couloir…
— Cela ne se fait plus, dit le jeune homme. Mais je peux prévoir quelques panneaux coulissants en résine colorée.
Quand il était parti, elle était complètement découragée. Elle avait eu l’impression que Sarah et Alban avaient des vues modestes, qu’ils voulaient aménager au mieux les vieux murs sans changer l’aspect général de l’habitation. Pour eux, restaurer la maison, c’était aussi garder le souvenir d’un être cher. Et la grande cheminée, pas question de la supprimer…
Finalement, on avait enterré les projets du jeune architecte, et c’est elle qui avait été chargée de dessiner les plans d’aménagement et d’agrandissement de la masure. Elle en était heureuse parce qu’elle n’avait participé aux travaux du magasin que pour peindre les murs. Elle avait eu tant de travail à l’Institut qu’elle n’avait pas pu faire grand-chose d’autre.
*
— Commissaire ! Où êtes-vous ? Le déjeuner est prêt !
Les mains en porte-voix, Marie hélait son mari sur le pas de la porte. Elle avait préparé des moules à la crème et au curry sur la bouteille de Butagaz qui faisait office de cuisinière, en attendant mieux.
Elle s’avança sur le terrain, appela encore son mari, puis aperçut dans le chemin creux une camionnette bleue aux chromes luisants qui approchait. Elle pensa à la Compagnie des Eaux. Ils avaient promis de se déplacer sur le terrain pour évaluer le coût d’une installation de l’eau de la ville.
Mais c’étaient les gendarmes de La Roche-Bernard, un homme et une femme.
Tous deux étaient jeunes.
Lui, pas très grand, avait des cheveux blonds et raides qui dépassaient à peine de sa casquette bleue, des yeux couleur myosotis pâle. Son sourire d’enfant creusait d’un côté une joue lisse. Il sortit de la voiture et dit :
— Excusez-nous de vous déranger. On nous a dit que la maison de madame Calvez était à nouveau habitée. Nous voulions vérifier que tout allait bien.
Elle sortit après lui de la camionnette, comme si elle ne voulait pas le laisser seul en terre inconnue. Grande, à la fois ronde et mince, droite et voluptueuse, elle portait un uniforme strict à pantalon. Son chapeau en feutre bleu lui donnait une dignité de reine et suggérait un désir de distance ou un goût pour le décorum. Une queue de cheval ondulée, soyeuse et bien coiffée, atténuait la sévérité de sa tenue. Ses yeux, entourés de longs cils foncés, étaient grands et doux, d’une couleur d’automne, noisette peut-être, en tout cas soigneusement assortis à ses beaux cheveux.
Des gendarmes en sucre… C’était… étonnant. Marie, fascinée, les pria d’entrer dans la maison, oubliant l’état peu engageant des lieux. La jeune femme lui adressa un sourire timide, entra calmement derrière son collègue. Elle ne prononça que deux ou trois mots, comme si elle n’était là que pour veiller sur lui. Le jeune homme, à la façon des gendarmes, regardait autour de lui et posait des questions. Était-elle une parente des Calvez ? Sa voiture, c’était la petite Citroën ? Et la grosse auto bleue à côté ? … Avait-elle l’intention de rester plusieurs jours ? Et les voisins, les Le Bihan, ceux qui élevaient des moutons, les connaissait-elle ?
Quand ils repartirent, auréolés par un rayon de soleil, Marie avait l’impression d’avoir rêvé. En même temps, elle était vaguement inquiète de cette visite. Le jeune homme avait parlé de rôdeurs, conseillé la prudence. Elle se demanda aussi si les voisins les avaient pris pour des squatters, son mari et elle, et ameuté la maréchaussée.
Le commissaire, précédé par Mathilde, la petite chienne, finit par arriver. Il était chargé d’un gros fagot de bois mort. Mathilde elle-même portait dans sa gueule une baguette fourchue. Elle marchait d’une allure empesée et solennelle qui fit sourire Marie. La baguette, c’est l’instrument de travail du sourcier. Un objet sacré, en quelque sorte…
Après s’être déshabillé et lavé dans un seau d’eau froide en jurant comme un charretier, le commissaire, en tenue d’Adam, entreprit de mettre le couvert sur la table de camping, sous le chêne devant l’entrée. Il alla chercher du vin blanc qui reposait dans un seau d’eau fraîche. Le pain, le fromage et les fruits étaient dans l’antique garde-manger grillagé au fond de la cuisine. Quand le commissaire passa près de Marie, qui goûtait la sauce des moules avec une vieille cuillère en bois, il s’arrêta. Elle tendit le bras, posa sa main libre sur le dos de son mari.
— Vous avez bien chaud ! dit-elle en riant. Mais vous devriez vous habiller pour déjeuner. Si quelqu’un arrivait…
— Ah oui ? Dites tout de suite que vous ne m’aimez pas dans cette tenue !
— Vous avez la peau douce et tiède, Commissaire ! C’est ça que vous vouliez m’entendre dire ?
— Oui. Dites-le encore, dit-il en lui ôtant la cuillère des mains et en la prenant dans ses bras.
Elle lui murmura des compliments extravagants. Il la caressa, la déshabilla, la caressa encore. Et puis il ferma le Butagaz, remit le couvercle sur la marmite, l’entraîna dehors vers le petit pré ombragé en contrebas de la grange…
*
Quand ils dégustèrent les moules, elles étaient tièdes. Ils les trouvèrent délicieuses.
Le commissaire pensait qu’une source passait sous les rochers moussus, près du coin aux ajoncs. Tout en épluchant une pêche, il développa une théorie sur l’observation minutieuse des végétaux.
— C’est primordial avant de passer à la détection proprement dite, dit-il.
— J’ai eu des visites en votre absence, dit Marie, qui était un peu dans les nuages.
— Ah oui ?
— Un homme qui cherchait des maisons et des terrains à vendre. Il a voulu visiter l’intérieur, mais je ne l’ai pas laissé entrer.
— Bien ! dit le commissaire. Qui d’autre ?
— Heu… Les gendarmes. J’aurais peut-être dû venir vous chercher, mais je ne savais pas où vous étiez.
— Qu’est-ce qu’ils voulaient ?
— Je l’ignore. Ils m’ont demandé d’être prudente, à cause des rôdeurs.
— Vous leur avez dit que je suis policier ?
— Non.
— Pourquoi ?
— Joseph ! Pour qu’on ne vous embête pas ! C’est votre dernier jour de vacances !
— De toutes façons, les gendarmes savent tout ! Ils sont venus vérifier les racontars des voisins. Ne vous inquiétez pas !
Il s’étira, se leva, débarrassa la table et dit :
— Je crois que je vais faire une sieste sous le chêne. Et vous ?
— Je vais un peu nettoyer dans la maison. On pourrait dormir à l’intérieur ce soir, qu’en pensez-vous ? Le temps pourrait bien tourner à l’orage…
* Il s’agit du vénérable Institut des Sciences Mérovéennes de Vannes, où Marie Lafitte dirige un laboratoire d’informatique destiné aux chercheurs en sciences humaines. Elle y enseigne aussi.
II
Le lendemain, à 8 heures du matin, Marie se retrouva seule dans la librairie de La Roche-Bernard. Elle s’était levée aussi tôt que le commissaire qui repartait travailler à Vannes parce qu’elle voulait répéter encore in situ certains gestes indispensables à son nouveau rôle de libraire, qui commençait ce matin-là.
Assise derrière le comptoir, Mathilde à ses pieds, elle réfléchissait.
Avait-elle eu raison de proposer de tenir la librairie au pied levé ?
« Tu voulais absolument dépanner Alban, d’accord, mais quel culot, Lafitte, d’offrir ton aide alors que tu ne connais rien à tout ça… »
Alban avait prévu une stagiaire, Florence Binot, pour aider dans le magasin pendant quinze jours. Elle devait se présenter le surlendemain qui était un samedi, jour chargé chez les commerçants. « C’est une jeune fille charmante », avait-il dit, « une étudiante en droit passionnée par les livres et qui a besoin de gagner de l’argent. Elle est de Nivillac. »
« En attendant, il faudra bien que tu te débrouilles toute seule, Lafitte… »
Est-ce qu’elle avait bien en tête la place des livres sur les rayons, est-ce qu’elle saurait faire une commande, conseiller les gens ? « C’est ça, Lafitte, tu voulais jouer à la marchande ! Eh bien, tu vas voir un peu ce que c’est, le public ! Ne te fais pas d’illusions, ce ne sera pas comme dans ton institut où il n’y a que des étudiants, des chercheurs et des profs ! Ce ne sont pas les mêmes gens, ici. Tu ne vas pas savoir comment t’y prendre ! Et rendre la monnaie ! Tu as déjà rendu de la monnaie ? Et les cartes bleues… Tiens, tu vas encore faire un essai avec la machine à cartes bleues ! »
Elle ouvrait un tiroir pour prendre l’appareil quand la clochette de la porte retentit. Sarah avait voulu garder le carillon de la mercerie en souvenir de sa tante. Ce tintement avait pour Marie une tonalité nostalgique, venue du fin fond de l’Auvergne, là où elle passait ses vacances quand elle était enfant. La sonnette de l’épicerie du village où, avec son frère Charles, elle allait acheter des bonbons, avait le même son cristallin. Elle ne pouvait entendre cette petite musique sans que surgisse dans sa conscience le parfum des caramels à la vanille, des rubans de réglisse et des coquelicots pour la gorge.
En même temps faisait irruption l’image de madame Boudon, l’épicière, toute courbée, revêtue d’une superposition de tabliers gris à petites fleurs mauves.
La librairie n’ouvrait qu’à 9 heures, mais Marie avait oublié de tourner du côté « Fermé » la pancarte accrochée à la porte.
Un homme entra.
Trapu, de taille moyenne, habillé d’un costume élégant, il tenait à la main une volumineuse serviette de cuir noir. Il avait des cheveux châtains ondulés, des yeux très bleus, un nez droit, des lèvres généreuses.
— J’ai vu de la lumière… dit-il en souriant.
— Et vous êtes entré ! La librairie n’ouvre qu’à…
— Je sais ! Mais je représente Sheraton, de Londres…
— Ah oui ! dit-elle. Un des plus grands distributeurs de romans anglo-saxons en France… Est-ce que je me trompe ?
— Vous ne vous trompez pas ! J’ai l’exclusivité de cette maison pour le Grand Ouest. Je m’appelle Yvan Le Guénec. Voici ma carte. Je n’ai pas pu vous parler le jour de l’inauguration de votre magasin et j’ai des propositions intéressantes à vous faire.
— Très bien ! dit Marie.
Elle saisit son petit bloc à carreaux et ajouta :
— Je vais noter, mais pour toute commande, c’est madame Calvez, la propriétaire, qui décide. Elle est absente en ce moment.
— Ah !
Il n’avait pas l’air découragé le moins du monde. Il ouvrit sa serviette noire tout en parlant et présenta à Marie les derniers titres d’une collection de romans policiers qui faisait fureur outre-Manche.
— J’ai lu The Dandelion, dit-elle d’un air dubitatif.
— Vous n’avez pas aimé ?
— Eh bien… La plupart des auteurs de cette collection ont, semble-t-il, un penchant pour un mélange d’érudition, de sexe, de violence, de scatologie… Et leur goût pour l’ésotérisme à la mode…
Elle fit une petite grimace. Il rit :
— Vous avez raison, Mademoiselle ! Mademoiselle ou Madame ?
— Oh ! Madame, si vous voulez ! Je m’appelle Marie Lafitte.
— Vous permettez que je vous appelle Marie ?
Elle sourit sans rien répondre. Puis, pendant qu’il farfouillait dans ses documents, elle dit :
— Avec madame Calvez, nous désirons satisfaire tous les publics, c’est vrai, mais pas les snobs. Nous suivons notre instinct, pas forcément la dernière mode parisienne ou londonienne. Nous aimons les histoires bien écrites, construites, documentées, pleines de surprises.
Comme par hasard, il connaissait les auteurs anglo-saxons de romans policiers qu’elle préférait et les aimait lui aussi. Ils bavardèrent un bon moment tout en parcourant la librairie. Au grand étonnement de Marie, il s’attarda un moment dans ce qu’elle appelait le coin fouillis.
Sarah et elle pensaient que beaucoup de gens, quels que soient leur profession ou leurs goûts, adorent farfouiller sans contrainte dans les magasins, histoire de se faire des surprises ou de trouver des cadeaux inédits.
Elles avaient soigneusement organisé le coin en question. Il y avait, bien sûr, des bacs de livres d’occasion et d’ouvrages neufs qui avaient des défauts. À côté, dans les tiroirs ouverts d’une vieille commode peinte par Marie, ornée d’oiseaux et de fleurs, elles avaient disposé quelques articles provenant du fond de l’ancienne mercerie : des ciseaux à couture dorés ornés d’une cigogne, un plateau de dés ouvragés de toutes les tailles, des rouleaux de soie, des bobines de fils multicolores, du coton suisse à crocheter, du fil à broder, des rubans, sans compter des aiguilles à coudre venues de Sheffield, que l’on trouve rarement en France.
À tous ces trésors, Tournebise, un collègue d’Alban féru de rugby, avait ajouté d’office, malgré leurs protestations, une grosse panière pleine de tee-shirts à l’effigie de son club.
Yvan Le Guénec admira la commode et finit par acheter deux mètres de soie blanche, une paire de petits ciseaux dorés et un album de Benjamin Rabier* auquel il manquait la page de garde.
— C’est pour ma mère, dit-il en riant.
Elle finit par lui proposer du café.
— Il y a une cafetière dernier cri dans la petite pièce à côté, dit-elle. Je ne l’ai pas encore essayée. Savez-vous vous servir de ces engins ?
— Vous voulez dire une cafetière qui fait aussi du capuccino ?
— Mais oui ! Du chocolat aussi !
Un moment après, ils étaient en train de déguster des capuccinos tout fumants quand la sonnette tinta encore. Le commissaire entra dans le magasin.
Il s’arrêta net quand il vit que Marie n’était pas seule, puis s’avança vers le comptoir. Il avait l’air contrarié et salua le représentant avec froideur.
— Marie ! dit-il avec brusquerie. Je voudrais vous parler. Seul à seule, ajouta-t-il d’un ton péremptoire.
— J’allais m’en aller, dit Yvan Le Guénec avec un sourire. Au revoir, Marie ! Au revoir, Monsieur !
Il se leva, ramassa sa serviette et se dirigea vers la porte.
— Au revoir, Yvan ! lui dit Marie. Je vous appellerai, pour la commande des Ruth Rendell** et des Barbara Cartland. À mon avis, madame Calvez sera d’accord…
*
— Qu’est-ce que c’est que ce nabot bellâtre ? dit le commissaire dès que la porte fut refermée. Il vend des Barbara Cartland ? ajouta-t-il d’un ton moqueur. Vous commencez bien, je vois ! Vous l’appelez par son prénom ? Vous lui faites du café, en plus ?
— Commissaire ! Qu’est-ce qui vous prend ? Acheter et vendre des livres, c’est mon rôle ! Vous n’allez pas me faire de reproches ! … Voulez-vous du café ? Grâce à lui, je sais me servir de la cafetière de l’escouade ! ***
— Ah… Oui, merci, Marie !
Il la suivit dans l’arrière-boutique, la prit dans ses bras. Murmurant des excuses pour son accès de mauvaise humeur, il souleva ses cheveux, l’embrassa derrière une oreille.
— Vous me chatouillez ! dit-elle en riant.
Elle posa ses lèvres sur la barbe courte et piquante du commissaire. Ils se sourirent.
Pendant qu’elle lui préparait un capuccino, il lui apprit qu’il était allé voir les gendarmes avant de partir pour Vannes.
— Par simple politesse, Marie. Et pour leur expliquer que nous sommes des amis et occupons la maison pendant les vacances. Mais ils m’ont retenu un bon moment, pour me raconter leurs soucis, les pauvres.
— Quels soucis ?
— Vendredi soir, la semaine dernière, ils ont trouvé le cadavre d’une jeune fille dans les bois qui longent le terrain de la tante de Sarah. Il était près du petit lac…
— Seigneur !
— Comme vous dites ! Elle a été étranglée.
— C’est pour ça que les gendarmes sont passés hier matin ?