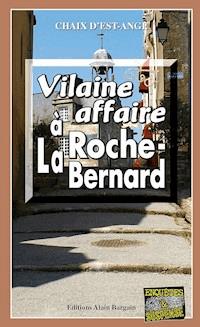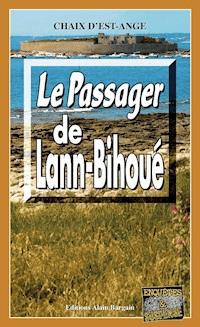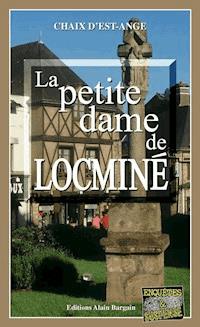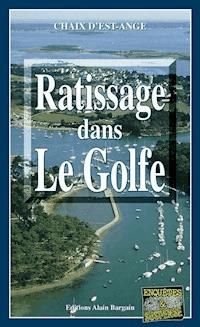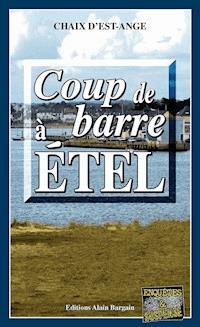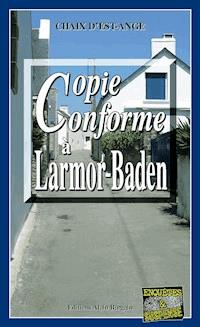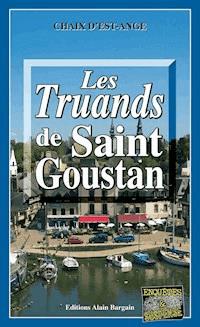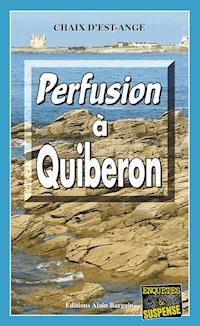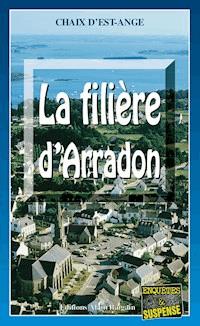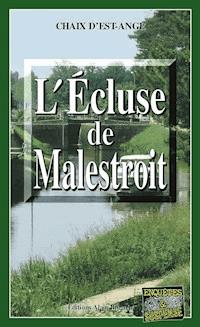
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Marie Lafitte
- Sprache: Französisch
Marie Lafitte se fiche éperdument du projet d'implantation d'un centre commercial dans son village, jusqu'à un étrange coup de fil...
Le projet d’implantation de centre commercial dans son village, qu’est-ce qu’elle en avait à foutre, Marie Lafitte ? Depuis la mort de son mari, elle avait eu cent fois la tentation de vendre la maison. Alors le béton, l’envahissement… Elle avait décidé de ne pas se mêler de cette affaire. Un coup de fil bizarre a suffi à la faire changer d’avis. Après, l’engrenage infernal… À commencer par la découverte du cadavre de monsieur Enjolras… Et ces dossiers poussiéreux, qu’elle va consulter à la mairie… Les dossiers, ça prend vite feu, non ?
Si ça vous chante, suivez ensuite Marie dans sa traque périlleuse au milieu des casses de voitures du Morbihan. Vous verrez qu’on y rencontre du bon et du mauvais. Et le contact avec l’eau glacée du canal de Nantes à Brest, ça vous dirait ?
Retrouvez Marie Lafitte dans le tome 4 de ses enquêtes haletantes au cœur de la Bretagne, et suivez pas à pas la traque périlleuse qu'elle mène au milieu des casses de voitures du Morbihan, le long du canal de Nantes à Brest.
EXTRAIT
On sonna à la porte. Il alla ouvrir machinalement, pensant que c’était la femme de ménage. C’était son ami Régis Armagnac, le médecin légiste. Il s’assit dans la cuisine, commença à manger distraitement le fromage qui était sur l’assiette du commissaire, réclama du café.
— C’est Alban qui m’a dit que tu étais chez toi, dit-il, entre deux bouchées. Tu ne m’as pas appelé hier. Comment va Marie ? Tu sais, ce n’est pas une plaisanterie, ce coma, même si elle s’en est bien sortie.
— J’ai quitté Marie dimanche soir… Nous nous sommes disputés.
—Joseph ! Tu es fou ! On ne se dispute pas avec quelqu’un qui sort d’un coma…
—Elle m’a pratiquement mis à la porte, si tu veux savoir !
— Et tu t’es laissé faire ! Grand con !
— J’aurais voulu t’y voir !
—Qu’est-ce que tu lui as encore dit ? Je suis sûr que tu as…
— J’ai parlé d’enfant. C’est tout !
—Elle n’en veut pas ? Elle t’a mis à la porte à cause de cela ? Je n’y crois pas !
Le commissaire finit par raconter à son ami ce qui s’était passé.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Après une carrière d'ingénieur de recherche au CNRS à Paris,
Chaix d'Est-Ange se consacre aujourd'hui à l'écriture de romans policiers. Le Pays de Vannes est, depuis de nombreuses années, son lieu favori de détente, l'hiver. C'est aussi le cadre choisi pour ce quatrième roman. Elle est décédée en 2011.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Nous remercions tout particulièrement les Éditions YCA à Quimper pour leur participation (photo de couverture) et vous recommandons leurs magnifiques cartes postales.
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Marie-Rose, l’amie de toujours.
REMERCIEMENTS
– À Jean-Marie, mari patient, critique avisé, lecteur attentif.
– À Yann Bijer, maître en langue bretonne.
PROLOGUE
Le vrai fauteur de trouble, dans cette histoire ? Le vétérinaire de Lamothe-Saint-Léonard, le docteur Oillic. Celui-là, pour déterrer les cadavres… Ou pour foutre un coup de pied dans la fourmilière… Il ne s’est jamais douté, peut-être, des embrouilles dans lesquelles il nous a tous plongés, à la Brigade Criminelle de Vannes. J’ai senti que la galère démarrait le jour où le commissaire divisionnaire Cazaubon m’a prévenu qu’il voulait me parler en privé, dans son bureau.
L’après-midi était bien avancée. Je regardais tout le temps ma montre parce que j’avais, ce soir-là, rendez-vous avec Sarah pour visiter un appartement. En attendant le commissaire, je faisais de la paperasse.
À côté de moi, mon collègue Tournebise écoutait les doléances d’une de ses mémés, comme il les appelle. Il les attire, avec sa bouille ronde et ses taches de rousseur. Et il a une de ces patiences, avec elles ! Mais cette fois, mon état d’énervement devait être communicatif. Je les entendais :
— Je ne supporte pas le bruit ! dit la dame. Hier, il devait être 6 heures du matin quand vos collègues ont monté l’escalier. On aurait dit un troupeau de bisons… Mon mari…
— Nous cherchions un individu dangereux, dit Tournebise.
— Et l’autre jour, au feu rouge, le jeune de la circulation… Vous savez ce qu’il a fait ? Il m’a prise par le bras et m’a traînée sur le trottoir… Sans dire ni bonjour ni bonsoir !
— Le feu n’était peut-être pas rouge.
— Je veux déposer plainte, dit la dame.
— Vous me faites perdre mon temps, madame Le Ny ! Et votre mari va s’inquiéter ! Vous êtes là depuis… Et zut !
Il se leva :
— Rentrez chez vous, madame Le Ny ! « Quand c’est vous qui serez assassinée, vous serez bien contente de venir nous chercher !* »
Ça, c’est un langage que les gens comprennent ! La dame s’en alla sans un mot.
Tournebise se tourna vers moi :
— Alban ! Qu’est-ce qu’il te veut, le commissaire ? Tu as encore fait une connerie ?
— C’est personnel, dis-je d’un air digne.
— Comment le sais-tu ?
— Il me l’a dit. Il s’agit de Marie Lafitte. Enfin, c’est ce que j’ai compris…
Il hocha la tête :
— Tu crois qu’ils se disputent ? Qu’est-ce qu’elle a encore fait ?
— J’ai l’impression qu’elle a encore trouvé un nid de…
Le commissaire apparut à la porte. À la déception de Tournebise, je me levai et nous montâmes dans son bureau.
Il faut que vous sachiez que le commissaire et Marie Lafitte vivent ensemble depuis quelques mois. Enfin… À leur façon… Depuis le temps qu’ils se connaissent, ils se disent vous, et elle l’appelle « Commissaire ». Mais personne n’ignore que notre chef passe tous ses moments libres chez elle, à Lamothe-Saint-Léonard, près de Locminé.
Il y a à peu près trois ans, en 1997, Marie a perdu son mari, Jean-Edmond, dans un accident de voiture. Apparemment, elle ne s’est pas remise du drame. Le commissaire m’en a souvent parlé. Je suis sûr qu’il est impatient de la demander en mariage. Cul bénit comme il est ! Mais c’est aussi un sage. Il attend de voir comment ça va tourner…
Le commissaire ferma la porte de son bureau, sortit une petite boîte de sa poche.
— Regarde, me dit-il. Qu’est-ce que tu en penses ?
J’ouvris la boîte. Sur un coussin de velours bleu foncé reposait un anneau d’or plat, assez large, historié, orné d’une petite émeraude rectangulaire. Le dessin de l’anneau était à la fois léger et compliqué. Une histoire sans fin… Des feuilles d’acanthe s’étiraient le long de l’anneau, interrompues par des bustes de femmes-griffons dans leurs minuscules médaillons. De chaque côté de la pierre, limpide et lumineuse, un griffon lilliputien faisait face à son pendant.
— Chef ! dis-je. Où avez-vous trouvé cette merveille ?
Il rit :
— Tu crois que je l’ai volée ? Tu ne pense qu’à ça, ma parole ! Non, elle me vient de ma grand-mère. C’est peut-être un dessin italien.
— C’est pour Marie ?
— Tu penses qu’elle l’aimera ? C’est un peu vieux jeu, pour une jeune femme de trente-deux ans, non ? Mais Rosine m’a persuadé que ça irait… C’est elle qui s’est chargée de faire ressertir et nettoyer la bague.
Ce qu’il ne me dit pas – je l’ai su après par ce concierge de Tournebise – c’est que Rosine, la fille du commissaire, en avait profité pour faire enrager son père de façon éhontée. Quand il avait demandé si cette vieillerie conviendrait à Marie, elle avait dit :
« Tu trouves que ça ne fait pas assez fiançailles ? Tu as envie de montrer au monde entier que Marie t’appartient ? »
Il s’était presque fâché, puis il avait ri en avouant à sa fille qu’il aurait voulu un gros diamant pour Marie, tout neuf. « Quelque chose qui en jette, hein ? » avait dit Rosine avec dérision. « Avec des trucs autour ? Mais tu n’as pas les moyens, pauvre flic. » « C’est comme ça que tu parles à ton père ? » avait répliqué le commissaire. « Les hommes sont aveugles. » dit alors Rosine d’un air sentencieux. « Marie sautera de joie si tu lui donnes cette bague ! »
L’anneau, une fois restauré, étincelait dans un écrin qu’il avait trouvé ridicule. « Mais Marie adore les boîtes… » avait protesté Rosine. « Elle m’a montré sa collection quand les Lafitte ont donné cette réception, après l’affaire Garnier**. Tu as bien dû la voir ? » « Non », dit le commissaire, éberlué. « C’est ça ! » dit Rosine. « Monsieur ne voit rien, n’entend rien, il passe son temps à poursuivre ses truands ! Tu as intérêt à lui en trouver, des boîtes, avant que d’autres lui en offrent ! » Le commissaire avait demandé à quoi ça ressemblait, ces boîtes-là. Pas des boîtes à chaussures, quand même ? « Pourquoi pas ? » avait dit Rosine d’un air énigmatique.
Le commissaire remit la bague dans sa poche. Il avait l’air tout content de ma réaction.
— Ce n’est pas pour ça que je t’ai dérangé, Alban ! dit-il. Figure-toi que le vétérinaire de Lamothe-Saint-Léonard, le docteur Oillic, a dit à Marie qu’elle ferait mieux de s’occuper un peu de ce qui l’entoure au lieu de pleurer sur le passé.
— Voilà qui est parler ! Mais qu’est-ce qu’elle est allée faire chez le vétérinaire ? Elle n’a plus de chien depuis belle lurette…
Vous voudriez bien savoir, bandes de pipelettes, de quoi nous avons parlé ensuite ? Je vous connais, vous êtes comme Tournebise, du genre à écouter aux portes. Bon, je vais tout vous raconter… Mais surtout qu’on ne m’interrompe pas pour des vétilles.
* Réplique de Louis Jouvet (l’inspecteur Antoine) à Suzy Delair (Jenny Lamour), dans le film Quai des Orfèvres. H.-G. Clouzot, 1947.
** Voir La petite dame de Locminé, 2001, même éditeur.
I
La maison de Marie à Lamothe-Saint-Léonard, près de Locminé, est située dans un lotissement récent. On l’appelle Ar C’hoad Bihan ou Le Petit Bois. Les maisons sont adossées à un ensemble boisé au nord de la forêt de Lanvaux, entre Brangouzerh et Kerhero. Ce n’est pas la peine que je me casse à vous décrire les lieux, je suis sûr que vous êtes incapables de retenir les noms. Quant à vous demander de lire une carte pour y aller voir de plus près, autant cracher en l’air. Et je suis encore poli.
Quoi qu’il en soit, il y a quelque temps, en rentrant de Vannes, après une journée de travail particulièrement merdique à l’Institut, Marie trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe à l’en-tête du conseil syndical* du Petit Bois. Elle regarda l’enveloppe avec indifférence. Jean-Edmond, son mari, avait été élu président du conseil syndical dès leur arrivée à Lamothe. Il s’occupait avec enthousiasme de la copropriété, mais elle… Elle se rappela soudain une conversation avec lui, un soir où il était rentré à minuit de l’assemblée générale des copropriétaires. « Tu comprends, ma puce, avait-il dit, nous avons la chance d’habiter un coin magnifique et verdoyant. Il ne faut pas laisser gagner le béton. Nous sommes des interlocuteurs importants pour la municipalité de Lamothe. Les gardiens de notre propre environnement… »
Depuis la mort de Jean-Edmond, elle avait eu cent fois la tentation de vendre la maison, alors le béton…
Elle ouvrit l’enveloppe. À sa grande surprise, elle vit que ce n’était pas une circulaire, mais une lettre personnelle du président, monsieur Seguin-Beaulieu. Il la conviait à la prochaine réunion du conseil syndical, certains des membres désirant qu’elle y siège, à titre honorifique au moins, en souvenir de son mari.
Elle réfléchit. Pourquoi faire appel à elle ? Elle n’assistait même pas aux assemblées générales. Les Chassagne, ses voisins, qui suivaient assidûment les événements locaux, acceptaient son pouvoir. Est-ce que Seguin-Beaulieu avait l’intention de démissionner ? Est-ce que les membres du conseil syndical étaient trop peu nombreux ? Il y avait bien… heu… 400 maisons dans le lotissement… Il faut un nombre minimal d’élus pour que le conseil ait une existence légale…
Elle bâilla. Elle verrait demain… De toutes façons, il était temps de préparer le dîner pour le commissaire. Il arriverait tard, mais un canard, il faut que ce soit bien cuit… Elle s’assoupit dans le fauteuil. La minute d’après, elle dormait profondément.
Jean-Edmond lui apparut en rêve. Il n’était pas là, bien sûr, mais à Saint-Pétersbourg. Est-ce qu’il téléphonait ? Il était pourtant tard…
« Marie, dit-il, tu as bien porté les affiches à l’imprimerie ? Non ? Oh ! Je t’avais dit de ne pas attendre ! Tu iras demain ? Bon ! D’accord ! Sois discrète, hein ? » « Pas trop froid. J’ai quand même acheté une toque en fourrure… Oui, oui, on peut rabattre les oreilles ! La toque sera pour toi quand je serai rentré. Madame Marshak m’a dit, en voyant ta photo, que ça ira avec tes cheveux… Oui, ma communication au colloque a bien marché. Ils ont ri de mon mauvais accent anglais, mais ils m’ont invité l’an prochain à l’Institut de Physique Nucléaire de Doubna. Tu viendras, cette fois ? »
Elle se réveilla brusquement. Le téléphone sonnait.
C’était une voix un peu nasillarde.
— C’est inutile d’aller à la réunion, dit la voix.
— Il y a une erreur, dit Marie. Qui demandez-vous ?
— Il n’y a pas d’erreur, Madame Lafitte. Je vous conseille de rester chez vous.
— Qui êtes-vous ?
On raccrocha.
Elle se précipita sur la lettre de Seguin-Beaulieu. Elle n’avait pas vu que la réunion du conseil syndical avait lieu le soir même, à 21 heures 30.
Elle haussa les épaules. « S’il croit te faire peur, celui-là… T’en as vu d’autres, Lafitte… »
Dans la cuisine, tout en farcissant le canard d’olives et d’ail, elle se dit qu’elle ne renoncerait pas à sa soirée avec le commissaire pour aller à la réunion. D’ailleurs, c’était trop tard pour le prévenir.
Deux secondes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. C’était le commissaire. Il ne pouvait pas venir dîner.
La fatigue de la journée l’envahit à nouveau. Elle remit le canard dans le réfrigérateur, alla chercher une boîte de sardines Petit Navire, de la salade, s’assit à la table de cuisine.
Après ce dîner, elle se sentait nettement mieux.
« Capable de te rendre à la réunion, Lafitte, hein, maintenant… Non pas parce que ça t’intéresse… Mais tu ne vas pas te laisser faire… »
Il n’était pas l’heure encore.
Une lampe à la main, elle alla ouvrir la porte d’entrée pour contempler les boutures de rosier blanc devant la maison. Ce n’était pas la saison des boutures, elle le savait, mais la gardienne de l’Institut, à Vannes, les avait volées pour elle deux jours auparavant dans le petit jardin central de la cafétéria. Il faut bien que les arbustes soient taillés, avait-elle dit en riant en tendant à Marie une brassée énorme de tiges verdoyantes.
Le rosier de l’Institut était haut et rond, couvert de fleurs neigeuses de mai à décembre. Marie avait embrassé la gardienne.
En sortant, elle faillit trébucher sur quelque chose qui était contre sa porte, sur le paillasson extérieur. Un chien, tout mouillé, d’une couleur foncée, était couché là, l’air misérable. Elle oublia les boutures. L’image de Murdoch, le chien qu’elle avait perdu, lui sauta au visage. Il avait du sang sur le nez. Ses petits pieds blancs, si chauds, si soyeux, étaient devenus raides, il ne la regardait pas…
Elle faillit refermer la porte.
« Mais tu n’as pas été élevée comme ça, Lafitte… »
Elle souleva le chien dans ses bras, l’emporta dans la cuisine. Il gémissait, elle serrait les dents.
C’était une petite chienne. Marie vit une blessure assez profonde à la cuisse. Elle tamponna la blessure avec un désinfectant, installa l’animal sur une vieille couverture, lui apporta le reste des sardines Petit Navire mélangées à du riz très cuit, un bol d’eau.
Quand elle partit pour la réunion syndicale, la bête n’avait pas bougé, pas mangé, pas bu. Marie la laissa dans la cuisine.
Dans la voiture, elle passait en revue son programme du lendemain, qui était un samedi. Visite au vétérinaire, déclaration aux gendarmes… Il fallait trouver une corde pour promener la chienne dans Lamothe-Saint-Léonard. Si jamais quelqu’un la reconnaissait… Elle rédigea aussi mentalement une petite annonce pour Ouest-France… « Trouvé jeune chienne grise, race indéfinie, petite taille… »
*
La réunion avait lieu dans une petite salle au premier étage de l’ancien Archevêché.
C’était un grand bâtiment qui devait dater de la fin du XIXe siècle, laid et imposant. On y avait logé les services municipaux, et il y avait des salles réservées aux activités des différentes associations locales.
Avant d’être admise, Marie dût montrer sa lettre d’invitation à la gardienne.
Tous les membres du conseil syndical étaient déjà arrivés quand elle apparut à la porte de la salle de réunion.
Le président, monsieur Seguin-Beaulieu, un homme jeune, élégant, un peu gras, se leva sans un mot, s’inclina. Il avait l’air d’un cadre prospère. Elle remarqua devant lui sur la table un de ces superbes agendas “organiseurs”, épais, à la couverture de cuir, que l’on vend en même temps que les séminaires qui vous apprennent à les utiliser.
Plusieurs membres du conseil s’avancèrent, se présentèrent à Marie en souriant et lui serrèrent la main.
Elle fut étonnée de reconnaître plusieurs personnes qui faisaient déjà partie du conseil quand Jean-Edmond était président : Amédée Marie-Rose, un colosse au doux visage, d’origine martiniquaise, Lucile Capdevielle avec ses fossettes malicieuses, monsieur Lacoste dans son costume trois pièces gris, Roland Nédellec, le trésorier, qui était souvent venu travailler à la maison avec Jean-Edmond…
Elle alla s’asseoir au bout de la table et sortit le petit bloc à carreaux qui ne quittait jamais son sac.
L’ordre du jour était chargé. Outre la préparation de la prochaine assemblée générale, il fut question du procès en malfaçons contre le promoteur qui avait construit leur village, du bail de location de l’ancienne maison-témoin, dite “Le Club”, du projet de construction d’un gigantesque centre commercial à proximité du village. Il y avait aussi les “questions diverses”. Il s’agissait souvent de querelles particulières entre voisins. Marie observa que le président essayait dans chaque cas de minimiser les difficultés. Elle se demanda, en plusieurs occasions, s’il n’éludait pas le fond des problèmes.
« En tout cas, il n’est pas avare de bonnes paroles », se dit-elle, essayant de noter avec précision les solutions retenues, noyées dans des expressions telles que « normaliser les rapports », « créer des structures », « trouver un module », « quantifier les retombées »… Elle faillit plusieurs fois intervenir pour demander des précisions. Elle n’osa pas.
À la fin de la réunion, elle eut la surprise de voir son voisin de droite, monsieur Lacoste, se lever, et demander que madame Lafitte soit acceptée comme membre à part entière du comité syndical, en lieu et place de monsieur Hénon, démissionnaire, qui n’avait jamais été remplacé.
— Mais je n’ai pas l’intention… balbutia Marie, prise de court.
Le président avait l’air embarrassé. « Les membres du conseil syndical, dit-il, doivent, normalement, être élus pendant l’assemblée générale… C’est vrai que parfois, en cas de nécessité, on accepte en cours d’année que les conjoints remplacent les élus… Et monsieur Lafitte… »
— Nous manquons de monde. Le nombre minimal est de dix. Nous ne sommes que huit, Monsieur le Président, coupa Lacoste.
— Oui, oui… clamèrent en chœur trois autres personnes.
— Bon, dit le président qui semblait vaguement réticent. Qu’en pensez-vous, Madame Lafitte ?
— Ce n’est pas possible. J’ai trop de travail dans l’immédiat, dit Marie fermement.
— Dans l’immédiat. Mais après, vous vous y mettrez ? demanda la dame qui était sur sa gauche avec un sourire enjôleur.
— On vote, maintenant, dit monsieur Lacoste. Qui est pour la candidature de madame Lafitte ?
Marie vit cinq mains se lever en même temps. Le président n’avait pas voté pour elle…
Après cette étonnante élection, monsieur Lacoste dit à la secrétaire de séance :
— Vous avez bien tout noté, pour le compte rendu, madame Miallon ? Bon ! Maintenant, on boit ! Madame de l’Écluse, avez-vous les bouteilles entamées à la dernière réunion ? Ma femme a fait un gâteau pour nous.
Madame de l’Écluse était la dame au sourire enjôleur assise près de Marie. Elle avait apporté aussi du Perrier, des glaçons… Marie se retrouva, un verre à la main, bavardant avec ses deux voisins qui l’avaient manifestement adoptée.
Roland Nédellec, le trésorier, vint se joindre à eux :
— On a oublié de parler des chiens errants, dit-il. Il y en a encore un qui traîne dans le bois depuis hier.
— Je sais, dit monsieur Lacoste. Mon fils a essayé de l’attraper. Il faudrait téléphoner à la gendarmerie. Mais je n’aime pas beaucoup…
— Comment est ce chien ? demanda Marie.
Le trésorier, comme monsieur Lacoste, fut vague. Un animal assez petit, foncé…
Quand Marie raconta qu’elle venait de trouver une chienne, petite et foncée, sur son paillasson, ils la regardèrent, stupéfaits. Un animal que personne n’avait pu approcher…
— Je vais rechercher ses maîtres, dit Marie fermement. Je ne veux pas…
Madame de l’Écluse l’interrompit :
— C’est bien utile, un animal, vous verrez ! Il y a toujours quelque chose à manger dans le réfrigérateur, quand on rentre le soir.
Ils approuvèrent tous d’un air grave.
*
Marie rêvait que le président, vêtu comme un prophète de la Bible, et qui était en réalité Yahvé, voulait lui reprendre Murdoch. Ou bien était-ce Mardochée ? Elle luttait, sentait ses forces s’épuiser… On lui avait déjà pris Jean-Edmond, elle était seule… Si seule… Et si elle demandait à… Il y avait quelqu’un. Quelqu’un de grand, très brun, avec une barbe courte, et des cheveux drus, coupés ras, une tête ronde. Un roi mage. Mais il était si loin… Dans le Nouveau Testament peut-être… Elle ouvrit la bouche pour appeler le commissaire… Le téléphone sonna encore. Elle tendit le bras vers la table de nuit.
C’était la voix nasillarde qu’elle avait déjà entendue dans la soirée :
— Deuxième avertissement. Ne vous mêlez pas du conseil syndical.
L’homme raccrocha.
« Qui connaît mon numéro de téléphone ? » se demanda Marie encore à moitié endormie. « Il est sur la liste rouge. »
Elle s’aperçut alors que la petite chienne était couchée contre elle, sous la couette. « Si tu ne laissais pas toujours les portes ouvertes, Lafitte… » Elle se rendormit.
* Note d’Alban : « conseil syndical », ça vous dit quelque chose, bande d’illettrés ? C’est une assemblée de copropriétaires élus qui veille aux intérêts communs, tranche les litiges, entretient les parties communes.
II
— Madame Lafitte, qu’est-ce que vous m’apportez là ? Je croyais que vous ne vouliez plus de chien ? dit le docteur Oillic.
— Docteur, elle n’est pas à moi. Je n’en veux pas. Je l’ai trouvée hier soir sur mon paillasson.
Après avoir examiné l’animal, le vétérinaire hocha la tête, et dit :
— Elle a reçu un méchant coup. Je vais être obligé de poser des agrafes. Mais l’os n’est pas cassé.
Après le pansement, ils bavardèrent.
Le docteur Oillic avait un faible pour Marie. Il aurait bien voulu savoir si elle avait refait sa vie, comme on dit. Il ne savait pas trop comment aborder le sujet. Lui, était toujours célibataire.
Il tourna autour du pot. Marie ne parla que de Murdoch, son chien mort.
« Comme si elle voulait nier l’existence de cette pauvre grisoune, se justifier de ne pas la garder », pensa-t-il.
Il lui dit rudement :
— Madame Lafitte, essayez un peu de regarder autour de vous ! Tenez ! Pour changer de sujet, vous savez ce qui se trame, ici, à Lamothe ? Si seulement j’avais le temps !
— Qu’est-ce qui se passe ?
— On reparle du centre commercial ! Vous allez voir la vie que nous aurons ! Le bois, on va en raser une partie pour construire. La petite route au-delà de la zone industrielle, n’en parlons pas ! Elle sera à quatre voies ! C’est sûr ! L’afflux de gens, le bruit… Vous ne vous êtes pas installée loin de la ville pour ça, je suppose ?
— Mais, dit Marie, l’emplacement du centre commercial n’est même pas choisi…
— Il n’y a que trois endroits possibles, vous le savez bien : le terrain vague après la zone industrielle, la pointe du Pendu, pas loin de l’église, et, tout près de chez vous, le Trou aux Rainettes. Quand je parle du terrain vague, je suis encore optimiste, c’est le plus éloigné du village !
— Docteur Oillic, que voulez-vous que je fasse ?
— Eh bien ! Protestez, entrez dans une association, rédigez des tracts, je ne sais pas, moi…
Marie ramassa ses affaires sans rien dire.
Le docteur Oillic se demanda aussitôt comment il avait pu lui parler sur ce ton. Il eut du remords.
Quand il lui mit la petite chienne dans les bras, il s’excusa. « Revenez pour les pansements », dit-il tendrement. Marie sourit. Il en fut tout remué.
« Elle n’a pas l’air de m’en vouloir », se dit-il en refermant la porte de son cabinet. « J’ai pourtant été infect… »
Le reste de la matinée, il poursuivit ses pensées de vétérinaire. « Je ne me rappelais pas qu’elle était aussi petite… À quoi me fait-elle penser ? Ses yeux sont clairs comme ceux du husky de madame Lebon. Non, du persan de monsieur… En plus gris… plus… nuageux. De toutes façons, ce n’est pas la même forme, c’est plus grand. Des cils noirs et longs comme ça, je n’en ai pas vu beaucoup chez mes patients… Et ses cheveux… Blond argenté… Un labrit ? Un épagneul ? On ne peut pas comparer, espèce de crétin… »
Tout en s’occupant des patients suivants, il continuait à comparer. Il se dit finalement que la grisoune était en bonne compagnie. Elle avait peut-être ses chances…
*
Après le vétérinaire, Marie se rendit à Locminé pour montrer sa trouvaille aux gendarmes. Dans la voiture, elle fulminait. « Tous des furieux, le docteur Oillic et les autres… Ils veulent te dicter une conduite, Lafitte… » À un feu rouge, elle jeta un coup d’œil à la petite chienne sur la banquette arrière. « Tu as intérêt à garder profil bas », lui dit-elle sévèrement. La petite chienne aplatit ses oreilles en se trémoussant d’un air engageant. « Encore une qui veut m’embobiner… » À la gendarmerie, elle ne vit pas l’adjudant-chef Perrault qui était un ami. Le sergent Petitmangin qu’elle ne pouvait pas souffrir*, prit sa déposition. Il mit un temps considérable à noter ci et ça, alla jusqu’à la voiture vérifier que Marie avait bien décrit la chienne, fit tout une histoire parce que la bête lui montra les dents quand il s’approcha, décréta finalement que c’était un sloughi.** Il écrivit le nom de travers. Marie repartit en continuant à fulminer.
Quand elles rentrèrent à la maison, la chienne alla se coucher sous la table de la cuisine.
« Tant mieux, comme ça, je ne la vois pas, cette horreur… Dès qu’elle est guérie, je la vire… »
Pendant que Marie développait distraitement le jambon qu’elle avait acheté pour le déjeuner, des souvenirs d’enfance heureuse à la campagne montèrent soudain à sa mémoire. Elle s’arrêta, stupéfaite, le jambon à la main.
L’horreur sous la table ressemblait beaucoup aux chiens à vaches qu’elle voyait en Haute-Loire, où ses parents avaient longtemps habité, dans un petit village près du Puy. Ces chiens étaient gris foncé. Un peu comme de la paille de fer, mais truités, avec des taches plus sombres. De petites oreilles pointues dont le bout retombe. Parfois un moignon de queue. Les meilleurs, d’après les paysans, avaient les yeux vairons.
Un des yeux de Mathilde était vert. L’autre avait l’aspect du verre pilé. Gris bleu assez pâle…
« Mathilde… ! Pourquoi Mathilde ? » Elle haussa les épaules.
*
L’après-midi, Marie marcha lentement avec la bête dans les rues de Lamothe. Personne ne les remarqua. Dans les magasins où elles entrèrent, on secoua la tête : désolé, on ne l’a jamais vue.
Sur la place de l’église, Marie ouvrit, à tout hasard, la porte du petit café où elle achetait ses cigarettes.
La patronne regarda la chienne et dit à son mari :
— Tu ne trouves pas qu’elle ressemble à la noiraude de monsieur Enjolras ?
— Tu crois ? dit le mari. Mais non, l’autre chien est plus grand.
— Qui est ce monsieur Enjolras ? demanda Marie.
— C’est un client. Un vieux monsieur qui vient parfois en vélo. Mais on ne l’a pas vu aujourd’hui. Hier… je ne me rappelle pas.
— Où habite-t-il ?
Le patron expliqua à Marie que c’était une petite maison isolée, de l’autre côté du bois, après la zone industrielle. « C’est le désert », ajouta-t-il. « Vous n’allez pas y aller seule quand même ? » « Monsieur Enjolras ne va pas me manger, si je lui rapporte son chien », dit Marie.
— C’est plutôt l’endroit qui n’a pas bonne réputation, reprit le patron. La maison de monsieur Enjolras a failli brûler, il y a juste trois semaines. Il a pris un chien pour la garde. Enfin, en plein jour…
Marie partit bravement. Elle se sentait le cœur lourd, elle ne savait pas pourquoi. « Enjolras… » songeait-elle en conduisant distraitement. « Ça me dit quelque chose… »
Après avoir longé le petit bois, elle se rappela. Le boulanger du village où habitaient ses parents en Haute-Loire s’appelait Enjolras, un des professeurs au lycée du Puy aussi…
Elle se perdit dans la zone industrielle, où elle n’était jamais allée. L’endroit lui donna le frisson. Des routes rectilignes en gravier poussiéreux, sans nom, sans arbres, séparaient des baraques en tôle gigantesques, vertes, bleues, roses, à toit plat, sans fenêtres, sans porte d’entrée reconnaissable.
Des pancartes incompréhensibles, « STECMA, PIERS, ZONE EXCLUSIVE DE LEVAGE, DEGAZ. AUT. » la mystifiaient à chaque croisement. Elle rencontra quelques camions cahotants, si hauts qu’on ne voyait pas leur conducteur.
« Tu traînes les pieds, Lafitte », se dit-elle soudain.
« Tu es persuadée maintenant que monsieur Enjolras est le maître de Mathilde, alors tu renâcles… Tu voudrais la garder, hein ? Eh bien, elle n’est pas à toi. Alors, sors-toi de là en vitesse et trouve la maison… »
Elle finit par émerger de la zone industrielle. La maison surgit au bout d’une petite route campagnarde, aux bas-côtés verdoyants.
Elle était basse, en granit doré, alternativement clair et foncé. Une glycine au tronc épais courait sous le toit en ardoise, éclairé par des chiens-assis peints en blanc. On y accédait par un perron à deux marches aux bords incurvés. La lourde porte moulurée avait une imposte vitrée protégée par une grille en fer forgé. Elle était surmontée d’une marquise en verre. Les fenêtres étaient couronnées d’un bandeau de pierre blanche.
Mathilde commençait à s’agiter sur la banquette arrière en poussant des cris de souris. Marie la laissa, descendit de voiture.
Un grillage tout neuf clôturait le terrain autour de la maison. Marie aperçut un potager bien dessiné, sans une mauvaise herbe, des massifs de camélias en boutons, aux feuilles brillantes, des fusains, des althæas, des viornes, une rangée de rosiers soigneusement taillés.
Au-delà du jardin, un immense terrain vague s’étendait jusqu’au bois de Lamothe-Saint-Léonard.
La grille d’entrée était entrouverte. Marie se dirigea vers le perron, sonna à la porte plusieurs fois, sans succès.
Il n’y avait aucun bruit.
Si vous aviez été à la place de Marie, qu’auriez-vous fait, bande de nases ?
« Enjolras ? Inconnu au bataillon, et je me tire vite fait avec la bête… La conscience tranquille… »
D’ailleurs, le silence a vite fait de vous oppresser, foies blancs que vous êtes. Ça vous met face à vous-même, et le spectacle est démoralisant. Vous auriez eu carrément les jetons, dans ce trou.
Marie a des défauts, c’est sûr, mais pas les mêmes que vous. Elle réagit contre l’oppression ambiante par une audace démesurée – par rapport à sa taille de microbe, j’entends.
Contrairement à vous, elle réfléchit. Elle avait remarqué une fenêtre entrouverte au rez-de-chaussée et la boîte aux lettres qui débordait de prospectus.
C’était bizarre, cette fenêtre ouverte, par un temps aussi froid, non ? Et tout ce courrier… Le maître des lieux, sûrement un homme méticuleux, ne l’aurait pas laissé s’entasser sans raison…
Elle essaya d’ouvrir la porte. Peine perdue. Elle fit le tour du jardin. Le désert.
Hésitant à peine, elle revint devant la maison, se hissa à la force des poignets sur l’appui de la fenêtre ouverte, sauta à l’intérieur.
Elle avait atterri dans la cuisine. Une de ces cuisines comme on n’en fait plus… Un buffet de formica blanc à deux corps, une cuisinière à gaz émaillée, d’un bleu pâle moucheté, avec des brûleurs noirs, un évier profond en porcelaine blanche, un réfrigérateur aux formes arrondies meublaient la pièce. Sur la table recouverte d’une toile cirée, elle vit une bouteille de vin blanc entamée et trois verres.
La seconde pièce, de l’autre côté du couloir d’entrée, était vide aussi. C’était la salle à manger.
La lourde table rectangulaire, au plateau épais, aux pieds droits, aux coins coupés, recouverte d’une plaque de verre, était entourée de huit chaises de même style, dont le dossier raide était sculpté de volutes en bas-relief. Un long dressoir occupait tout un côté du mur. Une sculpture en bronze, représentant une jeune fille aux cheveux ondulés, à moitié étendue sur un rocher, trônait sur le dressoir.
Il régnait un froid glacial dans la maison. « Il n’y a sûrement personne », se dit-elle.
Elle monta quand même les marches de l’escalier raide en bois brillant, dont la cage était recouverte d’un papier à fleurs tout neuf, appela plusieurs fois, s’avança sur le palier mansardé. Une porte était entrouverte, elle la poussa.
Il était là, couché dans le grand lit, sur le dos, les couvertures remontées jusqu’au menton. Ses yeux ouverts étaient tournés vers le plafond. Il ne bougeait pas.
Le cœur de Marie sauta. « Il est mort tout seul, sans personne pour lui tenir la main, sans Mathilde… Et je voulais lui prendre son chien… »
Moquez-vous maintenant, ô lecteurs dont le cœur est comme le plomb, vil et sans chaleur***. Devenue émotive depuis la mort de Jean-Edmond, Marie pleura. Le choc, le remords, ce que vous voudrez… Elle n’osa pas fermer les yeux de monsieur Enjolras.