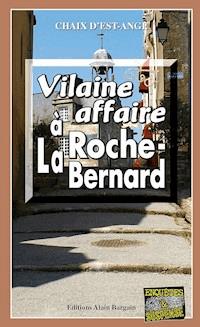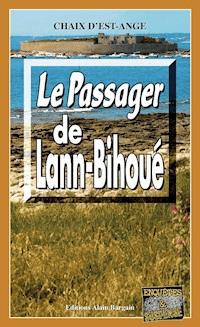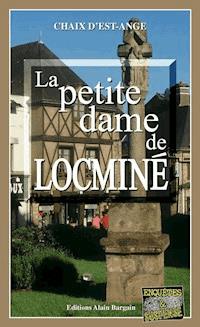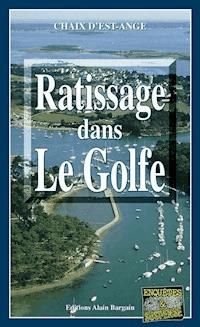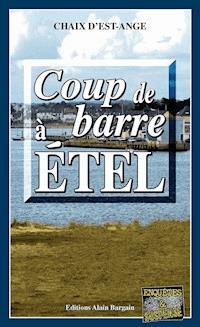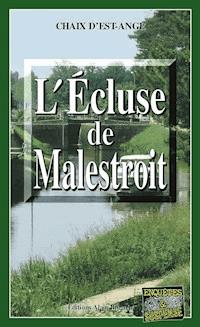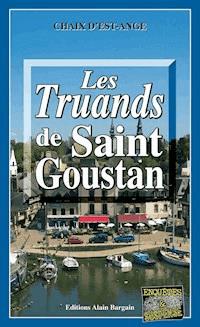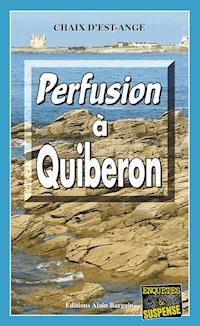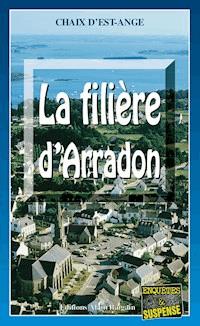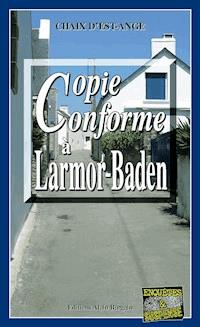
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Marie Lafitte
- Sprache: Französisch
Une nouvelle enquête de Marie Lafitte au cœur de la Bretagne : son été de canicule sera bien moins reposant qu'espéré...
Un peu de déprime, mes loulous ? Rien de tel que de bons amis pour vous trouver une occupation qui chasse les idées noires. Parlez-en donc à Marie Lafitte. Elle vous dira ce qu’elle en pense, de son été de canicule… Ses voisins Chassagne, qui partaient en vacances, la trouvant dolente et seulette, lui confièrent, pour la distraire, la mission de cueillir les fruits et les légumes de leur jardin et de les porter à leurs vieux amis de Larmor-Baden, les Chapelin. Comme dit Henri Chassagne, les haricots verts, ça devient vite fibreux si on attend. Les Chapelin étaient des artistes. Lui était peintre, elle avait un atelier de haute couture. Attachants, les artistes, non ? Marie passait des soirées entières chez eux et, toute étonnée, se reprenait à rire. Mais quelle idée a-t-elle eu, par une
chaude nuit de juin, de partir se balader avec son chien sur la plage de Larmor-Baden ? On ne trouve pas que des coquillages et des petits crabes dans les flaques de la mer montante, c’est moi qui vous le dis…
Dans le 5e tome de ses enquêtes, Marie Lafitte fait une amère découverte : sur la plage de Larmor-Baden, on ne retrouve pas que des coquillages et des petites crabes dans les flaques de la mer montante...
EXTRAIT
Marie passa la matinée du lendemain à téléphoner à Vannes, à Rennes, à Brest, à Paris et autres lieux pour trouver un expert en tableaux. Peine perdue. Ils étaient tous en vacances.
Vers midi, le major Kertanguy apparut dans l’entrée. Il annonça à Marie qu’il avait mis Karim en garde à vue. Oui, l’enquête était presque terminée. Karim était présumé coupable du meurtre de Jeanne Chapelin…
Elle resta d’abord sans voix.
—Mais les Chapelin ont eu de la visite, le soir du 13 juin… dit-elle ensuite. Vous ne pouvez pas…
—Ah ! Alors, il vous a raconté, pour la voiture ? On a vérifié, figurez-vous. Monsieur Chapelin avait eu un léger malaise trois jours auparavant, dans la nuit du mardi au mercredi. Sur le conseil du médecin de famille, madame Chapelin avait réussi à faire venir de Vannes un cardiologue qu’elle connaissait. Il est arrivé le vendredi soir vers 18 heures. C’est sa voiture que Karim a vue. Mais le médecin n’est resté qu’une demi-heure… Karim a eu tout le temps, dans la soirée, de revenir pour…
Marie l’interrompit :
— Karim n’a pas vu le caducée sur la voiture ? S’il avait su qu’il s’agissait d’un médecin…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Après une carrière d'ingénieur de recherche au CNRS à Paris,
Chaix d'Est-Ange se consacre aujourd'hui à l'écriture de romans policiers. Le Pays de Vannes est, depuis de nombreuses années, son lieu favori de détente, l'hiver. C'est aussi le cadre choisi pour ce cinquième roman. Elle est décédée en 2011.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 232
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Roger et Marie-Madeleine. Qu’ils veuillent bien me pardonner les libertés que j’ai prises avec les faits qu’ils m’ont relatés. Ces libertés ne sont pas dues à un manque de respect ou d’amour pour les disparus. J’ai voulu les faire revivre, à ma manière…
REMERCIEMENTS
– À Jean-Marie, du fond du cœur.
PROLOGUE
Raconter des histoires, je veux bien. Je vais peut-être me lancer pour vous dans celle des Chapelin. Mais vous croyez peut-être, vous autres, que je n’ai que ça à faire ? Moi, lieutenant Alban, de la Brigade Criminelle de Vannes, je vais passer capitaine et, naturellement, j’ai tout sur le dos. Notre divisionnaire, le commissaire Cazaubon, est encore en vadrouille, mon collègue Tournebise pris par une affaire de drogue. Quant à Guillou, depuis qu’il a décidé de se marier, il ne touche plus terre. Donc, je ne ferai pas de cadeau, je vous préviens. Ceux qui ne suivent pas, je les envoie chez le juge d’instruction pour des cours de rattrapage. Qu’ils se débrouillent avec lui, bonne chance à eux. Le bonhomme n’est pas aussi accommodant que moi. Et ne comptez pas sur moi pour les fioritures. Je sais que, de temps en temps, entre deux récits sordides d’assassinats, vous aimeriez bien lire de la vraie littérature. Comme d’autres, je serais capable d’écrire : « Elle fond dans ses bras comme si sa chair en fusion était devenue liquide… »*, ou : « Sa langue était devenue un être à part dont les méandres lui échappaient »**. Je suis obligé d’y renoncer, excusez-moi. Faute de temps.
L’histoire des Chapelin s’est passée peu de temps après le mariage de Marie Lafitte avec notre commissaire divisionnaire Cazaubon***. S’il n’était pas parti pour les États-Unis juste à ce moment-là… Lui n’aurait pas eu d’états d’âme… Je dis ça parce que Marie, restée seule en vacances à Larmor-Baden, a été mêlée de près à l’affaire et que les malentendus et les préjugés y ont eu une large place. Le major Kertanguy, de la gendarmerie de Vannes, chargé de l’enquête, avait, certes, un préjugé envers le Marocain. Mais l’inverse aussi était vrai. Par ailleurs, Marie croyait que le major voulait la peau du Marocain, ce qui n’est pas prouvé. Étant devenue la femme d’un commissaire divisionnaire, connu sur le plan international, elle avait aussi la vague impression que le major désirait en remontrer à la police. Bref, la spontanéité et la confiance ne régnaient pas… Toutes proportions gardées, j’ai souvent pensé, à propos de cette histoire, aux croyances ayant cours, dit-on, dans le différend entre Palestiniens et Israéliens, les uns persuadés qu’Israël nie leur droit à l’existence, les autres convaincus que l’Arabe veut les foutre à la mer. Les croyances viennent du passé. L’espoir surgit seulement quand l’avenir se construit.
* Dans : Madeleine Chapsal, Deux femmes en vue, page 232 – Librairie Arthème Fayard – Livre de Poche, 2001.
** C’est de moi.
*** Voir L’Écluse de Malestroit, 2003, même éditeur.
I
À Vannes, après une longue journée à l’Institut, Marie tournait en rond dans son bureau. Elle devait à tout prix retourner ce soir dans les magasins se trouver une robe pour cette soirée exceptionnelle avec son mari, le commissaire divisionnaire Cazaubon, et ses invités américains.
À midi, elle était déjà allée dans plusieurs boutiques. Elle n’avait rien trouvé. Quand on mesure un petit mètre cinquante…
Isabelle, la secrétaire du Laboratoire d’Informatique que dirigeait Marie, regarda sa montre.
— Ce soir, c’est trop tard, mais demain à midi, je vous accompagnerai. On trouvera bien quelque chose. Votre mari rentre quand des États-Unis ?
— Pas avant un mois.
— Vous avez le temps de vous tailler une robe. Vous êtes allée voir les tissus chez Le Tellier ?
— Isabelle, j’ai trop de travail. Je n’ai pas la tête à ça. Regardez tout ce que j’emporte ce soir ! Il faut que je prépare ce séminaire ! C’est le dernier avant les vacances ! Et puis, j’ai peur que mes créations ne soient pas assez bien ! Je me suis fait des robes d’été, mais pour le soir…
— On ne vous demande pas d’être habillée comme la première dame des États-Unis !
— C’est vrai !
Isabelle la laissa en lui faisant promettre de ne rien décider sans elle.
Marie n’alla pas dans les magasins ce soir-là. Elle ramassa sa documentation et fonça vers le parking. Une fois dans sa voiture, sur le chemin du retour, ruminant les propos d’Isabelle, elle se trouva ridicule. Pourquoi faisait-elle tout un foin de ce dîner ?
« Tu ne seras pas le personnage central de la soirée, Lafitte* », se dit-elle. « D’accord, il y aura deux gros bonnets du FBI avec leurs femmes… Et alors ? Tu es comme tu es… Oui, mais tu ne peux pas y aller en blue-jeans… Le meilleur restaurant de la région… La vérité, c’est que tu as peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir le commissaire… Eh bien ! Il a d’autres chats à fouetter, en ce moment, que de se soucier de tes robes… »
Une fois dans sa maison de Lamothe-Saint-Léonard près de Locminé, elle se précipita vers sa penderie, farfouilla, trouva une jupe noire, longue et fendue sur le côté, se dit qu’Isabelle lui trouverait bien le lendemain un tee-shirt élégant pour compléter, décida de n’y plus penser. Après le dîner, elle se plongea dans sa documentation de l’Institut, travailla longtemps, alla se coucher la conscience en paix.
*
À la fin de la semaine qui avait été très chargée, elle était contente de son travail. Son séminaire, en particulier, avait marché comme sur des roulettes. Les étudiants, ces créatures ingrates, l’avaient applaudie, ce qui ne s’était jamais vu… Elle était si fière de ce succès qu’elle avait téléphoné au commissaire pour le lui raconter.
Mais de tee-shirt du soir, point… Isabelle avait fini par la traîner chez Le Tellier, le marchand de tissus, et, après bien des hésitations, Marie avait acheté une belle soie rouge, souple et épaisse, du fil et un patron pour une robe du soir.
Le samedi matin, installée à la table de salle à manger, elle était en train d’ajuster le patron à ses mesures en disant des gros mots, quand sa voisine, Marguerite Chassagne, sonna à la porte.
Elle apportait des fraises du jardin.
— Je vais à Larmor-Baden voir Jeanne Chapelin et lui porter des fruits et des légumes. Vous ne voulez pas venir ? Il fait si beau…
— Heu… dit Marie. Je dois me faire une robe… J’aurais bien aimé la terminer demain soir, j’ai si peu de temps dans la semaine… Venez voir le tissu.
Marguerite Chassagne admira la soie rouge. Mais elle était dubitative.
— Vous voulez la terminer demain soir ? D’accord, il n’y a pas de manches, mais ça a l’air très compliqué d’ajuster ce patron… Et les finitions… Le tour du décolleté… On ne peut pas piquer ça à la machine…
— C’est vrai, dit Marie en essayant de ne pas se laisser gagner par le découragement. Il faut poser un biais au bord, repasser la couture, retourner, coudre à la main à petits points…
— Et pourquoi ne pas demander à Jeanne de vous faire la robe ?
— Je n’oserais jamais ! Et puis ça doit être très cher ! C’est un atelier de haute couture qu’elle a monté à Larmor-Baden, n’est-ce pas ?
— Oui, en un sens. Un petit… Mais comme elle vous connaît… ce sera très raisonnable. Vous vous rappelez notre dîner avec les Chapelin ? Il y a bien trois ans…
— Oui ! C’était avant la mort de Jean-Edmond…
— Eh bien ! Après votre départ, Jeanne m’a dit qu’elle aurait adoré vous habiller ! Elle vous trouve ravissante ! Vous êtes toutes les deux de la même taille, alors…
— Bon ! dit Marie, encore incertaine. Allons-y.
* Lafitte : nom de son premier mari, Jean-Edmond, décédé en 1997. Vous croiriez qu’elle aurait abandonné ses manies, après son second mariage, cette toupie ? Eh bien non !
II
En voiture avec Marguerite, Marie se remémorait le dîner avec les Chapelin.
C’était un repas de gala, pour fêter le succès d’une exposition de peinture à la Salle des Fêtes de Larmor-Baden, à laquelle Henri Chassagne et monsieur Chapelin avaient participé. Ils faisaient tous les deux partie d’une association locale de peintres amateurs et professionnels. Henri Chassagne, qui dessinait bien, s’était lancé dans l’aquarelle et jubilait comme un enfant parce qu’il avait vendu trois tableaux le jour du vernissage. Monsieur Chapelin, un homme âgé, plus expérimenté, avait exposé des fusains que Marie et Jean-Edmond, son premier mari, avaient admirés. Il peignait aussi des huiles sur toile, mais Marie n’avait pas aimé ses tableaux de fleurs qui avaient pourtant un succès fou.
Jean-Edmond, qui était physicien nucléaire, avait passé la nuit et la journée à l’Université de Rennes sur son cyclotron.
Il avait failli être en retard au vernissage à Larmor-Baden où il était arrivé tout crasseux. Elle se souvenait encore de l’avoir traité de plouc…
En rentrant de Larmor-Baden, elle l’avait forcé à passer se changer à la maison avant le dîner chez les Chassagne… Alors qu’il était si fatigué… Après, elle avait eu du remords…
*
Les Chapelin avaient pris leur retraite à Larmor-Baden après une vie mouvementée. Lui, né en 1922, était d’origine luxembourgeoise. Son nom était Ernst Kapellen qu’il avait francisé en Ernest Chapelin après la guerre. En 1940, sa famille habitait Luxembourg où il faisait des études d’infirmier et pratiquait le culturisme. Son père, soupçonné par l’occupant allemand de faire du renseignement pour Londres, fut bientôt mis en prison. Faute de preuves, on le relâcha, mais son fils fut sommé de s’enrôler dans la Wehrmacht.
Marie revit brusquement le vieux monsieur, au dîner du vernissage chez les Chassagne. C’était un bel homme, grand et musclé, aux cheveux argentés un peu trop longs. Il avait raconté avec verve ses premiers exercices dans la cour de la caserne allemande de Luxembourg.
— Les Boches m’ont pris pour mon physique ! se vantait-il. Beau, grand, blond, donc aryen ! Les cons ! Kapellen, c’est un nom celte !*
Sa femme l’avait interrompu :
— Ernest ! Ne dis pas les Boches ! C’est choquant ! Et je croyais qu’ils t’avaient muté dans le Train des Équipages parce que tu étais nul à l’exercice…
— Mais non ! C’est parce que j’avais déjà la moitié du diplôme d’infirmier. Ce n’était pas si fréquent, à l’époque. Ils avaient besoin de gens comme moi. Pour en revenir à mon physique…
Il avait alors raconté ses nombreuses liaisons, vanté le charme des auxiliaires féminines de la Gestapo. Ça avait choqué Marie. Jeanne Chapelin entendait tout ça sans ciller. Elle n’avait même pas l’air contrarié.
L’histoire d’Ernest Chapelin ressemblait ensuite à celle du Soldat Oublié*.
Envoyé sur le front russe comme brancardier, il avait passé trois ans dans la boue, la neige, le sang, s’était retrouvé en Ukraine en 1943, au moment de la bataille de Bielgorod où il dut combattre avec ses camarades. Il avait échappé à la canicule, à la dysenterie, aux obus, à l’horreur. Après Bielgorod, les Russes reprirent Kharkov et la Wehrmacht commença à se désagréger. Les pertes en hommes étaient effroyables. L’armée allemande livrait des combats désespérés, parfois encerclée par les divisions russes. L’ordre d’abandonner la progression vers l’Est pour se replier sur la rive ouest du Dniepr était venu trop tard. Ernest avait alors compris que son salut était du côté russe.
À ce moment du récit, Jeanne Chapelin avait interrompu son mari :
— C’est Olga qui t’a fait comprendre ça, gros nigaud ! Tu n’y aurais jamais pensé tout seul ! C’est bien ce que tu m’as raconté ? Ou tu perds la mémoire ?
— Ah ! Olga ! C’est vrai, j’allais l’oublier !
Il s’était tourné vers Henri Chassagne et avait dit :
— Olga ! Ah ! Olga ! Une jeune fille russe ! Je l’ai rencontrée dans un bled sur le Dniepr… Près de Kiev… Nous étions au repos pendant quelques jours… Elle avait des seins… D’ailleurs, elle m’a servi de modèle ! Oui, oui ! C’est dommage que je n’aie pas mon carnet de 1943… Jeanne ! Tu sais où il est ?
— Ben, dans le petit meuble de l’entrée, avec les autres.
— Alors, qu’est-ce qu’elle t’a dit, Olga ? souffla Henri Chassagne.
— La garce ! Elle a réussi à me faire signer un engagement dans l’armée russe ! Et au même moment, mon copain Bender a obtenu pour lui et moi une mutation en France. C’est que son père était général dans la Wehrmacht, en garnison à La Rochelle ! On n’a pas traîné, j’aime mieux vous dire ! Adieu ma belle Olga et en route pour La Rochelle ! À pied, à cheval et en voiture !
La suite de l’histoire était encore plus ahurissante. Ernest était resté de longs mois à la Rochelle, à faire de la paperasse, puis, abandonnant son copain Bender, il avait filé dans le maquis français. Là, il avait quelque temps ferraillé avec les Allemands, puis estimé que le groupe où il avait atterri était mal organisé et que l’armement était vétuste. À côté de ce qu’avaient les Boches ! Il avait alors décidé de rentrer à Luxembourg.
— Ouais ! Pour sauver ma peau ! Je le reconnais ! avait dit le vieux monsieur d’un air de défi. Mais j’ai peut-être eu tort ! Si vous saviez par quoi j’ai dû passer ! Le 16 décembre 1944, vous vous rappelez ? Non ? C’était la bataille des Ardennes qui commençait. Le cirque ! Et les civils qui déferlaient…
Il avait atteint Luxembourg contre vents et marées. Mais trois fois déserteur, de l’armée allemande, de l’armée russe et des Forces Françaises de l’Intérieur, il avait dû rester caché dans le grenier de son père jusqu’à la fin de la guerre…
À la fin de 1945, il avait préféré prendre le large. Ayant monté un numéro de culturisme avec une belle partenaire, il était parti pour l’Argentine le présenter dans tous les endroits à la mode. Ils avaient eu beaucoup de succès. Mais ce qu’il voulait, c’était Paris. Il avait continué à dessiner et désirait suivre les cours de l’Académie Julian.
— Ouais, avait dit Jeanne Chapelin, tu rêvais d’une vie d’artiste, au milieu des petites femmes !
— Pourquoi les autres et pas moi ? avait répondu son mari.
Sa vie à Paris ? Il l’avait décrite avec de gros rires. Vivant sur ce qu’il avait gagné en Argentine, payant avec peine ses cours de dessin, il habitait un hôtel minable. Jusqu’au jour où il avait rencontré une actrice connue à une exposition de peinture. Elle l’avait mis en relation avec des artistes en vue, des marchands de tableaux, l’avait nourri, habillé, invité à habiter chez elle. Ils avaient longtemps vécu ensemble.
— Je faisais partie de l’École de Paris* ! Ma fortune était faite si je n’avais pas rencontré Jeanne ! avait conclu le vieux monsieur.
À la grande surprise de Marie, il s’était alors penché vers sa femme, lui avait pris la main, l’avait posée sur sa joue. Elle avait dit :
— Ernest ! Ce que tu peux être bête par moments ! C’était une petite femme mince et vive, au teint mat, aux cheveux gris relevés en un chignon hélicoïdal. Elle portait avec élégance un tailleur fait d’une étoffe chinée, beige, rouge et verte, que Marie avait admiré. La coupe était droite et sévère. La veste sans col, bordée d’un galon, laissait voir un chemisier beige pâle au col drapé et un long collier doré, à plusieurs rangs. La jupe, plate, un peu longue était adoucie par quelques plis creux dans le bas.
Quand Jeanne avait rencontré son mari, elle était petite main chez Chanel.
— J’adorais mon métier, avait-elle confié à Marguerite Chassagne et à Marie après le dîner. J’ai hésité avant de suivre Ernest.
Elles étaient toutes les trois dans la cuisine en train de ranger et de préparer le plateau de café.
— Si seulement il n’y avait pas eu cette fête de la Sainte Catherine ! avait poursuivi Jeanne en riant, je n’aurais jamais rencontré mon mari. Qu’est-ce qu’il était venu faire là, je vous demande un peu ! Encore draguer ! … Marguerite, où est le sucrier ? … Si vous aviez vu les tissus chez Chanel ! Une révolution ! Des jerseys à se pâmer ! Des lainages chinés souples comme de la soie ! Depuis ce temps-là, j’ai une passion pour les tissus. D’ailleurs, je couds tous mes vêtements moi-même ! Oui ! Encore maintenant ! Et j’ai monté un petit atelier de couture à Larmor-Baden. Avec trois dames que j’ai formées moi-même. J’ai des clientes qui viennent me voir de loin, vous savez.
— Votre tailleur, c’est vous qui l’avez… ? avait balbutié Marie, incrédule.
— Mais oui, ma petite fille ! Celui-là aussi ! Je ne supporte pas la confection… ces coutures bâclées, ces doublures en toile à beurre, ces affreux boutons… Les boutons, c’est la moitié du chic d’un vêtement ! Regardez ceux-là ! J’ai mis du temps à les trouver. Pour les tissus, j’ai encore quelques relations à Paris, heureusement.
Elle avait regardé avec attention l’ensemble de Marie.
— Vous avez raison de porter du jersey. Pour nous autres, petits modèles, c’est parfait ! Ça nous moule ! Et le blanc vous va bien ! Mais si j’étais vous, je changerais les boutons. Il faudrait… Oh ! Je verrais bien… Jeanne avait alors énuméré des formes de boutons, des matières, des motifs qui avaient fait rêver Marie. C’était comme un poème. Elle s’était promis de chercher à Vannes le bouton idéal pour son ensemble blanc. Pendant que Marguerite Chassagne faisait le café, Jeanne avait ensuite raconté que son mari, tout en continuant à dessiner, avait repris le culturisme et qu’il était devenu masseur et maître nageur. Après leur mariage, ils étaient partis pour le Var, avaient acheté une petite maison au bord de la mer. Ils avaient obtenu une concession de plagistes, pas loin de Sainte-Maxime.
Jeanne s’occupait de la location des cabines de plage, de leur entretien et avait un fructueux petit commerce de boissons fraîches et de chichis*. Ayant la nostalgie de son Morbihan natal, elle faisait aussi des crêpes pour les baigneurs privilégiés.
— Ce n’était pas comme maintenant, avait-elle dit. Il n’y avait presque pas de concurrence. Je faisais sensation, avec mes crêpes.
Son mari massait les dames, apprenait à nager aux petits, faisait aussi des numéros de culturisme.
— Il avait un succès ! Un coq dans sa basse-cour ! avait dit Jeanne en riant.
— Vous n’aviez pas peur qu’on vous le vole, votre Ernest ? avait demandé Marguerite Chassagne.
— Il avait l’air si heureux ! Il faisait beau, on ne manquait de rien… L’hiver, on pouvait venir dans le Morbihan. Mes parents m’avaient laissé leur maison. Je n’allais pas m’inquiéter. Une fois pourtant, je n’ai pas été tranquille…
Elle avait alors raconté qu’un hôtel au luxe provocant s’était construit au bout du pays. Le directeur avait demandé à son mari de devenir le masseur et maître nageur attitré de ses pensionnaires, en échange d’appointements mensuels fixes.
Ernest avait accepté parce que les séances n’avaient lieu que le matin.
— Il a vite compris pourquoi ! avait dit Jeanne. L’hôtel avait un contrat avec des souteneurs parisiens qui désiraient mettre au vert leurs dames de petite vertu. Des dames de luxe, bien entendu ! Mais le maire de la commune avait exigé qu’elles ne viennent sur la plage que tôt le matin. À cause de leur langage… La voiture s’arrêta. Marie se secoua. Elle se dit qu’il fallait qu’elle oublie tout ça… Elle devait penser à l’avenir, à sa nouvelle vie avec le commissaire…
* Commentaire d’Alban : Ernest est un artiste et un breton d’adoption, ne l’oubliez pas ! Il penche du côté qu’il veut tomber ! Kapellen n’a jamais été un nom celte, parole de flic, mais vient du latin médiéval capella, chapelle, mais aussi cape. Capella serait un diminutif du bas latin capa, cape et ferait allusion au reliquaire de Saint-Martin de Tours qui contenait la cape du saint. Comme ça vous saurez, bandes d’ignorants !
* Guy Sajer, Le Soldat Oublié, Robert Laffont, 1967. Récit pathétique de la guerre en Russie d’un jeune homme, français par sa mère, allemand par son père, qui a été enrôlé dans la Wehrmacht.
* Ernest exagère encore ! L’École de Paris désigne habituellement un ensemble hétérogène d’artistes étrangers, tels Modigliani, Chagall, Kisling, et d’autres peintres moins connus, installés à Paris dans les premières années du XXe siècle. Il est vrai qu’après la seconde guerre mondiale, les peintres de la nouvelle génération ont repris abusivement le titre ! Les prix, j’aime mieux vous dire, ne sont pas les mêmes !
* Chichis : petits beignets.
III
Larmor-Baden a été bâti sur une butte qui domine la mer et les marais. C’est un bourg modeste et riant, fier de ses belles maisons qui dégringolent vers l’eau. L’église basse et blanche, aux chaînages de pierre rose, au clocher-mur de granit, n’a pas l’aspect imposant de celle de Baden. Des champs subsistent au milieu des propriétés cossues. Mais l’histoire de douleur et de pauvreté des siècles passés ne transparaît pas aujourd’hui dans les façades bien crépies, dans les jardins remplis d’orangers, de roses et de camélias. À la croisée des chemins, des mimosas immenses se balancent dans la brise.
La maison des Chapelin, rue du Verger, était au fond d’un jardin muraillé, orienté au sud. La grille était ouverte. Le jardin, quelque peu désordonné, mais plein de charme, ravit Marie. Au milieu de la pelouse, une fontaine en forme de dauphin ornait un bassin ovale. Elle rit en voyant un massif composé d’une grosse coloquinte orange entourée de roses trémières de toutes les couleurs, remarqua un énorme figuier couvert de fruits, un palmier, des massifs de camélias, des géraniums grands comme des arbres. Un plumbago gigantesque, à la douce couleur bleue, s’accrochait à la façade en granit austère. Les Chapelin devaient avoir la nostalgie des fleurs du midi…
— C’est Karim, un Marocain, qui s’occupe du jardin, dit Marguerite. Ernest et Jeanne adorent les fleurs mais n’y connaissent rien. Karim est venu du Var avec eux. Il habite à côté avec sa femme et ses quatre enfants.
On entrait dans la maison par une véranda qui donnait sur une petite entrée. Rien n’était fermé. Marguerite Chassagne s’avança hardiment. L’entrée et la salle de séjour étaient désertes. Elle appela Jeanne Chapelin d’une voix de stentor.
Elles entendirent un peu de bruit à l’étage.
— Ah ! dit Marguerite. Ernest est là. Je monte. Pendant ce temps, Marie regardait autour d’elle.
La salle de séjour, très vaste et claire, était en partie occupée par ce qui devait être l’atelier de couture de Jeanne. Elle vit trois machines à coudre, des rouleaux de tissus, des mannequins de couturière. L’un d’eux était habillé d’une robe du soir décolletée en satin vert sombre brodé de sequins. La forme était austère, le tissu jetait mille feux. « Ce n’es pas pour toi, Lafitte, se dit-elle… Ces étoffes brillantes… Tu aurais l’air d’un paon… Qu’est-ce que tu es venue faire dans cette galère ? Si seulement Jeanne était sortie, on pourrait repartir sans vexer personne… » Marguerite Chassagne descendit enfin l’escalier, l’air soucieux.
— Jeanne est à Lorient. Ernest ne sait pas quand elle rentrera. Il n’est pas habillé. Généralement, sauf s’il pleut, il peint au jardin, à cette heure-ci…
— Qui va lui faire son déjeuner ? demanda Marie. Il est bientôt 11 heures trente.
— Je ne sais pas trop… Ça vous ennuie si nous allons voir Karim pour le prévenir ?
Elles allèrent à pied jusqu’à la petite maison de Karim. Marguerite, qui était infirmière, connaissait très bien sa famille, ayant soigné tous les enfants quand elle était encore en activité.
Karim était en train de bêcher un coin du petit jardin.
C’était un homme d’une cinquantaine d’années, trapu, au teint mat, aux yeux dorés. Ses cheveux noirs étaient fins et ondulés. Il s’avança vers Marguerite et Marie en souriant.
— Ah ! Madame Marguerite ! Ça fait plaisir ! Venez vous asseoir avec la petite demoiselle !
Marguerite Chassagne fit les présentations. Elles entrèrent dans la cuisine.
— Ma femme n’est pas là. Elle est allée acheter des chaussures aux enfants. Vous reconnaîtrez ma fille aînée, Madame Marguerite ? Sélima, viens te montrer !
Sélima était une grande jeune fille aux longs yeux noirs, au sourire éclatant comme celui de son père.
On bavarda. Marie apprit que Sélima étudiait le droit à Vannes, que les trois autres enfants étaient en classe à Arradon.
— C’est madame Jeanne qui les a poussés, dit Karim fièrement. Elle a tout de suite vu qu’ils pouvaient faire des études…
Il était déjà midi quand Marguerite Chassagne aborda le sujet des Chapelin.
— Ah ! dit Karim. Monsieur Ernest n’était pas encore habillé ? Bon, je vais aller voir. Ces temps-ci, il n’est pas bien courageux… De toutes façons, il déjeunera avec nous si madame Jeanne tarde encore. Sélima, je reviens !
Ils partirent tous les trois.
Jeanne Chapelin aidait son mari à descendre l’escalier quand ils arrivèrent.
— Ah ! Karim ! dit-elle. Peux-tu installer mon mari à table ? Nous allons déjeuner en vitesse. J’ai du travail.
Elle aperçut Marguerite et Marie. Son visage s’éclaira.
— Marguerite ! J’ai vu votre panier ! Vos haricots ! Quelle merveille ! Et la salade… Et les fraises…
Elle se tourna vers Marie :
— Marie… Marie Lafitte ? … Oui ! Je vous reconnais bien ! Ernest ! Tu te souviens de Marie ?
— Je me souviens toujours des jolies femmes, répondit Ernest… Bonjour, Marguerite ! Bonjour, Madame ! Excusez-moi de ne pas me lever. Ma jambe me tourmente.
Il était assis dans un fauteuil que Karim avait rapproché de la table.
Marie le trouva vieilli.
— Vous êtes pressée, Jeanne. Marie et moi allions partir, dit Marguerite.
— Pas question ! Vous allez déjeuner avec nous.
*
Sur le chemin du retour, Marguerite dit triomphalement :
— C’était pas une bonne idée, pour votre robe ? La semaine prochaine, Jeanne vous la taille, vous la bâtit, vous l’essaye. Vous n’avez plus qu’à la coudre… Heureusement, votre soie rouge lui a tapé dans l’œil ! C’est qu’elle travaille à l’inspiration ! Vous n’en tirez rien si le tissu ne lui…
Marie l’interrompit :
— Marguerite ! J’ai eu l’impression qu’elle avait un souci ! Une commande pressée, peut-être ? Où sont les autres dames qui cousent avec elle ? Elle a peut-être tout sur le dos ? J’ai eu l’impression qu’elle allait passer son week-end à travailler… C’est qu’elle n’est pas toute jeune… Et son mari…
— Je vais demander à Henri d’aller le voir demain et de l’emmener peindre dehors. Comme ça, Jeanne aura les mains libres. Ernest demande beaucoup d’attention, maintenant…
*
La semaine de Marie avait été si chargée qu’elle ne put se rendre à Larmor-Baden que le samedi suivant.
Quand elle arriva chez les Chapelin, Jeanne était seule.
Il était 10 heures du matin.
— Henri Chassagne a emmené mon mari peindre à la pointe d’Arradon, dit-elle. Ça le stimule. Quand il est seul, il se laisse un peu aller… Incroyable, quand on l’a connu plus jeune… Alors, votre robe ? Qu’est-ce que vous avez en tête ?
Marie montra timidement le patron qu’elle avait acheté.
— Vous tenez vraiment à ce drapé autour du décolleté ? demanda Jeanne.
— Non, dit Marie. J’ai pris ce que j’ai trouvé. J’aimerais mieux une forme plus simple. La couleur est déjà voyante…
— Elle est parfaite.