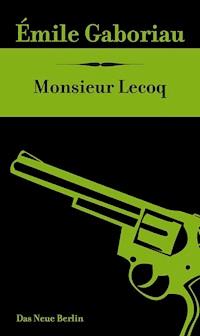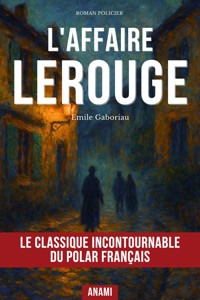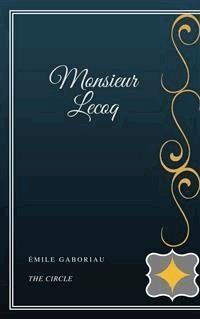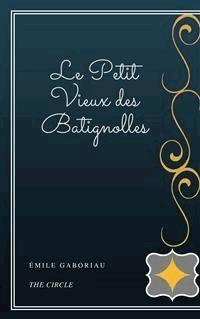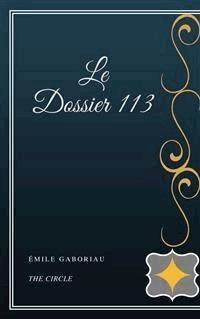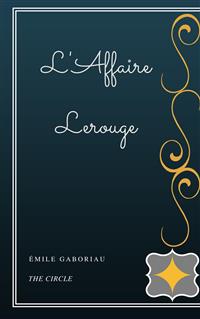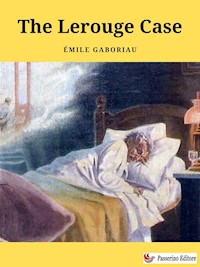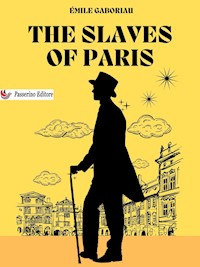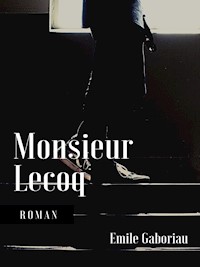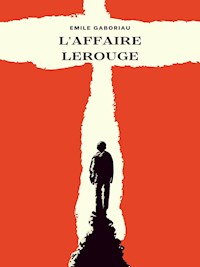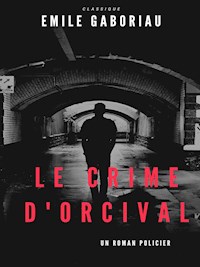
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Deux braconniers, le père et le fils, trouvent Berthe de Trémorel sauvagement assassinée dans le parc du chateau du comte de Trémorel, son époux, ce dernier restant introuvable. Ils sont vite accusés, avec un domestique du chateau au comportement suspect et sans alibi, du meurtre de ces deux notables très appréciés de leurs concitoyens d'Orcival. Les trois suspects, défavorablement connus des services de la police, s'enferment dans un mutisme révélateur. À peine arrivé, l'inspecteur Lecoq, constate que l'enquête a été baclée et la reprend à zéro. Il propose rapidement un début d'explication qui va à l'encontre de celle du juge d'instruction, ce dernier restant persuadé de la justesse de son analyse de la situation...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 567
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le Crime d'Orcival
Le Crime d'Orcival12345678910111213141516171819202122232425262728Page de copyrightLe Crime d'Orcival
Emile Gaboriau
1
Le 9 juillet 186., un jeudi, Jean Bertaud, dit La Ripaille, et son fils, bien connus à Orcival pour vivre de braconnage et de maraude, se levèrent sur les trois heures du matin, avec le jour, pour aller à la pêche.
Chargés de leurs agrès, ils descendirent ce chemin charmant, ombragé d’acacias, qu’on aperçoit de la station d’Évry, et qui conduit du bourg d’Orcival à la Seine.
Ils se rendaient à leur bateau amarré d’ordinaire à une cinquantaine de mètres en amont du pont de fil de fer, le long d’une prairie joignant Valfeuillu, la belle propriété du comte de Trémorel.
Arrivés au bord de la rivière, ils se débarrassèrent de leurs engins de pêche, et Jean La Ripaille entra dans le bateau pour vider l’eau qu’il contenait.
Pendant que d’une main exercée il maniait l’écope, il s’aperçut qu’un des tolets de la vieille embarcation, usé par la rame, était sur le point de se rompre.
– Philippe, cria-t-il à son fils, occupé à démêler un épervier dont un garde-pêche eût trouvé les mailles trop serrées, Philippe, tâche donc de m’avoir un bout de bois pour refaire notre tolet.
– On y va, répondit Philippe.
Il n’y avait pas un arbre dans la prairie. Le jeune homme se dirigea donc vers le parc de Valfeuillu, distant de quelques pas seulement, et, peu soucieux de l’article 391 du Code pénal, il franchit le large fossé qui entoure la propriété de M. de Trémorel. Il se proposait de couper une branche à l’un des vieux saules qui, à cet endroit, trempent au fil de l’eau leurs branches éplorées.
Il avait à peine tiré son couteau de sa poche, tout en promenant autour de lui le regard inquiet du maraudeur, qu’il poussa un cri étouffé.
– Mon père ! eh ! mon père !
– Qu’y a-t-il, répondit sans se déranger le vieux braconnier.
– Père, venez, continua Philippe, au nom du ciel, venez vite !
Jean La Ripaille comprit à la voix rauque de son fils, qu’il se passait quelque chose d’extraordinaire. Il lâcha son écope, et, l’inquiétude aidant, en trois bonds, il fut dans le parc.
Lui aussi, il resta épouvanté devant le spectacle qui avait terrifié Philippe.
Sur le bord de la rivière, parmi les joncs et les glaïeuls, le cadavre d’une femme gisait. Ses longs cheveux dénoués s’éparpillaient parmi les herbes aquatiques ; sa robe de soie grise en lambeaux était souillée de boue et de sang. Toute la partie supérieure du corps plongeait dans l’eau peu profonde, et le visage était enfoncé dans la vase.
– Un assassinat ! murmura Philippe dont la voix tremblait.
– Ça, c’est sûr, répondit La Ripaille d’un ton indifférent. Mais quelle peut être cette femme ? Vrai, on dirait la comtesse.
– Nous allons bien voir, dit le jeune homme.
Il fit un pas vers le cadavre ; son père l’arrêta par le bras.
– Que veux-tu faire, malheureux ! prononça-t-il ; on ne doit jamais toucher au corps d’une personne assassinée, sans la justice.
– Vous croyez ?
– Certainement ! il y a des peines pour cela.
– Alors, allons prévenir le maire.
– Pourquoi faire ? Les gens d’ici ne nous en veulent peut-être pas assez ! Qui sait si on ne nous accuserait pas ?
– Cependant, mon père…
– Quoi ! si nous allons avertir M. Courtois, il nous demandera comment et pourquoi nous nous trouvions dans le parc de M. de Trémorel pour voir ce qu’il s’y passait. Qu’est-ce que cela te fait qu’on ait tué la comtesse ? On retrouvera bien son corps sans toi… viens, allons-nous-en.
Mais Philippe ne bougea pas. La tête baissée, le menton appuyé sur la paume de sa main, il réfléchissait.
– Il faut avertir, déclara-t-il d’un ton décidé ; on n’est pas des sauvages. Nous dirons à M. Courtois que c’est en côtoyant le parc dans notre bachot que nous avons aperçu le corps.
Le vieux La Ripaille résista d’abord, puis voyant que son fils irait sans lui, il parut se rendre à ses instances.
Ils franchirent donc de nouveau le fossé, et, abandonnant leurs agrès dans la prairie, ils se dirigèrent en toute hâte vers la maison de M. le maire d’Orcival.
Situé à cinq kilomètres de Corbeil, sur la rive droite de la Seine, à vingt minutes de la station d’Évry, Orcival est un des plus délicieux villages des environs de Paris, en dépit de l’infernale étymologie de son nom.
Le Parisien bruyant et pillard, qui, le dimanche, s’abat dans les champs, plus destructeur que la sauterelle, n’a pas découvert encore ces campagnes riantes. L’odeur navrante de la friture des guinguettes n’y étouffe pas le parfum des chèvrefeuilles. Les refrains des canotiers, la ritournelle du cornet à piston des bals publics n’y ont jamais épouvanté les échos.
Paresseusement accroupi sur les pentes douces d’un coteau que baigne la Seine, Orcival a des maisons blanches, des ombrages délicieux et un clocher tout neuf qui fait son orgueil.
De tous côtés, de vastes propriétés de plaisance, entretenues à grands frais, l’entourent. De la hauteur, on aperçoit les girouettes de vingt châteaux.
À droite, ce sont les futaies de Mauprévoir, et le joli castel de la comtesse de la Brèche ; en face, de l’autre côté du fleuve, voici Mousseaux et Petit-Bourg, l’ancien domaine Aguado, devenu la propriété d’un carrossier illustre, M. Binder ; à gauche, ces beaux arbres sont au comte de Trémorel, ce grand parc est le parc d’Étiolles et dans le lointain, tout là-bas, c’est Corbeil ; cet immense bâtiment, dont la toiture dépasse les grands chênes, c’est le moulin Darblay.
Le maire d’Orcival habite tout en haut du village une de ces maisons comme on en voit dans les rêves de cent mille livres de rentes.
Fabricant de toiles peintes autrefois, M. Courtois a débuté dans le commerce sans un sou vaillant, et, après trente années d’un labeur acharné, il s’est retiré avec quatre millions bien ronds.
Alors il se proposait de vivre bien tranquille, entre sa femme et ses filles, passant l’hiver à Paris et l’été à la campagne.
Mais voilà que tout à coup, on le vit inquiet et agité. L’ambition venait de le mordre au cœur. Il faisait cent démarches pour être forcé d’accepter la mairie d’Orcival. Et il l’a acceptée, bien à son corps défendant, ainsi qu’il vous le dira lui-même.
Cette mairie fait à la fois son bonheur et son désespoir. Désespoir apparent, bonheur intime et réel.
Il est bien, lorsque le front chargé de nuages, il maudit les soucis du pouvoir, il est mieux lorsque le ventre ceint de l’écharpe à glands d’or, il triomphe à la tête du corps municipal.
Tout le monde dormait encore chez M. le maire, lorsque les Bertaud père et fils vinrent heurter le lourd marteau de la porte.
Après un bon moment, un domestique aux trois quarts éveillé, à demi vêtu, parut à l’une des fenêtres du rez-de-chaussée.
– Qu’est-ce qu’il y a, méchants garnements ? demanda-t-il d’un ton de mauvaise humeur.
La Ripaille ne jugea point à propos de relever une injure que ne justifiait que trop sa réputation dans la commune.
– Nous voulons parler à monsieur le maire, répondit-il, et c’est terriblement pressé. Allez l’éveiller, M. Baptiste, il ne vous grondera pas.
– Est-ce qu’on me gronde, moi ! grogna Baptiste.
Il fallut cependant dix bonnes minutes de pourparlers et d’explications pour décider le domestique.
Enfin les Bertaud comparurent par-devant un petit homme gros et rouge, fort mécontent d’être tiré du lit si matin : c’était M. Courtois.
Il avait été décidé que Philippe porterait la parole.
– Monsieur le maire, commença-t-il, nous venons vous annoncer un grand malheur ; il y a eu pour sûr un crime chez M. de Trémorel.
M. Courtois était l’ami du comte, il devint à cette déclaration inattendue plus blême que sa chemise.
– Ah ! mon Dieu ! balbutia-t-il, incapable de maîtriser son émotion, que me dites-vous là, un crime !…
– Oui, nous avons vu un corps, tout à l’heure, et aussi vrai que vous voilà, je crois que c’est celui de la comtesse.
Le digne maire leva les bras au ciel d’un air parfaitement égaré.
– Mais où, mais quand ? interrogea-t-il.
– Tout à l’heure, au bout du parc que nous longions pour aller relever nos nasses.
– C’est horrible ! répétait le bon M. Courtois, quel malheur ! Une si digne femme ! Mais ce n’est pas possible, vous devez vous tromper ; on m’aurait prévenu…
– Nous avons bien vu, monsieur le maire.
– Un tel crime, dans ma commune ! Enfin, vous avez bien fait de venir, je vais m’habiller en deux temps, et nous allons courir… C’est-à-dire, non, attendez.
Il parut réfléchir une minute et appela :
– Baptiste !
Le domestique n’était pas loin. L’oreille et l’œil alternativement collés au trou de la serrure, il écoutait et regardait de toutes ses forces. À la voix de son maître, il n’eut qu’à allonger le bras pour ouvrir la porte.
– Monsieur m’appelle ?
– Cours chez le juge de paix, lui dit le maire, il n’y a pas une seconde à perdre, il s’agit d’un crime, d’un meurtre peut-être, qu’il vienne vite, bien vite… Et vous autres, continua-t-il, s’adressant aux Bertaud, attendez-moi ici, je vais passer un paletot.
Le juge de paix d’Orcival, le père Plantat, comme on l’appelle, est un ancien avoué de Melun.
À cinquante ans, le père Plantat, auquel tout avait toujours réussi à souhait, perdit dans le même mois sa femme qu’il adorait et ses fils, deux charmants jeunes gens, âgés l’un de dix-huit, l’autre de vingt-deux ans.
Ces pertes successives atterrèrent un homme que trente années de prospérité laissaient sans défense contre le malheur. Pendant longtemps, on craignit pour sa raison. La seule vue d’un client, venant troubler sa douleur pour lui conter de sottes histoires d’intérêt, l’exaspérait. On ne fut donc pas surpris de lui voir vendre son étude à moitié prix. Il voulait s’établir à son aise dans son chagrin, avec la certitude de n’en point être distrait.
Mais l’intensité des regrets diminua et la maladie du désœuvrement vint. La justice de paix d’Orcival était vacante, le père Plantat la sollicita et l’obtint.
Une fois juge de paix, il s’ennuya moins. Cet homme, qui voyait sa vie finie, entreprit de s’intéresser aux mille causes diverses qui se plaidaient chez lui. Il appliqua toutes les forces d’une intelligence supérieure, toutes les ressources d’un esprit éminemment délié à démêler le faux du vrai parmi tous les mensonges qu’il était forcé d’écouter.
Il s’obstina d’ailleurs à vivre seul, en dépit des exhortations de M. Courtois, prétendant que toute société le fatiguait, et qu’un homme malheureux est un trouble-fête. Le temps que lui laissait son tribunal, il le consacrait à une collection sans pareille de pétunias.
Le malheur qui modifie les caractères, soit en bien, soit en mal, l’avait rendu, en apparence, affreusement égoïste. Il assurait ne pas s’intéresser aux choses de la vie plus qu’un critique blasé aux jeux de la scène. Il aimait à faire parade de sa profonde indifférence pour tout, jurant qu’une pluie de feu tombant sur Paris ne lui ferait seulement pas tourner la tête. L’émouvoir semblait impossible. « Qu’est-ce que cela me fait, à moi ! » était son invariable refrain.
Tel est l’homme qui, un quart d’heure après le départ de Baptiste, arrivait chez le maire d’Orcival.
M. Plantat est grand, maigre et nerveux. Sa physionomie n’a rien de remarquable. Il porte les cheveux courts, ses yeux inquiets paraissent toujours chercher quelque chose, son nez fort long est mince comme la lame d’un rasoir. Depuis ses chagrins, sa bouche, si fine jadis, s’est déformée, la lèvre inférieure s’est affaissée et lui donne une trompeuse apparence de simplicité.
– Que m’apprend-on, dit-il dès la porte, on a assassiné Mme de Trémorel.
– Ces gens-ci, du moins, le prétendent, répondit le maire qui venait de reparaître.
M. Courtois n’était plus le même homme. Il avait eu le temps de se remettre un peu. Sa figure s’essayait à exprimer une froideur majestueuse. Il s’était vertement blâmé d’avoir, en manifestant son trouble et sa douleur devant les Bertaud, manqué de dignité.
« Rien ne doit émouvoir à ce point un homme dans ma position », s’était-il dit.
Et, bien qu’effroyablement agité, il s’efforçait d’être calme, froid, impassible.
Le père Plantat, lui, était ainsi tout naturellement.
– Ce serait un accident bien fâcheux, dit-il d’un ton qu’il s’efforçait de rendre parfaitement désintéressé, mais, au fond, qu’est-ce que cela nous fait ? Il faut néanmoins aller voir sans retard ce qu’il en est ; j’ai fait prévenir le brigadier de gendarmerie qui nous rejoindra.
– Partons, dit M. Courtois, j’ai mon écharpe dans ma poche.
On partit. Philippe et son père marchaient les premiers, le jeune homme empressé et impatient, le vieux sombre et préoccupé.
Le maire, à chaque pas, laissait échapper quelques exclamations.
– Comprend-on cela, murmurait-il, un meurtre dans ma commune, une commune où de mémoire d’homme, il n’y a point eu de crime de commis.
Et il enveloppait les deux Bertaud d’un regard soupçonneux.
Le chemin qui conduit à la maison – dans le pays on dit au château – de M. de Trémorel est assez déplaisant, encaissé qu’il est par des murs d’une douzaine de pieds de haut. D’un côté, c’est le parc de la marquise de Lanascol, de l’autre le grand jardin de Saint-Jouan.
Les allées et les venues avaient pris du temps, il était près de huit heures lorsque le maire, le juge de paix et leurs guides s’arrêtèrent devant la grille de M. de Trémorel.
Le maire sonna.
La cloche est fort grosse, une petite cour sablée de cinq ou six mètres sépare seule la grille de l’habitation, cependant personne ne parut.
Monsieur le maire sonna plus fort, puis plus fort encore, puis de toutes ses forces, en vain.
Devant la grille du château de M. de Lanascol, située presque en face, un palefrenier était debout, occupé à nettoyer et à polir un mors de bride.
– Ce n’est guère la peine de sonner, messieurs, dit cet homme, il n’y a personne au château.
– Comment, personne ? demanda le maire surpris.
– J’entends, répondit le palefrenier, qu’il n’y a que les maîtres. Les gens sont tous partis hier soir, par le train de huit heures quarante, pour se rendre à Paris, assister à la noce de l’ancienne cuisinière, Mme Denis ; ils doivent revenir ce matin par le premier train. J’avais été invité, moi aussi…
– Grand Dieu ! interrompit M. Courtois, alors le comte et la comtesse sont restés seuls cette nuit ?
– Absolument seuls, monsieur le maire.
– C’est horrible !
Le père Plantat semblait s’impatienter de ce dialogue.
– Voyons, dit-il, nous ne pouvons nous éterniser à cette porte, les gendarmes n’arrivent pas, envoyons chercher le serrurier.
Déjà Philippe prenait son élan, lorsqu’au bout du chemin on entendit des chants et des rires. Cinq personnes, trois femmes et deux hommes parurent presque aussitôt.
– Ah ! voilà les gens du château, dit le palefrenier que cette visite matinale semblait intriguer singulièrement, ils doivent avoir une clé.
De leur côté, les domestiques, apercevant le groupe arrêté devant la grille, se turent et hâtèrent le pas. L’un d’eux, même, se mit à courir, devançant ainsi les autres ; c’était le valet de chambre du comte.
– Ces messieurs voudraient parler à monsieur le comte ? demanda-t-il, après avoir salué le maire et le juge de paix.
– Voici cinq fois que nous sonnons à tout rompre, dit le maire.
– C’est surprenant, fit le valet de chambre, Monsieur a pourtant le sommeil bien léger ! Après cela, il est peut-être sorti.
– Malheur ! s’écria Philippe, on les aura assassinés tous les deux !
Ces mots dégrisèrent les domestiques dont la gaieté annonçait un nombre très raisonnable de santés bues au bonheur des nouveaux époux.
M. Courtois, lui, paraissait étudier l’attitude du vieux Bertaud.
– Un assassinat ! murmura le valet de chambre ; ah ! c’est pour l’argent, alors, on aura su…
– Quoi ? demanda le maire.
– Monsieur le comte a reçu hier dans la matinée une très forte somme.
– Ah ! oui, forte, ajouta une femme de chambre, il y avait gros comme cela de billets de banque. Madame a même dit à Monsieur qu’elle ne fermerait pas l’œil de la nuit avec cette somme immense dans la maison.
Il y eut un silence, chacun se regardant d’un air effrayé. M. Courtois, lui, réfléchissait.
– À quelle heure êtes-vous partis hier soir, demanda-t-il aux domestiques.
– À huit heures, on avait avancé le dîner.
– Vous êtes partis tous ensemble ?
– Oui, monsieur.
– Vous ne vous êtes pas quittés ?
– Pas une minute.
– Et vous revenez tous ensemble ?
Les domestiques échangèrent un singulier regard :
– Tous, répondit une femme de chambre qui avait la langue bien pendue… c’est-à-dire, non. Il y en a un qui nous a lâchés en arrivant à la gare de Lyon, à Paris : c’est Guespin.
– Ah !
– Oui, monsieur, il a filé de son côté en disant qu’il nous rejoindrait aux Batignolles, chez Wepler, où se faisait la noce.
Monsieur le maire donna un grand coup de coude au juge de paix, comme pour lui recommander l’attention, et continua à interroger.
– Et ce Guespin, comme vous le nommez, l’avez-vous revu ?
– Non, monsieur, j’ai même plusieurs fois demandé inutilement de ses nouvelles pendant la nuit ; son absence me paraissait louche.
Évidemment la femme de chambre essayait de faire montre d’une perspicacité supérieure ; encore un peu elle eût parlé de pressentiments.
– Ce domestique, demanda M. Courtois, était-il depuis longtemps dans la maison ?
– Depuis le printemps.
– Quelles étaient ses attributions ?
– Il avait été envoyé de Paris par la maison du Gentil Jardinier pour soigner les fleurs rares de la serre de Madame.
– Et… avait-il eu connaissance de l’argent ?
Les domestiques eurent encore des regards bien significatifs.
– Oui, oui ! répondirent-ils en chœur, nous en avions beaucoup causé entre nous à l’office.
– Même, ajouta la femme de chambre, belle parleuse, il m’a dit à moi-même, parlant à ma personne :
« – Dire que monsieur le comte a dans son secrétaire de quoi faire notre fortune à tous !
– Quelle espèce d’homme est-ce ?
Cette question éteignit absolument la loquacité des domestiques. Aucun n’osait parler, sentant bien que le moindre mot pouvait servir de base à une accusation terrible.
Mais le palefrenier de la maison d’en face qui brûlait de se mêler à cette affaire, n’eut point ces scrupules.
– C’est, répondit-il, un bon garçon, Guespin, et qui a roulé. Dieu de Dieu ! en sait-il de ces histoires ! Il connaît tout, cet homme-là, il paraît qu’il a été riche dans le temps, et s’il voulait… Mais, dame ! il aime le travail tout fait, et avec ça c’est un noceur comme il n’y en a pas, un creveur de billards, quoi !
Tout en écoutant d’une oreille, en apparence distraite, ces dépositions, ou, pour parler plus juste, ces cancans, le père Plantat examinait soigneusement et le mur et la grille. Il se retourna à point nommé pour interrompre le palefrenier.
– En voilà bien assez, dit-il, au grand scandale de M. Courtois. Avant de poursuivre cet interrogatoire, il est bon de constater le crime, si crime il y a, toutefois, ce qui n’est pas prouvé. Que celui de vous qui a une clé ouvre la grille.
Le valet de chambre avait la clé, il ouvrit, et tout le monde pénétra dans la petite cour. Les gendarmes venaient d’arriver. Le maire dit au brigadier de le suivre, et plaça deux hommes à la grille, avec défense de laisser entrer ou sortir personne sans sa permission.
Alors seulement le valet de chambre ouvrit la porte de la maison.
2
S’il n’y avait pas eu de crime, au moins s’était-il passé quelque chose de bien extraordinaire chez le comte de Trémorel ; l’impassible juge de paix dut en être convaincu dès ses premiers pas dans le vestibule.
La porte vitrée donnant sur le jardin était toute grande ouverte, et trois des carreaux étaient brisés en mille pièces.
Le chemin de toile cirée qui reliait toutes les portes avait été arraché, et sur les dalles de marbre blanc, çà et là, on apercevait de larges gouttes de sang. Au pied de l’escalier était une tache plus grande que les autres, et sur la dernière marche une éclaboussure hideuse à voir.
Peu fait pour de tels spectacles, pour une mission comme celle qu’il avait à remplir, l’honnête M. Courtois se sentait défaillir. Par bonheur, il puisait dans le sentiment de son importance et de sa dignité une énergie bien éloignée de son caractère. Plus l’instruction préliminaire de cette affaire lui paraissait difficile, plus il tenait à bien la mener.
– Conduisez-nous à l’endroit où vous avez aperçu le corps, dit-il aux Bertaud.
Mais le père Plantat intervint.
– Il serait, je crois, plus sage, objecta-t-il, et plus logique de commencer par visiter la maison.
– Soit, oui, en effet, c’est ce que je pensais, dit le maire, s’accrochant au conseil du juge de paix, comme un homme qui se noie s’accroche à une planche.
Et il fit retirer tout le monde, à l’exception du brigadier et du valet de chambre destiné à servir de guide.
– Gendarmes, cria-t-il encore, aux hommes en faction devant la grille, veillez à ce que personne ne s’éloigne, empêchez d’entrer dans la maison, et que nul surtout ne pénètre dans le jardin.
On monta alors.
Tout le long de l’escalier les taches de sang se répétaient. Il y avait aussi du sang sur la rampe, et M. Courtois s’aperçut avec horreur qu’il s’y était rougi les mains.
Lorsqu’on fut arrivé au palier du premier étage :
– Dites-moi, mon ami, demanda le maire au valet de chambre, vos maîtres faisaient-ils chambre commune ?
– Oui, monsieur, répondit le domestique.
– Et, où est leur chambre ?
– Là, monsieur.
Et en même temps qu’il répondait, le valet de chambre reculait effrayé, et montrait une porte dont le panneau supérieur portait l’empreinte d’une main ensanglantée.
Des gouttelettes de sueur perlaient sur le front du pauvre maire ; lui aussi, il avait peur, à grand-peine il pouvait se tenir debout ! Hélas ! le pouvoir impose de terribles obligations. Le brigadier, un vieux soldat de Crimée, visiblement ému, hésitait.
Seul, le père Plantat, tranquille comme dans son jardin, gardait son sang-froid et regardait les autres en dessous.
– Il faut pourtant se décider, prononça-t-il.
Il entra, les autres le suivirent.
La pièce où on pénétra n’offrait rien de bien insolite. C’était un boudoir tendu de satin bleu, garni d’un divan et de quatre fauteuils capitonnés en étoffe pareille à la tenture. Un des fauteuils était renversé.
On passa dans la chambre à coucher.
Effroyable était le désordre de cette pièce. Il n’était pas un meuble, pas un bibelot, qui n’attestât qu’une lutte terrible, enragée, sans merci, avait eu lieu entre les assassins et les victimes.
Au milieu de la chambre, une petite table de laque était renversée, et tout autour s’éparpillaient des morceaux de sucre, des cuillères de vermeil, des débris de porcelaine.
– Ah ! dit le valet de chambre, Monsieur et Madame prenaient le thé lorsque les misérables sont entrés !
La garniture de la cheminée avait été jetée à terre ; la pendule, en tombant, s’était arrêtée sur trois heures vingt minutes. Près de la pendule, gisaient les lampes ; les globes étaient en morceaux, l’huile s’était répandue.
Le ciel de lit avait été arraché et couvrait le lit. On avait dû s’accrocher désespérément aux draperies. Tous les meubles étaient renversés. L’étoffe des fauteuils était hachée de coups de couteau et par endroits le crin sortait. On avait enfoncé le secrétaire, la tablette disloquée pendait aux charnières, les tiroirs étaient ouverts et vides. La glace de l’armoire, en pièces ; en pièces un ravissant chiffonnier de Boule ; la table à ouvrage, brisée ; la toilette, bouleversée.
Et partout du sang, sur le tapis, le long de la tapisserie, aux meubles, aux rideaux, aux rideaux du lit surtout.
Évidemment le comte et la comtesse de Trémorel s’étaient défendus courageusement et longtemps.
– Les malheureux ! balbutiait le pauvre maire, les malheureux ! C’est ici qu’ils ont été massacrés.
Et au souvenir de son amitié pour le comte, oubliant son importance, jetant son masque d’homme impassible, il pleura.
Tout le monde perdait un peu la tête. Mais pendant ce temps, le juge de paix se livrait à une minutieuse perquisition, il prenait des notes sur son carnet, il visitait les moindres recoins.
Lorsqu’il eut terminé :
– Maintenant, dit-il, voyons ailleurs.
Ailleurs le désordre était pareil. Une bande de fous furieux ou de malfaiteurs pris de frénésie, avait certainement passé la nuit dans la maison.
Le cabinet du comte, particulièrement, avait été bouleversé. Les assassins ne s’étaient pas donné la peine de forcer les serrures ; ils avaient procédé à coups de hache. Certainement ils avaient la certitude de ne pouvoir être entendus, car il leur avait fallu frapper terriblement fort pour faire voler en éclats le bureau de chêne massif. Les livres de la bibliothèque étaient à terre, pêle-mêle.
Ni le salon, ni le fumoir n’avaient été respectés. Les divans, les chaises, les canapés étaient déchirés comme si on les eût sondés avec des épées. Deux chambres réservées, des chambres d’amis, étaient sens dessus dessous.
On monta au second étage.
Là, dans la première pièce où on pénétra, on trouva devant un bahut attaqué déjà, mais non ouvert encore, une hache à fendre le bois que le valet de chambre reconnut pour appartenir à la maison.
– Comprenez-vous maintenant, disait le maire au père Plantat. Les assassins étaient en nombre c’est évident. Le meurtre accompli, ils se sont répandus dans la maison, cherchant partout l’argent qu’ils savaient s’y trouver. L’un d’eux était ici occupé à enfoncer ce meuble lorsque les autres, en bas, ont mis la main sur les valeurs ; on l’a appelé, il s’est empressé de descendre, et jugeant toute recherche désormais inutile, il a abandonné ici cette hache.
– Je vois la chose comme si j’y étais, approuva le brigadier.
Le rez-de-chaussée qu’on visita ensuite avait été respecté. Seulement, le crime commis, les valeurs enlevées, les assassins avaient senti le besoin de se réconforter. On retrouva dans la salle à manger des débris de leur souper. Ils avaient dévoré tous les reliefs restés dans les buffets. Sur la table, à côté de huit bouteilles vides – bouteilles de vin ou de liqueurs – cinq verres étaient rangés.
– Ils étaient cinq, murmura le maire.
À force de volonté, l’excellent M. Courtois avait recouvré son sang-froid habituel.
– Avant d’aller relever les cadavres, dit-il, je vais expédier un mot au procureur impérial de Corbeil. Dans une heure, nous aurons un juge d’instruction qui achèvera notre pénible tâche.
Ordre fut donné à un gendarme d’atteler le tilbury du comte et de partir en toute hâte.
Puis, le maire et le juge, suivis du brigadier, du valet de chambre et des deux Bertaud s’acheminèrent vers la rivière.
Le parc de Valfeuillu est très vaste ; mais c’est de droite et de gauche qu’il s’étend. De la maison à la Seine, il n’y a guère plus de deux cents pas. Devant la maison verdoie une belle pelouse coupée de corbeilles de fleurs. On prend pour gagner le bord de l’eau une des deux allées qui tournent le gazon.
Mais les malfaiteurs n’avaient pas suivi les allées. Coupant au plus court, ils avaient traversé la pelouse. Leurs traces étaient parfaitement visibles. L’herbe était foulée et trépignée comme si on y eût traîné quelque lourd fardeau. Au milieu du gazon, on aperçut quelque chose de rouge que le juge de paix alla ramasser. C’était une pantoufle que le valet de chambre reconnut pour appartenir au comte. Plus loin, on trouva un foulard blanc que le domestique déclara avoir vu souvent au cou de son maître. Ce foulard était taché de sang.
Enfin, on arriva au bord de l’eau, sous ces saules dont Philippe avait voulu couper une branche et on aperçut le cadavre.
Le sable, à cette place, était profondément fouillé, labouré, pour ainsi dire, par des pieds cherchant un point d’appui solide. Là, tout l’indiquait, avait eu lieu la lutte suprême.
M. Courtois comprit toute l’importance de ces traces.
– Que personne n’avance, dit-il.
Et, suivi seul du juge de paix, il s’approcha du corps.
Bien qu’on ne pût distinguer le visage, le maire et le juge reconnurent la comtesse. Tous deux lui avaient vu cette robe grise ornée de passementeries bleues.
Maintenant comment se trouvait-elle là ?
Le maire supposa qu’ayant réussi à s’échapper des mains des meurtriers, elle avait fui éperdue. On l’avait poursuivie, on l’avait atteinte là, on lui avait porté les derniers coups, et elle était tombée pour ne plus se relever.
Cette version expliquait les traces de la lutte. Ce serait alors le cadavre du comte que les assassins auraient traîné à travers la pelouse.
M. Courtois parlait avec animation, cherchant à faire pénétrer ses impressions dans l’esprit du juge de paix. Mais le père Plantat écoutait à peine, on eût pu le croire à cent lieues du Valfeuillu, il ne répondait que par monosyllabes : oui, non, peut-être.
Et le brave maire se donnait une peine infinie : il allait, venait, prenait des mesures, inspectait minutieusement le terrain.
Il n’y avait pas à cet endroit plus d’un pied d’eau.
Un banc de vase, sur lequel poussaient des touffes de glaïeuls et quelques maigres nénuphars, allait en pente douce, du bord au milieu de la rivière. L’eau était claire, le courant nul ; on voyait fort bien la vase lisse et luisante.
M. Courtois en était là de ses investigations lorsqu’il parut frappé d’une idée subite.
– La Ripaille, s’écria-t-il, approchez.
Le vieux maraudeur obéit.
– Vous dites donc, interrogea le maire, que c’est de votre bateau que vous avez aperçu le corps ?
– Oui, monsieur le maire.
– Où est-il, votre bateau ?
– Là, amarré à la prairie.
– Eh bien, conduisez-nous y.
Pour tous les assistants, il fut visible que cet ordre impressionnait vivement le bonhomme. Il tressaillit et pâlit sous l’épaisse couche de hâle déposée sur ses joues par la pluie et le soleil. Même, on le surprit jetant à son fils un regard qui parut menaçant.
– Marchons, répondit-il enfin.
On allait regagner la maison, lorsque le valet de chambre proposa de franchir la douve.
– Ce sera bien plus vite fait, dit-il, je cours chercher une échelle, que nous mettrons en travers.
Il partit, et une minute après reparut avec sa passerelle improvisée. Mais au moment où il allait la placer :
– Arrêtez, lui cria le maire, arrêtez !…
Les empreintes laissées par les Bertaud sur les deux côtés du fossé venaient de lui sauter aux yeux.
– Qu’est ceci ? dit-il ; évidemment on a passé par là, et il n’y a pas longtemps, ces traces de pas sont toutes fraîches.
Et, après un examen de quelques minutes, il ordonna de placer l’échelle plus loin. Lorsqu’on fut arrivé près du bateau :
– C’est bien là, demanda le maire à La Ripaille, l’embarcation avec laquelle vous êtes allés relever vos nasses ce matin ?
– Oui, monsieur.
– Alors, reprit M. Courtois, de quels ustensiles vous êtes-vous servis ? Votre épervier est parfaitement sec ; cette gaffe et ces rames n’ont pas été mouillées depuis plus de vingt-quatre heures.
Le trouble du père et du fils devenait de plus en plus manifeste.
– Persistez-vous dans vos dires, Bertaud ?, insista le maire.
– Et vous Philippe ?
– Monsieur, balbutia le jeune homme, nous avons dit la vérité.
– Vraiment ! reprit M. Courtois d’un ton ironique ; alors vous expliquerez à qui de droit comment vous avez pu voir quelque chose d’un bateau sur lequel vous n’êtes pas montés. Ah ! dame ! on ne pense pas à tout. On vous prouvera aussi que le corps est placé de telle façon qu’il est impossible, vous m’entendez, absolument impossible de l’apercevoir du milieu de la rivière. Puis, vous aurez à dire encore quelles sont ces traces que je relève, là sur l’herbe, et qui vont de votre bateau à l’endroit où le fossé a été franchi à plusieurs reprises et par plusieurs personnes.
Les deux Bertaud baissaient la tête.
– Brigadier, ordonna monsieur le maire, au nom de la loi, arrêtez ces deux hommes et empêchez toute communication entre eux.
Philippe semblait près de se trouver mal. Pour le vieux La Ripaille, il se contenta de hausser les épaules et de dire à son fils :
– Hein ! tu l’as voulu, n’est-ce pas ?
Puis, pendant que le brigadier emmenait les deux maraudeurs qu’il enferma séparément et sous la garde de ses hommes, le juge de paix et le maire rentraient dans le parc.
– Avec tout cela, murmurait M. Courtois, pas de traces du comte !…
Il s’agissait de relever le cadavre de la comtesse.
Le maire envoya chercher deux planches qu’on déposa à terre avec mille précautions, et ainsi on put agir sans risquer d’effacer des empreintes précieuses pour l’instruction.
Hélas ! était-ce bien là celle qui avait été la belle, la charmante comtesse de Trémorel ! Étaient-ce là ce frais visage riant, ces beaux yeux parlants, cette bouche fine et spirituelle.
Rien, il ne restait rien d’elle. La face tuméfiée, souillée de boue et de sang n’était plus qu’une plaie ; une partie de la peau du front avait été enlevée avec une poignée de cheveux. Les vêtements étaient en lambeaux.
Une ivresse furieuse affolait certainement les monstres qui avaient tué la pauvre femme ! Elle avait reçu plus de vingt coups de couteau, elle avait dû être frappée avec un bâton ou plutôt avec un marteau, on l’avait foulée aux pieds, traînée par les cheveux !…
Dans sa main gauche crispée était un lambeau de drap commun, grisâtre, arraché probablement au vêtement d’un des assassins.
Tout en procédant à ces lugubres constatations et en prenant des notes pour son procès-verbal, le pauvre maire sentait si bien ses jambes fléchir qu’il était forcé de s’appuyer sur l’impassible père Plantat.
– Portons la comtesse à la maison, ordonna le juge de paix, nous verrons ensuite à chercher le cadavre du comte.
Le valet de chambre, et le brigadier qui était revenu, durent réclamer l’assistance des domestiques restés dans la cour. Du même coup les femmes se précipitèrent dans le jardin.
Ce fut alors un concert terrible de cris, de pleurs et d’imprécations.
– Les misérables ! Une si brave femme ! Une si bonne maîtresse !
M. et Mme de Trémorel étaient, on le vit bien en cette occasion, adorés de leurs gens.
On venait de déposer le corps de la comtesse au rez-de-chaussée, sur le billard, lorsqu’on annonça au maire l’arrivée du juge d’instruction et d’un médecin.
– Enfin ! murmura le bon M. Courtois.
Et plus bas il ajouta :
– Les plus belles médailles ont leur revers.
Pour la première fois de sa vie, il venait sérieusement de maudire son ambition et de regretter d’être le plus important personnage d’Orcival.
3
Le juge d’instruction près le tribunal de Corbeil était alors un remarquable magistrat, M. Antoine Domini, appelé depuis à d’éminentes fonctions.
M. Domini est un homme d’une quarantaine d’années, fort bien de sa personne, doué d’une physionomie heureusement expressive, mais grave, trop grave.
En lui semble s’être incarnée la solennité parfois un peu roide de la magistrature.
Pénétré de la majesté de ses fonctions, il leur a sacrifié sa vie, se refusant les distractions les plus simples, les plus légitimes plaisirs.
Il vit seul, se montre à peine, ne reçoit que de rares amis, ne voulant pas, dit-il, que les défaillances de l’homme puissent porter atteinte au caractère sacré du juge et diminuer le respect qu’on lui doit. Cette dernière raison l’a empêché de se marier, bien qu’il se sentît fait pour la vie de famille.
Toujours et partout, il est le magistrat, c’est-à-dire le représentant convaincu jusqu’au fanatisme de ce qu’il y a de plus auguste au monde : la justice.
Naturellement gai, il doit s’enfermer à double tour lorsqu’il a envie de rire. Il a de l’esprit, mais si un bon mot ou une phrase plaisante lui échappent, soyez sûr qu’il en fait pénitence.
C’est bien corps et âme qu’il s’est donné à son état, et nul ne saurait apporter plus de conscience à remplir ce qu’il estime son devoir. Mais aussi, il est inflexible plus qu’un autre. Discuter un article du code est à ses yeux une monstruosité. La loi parle, il suffit, il ferme les yeux, se bouche les oreilles, et obéit.
Du jour où une instruction est commencée, il ne dort plus, et rien ne lui coûte pour arriver à la découverte de la vérité. Cependant on ne le considère pas comme un bon juge d’instruction : lutter de ruses avec un prévenu lui répugne ; tendre un piège à un coquin est, dit-il, indigne ; enfin, il est entêté, mais entêté jusqu’à la folie, parfois jusqu’à l’absurde, jusqu’à la négation du soleil en plein midi.
Le maire d’Orcival et le père Plantat s’étaient levés avec empressement pour courir au-devant du juge d’instruction.
M. Domini les salua gravement, comme s’il ne les eût point connus, et leur présentant un homme d’une soixantaine d’années qui l’accompagnait :
– Messieurs, dit-il, M. le docteur Gendron.
Le père Plantat échangea une poignée de mains avec le médecin ; monsieur le maire lui adressa son sourire le plus officiellement gracieux.
C’est que le docteur Gendron est bien connu à Corbeil et dans tout le département ; il y est même célèbre, malgré le voisinage de Paris.
Praticien d’une habileté hors ligne, aimant son art et l’exerçant avec une sagacité passionnée, le docteur Gendron doit cependant sa renommée moins à sa science qu’à ses façons d’être. On dit de lui : « C’est un original » ; et on admire ses affectations d’indépendance, de scepticisme et de brutalité.
C’est entre cinq et neuf heures du matin, été comme hiver, qu’il fait ses visites. Tant pis pour ceux que cela dérange ; ce ne sont point, Dieu merci ! les médecins qui manquent.
Passé neuf heures, bonsoir, personne, plus de docteur. Le docteur travaille pour lui, le docteur est dans sa serre, le docteur inspecte sa cave, le docteur est monté à son laboratoire, près du grenier, où il cuisine des ragoûts étranges.
Il cherche, dit-on dans le public, des secrets de chimie industrielle pour augmenter encore ses vingt mille livres de rentes, ce qui est bien peu digne.
Et il laisse dire, car le vrai est qu’il s’occupe de poisons et qu’il perfectionne un appareil de son invention, avec lequel on pourra retrouver les traces de tous les alcaloïdes qui, jusqu’ici, échappent à l’analyse.
Si ses amis lui reprochent, même en plaisantant, d’envoyer promener les malades dans l’après-midi, il se fâche tout rouge.
– Parbleu ! répond-il, je vous trouve superbes ! Je suis médecin quatre heures par jour, je ne suis guère payé que du quart de mes malades, c’est donc trois heures que je donne quotidiennement à l’humanité que je méprise et à la philanthropie dont je me soucie… Que chacun de vous en donne autant, et nous verrons.
Cependant, monsieur le maire d’Orcival avait fait passer les nouveaux venus dans le salon où il s’était installé pour rédiger son procès-verbal.
– Quel malheur pour ma commune, que ce crime, disait-il au juge d’instruction, quelle honte ! Voilà Orcival perdu de réputation.
– C’est que je ne sais rien, ou autant dire, répondait M. Domini, le gendarme qui est venu me chercher était mal informé.
Alors, M. Courtois raconta longuement ce que lui avait appris son enquête sommaire, n’oubliant pas le plus inutile détail, insistant sur les précautions admirables qu’il avait cru devoir prendre. Il dit comment l’attitude des Bertaud avait tout d’abord éveillé ses soupçons, comment il les avait pris, à tout le moins en flagrant délit de mensonge, comment finalement il s’était décidé à les faire arrêter.
Il parlait debout, la tête rejetée en arrière, avec une emphase verbeuse, s’écoutant, triant les expressions. Et à chaque instant, les mots de : « Nous, maire d’Orcival » ou de : « Ensuite de quoi » revenaient dans son discours. Enfin, il s’épanouissait dans l’exercice de ses fonctions, et le plaisir de parler le dédommageait un peu de ces angoisses.
– Et maintenant, conclut-il, je viens d’ordonner les plus exactes perquisitions qui, sans nul doute, nous feront retrouver le cadavre du comte. Cinq hommes, par moi requis et tous les gens de la maison battent le parc. Si leurs recherches ne sont pas couronnées de succès, j’ai sous la main des pêcheurs qui sonderont la rivière.
Le juge d’instruction se taisait, hochant simplement la tête de temps à autre en signe d’approbation. Il étudiait, il pesait les détails qui lui étaient communiqués, bâtissant déjà dans sa tête un plan d’instruction.
– Vous avez fort sagement agi, monsieur le maire, dit-il enfin. Le malheur est immense, mais je crois comme vous que nous sommes sur la trace des coupables. Ces maraudeurs que nous tenons, ce jardinier qui n’a pas reparu doivent être pour quelque chose dans ce crime abominable.
Depuis quelques minutes déjà, le père Plantat dissimulait tant bien que mal, plutôt mal que bien, des signes d’impatience.
– Le malheur est, dit-il, que si Guespin est coupable, il ne sera pas assez sot pour se présenter ici.
– Oh ! nous le trouverons, répondit M. Domini ; avant de quitter Corbeil, j’ai envoyé à Paris, à la préfecture de police, une dépêche télégraphique pour demander un agent de la police de la Sûreté, et il sera, je l’imagine, ici avant peu.
– En attendant, proposa le maire, vous désireriez peut-être, monsieur le juge d’instruction, visiter le théâtre du crime.
M. Domini eut un geste comme pour se lever et se rassit aussitôt.
– Au fait, non, dit-il, autant ne rien voir avant l’arrivée de notre agent. Mais j’aurais bien besoin de renseignements sur le comte et la comtesse de Trémorel.
Le digne maire triompha de nouveau.
– Oh ! je puis vous en donner, répondit-il vivement, et mieux que personne. Depuis leur arrivée dans ma commune, j’étais, je puis le dire, un des meilleurs amis de monsieur le comte et madame la comtesse. Ah ! monsieur, quels gens charmants ! et excellents, et affables, et dévoués !…
Et, au souvenir de toutes les qualités de ses amis, M. Courtois éprouva une certaine gêne dans la gorge.
– Le comte de Trémorel, reprit-il, était un homme de trente-quarante ans, beau garçon, spirituel jusqu’au bout des ongles. Il avait bien, parfois, des accès de mélancolie pendant lesquels il ne voulait voir personne, mais il était d’ordinaire si aimable, si poli, si obligeant, il savait si bien être noble sans morgue, que tout le monde dans ma commune l’estimait et l’adorait.
– Et la comtesse ? demanda le juge d’instruction.
– Un ange ! monsieur, un ange sur la terre ! Pauvre femme ! Vous allez voir ses restes mortels tout à l’heure, et certes vous ne devinerez pas qu’elle a été la reine du pays, par la beauté.
– Le comte et la comtesse étaient-ils riches ?
– Certes ! Ils devaient réunir à eux deux plus de cent mille francs de rentes ; oh ! oui, beaucoup plus ; car, depuis cinq ou six mois, le comte, qui n’avait pas pour la culture les aptitudes de ce pauvre Sauvresy, vendait les terres pour acheter de la rente.
– Étaient-ils mariés depuis longtemps ?
M. Courtois se gratta la tête ; c’était son invocation à la mémoire.
– Ma foi, répondit-il, c’est au mois de septembre de l’année dernière ; il y a juste dix mois que je les ai mariés moi-même. Il y avait un an que ce pauvre Sauvresy était mort.
Le juge d’instruction abandonna ses notes pour regarder le maire d’un air surpris.
– Quel est, demanda-t-il, ce Sauvresy dont vous nous parlez ?
Le père Plantat, qui se mordillait furieusement les ongles dans son coin, étranger en apparence à ce qui se passait, se leva vivement.
– M. Sauvresy, dit-il, était le premier mari de Mme de Trémorel ; mon ami Courtois avait négligé ce fait…
– Oh ! riposta le maire d’un ton blessé, il me semble que dans les conjonctures présentes…
– Pardon, interrompit le juge d’instruction, il est tel détail qui peut devenir précieux bien qu’étranger à la cause, et même insignifiant au premier abord.
– Hum ! grommela le père Plantat, insignifiant étranger !…
Son ton était à ce point singulier, son air si équivoque, que le juge d’instruction en fut frappé.
– Ne partageriez-vous pas, monsieur, demanda-t-il, les opinions de monsieur le maire sur le compte des époux Trémorel ?
Le père Plantat haussa les épaules.
– Je n’ai pas d’opinions, moi, répondit-il, je vis seul, je ne vois personne ; que m’importent toutes ces choses. Cependant…
– Il me semble, exclama M. Courtois, que nul mieux que moi ne doit connaître l’histoire de gens qui ont été mes amis et mes administrés.
– C’est qu’alors, répondit sèchement le père Plantat, vous la contez mal.
Et comme le juge d’instruction le pressait de s’expliquer, il prit sans façon la parole, au grand scandale du maire rejeté ainsi au second plan, esquissant à grands traits la biographie du comte et de la comtesse.
La comtesse de Trémorel, née Berthe Lechaillu, était la fille d’un pauvre petit instituteur de village.
À dix-huit ans, sa beauté était célèbre à trois lieues à la ronde, mais comme elle n’avait pour toute dot que ses grands yeux bleus et d’admirables cheveux blonds, les amoureux – c’est-à-dire les amoureux pour le bon motif – ne se présentaient guère.
Déjà Berthe, sur les conseils de sa famille, se résignait à coiffer sainte Catherine et sollicitait une place d’institutrice – triste place pour une fille si belle – lorsque l’héritier d’un des plus riches propriétaires du pays eut occasion de la voir et s’éprit d’elle.
Clément Sauvresy venait d’avoir trente ans ; il n’avait plus de famille et possédait près de cent mille livres de rentes en belles et bonnes terres absolument libres d’hypothèques. C’est dire que mieux que personne il avait le droit de prendre femme à son gré.
Il n’hésita pas. Il demanda la main de Berthe, l’obtint, et, un mois après, il l’épousait en plein midi, au grand scandale des fortes têtes de la contrée, qui allaient répétant :
– Quelle folie ! À quoi sert d’être riche, si ce n’est à doubler sa fortune par un bon mariage !
Un mois avant la noce, à peu près, Sauvresy avait mis les ouvriers au Valfeuillu, et, en moins de rien, il y avait dépensé, en réparations et en mobilier, la bagatelle de trente mille écus. C’est ce beau domaine que les époux choisirent pour passer leur lune de miel.
Ils s’y trouvèrent si bien qu’ils s’y installèrent tout à fait, à la grande satisfaction de tous ceux qui étaient en relation avec eux. Ils conservèrent seulement un pied à terre à Paris.
Berthe était de ces femmes qui naissent tout exprès, ce semble, pour épouser les millionnaires.
Sans gêne ni embarras, elle passa sans transition de la misérable salle d’école, où elle secondait son père, au superbe salon de Valfeuillu. Et lorsqu’elle faisait les honneurs de son château à toute l’aristocratie des environs, il semblait que de sa vie, elle n’avait fait autre chose. Elle sut rester simple, avenante, modeste, tout en prenant le ton de la plus haute société. On l’aima.
– Mais il me semble, interrompit le maire, que je n’ai pas dit autre chose, et ce n’était vraiment pas la peine…
Un geste du juge d’instruction lui ferma la bouche et le père Plantat continua :
– On aimait aussi Sauvresy, un de ces cœurs d’or qui ne veulent même pas soupçonner le mal. Sauvresy était un de ces hommes à croyances robustes, à illusions obstinées, que le doute n’effleure jamais de ses ailes d’orfraie. Sauvresy était de ceux qui croient, quand même, à l’amitié de leurs amis, à l’amour de leur maîtresse.
« Ce jeune ménage devait être heureux, il le fut.
« Berthe adora son mari, cet homme honnête qui, avant de lui dire un mot d’amour, lui avait offert sa main.
« Sauvresy, lui, professait pour sa femme un culte que d’aucun trouvait presque ridicule.
« On vivait d’ailleurs grandement au Valfeuillu. On recevait beaucoup. Quand venait l’automne, les nombreuses chambres d’amis étaient toutes occupées. Les équipages étaient magnifiques.
« Enfin, Sauvresy était marié depuis deux ans, lorsqu’un soir il amena de Paris un de ses anciens amis intimes, un camarade de collège dont on l’avait souvent entendu parler, le comte Hector de Trémorel.
« Le comte s’installa pour quelques semaines, annonça-t-il, au Valfeuillu, mais les semaines s’écoulèrent, puis les mois. Il resta.
« On n’en fut pas surpris. Hector avait eu une jeunesse plus qu’orageuse, toute remplie de débauches bruyantes, de duels, de paris, d’amours. Il avait jeté à tous les vents de ses fantaisies une fortune colossale, la vie relativement calme du Valfeuillu devait le séduire.
« Dans les premiers temps, on lui disait souvent : « Vous en aurez vite assez, de la campagne ! » Il souriait sans répondre. On pensa alors, et assez justement, que, devenu relativement très pauvre, il se souciait fort peu d’aller promener sa ruine au milieu de ceux qu’avait offusqués sa splendeur.
« Il s’absentait rarement, et seulement pour aller à Corbeil, presque toujours à pied. Là, il descendait à l’hôtel de la Belle Image, qui est le premier de la ville, et il s’y rencontrait – comme par hasard – avec une jeune dame de Paris. Ils passaient l’après-midi ensemble et se séparaient à l’heure du dernier train.
– Peste ! grommela le maire, pour un homme qui vit seul, qui ne voit personne, qui pour rien au monde ne s’occuperait des affaires d’autrui, il me semble que notre cher juge de paix est assez bien informé !
Évidemment M. Courtois était jaloux. Comment, lui, le premier personnage de la commune, il avait ignoré absolument ces rendez-vous ! Sa mauvaise humeur augmenta encore, lorsque le docteur Gendron répondit :
– Peuh ! tout Corbeil a jasé de cela, dans le temps.
M. Plantat eut un mouvement de lèvres qui pouvait signifier : « Je sais bien d’autres choses encore. » Il poursuivit cependant sans réflexions :
– L’installation du comte Hector au Valfeuillu ne changea rien absolument aux habitudes du château. M. et Mme Sauvresy eurent un frère, voilà tout. Si Sauvresy fit à cette époque plusieurs voyages à Paris, c’est qu’il s’occupait, tout le monde le savait, des affaires de son ami.
« Cette existence ravissante dura un an. Le bonheur semblait s’être fixé à tout jamais sous les ombrages délicieux du Valfeuillu.
« Mais, hélas ! voilà qu’un soir, au retour d’une chasse au marais, Sauvresy se trouva si fort indisposé qu’il fut obligé de se mettre au lit. On fit venir un médecin, que n’était-ce notre ami le docteur Gendron ! Une fluxion de poitrine venait de se déclarer.
« Sauvresy était jeune, robuste comme un chêne ; on n’eut pas d’abord d’inquiétudes sérieuses. Quinze jours plus tard, en effet, il était debout. Mais il commit une imprudence et eut une rechute. Il se remit encore du moins à peu près.
« À une semaine de là, nouvelle rechute, et si grave, cette fois, qu’on put dès lors prévoir la terminaison fatale de la maladie.
« C’est pendant cette maladie interminable qu’éclatèrent l’amour de Berthe et l’affection de Trémorel pour Sauvresy.
« Jamais malade ne fut soigné avec une sollicitude semblable, entouré de tant de preuves du plus absolu, du plus pur dévouement. Toujours à son chevet, la nuit aussi bien que le jour, il avait sa femme ou son ami. Il eut des heures de souffrance, jamais une seconde d’ennui. À ce point, qu’à tous ceux qui le venaient visiter il disait, il répétait, qu’il en était arrivé à bénir son mal.
« Il m’a dit à moi : « Si je n’étais pas tombé malade, jamais je n’aurais su combien je suis aimé. »
– Ces mêmes paroles, interrompit le maire, il me les a dites plus de cent fois, il les a répétées à Mme Courtois, à Laurence, ma fille aînée…
– Naturellement, continua le père Plantat. Mais le mal de Sauvresy était de ceux contre lesquels échouent et la science des médecins les plus expérimentés et les soins les plus assidus.
« Il ne souffrait pas énormément, assurait-il, mais il allait s’affaiblissant à vue d’œil, il n’était plus que l’ombre de lui-même.
« Enfin, une nuit, vers deux ou trois heures du matin, il mourut entre les bras de sa femme et de son ami.
« Jusqu’au moment suprême, il avait conservé la plénitude de ses facultés. Moins d’une heure avant d’expirer il voulut qu’on éveillât et qu’on fît venir tous les domestiques du château. Lorsqu’ils furent tous réunis autour de son lit, il prit la main de sa femme, la plaça dans la main du comte de Trémorel et leur fit jurer de s’épouser lorsqu’il ne serait plus.
« Berthe et Hector avaient commencé par se récrier, mais il insista de façon à leur rendre un refus impossible, les priant, les adjurant, affirmant que leur résistance empoisonnerait ses derniers moments.
« Cette pensée du mariage de sa veuve et de son ami semble, au reste, l’avoir singulièrement préoccupé sur la fin de sa vie. Dans le préambule de son testament, dicté la veille de sa mort à Me Bury, notaire à Orcival, il dit formellement que leur union est son vœu le plus cher, certain qu’il est de leur bonheur et sachant bien que son souvenir sera pieusement gardé.
– M. et Mme Sauvresy n’avaient pas d’enfant ? demanda le juge d’instruction.
– Non, monsieur, répondit le maire.
Le père Plantat continua :
– Immense fut la douleur du comte et de la jeune veuve. M. de Trémorel surtout paraissait absolument désespéré, il était comme fou. La comtesse s’enferma, consignant sa porte à toutes les personnes qu’elle aimait le mieux, même les dames Courtois.
« Lorsque le comte et madame Berthe reparurent, on les reconnut à peine, tant ils étaient changés l’un et l’autre. M. Hector, particulièrement, avait vieilli de vingt ans.
« Tiendraient-ils le serment fait au lit de mort de Sauvresy, serment que tout le monde savait ? On se le demandait avec d’autant plus d’intérêt qu’on admirait ces regrets profonds, pour un homme qui, fait bien remarquable, le méritait vraiment.
Le juge d’instruction arrêta, d’un signe de tête, le père Plantat.
– Savez-vous, monsieur le juge de paix, demanda-t-il, si les rendez-vous à l’hôtel de la Belle Image avaient cessé ?
– Je le présume, monsieur, je le crois.
– Et moi j’en suis à peu près sûr, affirma le docteur Gendron. Il me souvient avoir ouï parler – tout se sait à Corbeil – d’une bruyante explication entre M. de Trémorel et la jolie dame de Paris. À la suite de cette scène, on ne les revit plus à la Belle Image.
Le vieux juge de paix eut un sourire.
– Melun n’est pas au bout du monde, dit-il, et il y a des hôtels à Melun. Avec un bon cheval on est vite à Fontainebleau, à Versailles, à Paris même. Mme de Trémorel pouvait être jalouse, son mari avait dans ses écuries des trotteurs de premier ordre.
Le père Plantat émettait-il une opinion absolument désintéressée, glissait-il une insinuation ? Le juge d’instruction le regarda attentivement pour s’en assurer, mais son visage n’exprimait rien qu’une tranquillité profonde. Il contait cette histoire comme il en eût conté une autre, n’importe laquelle.
– Je vous demanderai de poursuivre, monsieur, reprit M. Domini.
– Hélas ! reprit le père Plantat, il n’est rien d’éternel, ici-bas, pas même la douleur ; mieux que personne, je puis le dire. Bientôt, aux larmes des premiers jours, aux désespoirs violents succédèrent chez le comte et chez Mme Berthe une tristesse raisonnable, puis une douce mélancolie. Et un an après la mort de Sauvresy, M. de Trémorel épousait sa veuve…
Pendant ce récit assez long, monsieur le maire d’Orcival avait, à bien des reprises, donné des marques d’un vif dépit. À la fin, n’y tenant plus :
– Voilà, certes, exclama-t-il, des détails exacts, on ne peut plus exacts ; mais je me demande s’ils ont fait faire un pas à la grave question qui nous occupe tous : trouver les meurtriers du comte et de la comtesse ?
Le père Plantat, à ces mots, arrêta sur le juge d’instruction son regard clair et profond, comme pour fouiller au plus profond de sa conscience.
– Ces détails m’étaient indispensables, répondit M. Domini, et je les trouve fort clairs. Ces rendez-vous dans un hôtel me frappent ; on ne sait pas assez à quelles extrémités la jalousie peut conduire une femme…
Il s’arrêta brusquement, cherchant sans doute un trait d’union probable entre la jolie dame de Paris et les meurtriers ; puis il reprit :
– Maintenant que je connais les « époux Trémorel » comme si j’eusse vécu dans leur intimité, arrivons aux faits actuels.
L’œil brillant du père Plantat s’éteignit subitement, il remua les lèvres comme s’il eût voulu parler, cependant il se tut.
Seul, le docteur, qui n’avait cessé d’étudier le vieux juge de paix, remarqua son subit changement de physionomie.
– Il ne me reste plus, dit M. Domini, qu’à savoir comment vivaient les nouveaux époux.
M. Courtois pensa qu’il était de sa dignité d’enlever la parole au père Plantat.
– Vous demandez comment vivaient les nouveaux époux, répondit-il vivement, ils vivaient en parfaite intelligence, nul dans ma commune ne le sait mieux que moi qui étais de leur intimité… intime. Le souvenir de ce pauvre Sauvresy était entre eux un lien de bonheur, s’ils m’aimaient tant, c’est que je parlais souvent de lui. Jamais un nuage, jamais un mot. Hector – je l’appelais ainsi familièrement, ce malheureux et cher comte – avait pour sa femme les soins empressés d’un amant, ces prévenances exquises, dont les époux, je ne crains pas de le dire, se déshabituent en général trop vite.
– Et la comtesse ? demanda le père Plantat, d’un ton trop naïf pour ne point être ironique.
– Berthe ! répliqua monsieur le maire – elle me permettait de la nommer paternellement ainsi – Berthe ! je n’ai pas craint de la citer maintes et maintes fois pour exemple et modèle à Mme Courtois. Berthe ! elle était digne de Sauvresy et d’Hector, les deux hommes les plus dignes que j’aie rencontrés en ma vie !…
Et s’apercevant que son enthousiasme surprenait un peu les auditeurs :
– J’ai mes raisons, reprit-il plus doucement, pour m’exprimer ainsi, et je ne redoute point de le faire devant des hommes dont la profession et encore plus le caractère me garantissent la discrétion. Sauvresy m’a rendu en sa vie un grand service… lorsque j’eus la main forcée pour prendre la mairie. Quant à Hector, je le croyais si bien revenu des erreurs de sa jeunesse, qu’ayant cru m’apercevoir qu’il n’était pas indifférent à Laurence, ma fille aînée, j’avais songé à un mariage d’autant plus sortable que, si le comte Hector de Trémorel avait un grand nom, je donnais à ma fille une dot assez considérable pour redorer n’importe quel écusson. Les événements seuls ont modifié mes projets.
M. le maire eût chanté longtemps encore les louanges des « époux Trémorel », et les siennes, par la même occasion, si le juge d’instruction n’eût pris la parole.
– Me voici fixé, commença-t-il, désormais il me semble…
Il fut interrompu par un grand bruit partant du vestibule. On eût dit une lutte, et les cris et les vociférations arrivaient au salon.
Tout le monde se leva.
– Je sais ce que c’est, dit le maire, je ne le sais que trop ; on vient de retrouver le cadavre du comte de Trémorel.
4
Monsieur le maire d’Orcival se trompait.
La porte du salon s’ouvrit brusquement et on aperçut, tenu d’un côté par un gendarme, de l’autre par un domestique, un homme, d’apparence grêle, qui se défendait furieusement et avec une énergie qu’on ne lui eût point soupçonnée.
La lutte avait duré assez longtemps déjà, et ses vêtements étaient dans le plus effroyable désordre. Sa redingote neuve était déchirée, sa cravate flottait en lambeaux, le bouton de son col avait été arraché, et sa chemise ouverte laissait à nu sa poitrine. Il avait perdu sa coiffure, et ses longs cheveux noirs et plats retombaient pêle-mêle sur sa face contractée par une affreuse angoisse. Dans le vestibule et dans la cour, on entendait les cris furieux des gens du château et des curieux – ils étaient plus de cent – que la nouvelle d’un crime avait réunis devant la grille et qui brûlaient de savoir et surtout de voir.
Cette foule enragée criait :
– C’est lui ! À mort l’assassin ! C’est Guespin ! Le voilà !
Et le misérable pris d’une frayeur immense continuait à se débattre.
– Au secours ! hurlait-il d’une voix rauque, à moi ! Lâchez-moi, je suis innocent !
Il s’était cramponné à la porte du salon et on ne pouvait le faire avancer.
– Poussez-le donc, commanda le maire, que l’exaspération de la foule gagnait peu à peu, poussez-le !
C’était plus facile à ordonner qu’à exécuter. La terreur prêtait à Guespin une force énorme.
Mais le docteur ayant eu l’idée d’ouvrir le second battant de la porte du salon, le point d’appui manqua au misérable, et il tomba, ou plutôt roula aux pieds de la table sur laquelle écrivait le juge d’instruction.
Il fut debout aussitôt, et des yeux chercha une issue pour fuir. N’en ayant pas, car les fenêtres aussi bien que la porte étaient encombrées de curieux, il se laissa tomber dans un fauteuil.
Ce malheureux offrait l’image de la terreur arrivée à son paroxysme. Sur sa face livide, se détachaient, bleuâtres, les marques des coups qu’il avait reçus dans la lutte ; ses lèvres blêmes tremblaient et il remuait ses mâchoires dans le vide, comme s’il eût cherché un peu de salive pour sa langue ardente ; ses yeux démesurément agrandis étaient injectés de sang et exprimaient le plus affreux égarement ; enfin son corps était secoué de spasmes convulsifs.
Si effrayant était ce spectacle, que monsieur le maire d’Orcival pensa qu’il pouvait devenir un enseignement d’une haute portée morale ; il se retourna donc vers la foule, en montrant Guespin, et d’un ton tragique, il dit :
– Voilà le crime !
Les autres personnes, cependant, le docteur, le juge d’instruction et le père Plantat, échangeaient des regards surpris.
– S’il est coupable, murmurait le vieux juge de paix, comment diable est-il revenu ?
Il fallut un bon moment pour faire retirer la foule ; le brigadier de gendarmerie n’y parvint qu’avec l’aide de ses hommes, puis il revint se placer près de Guespin, estimant qu’il ne serait pas prudent de laisser seul, avec des gens sans armes, un si dangereux malfaiteur.
Hélas ! il n’était guère redoutable en ce moment, le misérable. La réaction venait, son énergie surexcitée s’affaissait comme la flamme d’une poignée de paille, ses muscles tendus outre mesure devenaient flasques, et sa prostration ressemblait à l’agonie d’un accès de fièvre cérébrale.
Pendant ce temps, le brigadier rendait compte des événements.
– Quelques domestiques du château et des habitations voisines péroraient devant la grille, racontant les crimes de la nuit et la disparition de Guespin, la veille au soir, lorsque tout à coup on l’avait aperçu au bout du chemin, qui arrivait, la démarche chancelante et chantant à pleine gorge comme un homme ivre.
– Était-il vraiment ivre ? demanda M. Domini.
– Ivre perdu, monsieur, répondit le brigadier.